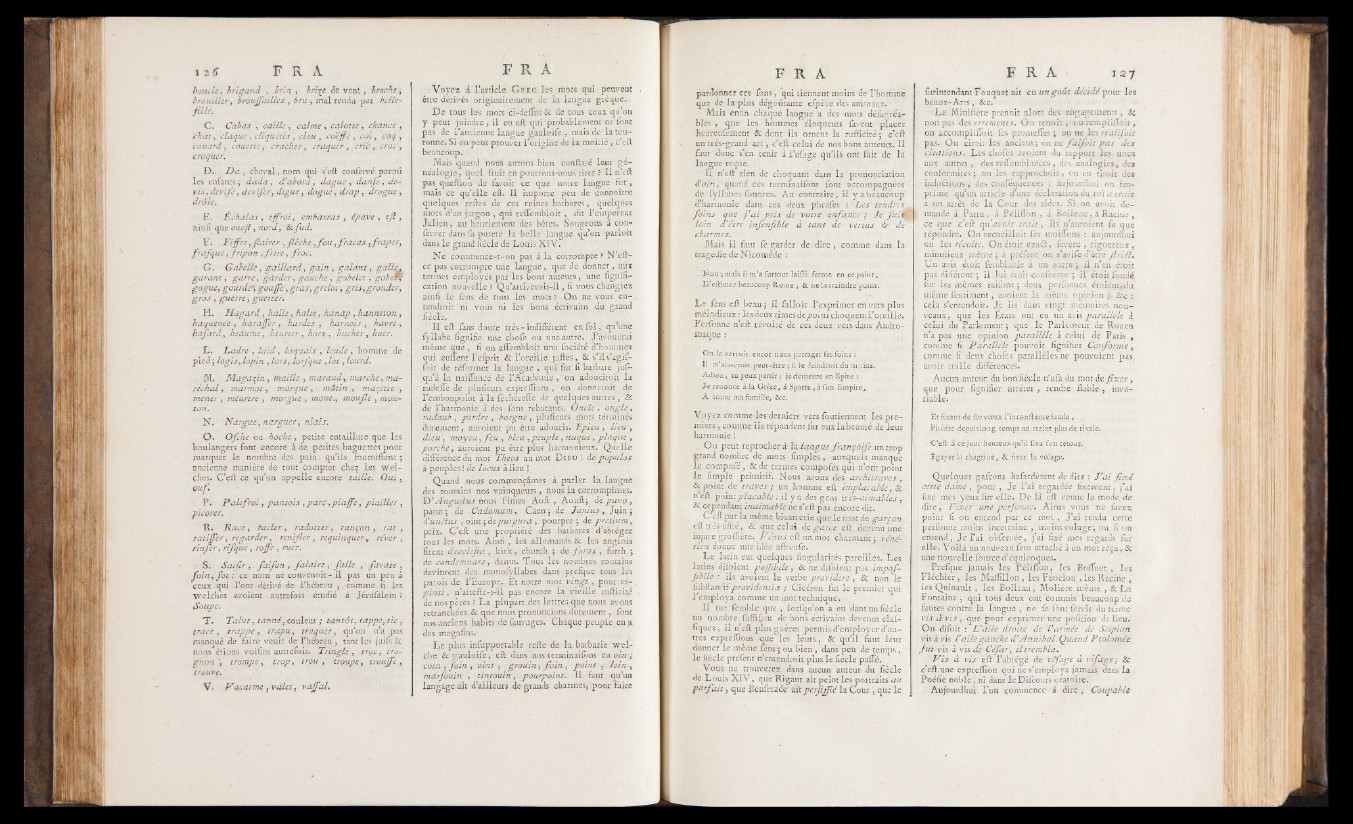
boucle, brigand , brin , br'ngt de vent , broche,
brouiller y broujfailles , bru , mal rendu par Ac/Ze-
f i lle ,
C . Cabas , caille , calme , ca lo tte , chance ,
chat y claque , c liq u e tis , clou , co'èffe , c o i , coq ,
couard, couette y cracher y craquer, c r ic , croc ,
croquer.
D . -D<2, cheval, nom qui s’eft confervé parmi
les enfants j d a d a , d ’abord, dague , d an fe , <ie-
v 'iSy devife'y devifer3 digue, dogue, d ra p , drogue -,
drôle.
E . É chalas -, effroi y embarras y épave y e j l ,
ainfi que oùe fl, nord y 8c fu d .
F . Fiffr e y fla ir er , flèche y f o u , fra ca s ,frâper,
fr a fq u e , fr ip on , fr ir e , fro c .
G . Gabelle y g a illa rd y ga in , g a lan t y galleA
g a r a n t , garre, gàrder, gauche , go be le t, gober,*
goguey gourde% gon fle , gra s , gr e lo t, gris,gronder,
g r o s , guerre, guetter.
H . Hagard. , /urZZe, halte ,■ hanap , hanneton,
haquenee , haraffer, hardes , harnois , havre ,
blafard, hèaume, heurter, h o r s , hucher,
L . Ladre , la id , laquais , leude , homme de
pied j log is, lopin , lors,' lorfque, l o t , lourd.
M. M a g a fln , maille , maraud, marche, maréchal
, marmot, marque, mâtin , manette ,
mener, meurtre , morgue , moue-, moufle , ttzozz-
ion.
N . Nargue, narguer, nia is . '
O . Ofche ou hoche, petite entaillure que les
boulangers font encore à de petites baguettes pour
marquer le nombre des pain; qu’ü s fou rn ifïen c ^
ancienne manière de tout compter che^ les w e l -
ches. C ’eft ce . qu’on appelle encore taille. Ou i ,
ouf.
P . P a le f r o i , p a n to is , p a r c ,p ia f f e , p ia i lle r ,
picorer.
R . Race , fa c ie r , radotter, rançon , rat ,
ra tiffer , regarder, renifle r, requinquer, réver ,
r in fer, r ifqu e, roffe , ruer.
S. S a i f lr , fa ifo n , fa la ir e , fa l le , fa v a te ,
fo in , fû t : .ce nom ne convenoit^ i l pas un peu a
ceux qui l ’ont dérivé de l ’hébreu , . comme fi les
w elche s avoient autrefois étudié à Jérufâlem ?
Soupe.
T . T a lu t , tanné, couleur ; tantôt, tappe, tic.,
trace , trappe, ■ trapu, traquer, qu’on n’a pas
manqué de faire venir de l’hébreu , tant les juifs 8c
nous étions voifîns autrefois. Tringle , troc, trognon
', trompe, trop, trou , troupe, trouffe ,
trouve.
V . Vqçqrme f vd let, vàffal,
Voyez à l ’article G rec les mots qui peuvent
être dérivés originairement de la langue grèque.
D e tous les mots ci-deffus & de tous ceux qu’on
y peut joindre , i l en eft qui probablement ne font
pas de l ’ancienne langue gauloife , mais de la teutonne.
Si on peut prouver l ’origine de la moitié, e’eft
beaucoup:
Mais quand .nous aurons bien cônftaté leur généalogie
, quel fruit en pourrons-nous tirer ? I l rveft
pas queftion de favoir ce que notre langue fu t ,
mais ce q u e lle eft. I l importe peu de connoître
quelques reftes de ces ruines Barbares , quelques
mots d’un jargon , qui réffembloit , dit l’empereur
Julien , au heurlement des bêtes. Songeons a çon-
ferver dans fa pureté la belle langue qu’on parloit
dans le grand ltècle de Louis X IV .
N e commence-t-on pas à_la corrompre? N ’eft-
ce pas corrompre une langu e, que de donner , aux
termes employés par les bons auteurs, une lignification
nouvelle ? Qu a rriveroit-il, fi vous changiez
ainfi le fens de tous les mots? O n ne vous en-,
tendroit ni vous ni les bons écrivains du grand
fiècle.
I l eft fansdoute très - indifférent en lo i , qu’une
fyllabe fignifie une chofe ou une autre. J’avouerai
même que , fi on affembloit une fociété d’hommes
qui euffent l ’elprit & l ’oreille- juftes, & s’i l s’agif-
foit de réformer la langue , qui fut fi barbare juf-
qu’ à la naiffancé de l ’Académie, ôn adouciroit la
rude fie de piufieurs. expreffions , on donneroit de
l ’embonpoint à la fécherefle de quelques autres , &
de l ’harmonie à des fons rebutants/ Oncle , o n g le,
radoub , perdre , borgne, plufieufs mots terminés
durement, auroient pu être adoucis. E p ieu , lieu ,
d ieu , moyeu, f e u , b leu , p eu p le , nuque, plaque ,
porche, auroient pu être plus harmonieux. Qu elle
différence du mot Theos au mot D i e u ! de populos
à peuples ! de locus à lieu 1
Quand nous commençâmes à parler la langue
des romains nos vainqueurs , nous la corrompîmes.
D ’A u g u flu s nous fîmes Aoft , Aouftj de pavo ,
paon j de Cadomum, C a en } de Ju n iu s , Juin ;
à’unclus , oint ; de purpura , pourpre de pretium
prix. C’efl une propriété des barbares d’abréger
tous les mots. Ainfi , lés allemands & les anglois
firent &,ecclefia , k ir k , church. j ôe fo r a s , furth j
de condemnare, damn. Tous les nombres romains
devinrent des monofyllabes dans t prefque tous les
patois de l ’Europe. Et notre mot v in g t , pour vi-
g in t i , n’attefte-t-il pas encore la v ieille rufticité
de nos pères ? L a plupart des lettres que nous avons
retranchées •& que nous prononcions durement, font
nos-anciens habits de fauvages. Chaque peuple en a
des magafins.
L e plus. infupportable refte de la barbarie w e l-
che & igauloife, eft dans “nos terminaifons en oin ;
coin , fo in , oint , grouin > fo in , p oint , lo in -,
marfouin , tin touin , pourpoint. II. faut qu’un
langage ait d’ailleurs de grands charmes, pour faire
pardonner ces fons, qui tiennent moins de l ’homme
que de la plus dégoûtante efpèce des animaux.
Mais enfin chaque langue a des -mots défàgréa-
bles , que les hommes éloquents lavent placer
heüreufement & dont ils ornent la rufticité • c’eft
un très-grand a r t , c’eft celui de nos bons auteurs. I l
faut donc s’en tenir à l ’ufage qu’ils ont fait de la
langue reçue.
I l n’eft rien de choquant dans la prononciation
S o in , quand cés terminaifons font accompagnées
de fyllabes fonores. A u contraire, i l y a beaucoup
d’harmonie dans ces deux phrafes : L e s tendies
fo in s que j ’ a i p r is de votre enfance , Je fuïsfi.
loin d ’être infenfible à tant de vertus & de
charmes.
Mais i l faut fe garder de dire , comme dans la
tragédie de Niconaède :
Non j mais il m’a furtout laifTé ferme en ce point,
D ’eftimer beaucoup R o m e & ne la craindre point.
L e fens eft beau ; i l falloit l ’exprimer en vers plus
mélodieux : les deux rimesAtpoint choquent l ’oreille.
Perfonne n’eft révolté de ces deux vers dans Andro-
maquè :
On le verroit encor nous partager fes foins :
Il m’aimeroit peut-être ; il le feindroitdu moins.
. Ad ieu , tu peux partir j je demeure en Épire
Je renonce à la Grèce, à Sparte , à fon Empire,
A toute ma famille, &c.
V o y e z comme les'derniers vers foutiennent les premiers
, comme ils répandent fur eux la beauté de leur
harmonie !
O n peut reprocher à la langue fran çôife un trop
grand nombre de mots fimples, auxquels manque
l e compofé, & de termes compofés qui n’ont point
le fimpie primitif. Nous avons des architraves.,
& point de traves ; un homme eft implacable y 8c
n eft point placable : i l y a des gens très-aimables,
8c cependant inaimable ne s’eft pas encore dit.
0 eft par la meme bizarrerie que le mot de garçon
eft très-ufité, & que celui de garce- eft devenu une
injure groflière. _ V én u s eft un mot charmant 5 vénérien
donne une idée affreufe.
L e latin eut quelques fingularités pareilles.' Les
latins difoient po ffib ile , & ne difoienc pas iinpof- ’
Jibile : ils avoient le verbe providere , & non le
fubftan:ifprovidentïa ; Cicéron fut le'premier qui
1 employa comme un mot technique.
I l me femble que , lôrfqu’on a-eu dans un fiècle
un nombre fufnfimt de bons écrivains devenus claf-
fiques , i l n’eft plus guères permis-d’èmployer d’autres
expreffions que les leurs , & qu’i l faut leur
donner le même fens j ou bien , dans peu de temps,
le fiècle préfent n’entendroit plus le fiècle pafie.
Vous ne trouverez dans aucun auteur du fiècle
de Louis X I V , que Rigaut ait peint les portraits au
p a r fa it , que Bejoferade- ait perfifflé la C o u r , que le
’ furintendant Fouquet ait eu un goût décidé pour les
b eaux- Arts y &c.
L e Miniftère prenoit alors des engagements , &
non pas des errements. On tenoit , on rcm p liflo it,
on accomplifioit fes promenés ; on ne les réalifoii
pas. O n citoic les anciens, on ne fa i fp i t p a s des
citations. Les chofes avoient du rapport les unes
aux autres , • des refiemblances, des analogies, des
conformités j on les rapprochoit, on en tiroit des
indüélions,,; des conféquences : aujourdhui on imprime
qu’un article d’une déclaration du roi a trait
à un. arrêt de la Cour des aides. Si on avoit de-
| mandé à Patru, à Péiiffon , à Bo ile au , à Racine ,
ce que c’eft avoir t r a i t , iis n’auroient fu que
répondre. On recueilloit fes moifions : aujourdhui
on les récolte. O n étpit exaél, févère , rigoureux,
minutieux même j; â préfent on s’ avife d’être f lr ié l .
Un avis étoit femblable à un autre ; i l n’en étoit
pas différent j i l lui étoit conforme ; i l étoit fondé
fur les mêmes raifons j deux perfpnnes. étoienc*du
même fentiment, avoient la même opinion ?.. &c :
cela s’entendoit. Je lis dans vingt mémoires nouveaux,
que les États ont eu un avis parallèle à
celui du Parlement ; que le Parlement de Rouen
n’a pas une opinion parallèle à celui de Paris ,
comme fi P a ra llè le pouvait fignifier Conforme,
comme fi deux chofes parallèles ne pouvôient pas,
avoir m ille différences.
Aucun auteur du bon fièple n’ufa du mot de f i x e r ,
que pour fignifier arrêter, rendre ftab le , invariable.
Et fixant de fes voeux l’in confiance fatale ,
Phèdre depuis long temps ne craint plus de rivale.
C’ëft à ce jour heureux qu’il fixa fon retour.
Égayer la chagrine, 8c fixer la volage.
Quelques gafeons hafardèrent de dire : J ’a i f i x é
cette dame , pour , Je l ’ai regardée fixement, j’ai
fixé mes yeux fur elle . D e là eft venue la mode de
dire, F ix e r une perfonne. Alors vous ne favez
point fi on entend par ce mot , J’ai rendu cette
perfonne moins incertaine , moins v o la g e , ou fi on
entend, Je Fai obfervée, j’ai fixé mes regards fur
elle . V o ilà un nouveaii fens attaché à un mot reçu, &
une nouvelle fourcè d’équivoques.
Prefque jamais les Péliflon, les Boftuet , les
F lé ch ie r , les Maffillon , les Fénelon , les Racine ,
les Quinault , les Boile au , Molière même , & L a
Fontaine , qui tous deux ont commis beaucoup de
fautes contre la langue , ne fe font fervis du terme
vis d vis , que pour exprimer une pofîtion de lieu.
On difoit : L ’ aile droite de l ’ armée de Scipion
vis à vis l ’aile gauche d’A n n iba l. Quand P tolomée
f u t vis à vis de Céfar, i l trembla.
V i s à vis eft l ’abrégé de vifâge à v i f âge ; 8c
c’eft une expreffion qui ne s’employa jamais dans la
Poéfie noble f ni dans le Difcours oratoire.
Aujourdhui l'on commence à d ire , CoupabU