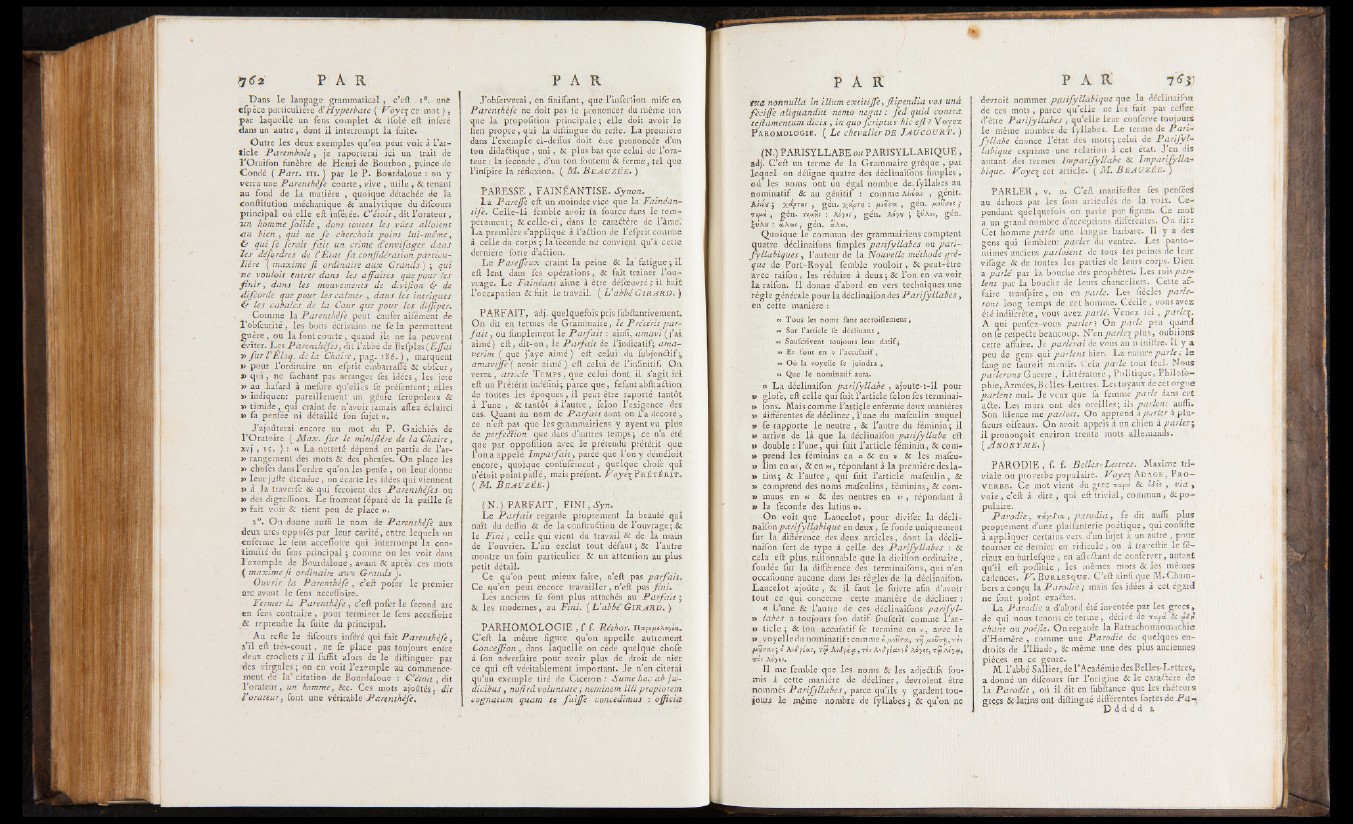
Dans le langage grammatical, c’eft 1®. une
efpèce particulière d’Hyperbate \ V o y e \ ce mot ) ,
par laquelle un fens complet & ifo lé . eft inféré
flans un autre, dont i l interrompt la fuite.
Outre les deux exemples qu'on peut voir à l ’art
ic le P arembole, je raporterai ici un trait de
l ’Oraifon funèbre de Henri de Bourbon , prince de
Condé ( P a r t . n i . ) par le P . Bourdaioue : on y
verra une Parenthèfe courte, vive , utile , & tenant
au fond de la matière , quoique détachée de la
conftitution méchanique & analytique du difcours
principal où e lle eft inférée. C ’ é to it, dit l ’orateur,
u n homme f o l id e , dont toutes les vîtes alloient
4iu bien , qui ne Je cherchoit p o in t lui-même,
& qui f e Jeroit f a i t un crime dl envifager dans
des déforfires de L’E ta t f a conjidération particulière
( maxime f i ordinaire a u x Grands) ; qui
ne vouloit entrer dans les affaires que pour Les
f u i r , dans les mouvements de divijîon & de
difcorde que pour les calmer , dans les intrigues
& les cabales de la Cour que pour les dijjiper.
Comme la Parenthèfe peut caufer aifément de
l ’obfcurité, les bons écrivains ne fe la permettent
g u è r e , ou la font courte, quand ils ne la peuvent
éviter. Les Parenthèfes, dit l ’abbé de Befplas [Effa i
» fu r l ’ Elo q. de la Chaire, pag. 1 86. ) , marquent
» pour l ’ordinaire un efprit embarraffé & ©bfcur,
» q u i , ne fachant pas arranger fes idées, les jeté
» au hafard à mefure qu’elles fe préfentent; elles
» indiquent pareillement un génie fcrupuleux &
» timide, qui craint de n’avoir jamais allez éclairci
» fa penfée ni détaillé fon fujet ».
J ’ajouterai, encore un mot du P. Gaichiés de
l ’Oratoire ( M a x . fu r le minijlère de la Chaire,
xvj , i? . ) : « La-netteté dépend en partie de l ’ar-
» rangement des mots & des phrafes. O n place les
» chofes dans l ’ordre qu’on les penfe , on leur donne
» leur jufte étendue, on écarte les idées qui viennent
» à J a traverfe & qui feroient des Parenthèfes ou
» des digreffions. Le froment féparé de la p a ille fe
» fait voir & tient peu de place ».
z ° . O n donne auflï le nom de Parenthèfe aux
deux arcs oppofés par leur ca vité, entre lequels on
enferme le fens acceffoire qui interrompt la continuité
du fens principal ; comme on les voit dans
l ’exemple de Bourdaioue, avant & après ces mots
( maxime f i ordinaire a u x Grands ).
Ouvrir, la Parenthèfe , c’ eft pofer le premier
arc avant le fens acceffoire.
Fermer U Parenthèfe , c’ eft pofer le fécond arc
en fens contraire , pour terminer le fens acceffoire
reprendre la fuite du principal.
A u refte le difcours inféré qui fait Pa r en th è fe,
s’ i l eft très-court, ne fe place pas toujours entre
deux crochets ,* i l fuffit alors de le diftinguer par
des virgules ; on en voit l ’exemple au commencement
de la* citation de Bourdaioue : C ’é to it , dit
l ’orateur, un homme, &c. Ces mots ajoutés, dit
l ’ orateur, font une véritable Parenthèfe*
J’obferverai, en finiffant, que l ’infertion mifc en
P a r e n t h è f e ne doit pas fe prononcer du même ton
que la propofition principale; elle doit avoir le
fien propre, qui la diftingue du refte. L a première
dans l ’exempfe ci-deffus doit être prononcée d’un
ton didaétique , u n i, & plus bas que celui de l ’orateur
: la fécondé , d’un ton foutenu & ferme, tel que
l ’infpire la réflexion. ( M . B e a u z é e . )
PARE SSE , F A IN É A N T IS E . S y n o r t .
La P a r e f f e eft un moindre vice que la F a i n é a n -
t i f e . C e lle - là femble avoir fa fource dans le tempérament
; & c e lle - c i, dans le caraétère de 1’âmei
L a première s’applique à i ’aétion de l ’efprit comme
à ce lle du corps ;f la fécondé ne convient qu’ à cette
dernière forte d’aétion.
L e P a r e f f e u x craint la peine & la fatigue ; i l
eft lent dans fes opérations, & fait traîner l ’ouvrage.
L e F a i n é a n t aime à être défoeuvré ; i l hait
l ’occupation & fuit le travail. ( L ’ a b b é G lR A R D . )
P A R F A IT , adj. quelquefois pris fubftantivement.
On dit en termes de Grammaire, l e P r é t é r i t p a r f
a i t , ou Amplement le P a r f a i t : ainfi, a m a v i ( j’a i
aimé) e ft, d it-on , le P a r f a i t de l ’indicatif; a m a -
v e r im ( que j’aye aimé ) eft celui du fubjonétif ;
a m a v i f f e ( avoir aimé ) eft celui de l ’inflnitif. O n
verra, a r t i c l e T e m p s , que celui dont, i l s’agit ic i
eft un Prétérit indéfini; parce que, fefant abftiaétion
de toutes les époques, i l peut être raporté tantôt
à l ’une , & tantôt à l ’autre, félon l ’exigence des
cas. Quant au nom de P a r f a i t dont on l a décoré>
c e n’eft pas que les grammairiens y ayent vu plus
de p e r f e é l i o n que dans d’autres temps; ce n’a été
que par oppofition avec le prétendu prétérit que
Io n a appelé Im p a r f a i t , parce que l ’on y déinéloit
encore, quoique confufément, quelque chofe qui
n’étoit pointpaffé, maispréfent. V~oye-[ P r e t Ér j t .
( M . B e a u z é e . )
( N . ) P A R F A I T , F IN I , S y n .
L e P a r f a i t regarde proprement la beauté qui
naît du deffin & de la conftruétion de l ’ouvrage; &
le F i n i , ce lle qui vient du travail & de la mai»
de l ’ouvrier. L ’un exclut tout défaut ; & l ’autre
montre un foin particulier & un attention au plus
petit détail.
C e qu’on peut mieux faire, n’eft pas p a r f a i t »
Ce qu’on peut encore t ra v a ille r, n’eft pas f i n i .
Les anciens fe font plus attachés au P a r f a i t ;
& les modernes, au F i n i . ( L ’ a b b é 'G lR A R D . }
P A R H O M O L O G IE , f f, R é t h o r . n<xpo/uoAo?i,£t.
C ’eft la même figure qu’on appelle autrement
C o n c e j f i o n , dans . laquelle on cède quelque chofe.
à fon adverfàire pour avoir plus de droit de nier
ce qui eft véritablement important. Je n’en citerai
qu’un exemple tiré de Cicéron : S u m e h o c a h j i é -
d i c i b u s , n o f l r â v o lu n t a t e ; n em in em ilL i p r o p io r e n t
c o g n a t u m q u a n t t e f u i f f e c o n c e d im u s : o f f i c i a
tua nonnülla in ilium extitiffe, fiipendia vos unà
feciffe aliquandiu netno negat : fed quid contra
teflamentum dicis , in quo Jcriptus hic ejl ? V o y e z
P aromologie. ( Le chevalier de Ja u c o u r t . )
(N.) P A R IS Y L L A B E ou P A R IS Y L L A B IQ U E ,
adj. C ’eft un terme de la Grammaire grèque , par
leque l on défigne quatre des déclinaifons fimples ,
où les noms ont un éga l nombre de.fyllabes au
nominatif & au g énitif : comme Aheas , genife.
A/v/v ; xapT«j , gén. xaprv : /touVa , gén. povo-tis ,*
rifitn f gén. Ti/éiîs : Aly»s, gén. hlyv ; IjùAo», gen.
ÇuA# : «awî , gen. aAw.
Quoique le commun des grammairiens comptent
quatre déclinaifons fimples parifyllabes ou pari-
Jyllabiques, l ’auteur de la Nouvelle méthode grèque
de Po rt-R o ya l femble vouloir , & peut-être
avec ràifon, les réduire à deux ; & l ’on en va voir
la raifon. I l donne d’abord en vers techniques une
règ le générale pour la déclinaifondes P arifyllabes,
en cette manière :
« Tous les noms fans accroiflemenr,
» Sur l’article fe déclinant ,
» Soufcrivent toujours leur datifj
» Et font en v l’accufatif,
» Où la voyelle fe joindra ,
»1 Que le nominatif aura.
« L a déclinaifon parifyllabe , ajoute-t-il pour
» glofe, eft ce lle qui fuit l ’article félon fes terminai-
» Ions. Mais comme l ’article enferme deux manières
m différentes de décliner, l ’une du mafeulin auquel
» fe rapporte le neutre , & l ’autre du féminin; i l
» arrive de là que la déclinaifon parifyllabe eft
» double : l ’une, qui fuit l ’article féminin, & com-
» prend les féminins en a. & en « & les mafeu-
» lins en as, & en «t, répondant à la première d esla-
» tins ; & l ’autre, qui fuit l ’article mafeulin, &
» comprend des noms mafeulins, féminins, & com-
» muns en os & des neutres en ov , répondant à
» la fécondé des latins ».
O n voit que Lan ce lo t, pour divifer la déclinaifon
parifyllabique en deux, fe fonde uniquement
fut la diftérence des deux articles, .dont la déclinaifon
fert de type à ce lle des P arifyllabes : &
cela eft plusN raifonnable que la divifîon ordinaire,
fondée fur la différence des terminaifons, qui n’en
occafionne aucune dans,les règles de la déclinaifon.
Lancelot ajoute , & i l faut le fuivre afin d’a voir1
tout ce qui concerne cette manière de décliner :
« L’une & l’autre de ces déclinaifons parifyl-
» labes a toujours fon datif foujerit comme l ’ar-
» ticle ; & Ion accufatif fe termine en v, avec la
» .voyelle du nominatif : comme.«* «.ou^-a, rn povo-v,, r-À»
fA.'tScrcL't ; o Av<rpgaï, ra Av<TpÉ«5,T°v Av<Tpcay;o \oyas, r«.Ao ya.y
tov Aoj<«ï .
I l me femble que les noms 8c les adjeétifs fournis
à cette manière de décliner, devroient être
nommés Parifyllabes, parce qu’ils y gardent tou-
jjoivÿ le m|me nombre de fyllabes ; & qu’on ne
devroit nommer parifyllabique que la déclinaifon
de ces mots, parce qu’e lle ne les fait pas ceflec
d’être P arifyllabes , qu’e lle leur conferve toujours
le même nombre de lyllabes. L e terme de P a r i fy
lla b e énonce l ’état des mots ; celui de P a r ify l-
labique exprime une relation à cet état. J en dis
autant- des termes Imparifyllabe & Imparifylla-
bique. F o y e£ cet article. ( M . B E A U Z É E . )
P A R L E R , v.. n. C ’eft manifefter fes penféeS
au dehors par les fons articulés de- la voix. C e pendant
quelquefois on parle par lignes. C e mot
a un grand nombre d’acceptions différentes. O n dit:
Ce t homme parle une langue barbare. I l y a des
gens qui femblen!: parler du ventre. Les pantomimes
anciens parloient de tous les points de leur
vifage & de toutes les parties de leurs corps. Dieu
a p arlé par la bouche des prophètes. Les rois parlent
par la bouche de leurs chanceliers. Cette a f faire
tranfpire, on en parle. Les fiecles parleront
long temps de cet homme. C é c ile , vous avez
été indiferète, vous avez parlé. Venez ici , parle\.
A qui penfez-vous parler ? On parle peu quand
on fe refpeéte beaucoup. N ’enparle^ plus, oublions
cette affaire. Je parlerai de vous au miniftre. I l y a
peu de gens qui parlent bien. L a nature parle ,• le
fang ne fauroit mentir. C e la parle tout feui. Nous
parlerons Guerre , Littérature , Politique, P h ilo fo-
phie, Armées, B elles-Lettres. Les tuyaux de cet orgue
parlent mal. Je veux que fa femme parle dans cet
à été. Les murs ont des o reilles; iis parlent auffi.
Son filence me parloit. O n apprend à p jr lç r z plu-
fieurs oifeaux. On avoit appris à un chien à parler5
i l prononçoit environ trente mots allemands.
[ A n o n y m e . )
P A R O D IE , f. f. B elles-Lettres. Maxime triviale
ou proverbe populaire. F o y e \ A d^g e , P r o v
e r b e . C e mot vient du grec t apà & oj'os , via ,
voie , c’eft à dire , qui eft trivial, commun, & populaire.
P a r o d ie , »apo<T/a , p a ro d ia , fe dit auffi. plus
proprement d’une plailanterie poétique, qui confifte
à appliquer certains vers d’un fujet à un autre , pour
tourner ce dernier en ridicule, ou a traveftir le fe—
rieux en burlefque , en affeétant de conferver, autant
qu’i l eft poflible , les mêmes mots & les mêmes
cadences. V . Burlesque. C ’eft ainfi que M.Cham-
bers a conçu la Parod ie ; mais fes idées à cet égard
ne font point exaétes.
L a Parod ie a d’abord été inventée par les grec s,
de qui nous tenons ce terme, dérivé de irapà & «Vjf
chant ou poéfie. O n regarde la Batrachomiomachie
d’Homère , comme une Parod ie de quelques endroits
de l ’Iliade, & même une des plus anciennes
pièces en ce genre.
M. l ’abbé Sallicr, de L’Académie des Belles-Lettres,
a donné un difcours fur l ’origine & le caradlere de
la P a r o d ie , où i l dit en fubftance que les rhéteurs
e r« s & latins ont diftingué différentes fortes de P a -1
& P d d d d i