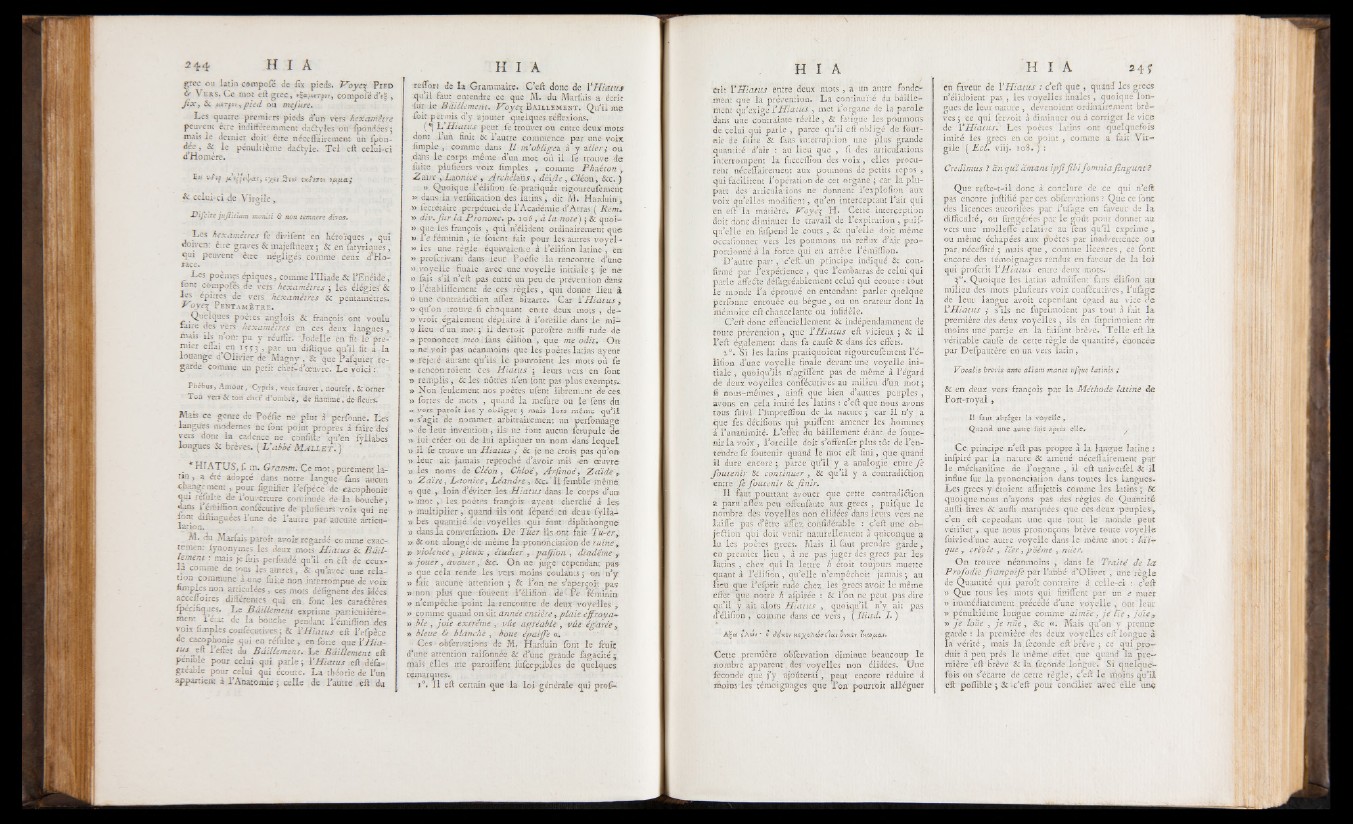
244 H I A H I A
grec ou latin compofe de fîx pieds. Voyez Pifd
& V ers. Ce mot eil grec, sça/csi-po/, compofe d’«£ ,
J zx , & jtu rpo», pied ou mej'ure.
Les quatre premiers pieds dfan vers hexamètre
peuvent ecre indifféremment daftylesou ipôndéès j
mais le dernier doit être néceffairement un ipon-
dée, & le pénultième dadyle. Te l eft celui-ci
d Homère.
Ek uJ'sp tu spp î'fctî, î^fi S'faj îxifiîTOï su.fia.;
& celui-ci de V ir g ile ,
D i ja îe jujiitiam moniti ù non temnere diras.
L e s hexamètres fe divifent en héroïques , qui
doivent être graves & majeftueux 3 & en fatyriques,
qui peuvent être négligés comme ceux d’H o race.
L e s poèmes épiques, comme l ’Iliade & l ’Enéide,
jont compoles de vers hexamètres 3 les élégies1 &
le s epicres de vers hexamètres & pentamètres.
V oye-[ P e n t a m è t r e .
Quelques poetes ànglois & françois ont voulu
faire des vers hexamètres en ces deux langues ,
mais ils n on: pu y réuffîr. Jodelle en fît- le pre-
mier eflai^en 1553 » par. un diftique qu’i l fît à la
louange d Olivie r de Magny , & que Pafquier regarde
comme un pecit chef-d’oeuvre. L e voici':
Pbébus, Amour, Cypris, veut fauver, nourrir, & orner
T od vers & ton chef d’ombre, de fianime, d e fleurs.'
Mais ce genre de Poéfie ne plut a perfonne. Les
langues modernes ne font point propres à faife des1
vers dont la cadence ne confifte ;qu’en fyllàbes
longues & brèves. ( U abbé Ma l l e t . )
H IA T U S , f. m. Gramm. C e mot, purement la tin
, a été adopté dans notre langue fans aucun
changement, pour lignifier l ’efpèce de cacophonie
qui refaite de l ’ouverture continuée de la bouche,
dans 1 emifnqn confécutive de plufieurs voix qui ne
ion: diftinguees l ’une de l ’autre par aucune articulation.
\
M. du Mariais paroît avoir regardé comme exactement
lynonymes les deux mots H ia tu s 8c B â i l lement
: mais je fais perfuadé qu’i l en eft de ceux-
; cornme toas les autres, & qu’avec une relation
commune à une faite non interrompue de voix
fimples non articulées , ces mots défignent des idées
^C(je.~olres differentes qui en font les caractères
lpecifîques. L e Bâillement exprime parricuiière-
me„nT- 1 £:-at de la bouche pendant l ’émiffion des
voix Amples confécutives ; & Y H ia tu s eft l ’efpèce
de cacophonie qui en refaite , en forte que YH ia -
tuf ^e^££ du Bâ illem en t. L e Bâillement eft
peniole pour celui qui parle 3 Y Hia tu s eft défa-
gréable pour celui qui écouté. L a théorie de l ’un
appartient à l ’Anatomie 5 c e lle de l ’autre . eft du
raifort de la Grammaire. C ’eft donc de Ÿ Hia tu s
q u i l faut entendre ce que M. du Mariais a écrit
•lur le Bâillement. V oy e \ Bâillement. Qu’i l me
foie permis d’y ajouter quelques réflexions.
( 1 IdH ia tu s peut fe trouver ou entre deux mots
. donc l ’un finit & l ’autre commence par une voix
fimple , comme dans I I m1obligez, à y a lier ,* ou
dans le corps même d’un mot où i l fe trouve de
fuite plufieurs voix Amples , comme Phzéton ,
Zàire , Lzonice , Archélzùs , déifie , Clé on, &c. )
» Quoique l ’élifion fe,pratiquât rigoureufamènt
» dans la verfificacion des latins , dit M. Harduin,
» fecréraire perpétuel de l ’Académie d’Arras ( Rem.
» div. fu r la Prononc. p. 106, à la note) j & quoi-
» que les français , qui n’élident ordinairement que
« l e féminin , fe foient fait pour les autres v o y e l-
» les une règ le équivalente à i ’éiifion latine , en
» profcrivanc dans leur. Poéfie T a rencontre d’iine
» vo y e lle fiuaie avec une v o y elle initiale 3: je né
» fais s’ i l n’eft pas encré un peu de prévention dans
» TétabliiTement de ces règles , qui donne lieu à
» une contradicrien allez bizarre. Car Y H ia tu s ,
» qu’on :rouv,e fi choquant entre deux mots , de-
» vrôic également déplaire à l ’otreille dans le m i-
» lieu d’un mot 3 i i devroit paroître aufli rude de
» prononcer meo fans élifion , que me odit. O n
» ne voit pas néanmoins que les poètes ladns ayenc
» rejeté autant qu’ils le. pouvorent les mots où fe
» rencon roient ces Hia tu s 3 leurs vers1 en font
» remplis , & les nôtres n’en font pas plus exempts*
» Non feulement nos poètes ufent librement de ces
» fortes de mots , quand la mefare ou le fans du
» vers paroît les y obliger 5 mais lors même qu’i l
» s’agit de nommer arbitrairement un perfonnage
» de leur invention, ils ne font aucun fcrupule de
» lui créer ou de lui apliquer un nom dans leq u e l
» i l fe trouve un H ia tu s ,• & je. ne crois pas qu’oiï
» leur ait jamais reproché d’avoir mis -en oeuvre
» l e s noms de Çléon , C h io t, Arjînoé,. Z aide r.
» Z a i r e , La on ice , Le'andre, &c. ' I l femble' mêmé
» que .,. loin d’éviter les H ia tu s dans- le corps d’uiî
»'mot , ■ le s poètes fraaçbis: ayent cherché à le s
» mu ltiplier, quand vilsoont .fépat-é- en deux fylla-1
» bes quantité;[debvoyelles qui font diphthongue
» dans la converfetion. D e Tuer ils-ont fait- Tu^erÿ
» & ont aiongé ide même la prononciation de ruine ±
r> violence, p ie u x , étudier , p a ffo n , diadème r
» jo u e r , avouer f. 8cc. On ne juge1 cependant pas
» que cela-rende les vers, moins couiaùts 3 on : n’y*
» fait aucune attention 5 & l ’on ne s’aperçoit pas
» non plus que foùvent Télifîon de - l ’e féminin;
» n ’empêche point la;rencontre de deux voyelles j,
» comme quand on dit année entière, pla ie effi.oy.a-*-
y> b le , jo ie extrême , vûe agréable , vue égarée y
» bleue & blanche , boue épaiffe «.
■ Ces - obfervatîons de M. Harduin font le fruit
d’une attention raifonnée & d’une grande fagacité 3
mais elles me paxoiffent ftifcpptibles de quelques
remarques.,
j° . 1 1 eft certain que la lo i générale qui pro£-
H I A
cri: Y H ia tu s entre deux mots , a un antre fondement
que la prévention. L a continuité du bâillement
qu’ e.xige Y H ia tu s , met l ’organe de la parole
dans une contrainte ré e lle , & fatigue les poumons
de celui qui parle , parce qu’ i l eft obligé de fournir
de fuite & fans interruption une plus grande
quantité d’air : au lieu que , fi des articulations
interrompent la facceflïon des v o ix , elles procurent
néceffairement aux poumons de petits repos f
qui facilitent l ’opération de cet organe 3 car l a plupart
des articulations ne donnent i ’explofîon aux
voix qu’elles modifient , qu’en interceptant l ’air qui
en eft l a matière. V oÿ e \ H . Cette interception
doit donc diminuer le travail de l ’expiration , puif-
qu’elle en fafpend le cours , & qu’e lle doit même
occafîonner vers lés poumons un reflux d’air proportionné
à la force qui en arrête l ’émiffion.
D ’autre part1, ■'c’ eft. un principe indiqué & confirmé
par l ’expérience -, que 1Jembarras de celui qui
parle affeéîte défagréablement celui qui écoute-: tout
le monde l ’a éprouvé en entendant parler quelque
perfonne enrouée ou b ègu e, ou un orateur dont la
mémoire eft chancelante ou infidèle. .
- C ’ eft donc eflenciellement & indépendamment de
route prévention, que Y H ia tu s eft vicieux J & i l
l ’eft également dans fa caufe & dans fes effets.
i ° . Si les latins pratiquoient rigoureufement l ’é-
lifîon d’une v o y elle finale devant une v o y elle initiale
, quoiqu’ils n’agîffent pas de même à l ’égard
de deux voyelles confécutives au milieu d’un mot j
fi nous-mêmes , ainfi que bien d’autres peuples ,
avons en cela imité les latins : c’ eft que nous avons
tous fuivi rimprelïion de la nature 3 car i l n’y a
que fes décifions qui puiffent amener les hommes
â runanimité. L ’effet du bâillement étant, de foute-
nir la voix , l ’oreille doit s’offenfer p lus tôt de l ’en-
teùdre fe foutenir quand le mot eft fin i, que quand
i i dure encore 3 parce qu’i l y a analogie entre f e
fo u ten ir & continuer , & qu’i l y a contradiction
entre f e fou ten ir & fin ir .
I l faut pourtant avouer que cette contradiction
a paru allez peu dffenfahte aux grecs , puifque le
nombre dès voyelles non élidées dans leurs- vers ne
laiffe pas d’ être affez confidërable : c’eft une objection
qui doit venir naturellement à quiconque a
lu les poètes grecs. Mais i l faut prendre g arde,
en premier lieu , à ne pas juger des grecs par les
latins , chez qui la lettre h etoit toujours muette
quant à l ’élîfîcn , qu’elle n’empêchoit jamais 3 au
lieu que i ’ elprit rude chez les grecs avoir le même
effet que. riotre h alpirée : & l ’on ne peut pas dire
qu’i l y ait alors H ia tu s , quoiqu’ i l n’y ait pas
d’elifîon , Gomme dans ce vers , ( Iliad . I . )
A £ û ) £ À W » * 0 J V x ÉV 0 V X É V 7 x 6 4 y tC tt/.
Cette première obfoï\^ation diminue beaucoup le
nombre apparent. des voyelles non élidées. Une
féconde que j’y ajouterai, peut encore réduire a
fooins les témoignages que l ’on pourroic alléguer
H I A 24f
en faveur de Y H ia tu s : c’ eft que , quand" le s grecs
n’élidoient pas , les voyelles finales, quoique longues
de leur nature , devenoient ordinairement brèves
3 ce qui fer/oit à diminuer ou d corriger le vice
de Y Hiatus..' Les poètes latins -ont quelquefois
imité les grecs en ce point , comme a fait V ir g
ile ( E cL. viij. 108. ) :
Credimus ? an qui amant ipji Jibi fomnia fln g u n t ?
Qu e refte-t-il donc à conclure de ce qui n’ eft
pas encore juftifié par ces oEfervations ? Que ce font
des licences autorilées par l ’ulage en faveur de la
difficulté, ou faggérées par le goût pour donner au
vers une molle ne relative au fens qu’i l exprime ,
ou même échapées aux poètes par inadvertence ou
par. néceflicé ; mais qüe , comme licences, ce font
encore dès témoignages tendus en faveur de la lo i
qui proferit Y H ia tu s entre deux mots.
30.. Quoique les. latins admîfient fans élifion au
milieu des .mots plufieurs voix confécutives, l ’ufàgc
de leur langue.avoit cependant égard au vice de
Y H ia tu s ; s’ils ne fuprimoient pas tout a fait la
première des deux v o y e lle s , ils en faprimoient du
moins une partie en la faifant brève. T e l le eft la
véritable caufe de cette règle de quantité, énoncée
par Defpautère en un vers la t in ,
Vocalis brevis ante aliam manet ufque latinis ;
& en deux vers françois par la Méthode latine de
Port-royal ,
II faut abréger la voyelle r
Quand, une autre fuit après elle.
Ce. principe n’eft pas propre à la langue latine :
infpiré par la nature & amené néceffairement par
le .méchanifme de l ’organe , i l eft univerfel & i l
influe far la. prononciation dans toutes les langues-
Les grecs y étoient affujettis comme les latins 3 8C
quoique nous n’ayons pas des règles de Quantité
aufli fixes & aufli marquées que ces deux peuples ,
c’en eft cependant une que tout le monde peut
vérifier que nous prononçons brève toute v o y e lle
fuivie d’une autre v o y elle dans le même mot : l<tï~
que , créole , lie r , poème , niler.
On trouve néanmoins , dans le Traité de la
Profodie françoife par l ’abbé d’O liv e t , une règ le
de Quantité qui paroît contraire â celle-ci : c eft
» Que tous les mots qui fimffent par un e muet
» immédiatement ^précédé d’une vo y e lle , ont leur
» pénultième longue comme aim é e , j e lie y jo i e s
» j e loüe , j e n u e , &c «. Mais qu’on y .prenne
garde : la première dès deux voyelles eft longue à
la vérité, mais la.faconde eft brève 3 ce qui p ro -
. duit â peu près le même effet que quand la première
eft brève & la faconde longue. Si quelquefois
011 s’ écarte de cette règle , c’eft le moins qu’i l
eft poflible 3 & - c’eft pour concilier avec elle une