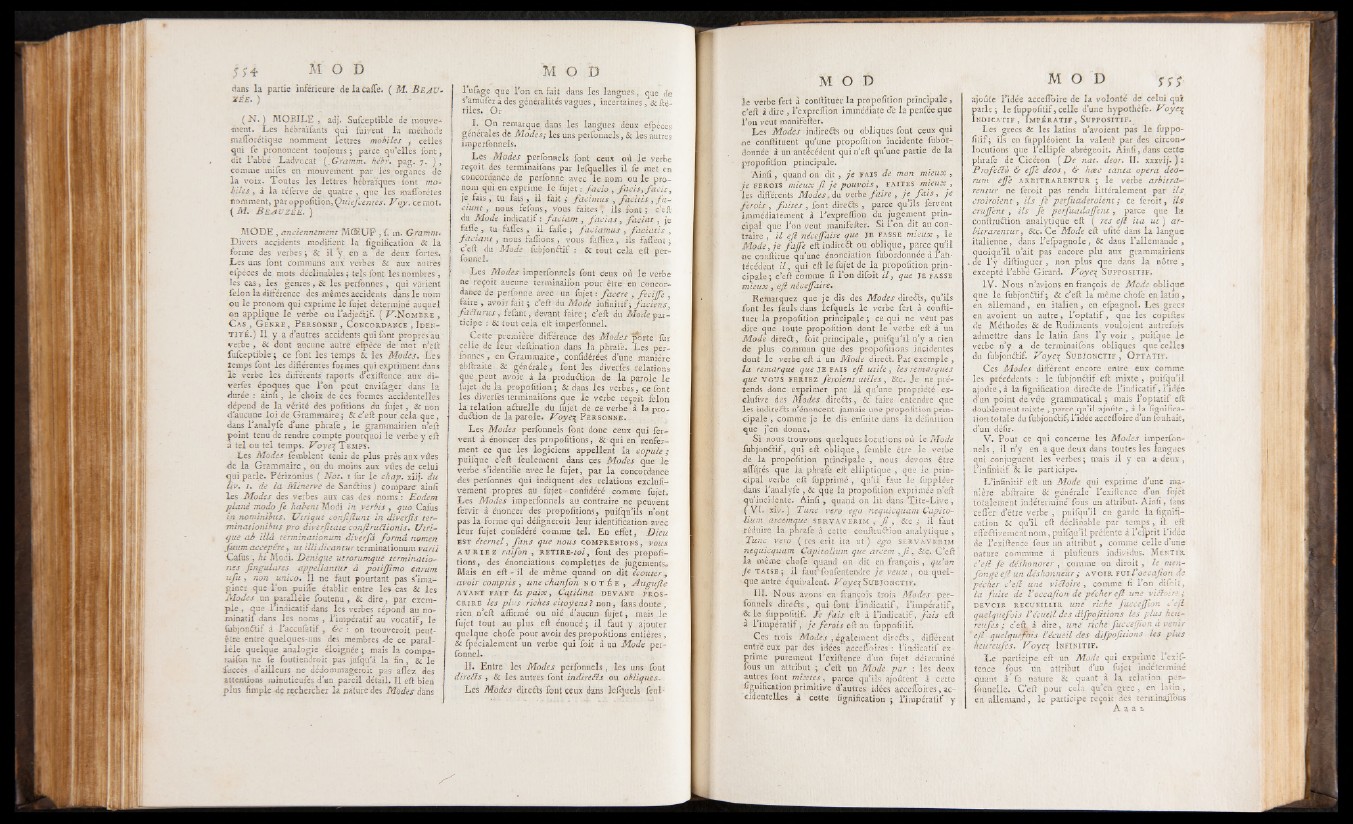
M- O D
dans la partie inférieure de la caffe. ( M. B e a u -
2 É E . )
( N . ) M O B IL E , adj. Sufceptible de mauve*
•nient. Les hébraïfants qui fuirent la méthode
maffdrétiqae nomment lettres m o b i l e s , celles
qui fe prononcent toujours ; parce qu’elles fon t ,
dit l ’abbé Ladvccat (_Gramm. hébr. p a g ..7. ) ,
comme mifes en mouvement par les organes de
l a voix. Toutes les lettres hébraïques lont m o b
i l e s , à la réferve de quatre , que les mafforètes
nomment, par oppofitfon, Q u i e f c e n t e s . V o y < ce mot.
( M. B e a u z é e . )
M O D E , a n c i e n n em e n t MCEUP , f. m. G r u m n i t
Divers accidents modifient la lignification & la
forme des verbes ; & il y en a de deux fortes.
Les Uns font communs aux verbes & aux autres
elpèces de mots déclinables, tels font les nombres ,
les cas, les genres, & les perfonnes , qui varient
félon la différence des mêmes accidents dans le nom
ou le pronom qui exprime le fujet déterminé auquel
on applique le verbe ou l ’adje&if. (/ ''‘.Nombre,
C as , G enre, Personne, C oncordance , Ident
i t é .) I l y a d’autres accidents qui font propres au
verbe , & dont aucune' autre efpèce de mot n’eft
fufceptible ; ce font les temps & les M o d e s . Les-
temps font les différentes formes qui expriment dans
le verbe les différents iaports dexiftence aux di-
verfes époques que l ’on peut envifager dans la
Jurée : ainfi , le choix de ces formes accidentelles
dépend de la vérité des pofitions du fujet, & non
düaucune lo i de Grammaire ; & c’eft pour'cela que,
dans l ’analyfe d’une phrafe , le grammairien n’eft
point tenu de rendre compte pourquoi le verbe y eft
à tel ou tel temps. V o y e \ T emps.
Les Modes femblent tenir de plus près aux viles
-de la Grammaire, ou du moins -aux vues de celui
qui parle. Périzonius ( N ot. 1 fur le chap. xiij. du
liv. 1. de la Minerve de Sanètius ) compare- ainfi
les Modes des verbes aux cas des noms-: Eodem
plané modo f e habent Modi in yerbis , quo Cafus
in nominibus. Utriqus confijlunt in diverfis ter-
minationibus pro diverfitate conftruclionis. Utr i-
que ab illâ terminationitm divetfâ fo rm a nomen
fuum accepêre, ut illi dicantur terminationum varii
Cafus , hi Modi. Denique utrorumque terminatio-
nés fingulares appellantur à potiffimo earum
ufu , non unieo. Il ne faut pourtant pas s’imaginer
que l’on puiffe établir entre les cas & les
M od e s un parallèle foutenu , & dire, par exemp
l e , que 1 indicatif dans les verbes répond au no-
ininatif dans les noms , l ’impératif au vocatif, le
ûibjonètif à l ’accufatif, & c : on trouveroit peut-
être entre quelques-uns des membres -de ce parallèle
quelque analogie éloignée ; mais la compa-
raifon ne fe foutiendroit pas jufqu’à la fin, & le
fuccès d’ailleurs ne dédommageait pas affez des
attentions rainutieufes d’an pareil détail. Il eft bien
plus fimple de rechercher la nature des M o d e s dans
M O D
l ’ufage que l ’on en fait dans les langues, que de
s’amufer à des généralités vagues, incertaines, & fté-
riles. Or
I. O n remarque dans les langues deux elpèces
generales de M o d e s ; les uns perfonnels, & les autres
imperfonnels.
Le s M o d e s perfonnels font ceux où l e verbe
reçoit des terminaifons par lefquelles i l fe met en
concordance de perfonne avec le nom pu l e pronom
qui en exprime le fujet : f a e i o , fa c i s , fa c h ,
je fais , tu fais , i l fait ,• f a e im u s , f a c i t i s , f a -
c i u n t , nous fefons, vous faites* ils fon t; ce ft
du M o d e indicatif : f a c i a m , f a d a s , f a c i a t , je
faffe , tu faffes , i l faffe ; f a c i a m u s , f a c i a t i s ,
f a c i a n t , nous faffions , vous faftiez, ils faffent ;
c’eft du M o d e fubjonètif :- & tout cela eft per-
fonnel.
Le s M o d e s imperfonnels font ceux où le verbe
ne reçoit aucune terminaifon pour être en concordance
de perfonne. avec ■ un fujet : f a c e r e , f e c i j f e ,
faire , avoir fait ; c’ eft du M o d e infinitif ; f a c i e n s ,
f a c î u r u s fefant, devant faire ; c’eft du M o de. participe
: & tout cela eft imperfonuel.
Cette première différence des M o d e s 'jfèrte fur
ce lle de leur deftination dans la phrafe. Les perfonnes
, en Grammaire, confidérées d’une manière
abftraile & générale, font les diverfes relations
que .peut avoir à la production de la parole le
fojet de la propofition ; & dans les verbes, ce font
les diverfes terminaifons que le verbe reçoit félon
la relation aètuelle du fujet de ce verbe à la production
de la parole. V o y e \ P e r s o n n e . .
Les M o d e s perfonnels font donc ceux qui fervent
a énoncer des propofitions, & qui en renferment
ce que les logiciens appellent la c o p u l e ;
puifque c’ eft feulement dans ces M o d e s que le
verbe s’identifie avec le fujet, par la concordance
des perfonnes qui indiquent des | relations exclufi-
vement propres au fujet - confidéré comme fujet.
Le s M o d e s imperfonnels au contraire ne peuvent
fervir à énoncer des propofitions, puifqu’ils n’ont
pas la forme qui défigneroit leur identification- avec
leur fujet confidéré comme tel. En effet, D i e u
e s t é t e r n e l , f a n s q u e n o u s c o m p r e n i o n s , v o u s
a u r i e z r a i f o n , r e t i r e - t o i , font des propofitions,
des énonciations complettes de jugements.
Mais en eft - i l de même quand on dit é c o u t e r ,
a v o i r c o m p r i s , u n e c h a n f o n n o t é e , A u g u f t e
a y a n t f a i t l a p a ix , Catilina d e v a n t p r o s c
r i r e l é s p l i - s r ic h e s c i t o y e n s ? non, fans doute ,
rien, n’eft affirmé ou nié d’aucun fu je t, mais .le
fujet tout au plus eft énoncé ; i l faut y ajouter
quelque chofe pour avoir des propofitions entières,
& fpecialement un verbe qui foit a un M o d e per-
fonnel.
II. Entre les M o d e s perfonnels , les uns- font
d i r e c t s , & les autres font in d i r e c t s ou o b l iq u a s .
Les M o d e s directs font ceux dans lefquels feuL
îe verbe fert à conftituer la propofition principale,
c ’eft à dire , l ’expreflion immédiate de la penfée que
l ’on veut manifefter.
Les M o d e s indirects ou obliques font ceux qui
■ ne confti tuent qu’une propofition incidente fubo'r-
donnée à un antécédent qui n’eft qu’ une partie de la
propofition principale.
Ainfi , quand on dit , j e f a i s d e m o n m i e u x ,
j e f e r o i s m i e u x f i j e p o u v o i s , f a i t e s m i e u x ,
les différents M o d e s . du verbe f a i r e , j e f a i s , j e
f e r o i s , f a i t e s , font directs , parce qu ils fervent
immédiatement à l ’expreffion du jugement principal
que l ’on veut manifefter. Si l ’on dit au contraire
, i l e f i n é c e j fa i r e q u e J E f a s s e m i e u x , le
M o d e , j e f a f i e eft indire èt ou oblique, parce qu’il
ne conftitue qu’une énonciation lubordonnée à l'an técédent
i l , qui eft lé fujet de la propofition princ
ip a le ; c’eft comme fi l ’on difoit i l , q u e J E f a s s e
m i e u x ., e f i n é c e j fa i r e .
Remarquez que je dis des M o d e s directs, qu’ ils
font les fouis dans lefquels le verbe fort à conftituer
la propofition principale ; ce qui ne veut pas
dire que toute propofition dont le verbe eft à un
M o d e direét, foit principale, puifqu’ i l n’y a rien
de plus commun que des propofitions incidentes
dont le verbe eft à un M o d e direét. Par exemple ,
l a r em a r q u e q u e j e f a i s e f i u t i l e , l e s r em a r q u e s
q u e v o u s f e r i e z f e r o i e n t u t i l e s , &c. Je ne prétends
donc exprimer par là qu’une propriété ex-
dufive des M o d e s direCts, & faire entendre que
les indire&s.n’énoncent jamais une propofition principale
, comme je le dis enfuite dans la définition
que j’en donne.
Si nous trouvons quelques locutions où le M o d e
fubjonétif, qui eft oblique, femble être le verbe
de la propofition principale , nous devons être
affurés que la phrafe eft elliptique , que le principal
verbe eft fupprimé, qu’il faut le fuppléer
dans l ’analyfe , & que la propofition exprimée n’eft
qu’incidente. Ainfi , quand on lit dans T it e -L iv e ,
(VI . xiv. ) T u n e v e ro e g o n e q iù c q u a m C a p i t o -
l i u m a r c em q u e s e r v a v e r i m , f i , & c ; i l faut
-.réduire la phrafe à cette conftruCtion analytique ,
T u n e v e r o ( res erit ita ut ) egu s e r v a v e r i m
n e q u i c q u a m C a p i t o l iu m q u e a r c em , f i , &c. C ’eft
la même çhofe quand on dit en François , q u o n
J e t a i s e ; i l faut' foufenteiadre j e v e u x , ou quelque
autre équivalent. V o y e \ S u b j o n c t i f ,
III. Nous avons ' en françois trois M o d e s perfonnels
direCts, qui font l ’indicatif, l ’impératif,
& le fuppofitif. J e f a i s eft à l ’indicatif, f a i s eft
a l ’imp ératif, j e f e r o i s eft au fuppofiîif.
Ces trois M o d e s , également d i r e c t s , diffèrent
entre eux par des idées acceffoires : l ’ in d i c a t i f exprime
purement l ’exiftence d’un fiijet déterminé
fous un attribut ; c’eft un M o d e p u r : les deux
autres font m i x t e s , parce qu’ils ajoutent à cette
lignification primitive d’autres idées acceffoires, accidentelles
à cette lignification ; l ’impératif y
ajoute l’idée accefloire de la volonté de celui qui
parle ; le fuppofitif, celle d’une hypothèfo. Voye%
I n d i c a t i f , Impératif , Suppositif.
Les grecs & les latins n’avoient pas le fuppofitif;
ils en fuppléoient la valeur par des circon-'
locutions que l ’ellipfe abrégeoit. Ainfi, dans cette
phrafo de Cicéron ( De nat. deor. II. xxxvij. ) - Projette & ejfe deos, & hoec tanta opéra deo-
rum ejfe a r b i t r a r e n t u r ; le verbe arbitrât
rentur ne foroit pas rendu littéralement par ils
croiroient , ils fe perfuaderoient ; ce feroit, ils
crufient , ils fe perfuadajfent, parce que la
conftruétion analytique eft ( res eft ita ut ) arbitrarentur,
&c. Ce Mode eft ufité dans la langue
italienne, dans l ’etpagnole, & dans l ’allemande ,
quoiqu’il n’ait pas encore plu aux grammairiens
de l ’y diftinguer , non plus que dans la nôtre,
excepté l ’abbé Girard. V~oye\ S u p p o s i t i f .
IV. Nous n’avions en françois de Mode oblique
que le fubjonètif ; & c’eft la même chofe en latin ,
en allemand, en italien, en etpagnol. Les grecs
en avoient un autre, l ’optatif, que les copiftes
de Méthodes & de Rudiments vouloient autrefois
admettre dans le latin fans l ’y voir , puifque le
verbe n’y a de terminaifons obliques que celles
dit fubjonètif. Voye^ S u b j o n c t i f , O p t a t i f .
Ces Modes different encore entre eux comme
les précédents : le fubjonètif eft mixte , puifqu’il
ajoute, à la lignification direète de l ’indicatif, l’idée
d’un point de vue grammatical ; mais l ’optatif eft
doublement mixte , parce qu’il ajoute , à la lignification
totale du fubjonètif, l’idée acceffoire d’un fouhait,
d’un défir.
V. Pour ce qui concerne les Modes imperfonnels,
il n y en a que deux dans toutes les langues
qui conjuguent les verbes ; mais i l y en a deux,
1 infinitif & le participe.
L ’infinitif eft un Mode qui exprime d’une manière
abftraite & générale l’exiftence d’un fujet
totalement indéterminé' fous un attribut. Ainfi , fans
ceffer d’être verbe , puifqu’il en garde la lignification
& qu’il eft déclinable par temps, il eft
effeétivementnom, pui(qu’il préfente à l ’efprit l ’idée
de l’exiftence fous un attribut, comme celle d’une
nature commune à pluiieurs individus. M e n t i s . c’efi fe déshonorer , • comme on diroit , le men-
fonge efi un déshonneur ; a v o i r f u i Voecafion de
pécher c’efi une victoire, comme fi l ’on difoit, la fuite de Voecafion de pécher efi une victoire ;
d e v o i r r e c u e i l l i r une riche fuccejfion ceji
quelquefois Vécueil des dîfpofitions les plus heure
u f es ; c’eft. à dire, une riche fuccejfion avenir
'efi quelquefois l’écueil des difpofitions les plus
iieureufes. Voye\ I n f i n i t i f .
Le participe eft un Mode qui exprime l’exiftence
fous un attribut d’un fujet indéterminé
quant à 'fa nature & quant à la relation per-
fonnelle. C’eft pour cela qu’en grec , en latin ,
en allemand, le participe reçoit dés terminaifons