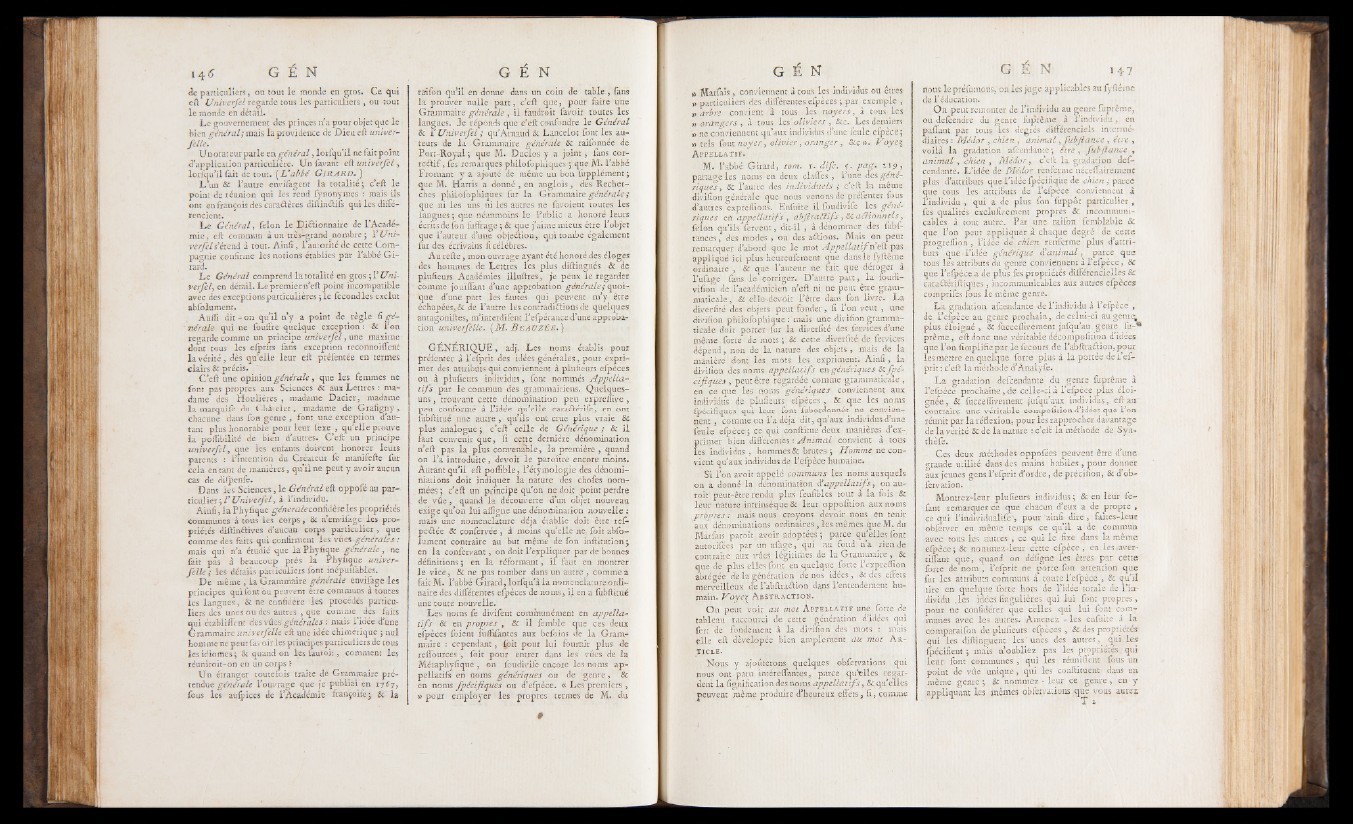
de particuliers, ou tout le monde en gros. C e qui
eft Univerfel regarde tous les particuliers , ou tout
le monde en détail.
L e gouvernement des princes n a pour objet que le
bien général; mais la providence de Dieu eft univer-
f i l l e .
Un orateur parle en gén é ral, lorfqu’i l ne fait point
d’application particulière. Un lavant eft u n iv er fe l,
loriqu’i l fait de tout. {JJabbé GlRARD.. ) L un & l ’autre envifagent la totalité ; c’eft le
point de réunion qui les rend fynonymes : mais ils
ont en François des càraâères diftin&ifs qui les différencient.
L e Général, félon le Didionnaire de l ’Académ
ie , eft commun à un très-grand nombre ; l ’ Univerfel
s’étend à tout. A in f i, 1 autorité de cette Compagnie
confirme les notions établies par l ’abbé G i rard.
L e Général comprend la totalité en gros Univerfel,
en détail. L e premier n’eft point incompatible
avec des exceptions particulières j le fécond les exclut
abfolumem.
Auffi d i t - o n qu’i l n’ y a point de règle f ig é -
' n é raie qui ne fouffre quelque exception : & l ’on
regarde comme un principe univerfel, une maxime
dont tous les elprits fans exception reconnoiffent
l a v érité, dès q u e lle leur eft préfentée en termes
clairs & précis. ~
C ’eft une opinion géné rale, que les femmes ne
font pas propres aux Sciences & aux Lettres : madame
des Hôulières , madame Dac ier, madame
la marquife du C h â te le t , madame de G ra fign y ,
Chacune dans fon genre , font une exception d’autant
plus honorable pour leur lèxe , qu e lle prouve
la poflîbilité de bien d’autres. C ’eft un principe
univerfel, que les enfants doivent honorer leurs
parents : l ’intention du Créateur fe manifefte fur
ce la entant de manières, qu’i l ne peut y avoir aucun
cas de difpenfe. H ' • ;
Dans les Sciences, le Général eft oppofé au particulier
\V Univerfel, à l ’individu.
A in fi, la Phyfique généraleconfidèreles propriétés
communes à tous les corps, & nenvifage les propriétés
diftinttives d’aucun corps particulier , que
comme des faits qui confirment les vues générales :
mais qui n’a étudié que la Phyfique générale, ne
fait pas â beaucoup près la Phyfique univer-
f ê lle ; les détails particuliers font inépuifables.
D e même , la Grammaire générale envifàge les
principes qui font ou peuvent être communs à toutes
les langues , & ne confidère les procédés particuliers
des unes ou des autres , que comme des faits
qui établirent des vues générales : mais l ’idée d’une
Grammaire univerfelle eft une idée chimérique ; nul
homme ne peut favair les principes particuliers de tous
les idiomes j & quand on les fauroit, comment les
iéuniroit-on en un corps ?
U n étranger toutefois traite de Grammaire prétendue
générale l ’ouvrage que je publiai en 17 67,
fous les aufpices de l ’Académie françoife; & la
raifon qu’i l en donne dans un coin de table , fans
la prouver nulle p a rt , c’ eft que, pour faire une
Grammaire générale , il faudroit favoir toutes les
langues. Je réponds que c’ eft confondre le Général
& l ’ Univerfel ,• qu’Arnaud & Lancelot font les auteurs
de la Grammaire générale 8c raifonnée de
Port-Royal 5 que M. Duclos y a joint , fans correctif
, fes remarques philofophiques ; que M. l ’abbé
Fromant y a ajouté de même un bon fupplément ;
que M. Harris a donné , en an g lo is , des Recherches
phiiofophiques fur la Grammaire générale ,*
que ni les uns ni les autres ne fa voient toutes les
langues $ que néanmoins le Public a honoré leurs
écrits de fon fuffrage ; & que j’aime mieux être l ’objet
que l ’auteur d’une objection, qui tombe également
fur des écrivains fi célèbres. .
Au refte, mon ouvrage ayant été honoré des éloges
des hommes de Lettres les plus diftingués & de
plufieurs Académies illuftres, je peux le regarder
comme jouïffant d’une approbation générale $ quoique
d’une part les fautes qui peuvent m’y être
echapées,& de l ’autre les contradictions de quelques
antagoniftes, m’interdifent l ’efpérance d’une approbation
univerfelle. (ikf. B e a ü z é e . )
G É N É R IQ U E , adj. Les noms établis pour
préfenter à l ’efprit des idées générales, pour exprimer
des attribùts qui conviennent à plufieurs efpeces
ou à plufieurs individus, font nommés A p p e lla t
i f s par le commun des grammairiens. Quelques-
uns , trouvant cette dénomination peu expreffive ,
peu conforme à l ’ idée qu’e lle caraCtérife, en ont
liibftitué une autre , qu’ils ont crue plus vraie &
plus analogue $ c ’eft ce lle de Générique ; & i l
faut convenir que, fi cette dernière dénomination
n’eit pas la plus convenable, la première, quand
on l ’a introduite, devoir le paroître encore moins.
Autant qu’i l eft poffible, l ’étymologie des dénomî-
niations doit indiquer la nature des chofes nommées
; c’eft un principe qu’on ne doit point perdre
de v u e , quand la découverte d’un objet nouveau
exige qu’on lui affigne une dénomination nouvelle :
mais une nomenclature déjà établie doit être ref-
pcCtée & confervée , à moins qu’elle ne, foit abfo-
lument contraire au but même de fon inftitution ;
en la confervant, on doit l ’expliquer par de bonnes
définitions ; en la réformant, i l faut en montrer
l e v ic e , & ne pas tomber dans un autre, comme a
faicM. l ’abbé Girard, lorfqu’à la nomenclature ordinaire
des différentes efpèces de noms, i l en a fubftitué
une toute nouvelle.
Le s noms fe divifent communément en appellat
i f s 8c en propres , & i l femble que ces deux
efpèces foient fuffilantes aux befoins de la Grammaire
: cependant, foit pour lui fournir plus de
refïources-, foit pour entrer dans les vues de la
Métaphyfique , on foüdivife_.encore les noms ap-
pellatifs en noms génériques ou de genre, &
en noms fpécifiques ou d’efpèce. « Les premiers ,
» pour employer les propres termes de M. du
0
0 Mar fais , conviennent à tous les individus ou êtres
» particuliers des différentes efpèces ; par exemple ,
» arbre convient à tous les noyers, à tous les
» orangers , à tous 1 qs' oliviers , &c. Les derniers
» ne conviennent qu’aux individus d’une feule efpèce ;
» t e ls font n oy er, o liv ie r , oranger, & c» . V oy e \
A ppel-latif.
M. l’abbé Girard, tom. t. dife. f . p a g . z ip ,
partage les noms en deux claftes , l ’une de s génériques,
8c l ’autre des individuels ; c’eft la même
divifion générale que nous venons de préfenter fous
d’autres expreflions. Enfuite i l foudivife les génériques
en appellatïfs , abfirà clifs , & ac tionnels,
félon qu’ils fervent, dit-il , à dénommer des fubf-
tances, des modes , ou des aéfions. Mais on peut
remarquer d’abord que le mot A p p e lla t i f n eft pas
appliqué ici plus heureufement que dansle fyftême
ordinaire , & que l ’auteur ne fait que déroger a
l ’ufage fans le corriger. D ’autre pa rt, la foudi-
vifion de l ’académicien n’eft ni ne peut être grammaticale,
& elie-devoit l ’être dans fon . livre. L a
diverfité des objets peut fonder, fi l ’on veut , une
divifion philofophique : ’ mais une divifion grammaticale
doit porter fur la diverfité des fervices d’une
même force de mots ; & cette diverfité de fervices
dépend, non de la nature des objets, mais de la
manière dont les mots les expriment. A in f i, la
divifion des noms appellatif.s en génériques 8c fpécifiques
, peut être regardée comme grammaticale ,
en ce que les noms génériques conviennent aux
individus de plufieurs efpèces , & que les noms
fpécifiques qui leur . font fubordonnés ne conviennent
, comme on l ’a déjà dit, qu’aux individus d’une
feule efpèce j ce qui conftitue deux manières d’exprimer
bien différentes : A n im a l convient à tous
les individus , hommes & brutes ; Homme ne convient
qu’aux individus de l ’efpèçe humaine.
Si l ’on avoit appelé communs les noms auxquels
on a donné la dénomination d’appellatif s , onau-
roit peut-être rendu plus fenfibles tout à la fois &
leur nature intrinsèque & leur oppofîtion aux noms
propres : mais nous croyons devoir nous . çn tenir
aux dénominations ordinaires .., les mêmes que M. du
Marfais parbît avoir adoptées ; parce qu’elles font
autorifées par un u fag e, qui au fond n’a rien de
contraire aux vues légitimes de la Grammaire , &
que de plus elles font en quelque force l ’expre filon
abrégée de la génération denos idées-, & des effets
merveilleux -de rabftra&ion dans l ’entendement humain.
V oy e \ A bstraction.
O n peut voir au mot A ppellatif une force de
tableau raccourci de cette génération d’idées qui
fort de fondement à la divifion des 'mots. : mais
e lle eft dèvelopée bien amplement, au mot A rticle.
Nous y ajouterons quelques o b s e r v a t io n s qui
nous ont paru intéreflantes, parce qu’elle s regardent
la S ig n i f ic a t io n , des lioms a p p e lla tif s , 8c qu’elles
peuvent même produire d’heureux effets, fi, comme
nous le préfumons, on les juge applicables au fyftêine
de l ’éducation.
O n peut remonter de l ’individu au genre fuprême,
ou defeendre du genre fuprême à l ’ individu, en
paffant par tous les degrés différenciels intermédiaires
: NLédor , chien , an im a l, fu b jla n ce , être ,
voilà la gradation afeendante • être , fu b jla n ce ,
animal , chien , NLédor, c’eft la gradation descendante.
L ’idée de NLédor renferme néceffairement
plus d’attributs que l ’ idée fpéciiiqiie de chien ,• parce
que tous les attributs de l ’efpèce conviennent à
l ’individu , qui a de plus fon fuppôt particulier ,
fes qualités exclufîvement propres & incommunicables
à tout autre. Par une raifon femblable &
que l ’on peut appliquer à chaque degré de cette
progreffion , l ’idée de chien, renferme plus d’attributs
que l ’idée générique d’a n im a l, parce que
tous les attributs au genre conviennent à l ’efpèce, 8c
que l ’efpèce a de plus fes propriétés differencielles 8C
caraélériftiques, incommunicables aux autres efpèces
comprifes fous le même genre.
L a gradation afeendante de l ’individu à l’efpèce ,
de l ’efpèce an genre prochain, de celui-ci au genre
plus éloigné , & facceflivément jufqu’au genre
prême, eft donc une véritable décompofition d’idees
que l ’on fimplifiepar le fecours de l ’abftraéHon, pour
les mettre en quelque force plus à la portée de i ’ef-
prit : c’eft la méthode d’Analyfe.
L a gradation defçendante du genre fuprême à
l ’efpèce prochaine, de ce lle-ci à l ’efpèce plus éloignée
, & fucceffivement jufqu’aux individus, eft air
contraire une véritable compofîtion d’idées que l ’on
réunit par la réflexion, pour les rapprocher davantage
de la vérité & de la nature : c’eft la méthode de Syn-
thèfo. '
Ces deux méthodes oppofées peuvent être d’une
grande utilité dans des mains habiles , pour donner
aux jeunes gens l ’efprit d’ordre, de préciuon, & d’ob-
fervation.
Montrez-leur plufieurs individus ; & en leur fe -
fant remarquer ce que chacun d’eux a de propre ,
ce qui i ’individualife', pour 'ainfi dire , faites-leur
obferver en même temps ce qu’ i l a de commun,
avec tous les, autres , Ce qui le fixe dans la même
efpèce; & nommez-leur cette e fp èc e, en les.aver-
tiffant que, quand on défigne les êtres par cette
forte de nom , l ’efprit ne porte fon attention que
fur les attributs communs à toute l ’efpèce , & qu’ il
tire en quelque forte hors de l ’idée totale de l ’in dividu
.les idées fingulières qui lui font propres,
pour ne conudérej: que celles qui lui font communes
avec les autres. Amenez - les enfuite à la
comparaifon de plufieurs efpèces , & des propriétés
qui les difting.uent l e s ’ unes des autres^ qui les
fpécifienf; mais n’oubliez pas les propriétés qui
leur font communes , qui les réunifient fous un
point de vue unique, qui les conftituent dans un
même genre ; & nommez - leur ce genre , en y
appliquant les mêmes obfervadons que vous aurez