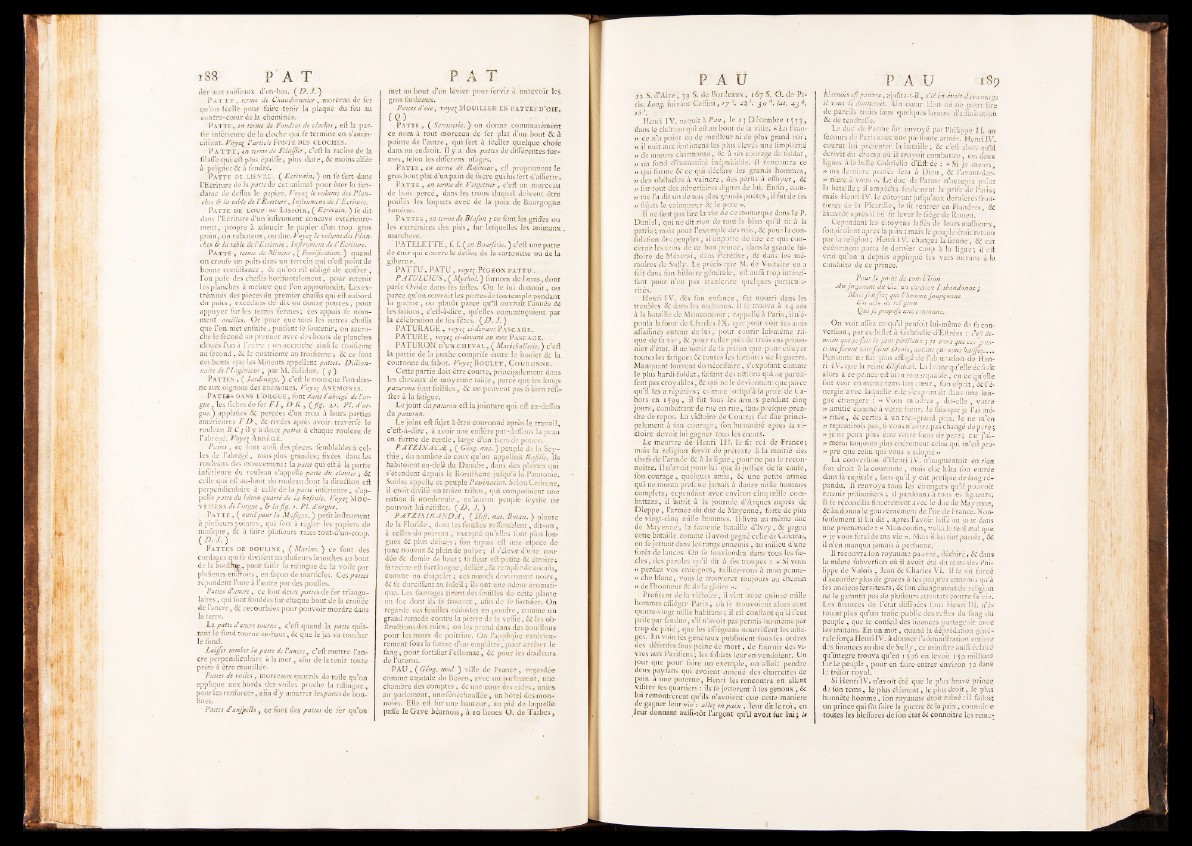
î 8 8 P A T
1
m Æ
der aux ruiffeaux d’en-basi ( D. J. )
Pa t t e , terme de Chaudronnier, morceaii de fer
qu’on fcelle pour faire tenir la plaque du feu au
contre-eoeur de-la cheminée.
Pa t t e , en terme de Fondeur de cloches, eft là partie
inférieure de la cloche qui fe termine en s’amin-
ciffant. Voyt[ l'article Fonte des cloches.
P a t t e ,«« terme de Filajjier, c’eft la racine de la
filaflê qui eft plus épaifle, plus dure, & moins aifée
à peigner & à fendre.
Patte de l ie v r e , ( Ecrivain; ) on fe fert dans
l’Ecriture de la patte de cet animal pour ôter la fan-
darac de deffus le papier. Voye^ le volume des Planches
& la table de l'Ecriture, injlrumens de l'Ecriture.
Patte de loup ou Lissoir, ( Ecrivain. } fe dit
dans l’Ecriture d’un infiniment concave extérieurement,
propre à adoucir le papier d’un trop gros
grain, ou raboteux, ou dur. Voye^ le volume des Planches
& la table de l'Ecriture, Injlrurnent de l'Ecriture.
Pa t t e , terme de Mineur ^ (Fortification. } quand
On creufe un puits dans un terrein qui n’eft point de
bonne confiftance, & qu’on eft obligé de coffrer ,
l’on pofe des chaffis horifontalement, pour retenir
les planches àmefure que l’on approfondit. Les extrémités
des pièces du premier chaffis qui eft au bord
du puits, excédans de dix ou douze pouces, pour
appuyer ffir les terres fermes ; ces appuis fe nomment
oreilles. Or pour quêtons les autres chaffis
que l’on met enfuite, puiflent fe foutenir, on accroche
le fécond au premier avec des bouts de planches
cloués l’un à l’autre : on accroche ainfi le troifieme
au fécond, 6c le quatrième au troifieme ; 6c ce font
ces bouts que les Mineurs appellent pattes. Dictionnaire
de l'Ingénieur^ par M. Belidor. ( q }
Pattes , ( Jardinage. } c’eft le nom que l’on donne
aux oignons des anémones. F’oye? Anémones.
Pattes DANS L’ORGUE, font dans l'abrégé de U orgue
, les fiches de fer F I , D K , ( fig. z i. PI. d'orgue.}
applaties & percées d’un trou à leurs parties
antérieures F D , 6c rivées après avoir. traverfé le
rouleau B C ; il y a deux pattes à chaque rouleau de
l’ abrégé. Voye^ Abrégé.
Pattes, ce font auffi des pièces femblables à celles
de l’abrégé, mais plus grandes ; fixées dans les
rouleaux des mouvemens : la patte qui eft à la partie
inférieure du rouleau s’appelle patte du clavier ; 6c
celle qui eft au-haut du rouleau dont la direfrion eft
perpendiculaire à celle de la patte inférieure, s’appelle
patte du bâton quarré de la bafcule. Voye? Mou-
VEMENS de C orgue , & la fig. i. Pl. d'orgue.
Pa t t e , ( outilpour la Mufique. } petit infiniment
à plufieurs pointés, qui fert à régler les papiers de
mufique, 6c à faire plufieurs raies tout-d’un-coup.
I B M
Pa tt es de bo u l in e , (Marine.} ce font des
cordages quife divifent en plufieurs branches au bout
de la boulhtfr, pour faifir la ralingue de la voile par
plufieurs endroits, en façon de marticles. Ces pattes
répondent l’une à l’autre par des poulies.
Pattes dé ancre , ce font deux pattes de fer triangulaires
, qui fontfoudées fur chaque bout de la croifée
de l’ancre, 6c recourbées pour pouvoir mordre dans
la terre.
La patte d’ancre tourne y c’eft quand la patte quittant
le fond tourne en-haut, 6c que le jas va toucher
le fond.
Laijfer tomber la patte de t'ancre, c’eft mettre l’ancre
perpendiculaire à la m er, afin de la tenir toute
prête à être mouillée.
Pattes de voiles, morceaux quarrés de toile qu’on
applique aux bords des voiles proche la ralingue
pour les renforcer, afin d’y amarrer les pattes de boulines.
Pattes d'anfpecls, ce font des pattes de fer qu’on
P A T
inet au bout d’un lévier pour fervir à moitvoir les
' gros fardeaux.
Pattes d'oie , VOye{ Mo u il l e r EN PATTES D’OIEi
( e )
Patte , ( Serrurerie. } on donne communément
ce nom à tout morceau de fer plat d’un bout 6c à
pointe de l’autre, qui fert ’ à fceller quelque chofe
dans un endroit. Il y a des pattes de différentes formes
, félon les différens ufages,
Patte , en terme de Rafineur, eft proprement le
gros bout plat d’un pain de fucre qui lui fert d’afliette;
Pa t t e , en terme de Vergettier, c’eft un morceau
de bois percé, dans les trous duquel doivent être
poiffés les loquets avec de la poix de Bourgogne
fondue.
Pa t t e s , en terme de Blafon ; ce font les griffes ou
les extrémités des piés, fur lefquelleS les animaux .
marchent.
PATELETTE, f. f. ( en Bourferie.} c’eft une patte
de cuir qui couvre le deffus de la cartouche ou de la
giberne.
PA T TU , PATU, voyeç Pigeo n pa t tu .
PATULC1U S , ( Mythol.} furnom de Janus, dont
parle Ovide dans les faites. On le lui donnoit, ou
parce qu’on ouvroit les portes de l’on temple pendant
la guerre, ou plutôt parce qu’il ouvroit l’année 6c
leslaifons, c’eft-à-dire, qu’elles commençoient par
la célébration de fes fêtes. (D . J .}
PATURAGE , voye^ ci-devant PASCAGE.
PATURE, voye^ ci-devant au mot PASCAGE.
PATURON d’un ch e v a l , (Maréchallerie.} c’ eft
la partie de la jambe comprife entre le boulet 6c la
couronne du fabot. Koye{ Boule t , C ouronne.
Cette partie doit être courte, principalement dans
les chevaux de moyenne taille, parce que les longs
paturons font foibles , 6c ne peuvent pas fi bien réfi-
fter à la fatigue.
Le joint du paturon eft la jointure qui eft au-deffus
du paturon.
Le joint eft fujet à être couronné après le travail,
c’eft-à-dire, à avoir une enflure par-deffous la peau
en forme de cercle, large d’un tiers de pouce.
P ATZINACÆ , ( Géog. anc. } peuple dé la Scy-^
thie, du nombre de ceux qu’on appelloit Bajîlii. Ils
habitoient au-delà du Danube, dans des plaines qui
s’étendent depuis le Boriflhène jufqu’à la Pannonie.
Suidas appelle ce peuple Patrinacitce. Selon Cedrene,
il étoit divifé en treize tribus, qui compofoient une
nation fi nombreufe, qu’aucun peuple lcythe ne
pou voit lui réfifter. ( D . J .}
P A T Z IS IR A N D A , (Hifi. nat. Botan. } plante
de la Floride, dont les feuilles reffemblent, dit-on,
à celles du poireau, excepté qu’elles font plus longues
6c plus déliées ; fon tuyau eft une efpece de
jonc noueux 6c plein de pulpe ; il s’élève d’une coudée
6c demie de haut ; "l’a fleur eft petite 6c étroite;
faracine eft fortlongue, déliée, 6c remplie de noeuds,
comme un chapelet ; ces noeuds deviennent noirs ,
& fe durciffent au foleil ; ils ont une odeur aromatique.
Les fauvages tirent des feuilles de cette plante
un fuc dont ils fe frottent, afin de fe fortifier. On
regarde ces feuilles réduites en poudre, comme un
grand reniede contre la pierre de la veffie, & les ob-
ftru&ions des reins ; on les prend dans des bouillons
pour les maux de poitrine. On l’applique extérieur
rement fous la forme d’un emplâtre, pour arrêter le
fang, pour fortifier l’eftomac, 6c pour les douleurs
de l’uterus.
PAU , ( Géog. mod. ) ville de France , regardée
comme capitale du Béarn, avec un parlement, une
chambre des comptes , 6c une cour des aides, unies
au parlement, une fénéchauflée, un hôtel des mon-
noies. Elle eft fur une hauteur, au pié de laquelle
paffe le G ave béarnois, à io lieues O. de Tarbes,
I § i | i
4 L j l
P A Ü
I l S. d’A irc ; 39 S. dé Bordeaux , 167 S. O. de Paris
Long frnvaat Camni 9» 4 22 ' 3 o " . lut 4g d.
Henri IV . naquit à Pau, le 13 Décembre 1553,
dans lé château qui ell au bout de la ville. « La Fran-
» ce n’a point eu de meilleur ni de plus grand roi ;
» il unit auxfentimens les.plus élèves une fimplicit'é
» de moeurs charmante, 6c à un courage de foidat,
» un fond d’humaniîé inépuilàble. Il rencontra ce
» qui forme 6c ce qui déclare les grands hommes,
» des obftacles à .vaincre, des périls, à efluyer, 6c
» fur-tout des adversaires dignes de lui. Enfin, com-
» me l’a dit un de nos plus grands poetes, il fut de fes
» fiijets le vainqueur 6c le pere ».
Il ne faut pas lire la vie de ce monarque dans le P.
Danié-lq qui ne dit rien de tout le bien qu’il rit à la
patrie:; mais pour l’exemple des rois, 6c pour la con-
folation des peuples , il importe de lire ce' qui concerné
les tems de ce. bon prince, dans la grande hi-
floire de Mézerai, dans Péréfixe , 6c dans les mémoires
de Sully. Le précis que M. de Voltaire en a
■ fait dans, fon hilloire générale, eft auffi trop intéref-
fant pour n’en pas tranfcrire quelques particularités..
'
Henri IV. dès fon enfance, fut nourri dans les
troubles 6c dans les malheurs.1!! iè trouva à 14 ans
à la bataille de Moncoritour ; rappellé à Paris, iln'é-
poufa làfoeur de Charles IX. que pour voir fes amis
affaffinés autour de lui-, pour courir lui-même rif-
. que de fa v ie , 6c pour refter près de trois ans prifon-
niër d’état. Il ne iôrtit de fa prifon que pour efluyer
toutes les fatigues & toutes les fortunes de la guerre.
Manquant fouvent du néceffaire, s’expofant comme
le plus hardi foidat, fail'ant des aérions qui ne paroil-
fent pas croyables, 6c qui ne le deviennent que parce
qu’il les a répétées ; comme lorlqu’à la prif e de Ca-
hors en 1599, il fut fous les armes pendant cinq
jours^ combattant de rue en rue, fans prefque prendre
de repos; La viâoire de Coutras fut due principalement
à fon courage ; fon humanité après la v i-
.éloire devoit lui-gagner tous les coeurs.
Le meurtre de Henri IIri le fit roi de France;
mais la religion fervit de prétexte à la moitié des
chefs de l’armée & à la ligue, pour ne pas le recon-
noîtrg. Il n’avoit pour lui que la juftice de fa caufe,
fon courage, quelques amis, 6c une petite armée
qui ne monta prefeue jamais à douze mille hommes
complets ; cependant avec environ cinq mille com-
battans, il battit à la journée d’Arques auprès de
Dieppe , l’armée du duc de Mayenne, forte de plus,
de vingt-cinq mille hommes; Il livra au même duc
de Mayenne, la fameufe bataille d’Iv ry, & gagna
cette bataille comme il avoit gagné celle de Coutras,
en fe jettantdans les rangs ennemis , au milieu d’une
forêt de lances. On fe fouviendra dans tous les ficelés
, des paroles qu’il dit à ( fes troupes : « Si vous
» perdez vos enfeignes, ralliez-vous à mon penna-
» che blanc, vous le trouverez toujours au chemin
» de l’honneur 6c de la gloire ».
Profitant de la viéloire, il vint avec quinze mille
nommes affiéger Paris, oii fe trouvoient alors cent
quatre-vingt mille habitans ; il eft confiant qu’il l’eût
prife par famine, s’il n’avoit pas permis lui-même par
trop de pitié , que les affiégeans nourriU'ent les alfié-
ges. En vain fes généraux publioient-fous fes ordres
des derenfes fous peine de mort, de fournir des vivres
aux Pariliens; les foldats leur en vendoient. Un
jour que pour faire un exemple * on alloiî pendre
deux paylans qui àvoient .amené des charrettes de
pain a une poterne, Henri les rencontra en allant
vifiter fes quartiers : ils fë jettêrent à fes genoux, 6c
lui remontrèrent qu’ils n’avoient- que cette maniéré
de gagner leur vie : alle^ en paix , leur dit le ro i, en
leur donnant auffi-tôt l’argent qu’il avoit fur lui; le
V A U 189
béarnois eji pauvre, ajouta-t-il, s'il en àvoit davantage
il vous Le donner oit. tJn coeur bien né ne peut lire
de pareils traits- fans quelques larmes d’admiration
6c de tendreflë.
Le duc de Parme fut envoyé par Philippe 11. au
fecours de Paris avec une puiffante armée. Henri IV.
courut lui prélènter la bataille; & c’eft alors qu’il
écrivit du champ oii il croyoit combattre, ces deux
lignes à la belle Gabrieile d’Eftrée : «Si je meurs,
» ma derniere penfee fera à D ieu , 6c l’avant-der-
» niere à vous »./Le duc de Parme n’accepta point
la bataille ; il empêcha feulement la prife de Paris;
mais Henri IV. le côtoyant jufqu’aux dernières frontières
de la Picardie, le rit rentrer en Flandres, 6c
bien-tôt après il lui fit lever le fiége de Rouen.
Cependant les Citoyens laffés de leurs malheurs
foupiroient après la paix ; mais le peuple étoit retenu
par la religion; Henri IV. changea la-fienne, 6c cet
événement porta le dernier coup à la ligue; il eft
vrai qu’on -a depuis appliqué les vers fuivans à la
conduite de ce prince.
Pour le point de conviction
Au jugement du Ciel un chrétien T abandonne ;
Mais foufire[ que l'homme foupçônne
Un acte de religion
Qui je propofe une couronne.
Ori voit affez ce qu’il penfoit lui-même de fa con-
verfion, par ce billet à Gabrieile d’Eftrées : ce fl demain
que je fais le faut périlleux y je crois que ces <*ens-
0 me feront hoirfaint Denis, autant que volts hdiffe£....
Perfonne ne fi.it plus affligé de l’abjuration de Henri
IV. que la reine Elifabeth. La lettre qu’elle écrivit
alors à ce prince eft bien remarquable, en ce quelle
fait voir en même tems fon coeur, fon efprit, 6c l’énergie
avec laquelle elle s’exprimoit dans une langue
étrangère : « Vous m’offrez ,- dit-elle , votre
» amitié comme à votre feeur. Je fais que je l’ai mé-
»ritee,. Si certes à un très-grand prix. Je ne m’en
» repentirois pas, fi vous n’aviez pas changé de pere ;
» je ne peux plus être votre foeur de pere; car j’ai-
» merai toujours plus chèrement celui qui m’eft proi
» pre que celui qui vous a adopté »
La converfion d’Henri IV. n’augnientoit én rien
fon droit à la couronne , mais, elle hâta fon entrée
dans fa capitale , fans qu’il y eût prefque de fang répandu.
Il renvoya tous les étrangers qu’il pouvoit
retenir prifonniers ; il pardonna à tous les ligueurs;
Il fe réconcilia fincerement avec le duc dé Mayenne,
& lui donna le gouvernement de l’îie de France. Non-
feulement il lui d it , après l’avoir laffé un jour dans
une promenade : « Mon coufin* voilà le feul mal que
» je vous ferai de ma vie ». Mais il lui tint parole, 6c
il n’en manqua jamais à perfonne.
Il recouvra fon royaume pauvre, déchiré y 61 dans
la même fubverfion où il avoit été du tems des Philippe
de Valois , Jean 6c Charles VI. Il fe vit forcé
d’accorder plus de grâces à fes propres ennemis qu’à
fes anciens ferviteurs, 6c fon changement de religion
ne le garantit pas de plufieurs attentats contre fa vie.
Les finances de l’état diffipées fous Henri III. n’é-'
toient plus qu’un trafic public des reftes du fang du
peuple , que le confeil des finances partageoit avec
leStraitans. En un m ot, quand la déprédation générale
força Henri IV. à donner Padminiftrâtion entière
des finances au duc de Sully, ce miniftre auffi éclairé
qu’integre trouva qu’eri 1596 on le voit 150 millions
f ir le peuple , pouf en faire entrer environ 30 dans
le tréfor royal. .
Si Henri IV; n’avoit été que le plus brave prince
de fon tems, le plus clément, le plus droit, le plus
honnête homme, fon royaume étoit ruiné : il falloit
un prince qui fût faire la guerre 6c la paix, connôître
toutes les bleffures de fon état & connoître les reme*