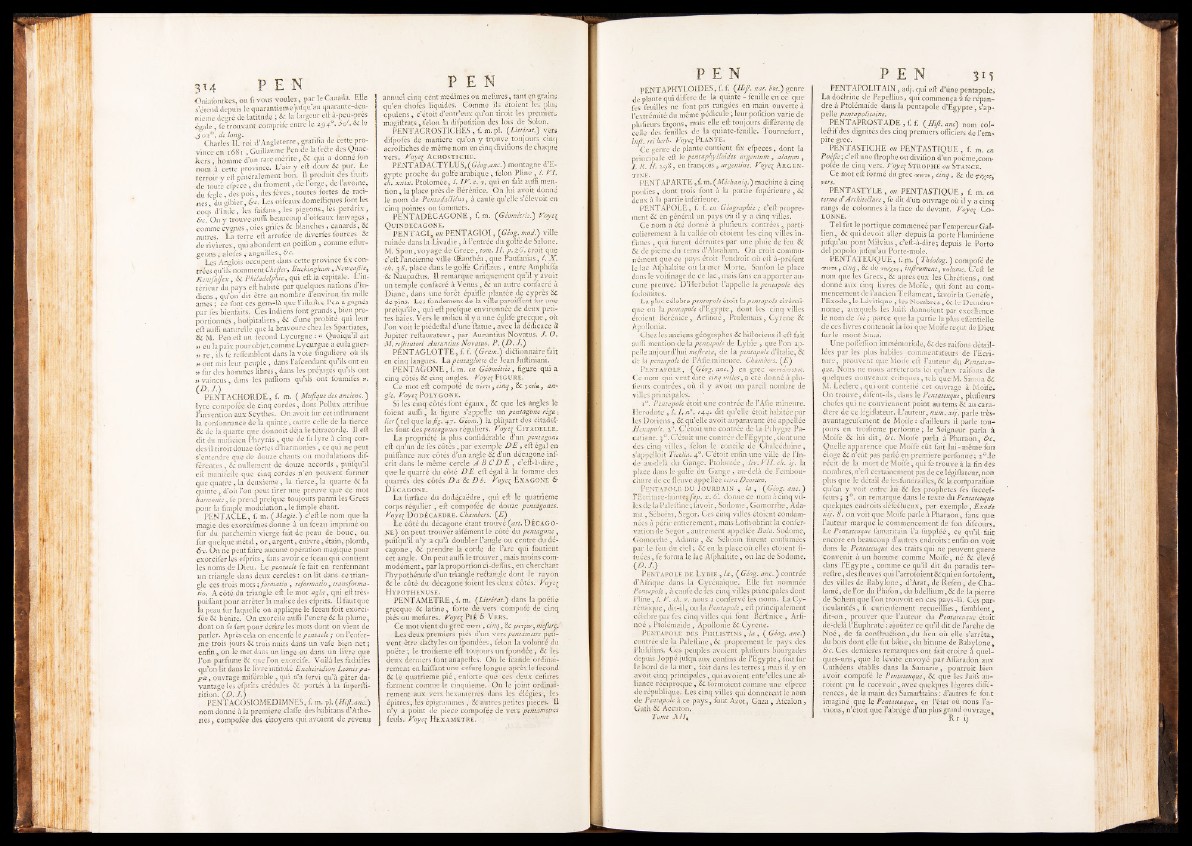
Oniafontkes, ou fi Vous voulez, par le Canada. Elle
s’étend depuis le quarantième jufqu’au quarante-deuxième
degré de latitude ; 6c 1« largeur eft j\-peu-pres
égale , lé trouvant comprilé entre le 29 4°• ' ^ 'e
-^02°. de long. . . *
Charles I l.ro i ^’Angleterre, gratifia de cette province
en 1681 , Guillaume Pen de lafefte des Quac-
kers , homme d’ùn rare mérite, & qui a donne Ion
nom à cette province. L’air y eft doux & pur. Le
terroir y eft généralement bon. Il produit des truits
de toute efpece , du froment, de l’orge, de l’avoine,
du fegle , des pois, des fèves, toutes fortes de racines
du gibier, &c. Les oifeaux domeftiques font les
coqs d’Inde, les faifans , les pigeons,-les perdrix,
&c. On y trouve aufli beaucoup d’oifeaux fauvages,
comme cygnes, oies griles 6c blanches, cornards, ôc
autres. La terre eft arrofée de diverlès fources 6c
de rivières, qui abondent en poifion, comme eftur-
geons » alofes ,‘ anguilles, Oc. • _
Les Anglois occupent dans cette province fix contrées
qu’ils nomment Chcjler, Buckingham, Newcajllc,
KentJ’uJJex, 6c Philadelphie, qui eft la capitale. L’intérieur
du pays eft habité par quelques nations d’indiens
, qu’on dit être au nombre d’environ fix mille
âmes ; ce font ces gens-là que 1 illuftre P en a gagnes
par fes bienfaits. Ces Indiens font grands, bien proportionnés
, hofpitaliers, 6c d’une probité qui leur
eft aufli naturelle que la bravoure chez les Spartiates,
& M. Pen eft un fécond Lycurgue : « Quoiqu’il ait
» eu la paix pour objet,comme Lycurgue a eulaguer-
» re ils fe reffemblent dans la voie finguliere où ils
» ont mis leur peuple , dans l’afcendant qu’ils ont eu
» fur des hommes lihres, dans les préjuges qu’ils ont
» vaincus, dans les pallions qu’ils ont foumiles ».
(D . J.)
PENTACHORDE, fi m. ( Mufique des anciens. )
lyre compofée de cinq cordes, dont Pollüx attribue
l’invention aux Scythes. On avoit fur cet infiniment
la confonnance de la quinte, outre celle de la tierce
& de la quarte que donnoit déjà le tétracorde. Il eft
dit du muficien Phrynis , que de fa lyre à cinq cordes
i l tiroit douze fortes d’harmonies , ce qui ne peut
s ’entendre que de douze chants ou modulations différentes
, 6c nullement de douze accords , puifqu’il
eft manifefte que cinq cordes n’en peuvent former
que quatre, la deuxieme, la tierce, la quarte 6c la
quinte, d’oii l’on peut tirer une preuve que ce mot
harmonie, fe prend prefque toujours parmi les Grecs
pour la fimple modulation, le fimple ehant.
PENTACLE, fi m. (Magie. ) c’eft le nom que la
■ magie des exorcifmes donne à un fceau imprimé ou
fur du parchemin vierge fait de peau de bouc, ou
fur quelque métal, o r , argent, cuivre, étain, plomb,
&c. On ne peut faire aucune opération magique pour
exorcifer les efprits, fans avoir ce fceau qui contient
les noms de Dieu. Le pentacle fe fait en renfermant
un triangle dans deux cercles : on lit dans ce triangle
ces trois mots ; formatïo , reformatio, transforma-
tio. A côté du triangle eft le mot agla, qui efttrès-
puiffant pour arrêter la malice des efprits. 11 faut que
la peau fur laquelle on applique le fceau foit exorci-
fée 6c bénite. On exorcife aufli l’encre 6c la plume,
dont on fe fert pour écrire les mots dont on vient de
parler. Après cela on encenfe le pentacle ; on l’enferme
trois jours 6c trois nuits dans un vafe bien net ;
enfin, on le met dans un linge ou dans un livre que
l’on parfume 6c que l’on exorcife. Voilà les fadaifes
qu’on lit dans le livre intitulé Enclieiridion Leonis pava
, ouvrage miférable , qui n’a fervi qu’à gâter davantage
les efprits crédules & portés à la fuperfti-
litiori. CD. J.) -".M .
PENTACOSIOMEDIMNES, f. m. pl. (Hijl.anc.)
nom donné à la première clafle des habitans d’Athènes
, compofée des citoyens qui avoient de /evenij.
annuel cinq cent medimes ou mefures, tant en grains
qu’en chofes liquides. Comme ils étoient les. plus
cpulens, c’étoit d’entr’eux qu’on tiroit les premiers
-mapiftrats , félon la difpofition des lois de Solon.
PENTACROSTICHES , fi m. pl. (Littéral.) vers
difpofés de maniéré qu’on y trouve toujours cinq
acroftiches de même nom en cinq divifions de chaque
vers. Foye[ A cr o st ich e .
PENTADACTYLUS,(G<!o^.û/if.) montagne d’Egypte
proche du golfe arabique, félon Pline , l. FI.
ch. xxix. Ptolomee, l. IF . c. v. qui en fait aufli mention,
la place près de Bérénice. On lui avoit donné
le nom de Pentadaclilus, à caufe qu’elle s’élevoit en
-cinq pointes ou fommets.
PENTADÉCAGONE, f. m. (-Géométrie.) Foye^
Q uindëcagone.
PENT AGI, cm PENTAGIOl, (Geog. mod.) ville
ruinée dans la Livadie, à l’entrée du golfe de Salone.
M. Spon, voyage d'è Grece, tom. II. p.zG. croit que
-c’eft l’ancienne ville (Eanthéa, que Paufanias, l. X .
•ch. 3 8. place dans le golfe Criflæus , entre Amphifîà
6c Naupaûus. Il remarque uniquement qu’il y avoit
un temple confacré à Venus, & un autre confacré à
Diane, dans une forêt épaiffe plantée de cyprès 6c
de pins. Les fondemens de la ville paroiflent fur une
prefqu’île , qui eft prefque environnée de deux petites
baies. Vers le milieu il y a une églife grecque, oîi
Ton voit le'piédeftal d’une ftatue, avec la dédicace à
Jupiter reftaurateur, par Auruntius Novatus. J. O.
M. reflitutori Auruntius Novatus. P. (D . J.)
PENTAGLOTTE, fi f. (Gram.) di&ionnaire fait
en cinq langues. La pentagldue de Jean Juftiniani.
PENTAGONE, fi m. en Géométrie , figure qui a
cinq côtés 6c cinq angles, Foye^ Figure.
Ce mot eft compofé de m m , cinq, 6c yovU, angle.
Foyei Po lyg o n e,
Si les cinq côtés font égaux, 6c que les angles le
foient aufli, la figure s’appelle un pentagone régu •
lier ( tel que lafig. 47. Géom.) la plupart des citadelles
font des pentagones réguliers. Foye£ Citadelle.
La propriété la plus confidérable d’un pentagone
eft qu’un de fes côtés , par exemple D E , eft égal en
puiflance aux côtés d’un angle 6c d’un décagone inf-
crit dans le même cercle A B C D E , c’eft-à-dire ,
que le quarré du côté D E eft égal à la fomme des
quarrés des côtés D a 6c D b. Foye1 Exagone &
D écago ne.
La furface du dodécaèdre, qui eft le quatrième
corps régulier , eft compofée de douze pentagones.
Foyei D odécaèdre. Chambers. (E)
Le côté du décagone étant trouvé (art. D éc ag o ne)
on peut trouver aifément le côté du pentagone,
puifqu’il n’y a qu’à doubler l’angle ou centre du décagone
, 6c prendre la corde de l’arc qui foutient
cet angle. On peut aufli le trouver, mais moins commodément,
par la proportion ci-deflùs, en chêrchant
l’hypothénule d’un triangle reftangle dont le rayon
6c le côté du décagone loient les deux côtés. Foye£
Hypothenuse.
PENTAMETRE, f. m. (Litrérat.) dans la poéfie
grecque 6c latine, forte de vers compofé de cinq
piés ou mefures. Foye^ PiÉ & VERS.
Ce mot vient du grec m m , cinq, 6c p^pov^mefurej
Les deux premiers piés d’un vers/’e/zwwcr« ,peuvent
être da&yles ou fpondées, félon la volonté du
poète ; le troifieme eft toujours un fpondée ; & les
deux derniers font anapeftes. On le fearide ordinairement
en laiflant une cefure longue après lé fécond
& le quatrième pié, enforte qué cés detix cefures
forment comme le cinquième. On le joint ordinairement
aux vers hexamètres dans les élégies-, les
épitres, les épigrammes , &:-autres petites pièces. Il
n’y à point de piece compofée de vers pentamètres
feills.: Foye{ HEXAMETRE.
PENTAPH Y L01D ES, f. f. (Hiß. nat. bot.) genre
de plante qui différé de la quinte - feuille en ce que
fes feuilles ne font pas rangées en main ouverte à
l’extrémité du même pédicule ; leur pofition varie de
pluûeurs façons, mais elle eft toujours différente de
celle des feuilles de la quinte-feuille. Tournefort,
infi. rei herb- Foye^ PLANTE.
Ce genre de plante contient fix efpeces., dont la
principale eft le pcntaphylloïdes argentum , alatum ,
I. R. IL 298, en françois , argentine. Foye^ A rgentine.
PENTAP A R T E , fi m. (Méchanlq.) machine à cinq
poulies , dont trois font à la partie fupérieure , 6c
deux à la partie inférieure.
PENTAPQLE, f. f . en Géographie ; c’eft proprement
6c én général un pays où il y a cinq villes.
Ce nom a été donne à plufieurs contrées , particulièrement
à la vallée où étoient les cinq villes infâmes
, qui furent détruites par une pluie de feu &
& de pierre.du tems d’Abraham. On croit communément
que ce pays étoit l’endroit où eft à-préfent
le lac Afphaltite ou la mer Morte. Sanfon le place
dans le voifinage de ce lac, mais fans en apporter aucune
preuve* D’Herbelot l’appelle la pentapole des
fodomites.
La plus célébré pentapole étoit la pentapole cirénari
que ou la pentapole d’Egypte, dont les cinq villes
etoient Bérénice, Arfinoë, Ptolémaïs, Cyrene &
Apollonia.
Chez les anciens géographes & hiftoriens il eft fait
aufli mention de la perttfipole de Lybie > que l’on appelle
aujourd’hui mefirala> de la pentapole d’Italie, 3c
de la pentapole de J’Afie,mineure. Chambers. (E)
■ Pen ta pole, ( Géog. qnc.) en grec 'sw-tà^o^iç.
Ce nom qui veut dire cinq villes, a été donné à plufieurs
contrées, où il y avoit un'pareil,nombre de
villes principales. ■
i°. Pentapole étoit une contrée dé l’Afie mineure.
Hérodote , L I . n°. 144. dit qu’elle étoit habitée par
les Doriens , & qu’elle avoit auparavant été appellée
Hîxapole. z°. C ’etoit une contrée de la Prhygie Pa-
catiane. 3 ° .C ’étoit une contrée de l’Egypte, dont une
des cinq ville s , félon le concile de Chalcédoine,
s’appelloit Ticelia. 40. C’étoit enfin une ville de l’Inde
au-delà dù Gange. Ptolomée, liv. FII. ch. ij. la
place dans le golfe du Gange , au-delà de l’embouchure
de ce fleuve appellée citraDeorum.
Pentapole- du Jourdain , la , (Géog. anc. )
TEcriture-faintef_/îzjp. x. 6. donne ce nom à cinq villes
de la Paleftine ; favoir, Sodome, Gomorrhe, Ada-
ma , Séboim, Segor. Ces cinq villes étoient condamnées
à périr entièrement, mais Loth obtint la confer-
vationde Segor, autrement appellée Bala. Sodome,
Gomorrhe, Adama , 6c Séboim furent confumées
par le feu du ciel ; & en la place où elles étoient fi-
tuées, fe forma le lac Afphaltite, ou lac de Sodome.
Pentapole de Lyb ie , la, (Geog. anc. ) contrée
d’Afrique dans la Cyrénaïque. Elle fut nommée
Pentapole, à caufe de les cinq villes principales dont
Pline, /. F. cli. v. nous a confervé les noms. La C y rénaïque,
dit-il, ou la Pentapole, eft principalement
célébré par fes cinq villes qui font Bérénice , Arfi-
noé , Ptolémaïde , Apollonie 6c Cyrene.
Pentapole des Philistins , la , ( Géog. anc.)
contrée de la Paleftine, 6c proprement le pays des
Philiftins. Ces peuples avoient plufieurs bourgades
depuis Joppé jufqu’aux confins de l’Egypte, foit fur
le bord de la m er, foit dans les terres ; mais il y en
avoit cinq principales, qui avoient entr’elles une alliance
réciproque, 6c formoient comme une efpece
de république. Les cinq villes qui donnèrent le nom
de Pentapole à ce pays, font Azot, Gaza , Afcalon,
Gath 6c Accaton.
Tome X IL
PENTAPOLITAIN, adj. qui eft d’üne pentapole»
La do&rine de Papellius, qui commença à fe répandre
à Ptolémaïde dans la pentapole d’Egypte, s’appelle
pentapolitaine.
PENTAPROSTADE, f. f. ( Hifi. anc) nom col-
leftif des dignités des cinq premiers officiers de l’empire
grec.
PENTASTICHE 0« PENTASTIQUE , fi m. e/z
Poéjje ; c’eft une ftrophe ou divifion d’un poème,corn-
polee de cinq vers. Foyeç Strophe ou Stance.
Ce mot eft formé du grec m m , cinq , 6c de
vers.
PENTASTYLE , ou PENTASTIQUE, fi m. en
terme £ Architecture, fe dit d’un ouvrage où il y a cinq
rangs de colonnes à la face de devant. Foye^ C olonne.
Tel fut le portique.çommencé par l’empereur Gal-
lien, 6c qui devoit aller depuis la porte Flaminiene
jufqu’au pont Milvius, c’eft-à-dire; depuis le Porto
del popolo jufqu’au Porte-mole.
PENTATEUQUE, f. m. ( Théolog. ) compofé de
m m , cinq, & de nv^oc, injlrument, volume. C’eft le
nom que les Grecs , 6c après eux les Chrétiens, ont
donne aux cinq livres de Moïfe, qui font au commencement
de l’ancien Teftament, favoir la Genèfe ,
l’Exode, le Lévitique , les Nombres , 6c le Deutéronome,
auxquels les Juifs donnoient par excellence
le nom de loi ; parce que la partie la plus eflentielle
de ces livres contenoit la loi que Moïfe reçut de Dieu
furie mont Sinaï.
Une pofleffion immémoriale, &des raifons détaillées
par les plus habiles commentateurs de l’Ecriture,
prouvent que Moïfe eft l’auteur du Pentateu-
que. Nous ne nous arrêterons ici qu’aux raifons de
quelques nouveaux critiques, tels queiM. Simon 6c
M. Leclerc, qui ont contefté cet ouvrage à Moïfe.
On trouve, difent-ils, dans le Pentateuque, plufieurs
chofes qui ne conviennent point au tems 6c au cara-
âere de ce légiflateur. L’auteur, num. xi/. parle très-
avantageufement de Moïfe : d’ailleurs il parle toujours
en troifieme perfonne ; le .Seigneur parla .à
Moïfe 6c lui dit, &c. Moïfe parla à Pharaon,
Quelle apparence que Moïfe eût fait lui-même fon
éloge & n’eût pas parlé en première perfonne; 2°.le
récit de la mort de Moïfe, qui fe trouve à la fin des
nombres, n’eft certainement pas de ce. légiflateur, non
plus que le détail de fes funérailles, 6c la comparaifon
qu’on y voit entre lui 6c les prophètes fes fuccef-
leurs ; 3 °. on remarque dans le texte du Pentateuque
quelques endroits défe&ueux, par exemple, Exode
xij. 8. on voit que Moïfe parle à Pharaon-, fans que
l’auteur marque le commencement de fon difeours.
Le Pentateuque famaritain l’a fuppléé, ce qu’il fait
encore en beaucoup d’autres endroits : enfin on voit
dans le Pentateuque des traits qui ne peuvent guere
"convenir à un homme comme Moïfe, né & élevé
dans l’Egypte, comme ce qu’il dit du paradis ter-
. reftre, des fleuves qui l’arroloient&quien fortoient,
des villes de Babylone, d’Arat, de Refen, de Cha-
lamé, de l’or du Phifon, du bdellium, 6c de la pierre
i de Sohem que l’on trouvoit en ces pays-là. Ces particularités
, fi curieufement recueillies, femblent,
dit-on , prouver que l’auteur du Pentateuque. étoit
de-delà l’Euphrate : ajoûtez ce qu’il dit de l’arche de
N o é, de fa conftruclion, du lieu où elle s’arrêta,
du bois dont elle fut bâtie, du bitume de Babylone,
&c. Ces dernieres remarques ont fait croire à quelques
uns, que ie lévite envoyé parAflaradon aux
Cuthéens établis dans la Samarie, pourroit bien
avoir compofé le Pentateuque, 6c que les Juifs auraient
pu le recevoir, avec quelques légères différences
, de la main des Samaritains : d’autres fe font
imaginé que le Pentateuque, en l’état où nous l’ avions,
n’étoit que l’abrégé d’iïn plus grand ouvrage*
R r ij