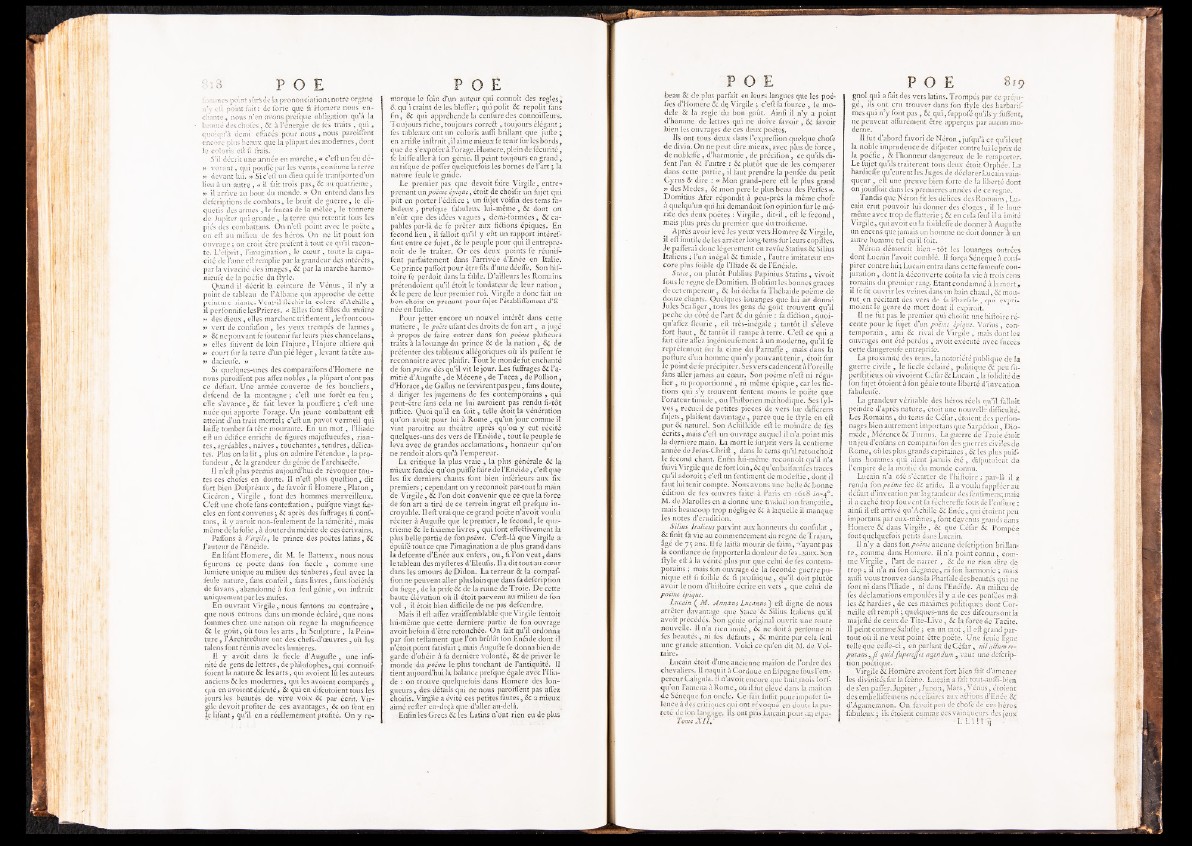
fommes point sCirS de la prononciation ; notre ôrgânô
n’y eft point fait : de forte que fi Homere nous enchante
, nous n’en avons prefque obligation qu’à la
beauté des choies, 6c à l’énergie de fes traits , q ui,
quoiqu’à demi effacés pour nous , nous paroiffent
encore plus beaux que la plupart des modernes , dont
le coloris eft li frais.
S’il décrit une armée en marche, « c’eftun feu dé-
» votant, qui pouffe par les vents, confume la terre
» devant lui. » Si c’eff un dieu qui fe tranfporte d’un
lieu à un autre, « il fait trois pas, 6c au quatrième,
» il arrive au bout du monde. » On entend dans les
deferiptions de combats, le bruit de guerre, le cliquetis
des armes, le fracas de la mêlee, le tonnere
de Jupiter qui gronde , la terre qui retentit fous les
piés des combattans. On n’eft point avec le poëte ,
on cft au milieu de fes héros. On ne lit point fon
ouvrage ; on croit être préfent à tout ce qu’il raconte.
L’eïprit, l’imagination, le coeur , toute la capacité
de l’ame eft remplie parla grandeur des intérêts,
par la vivacité des images, & par la marche harmo-
nieufe de la poéffe du ftyle.
Quand il décrit la ceinture de Vénus, il n’y a
point de tableau de l’Albane qui approche de cette
peinture riante. Veut-il fléchir la colere d’Achille,
il perfonnifielesPrieres. « Elles font filles du maître
» des dieux, elles marchent triftement, le front cou-
» vert de confufion , les yeux trempés de larmes ,
» & ne pouvant fe foutenir fur leurs piés chancelans,
» elles fuivent de loin l’Injure, l’Injure altiere qui
»> court fur la terre d’un pié léger, levant fa tête au-
» dacieufe. »
Si quelques-unes des comparaifons d’Homere ne
nous paroiffent pas affez nobles, la plupart n’ont pas
ce défaut. Une armée couverte de fes boucliers,
defeend de la montagne ; c’eft une forêt en feu ;
elle s’avance, 6c fait lever la poufliere ; c’ eft une
nuée qui apporte l’orage. Un jeune combattant eft
atteint d’un trait mortel; c’eftun pavot vermeil qui
laiffe tomber fa tête mourante. En un mot , l’Iliade
eft un édifice enrichi de figures majeftueufes, riantes
, agréables, naïves, touchantes, tendres, délicates.
Plus on la l i t , plus on admire l’étendue , la profondeur
, 6c la grandeur du génie de l’architeâe.
Il n’eft plus permis aujourd’hui de révoquer toutes
ces chofes en doute. Il n’eft plus queftion, dit
fort bien Defpréaux , de favoir fi Homere , Platon ,
Cicéron , Virgile , font des hommes merveilleux.
C ’eft une choie fans conteftation , puifque vingt fie-
cles en font convenus ; 6c après des fuffrages fi conf-
tans, il y auroit non-feulement de la témérité, mais
même de la folie , à douter du mérite de ces écrivains.
Paffons à Virgile, le prince des poètes latins, 6c
l ’auteur de l’Enéide.
En lifant Homere, dit M. le Batteux, nous nous
figurons ce poëte dans fon fiecle , comme une
lumière unique au milieu des ténberes, feul avec la
feule nature, fans confeil, fans livres, fans fociétés
de favans, abandonné à fon feul génie, ou inftruit
uniquement par les mufes.
En ouvrant Virgile, nous fentons au contraire ,
que nous entrons dans un monde éclairé, que nous
fommes chez une nation oii régné la magnificence
& le goût, oii tous les arts , la Sculpture , la Peinture
, l’Architecture ont des chefs-d’oeuvres , oii les
taîens font réunis avec les lumières.
Il y avoit dans le fiecle d’Augufte, une infinité
de gens de lettres, de philofophes, qui connoif-
foient la nature 6c les arts, qui avoient lu les auteurs
anciens & le s modernes, qui les avoient comparés ,
qui en avoient difeuté, & qui en difeutoient tous les
jours les beautés de. vive voix & par écrit. Virgile
devoit profiter de ces avantages, 6c on fent en
le lifant ? qu’il en a réellemement profité. On y remarque
le foin d’un auteur qui connoît des réglés i
& qit i craint de les blefl'er ; qui polit 6c repolit fans
fin, 6c qui appréhende la cenfuredes cônnoiffeurs.
Toujours riche, toujours correét, toujours élégant ;
fes tableaux ont un coloris aufli brillant que jufte ;
en artifte inftruit, il aime mieux fe tenir fur les bords,
que de s’expofer à l’orage. Homere, plein de fécurité,
fe laiffe aller à fon génie. Il peint toujours en grand,
au rifque de paffer quelquefois les bornes de l’art ; la
nature feule le guide;
Le premier pas que devoit faire Virgile, entreprenant
un poème épique, étoit de choifir un fujet qui
put en porter l’édifice ; un fujet voifin des tems fabuleux
, prefque fabuleux lui-même, 6c dont on
n’eut que des idées vagues , demi-formées , & capables
par-là de fe prêter aux fiûions épiques. En
fécond lieu , il falloit qu’il y eût un rapport intéref-
fant entre ce fujet ,& le peuple pour qui il entrepre-
noit de le traiter. Or ces deux points fe réunif-
fent parfaitement dans l’arrivée d’Enée en Italie.
Ce prince paffoit pour être fils d’une déeffe. Son hif-
toire fe perdoit dans la fable. D’ailleurs les Romains
prétendoient qu’il étoit le fondateur de leur nation,
& le pere de leur premier roi. Virgile a donc fait un
bon choix en prenant pour fujet l’établiffement d’Enée
en Italie.
Pour jetter encore un nouvel intérêt dans cette
matière, le poète ufant des droits de fon a r t , a jugé
à propos de faire entrer dans fon poème plufieurs
traits à la louange du prince 6c de la nation , de
préfenter des tableaux allégoriques oit ils puffent fe
reconnoître avec plaifir. Tout le monde fut enchanté
de fon poème dès qu’il vit le jour. Les fuffrages 6c l’amitié
d’Augufte, de Mécene, de Tuc ca, de Pollion,
d’Horace, de Gallus ne fervirentpas peu, fans doute,
à diriger les jugemens de fes contemporains , qui
peut-être fans cela ne lui auroient pas rendu fi-tôt
juftice. Quoi qu’il en foit, telle étoit la vénération
qu’on avoit pour lui à Rome , qu’un jour comme il
vint paroître au théâtre après qu’on y eut récité
quelques-uns des vers de l’Enéide, tout le peuple fe
leva avec de grandes acclamations, honneur qu’on
ne rendoit alors qu’à l’empereur.
La critique la plus vraie , la plus générale 6c la1
mieux fondée qu’on puiffe faire de l’Enéide, c’eft que
les fix derniers chants font bien inférieurs aux fix
premiers ; cependant on y reconnoît par-tout la main
de Virgile, 6c l’on doit convenir que ce que la force
de fon art a tiré de ce terrein ingrat eft prefque incroyable.
Il eft vrai que ce grand poëte n’avoit voulu
réciter à Augufte que le premier, le fécond, le quatrième
& le fixieme livres , qui font effe&ivement la
plus belle partie de fon poème. C’eft-là que Virgile a
épuifé tout ce que l’imagination a de plus grand dans
la defeente d’Enée aux enfers, ou, fi l’on veut, dans
le tableau des myfteres d’Eleufis. Il a dit tout au coeur
dans les amours de Didon. La terreur- & la compaf-
fionne peuvent aller plus loin que dans fa defeription
du fiege, de la prife 6c de la ruine de Troie. De cette
haute élévation où il étoit parvenu au milieu de fon
v o l , il étoit bien difficile de ne pas defeendre.
Mais il eft affez vraiffemblable que Virgile fentoit
lui-même que cette derniere partie de fon ouvrage
avoit befoin d’être retouchée. On lait qu’il ordonna
par fon teftament que l’on brûlât fon Enéide dont il
n’étoit point latisfait ; mais Augufte fe donna bien de
garde d’obéir à fa derniere volonté, 6c de priver le
monde du poème le plus touchant de l’antiquité. Il
tient aujourd’hui la balance prefque égale avëc l’Iliade
: on trouve quelquefois dans Homere des longueurs,
des détails qui ne nous paroiffent pas affez
choifis., Virgile a évité ces petites fautes, 6c a mieux
aimé refter en-deçà que-d’aller au-delà.
Enfin les Grecs 6c les Latins n’o'nt rien eu de plus
beau & de plus parfait en leurs langues que les poé-
fies d’Homere 6c dç Virgile ; c’eft la fource , le modèle
& la réglé du bon goût. Ainfi il n’y a point
d’homme de lettres qui ne doive favpir , 6c lavoir
bien les ouvrages de ces deux poëtes.
Ils ont tous deux dans l’expreffion quelque chofe
de divin. On ne petit dire mieux, avec plus de force,
de noblefié, d’harmonie, de précifion, ce qu’ils di-
fent l’un 6c l’autre : 6c plutôt que de les comparer
dans cette partie, il faut prendre la penfée du petit
Cyrus Sr dire : « Mon grand-pere eft le plus grand
» des Medes, & mon pere le plus beau des Perfes».
Domitius Afer répondit à peu-près la même chofe
a quelqu’un qui lui demandoit fon opinion fur le mérite
des deux poëtes : Virgile, dit-il, eft le fécond,
mais plus près du premier que du troifieme.
Après avoirleve les yeux vers Homere 6c Virgile,
il eft inutile de les arrêter long-tems fur leurs copiftes.
Je pafferai donc légex-ement en revûeStatius 6c Silius
Italicus ; l’un inégal 6c timide , l’autre imitateur encore
plus foible de l’Iliade & de l’Enéide.
Stace, ou plutôt Pubiius Papinius Statius , vivoit
fous le régné de Domitien. Il obtint les bonnes grâces
de cet empereur, 6c lui dédia fa Thébaïde poëme de
douze chants. Quelques louanges que lui ait donné
Jules Scaliger, tous les gens de goût trouvent qu’il
peche du côté de l’art 6c du génie : fa di&ion, quoi-
qu’aflez fleurie , eft très-inégale ; tantôt il s’eleve
fort haut, 6c tantôt il rampe à terre. C’eft ce qui a
fait dire affez ingénieufement à un moderne, qu’il fe
repréfentoit fur la cime du Parnaffe , mais clans la
pofture d’un homme qui n’y pouvant tenir, étoit fur
le point defe précipiter. Ses vers eadencent à l’oreille
fans aller jamais au coeur. Son poëme n’eft ni régulier
, ni proportionné , ni même épique, car les fictions
qui s’y trouvent fentent moins le poëte que
l’orateur timide , ou l’hiftorien méthodique. Ses fyl-
v e s , recueil de petites pièces de vers fur diftérens
fujets, plaifent davantage, parce que le ftyle en eft
pur 6c naturel Son Achilléide eft le moindre de fes
écrits, mais c’eft un ouvrage auquel il n’a point mis
la derniere main. La mort le furprit vers la centième
année de Jefus-Chrift , dans le tems qu’il.retouchoit
le fécond chant. Enfin lui-même reconnoît qu’il n’a
fui vi Virgile que de fort loin, 6c qu’en baifantfes traces
qu’il adoroit ; c’eft un fentiment de modeftie, dont il
faut lui tenir compte. Nous avons une belle 6c bonne
édition de fes oeuvres faite à Paris en 1618 z/z-40.
M. deMarolles en a donné une traduûion françoife,
mais beaucoup trop négligée 6c à laquelle il manque
les notes d’érudition.
Silius Italicus parvint aux honneurs du Gonfulat ,
& finit fa vie au commencement du régné deTrajan,
âgé de 75 ans..Il fe laiffa mourir de faim-, Payant pas
la confiance de fupporterla douleur de fes.jaux. Son
ftyle eft à la vérité plus pur que celui de fes contemporains
; mais fon ouvrage de la fécondé guerre.pu-
nique eft fi foible 6c fi profaïque^ qu’il doit plutôt
avoir le nom d’hiftoire écrite en vers , que celui de
poème épique.
Lucain ( M. Anticeus Lucanus ) eft digne de nous
arrêter davantage que Stace '6c Silius Italicus qu’il
avoit précédés. Son génie original ouvrit une route
nouvelle. Il n’a rien imité , & ne doit à perfonneni
fes beautés , ni fes défauts , 6c mérite par cela-feul
line grande attention. Voici ce qu’en dit M. de, Voltaire.
Lucain étoit d’une ancienne maifon de l’o/dre des
chevaliers. Il naquit àCordoue .enEfpagnefouslern-,
pereur Caiigula.il n’avoit encore que huitjnois lorf:
qu’on l’amena à Rome, où il fut élevé dans la maifon
de Séneque fon oncle. Ceifait iuffit pqur impofer fi-
lence à de£critiques qui ont révoqué en doute la p u reté
de fon langage. Ils ont priscLucain,pour un elpa-
Tome X I I%L
gnol qui a fait des vers latins. Trompés par ce préjug
e , ils ont cru trouver dans fon ftvle des barbarif-
mes qui n’y font pas , 6c qui, fuppofe qu’ils y fuffent,
ne peuvent affurément être apperçus par aucun moderne.
Il fut d’abord favori de Néron, jufqu’à ce qu’il eut
la noble imprudence de difputer contre lui le prix de
la poéfie, & l’honneur dangereux de le remporter.
Le fujet qu’ils traitèrent tous deux étoit Orphée. La
hardieflè qu’eurent les Juges de déclarer Lucain vainqueur
, eft une preuve bien forte de la liberté dont
on jouiffoit dans les premières années de ce régné.
Tandis que Néron fit les délices des Romains, Lucain
crut pouvoir lui donner des éloges , il le louer
même avec trop de flatterie ; 6c en cela feul il a imité
Virgile, qui avoit eu la foibleffe de donner à Augufte
un encens que jamais un homme ne doit donner à un
autre homme tel qu’il foit.
Néron démentit bien - tôt les louanges outrées
dont Lucain l’avoit comblé. II força Séneque à conf-
pirer contre lui; Lucain entra dans cettefameufecon-
juration, dont la découverte coûta la vie à trois cens
romains du premier rang. Etant condamné à la mort,
il fe fit ouvrir les veines dans un bain chaud, 6c mourut
en récitant des vers de fa Pharfale , qui expri-
moient le genre de mort dont il expiroit.
Il ne fut pas le premier qui choifit une hiftoire récente
pour le fujet d’un poème épique. Varius , contemporain
, ami 6c rival de Virgile , mais dont les
ouvrages ont été perdus , avoit exécuté avec fuccès
cette dangereufe entreprife.
La proximité des tems, la notoriété publique de la
guerre civile , le fiecle éclairé, politique 6c peu fu-
perftitieux où vivoient Céfar & Lucain, la folidité de
Ion fujet ôtoient à fon génie toute liberté d ’invention
fabuleufe.
La grandeur véritable des héros réels qu’il falloit
peindre d’après nature, étoit une nouvelle difficulté.
Les Rpmains, du tems de Céfar, étoient des perfon-
nages bien autrement importans que Sarpédon, Diomède
, Mézence 6c Turnus. La guerre de Troie étoit
unjeu d’enfans en comparaifon des guerres civiles de
Rome, oùles plus.grands capitaines * 6c les plus puiff
fans hommes qui aient jamais é té , difputoient de
l’empire de la moitié du monde connu.
Lucain n’a ofé s’écarter de l’hiftoire ; .par-là il a
rendu fon poème fec 6c aride. Il a voulu fuppléer au
défaut d’invention par la grandeur des fentimens; mais
il a caché trop fouvent la féchéreffe fous de l’enflure :
ainfi il eft arrivé qu’Achille 6c Enée, qui étoient peu
importans par eux-mêmes, font devenus grands dans
Homere 6c dans Virgile, 6c que Céfar 6c Pompée
font quelquefois petits dans Lucain.
Il n’y a dans fon poème aucune defeription brillante
, comme dans Homere. Il n’a point connu, comme
Virgile , l’art de narrer , 6c de ne rien dire de
trop ; il n’a ni fon élégance, ni fon harmonie ; mais
auffi vous trouvez dans.la Pharfale des beautés qui ne
font ni dans l’Iliade , ni dans l’Enéïde. Au milieu de
fes déclamations empoulées il y a de ces penfées mâles
6c hardies , de ces maximes politiques dont Corneille
eft rempli ; quelques-uns de ces difcoursontla
majefté de ceux de Tite-Live, 6c la force de Tacite.
Il peint comme Salufte ; en ün mot ,; il eft grand partout
où il ne veut point êtrë poëte. Une feule ligne
telle que celle-ci, en parlant de Cqfar, nilactum n-
putans quid fuperejfu agendum, vaut une defeription
poétique.
Virgile & Homère avoient fort bien fait d’amener
les divinités fur la fcène. Lucain a fait tout-auffi-bien
de s’en paffer. Jupiter, Junop, Mars, Vénus, étoient
des embelliffemens nécéffairès aux aélions.d’Enée 6c
d’Aganaemnon. On favoit.peu de chofe de ces héros,
fabuleux ; iis étoient cqmme .ces vainqueurs, des jeux'