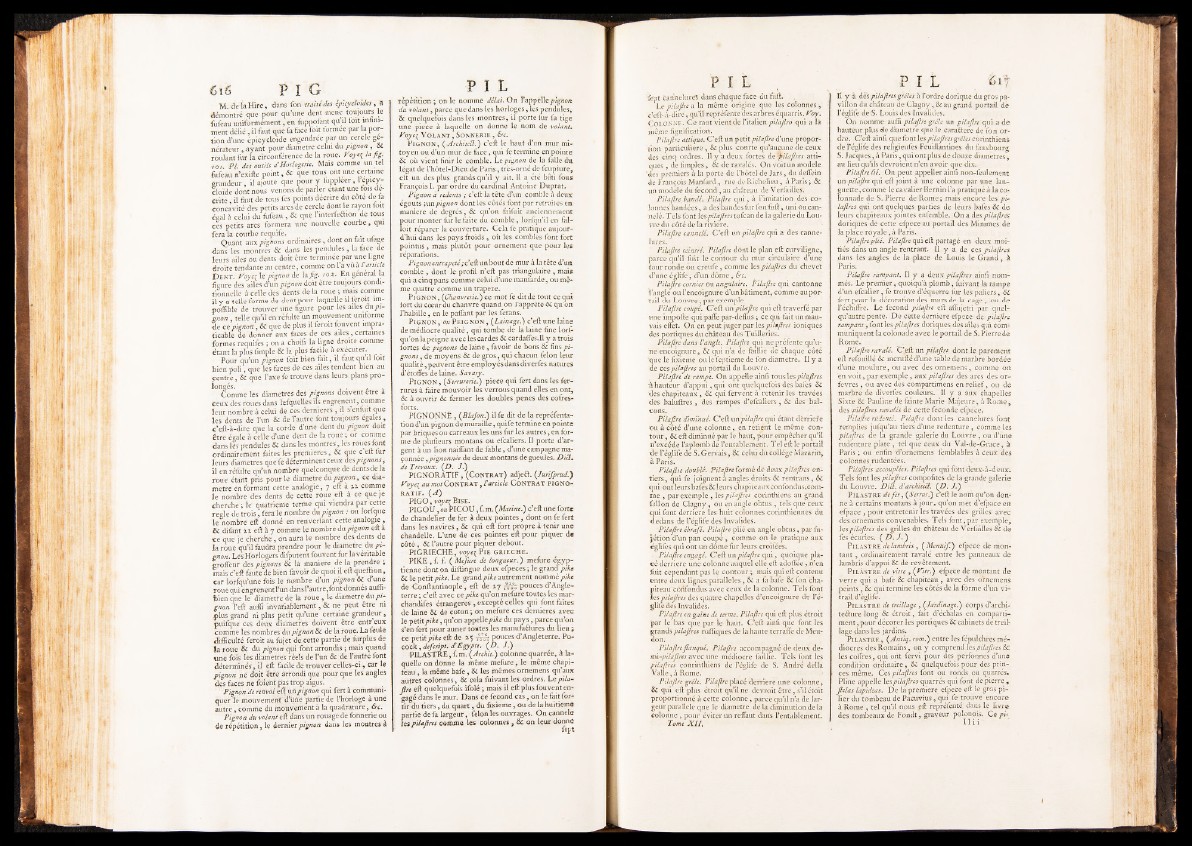
«tfi P ï G
M.-cle la Hire, ’dans fon traité-dés <f>aycloUks, S
démontré que pour qil’une dent mene toujours le
fufeau imlt'onnoment, en foppofant qù il H B
ment délié, il faut que fa face loil formée par la portion,
d'une épicycldïdé engendrée par un cercle générateur
, ay ant pour diamètre celui du pignon , oc
foulant fur là circonférence delà roue. B S® m m
■ <ot PL des outils dHorlogerie. Mais comme un tel
fufeaun’exiftepoint, & que tous ontune certame
grandeur, il ajoute que pour y fujipleer, 1 épicy-
cloïde dont nous venons dé parler étant une fois décrite
, il faut de tous fés points décrire du cote de la
concavité des petits arcs de cercle dont le rayon loit
•égal à celui du fofe.au, & que 5 nterfeâioa de tous
c c S petits arcs formera une nouvelle courbe , qui
fera la courbe requife. _. _
Quant sax pigeons ordinaires , dont on tait uiage
dans les montres & dans les pendules, la face de
leiifs aileÿ ou dents doit être terminée^par une ligne
droite tendante au centre, comme on l’a vu à L article
D eNT. f le pignon de la fig. 102. En general la
fioure des ailes d’un pignon doit être toujours conditionnelle
à celle dès dents de la roue ; mais comme
il y a telle forme de dent pour laquelle il feroit îm-
poffible de trouver une figure pour les ailes du pignon
telle qu’il en réfulte un mouvement uniforme
de ce pignon, & que de plus il feroit fouvent impraticable
de donner aux feces de ces ailes, certaines
formes requifes ; on a choifi la ligne droite comme
étant la plus limple & la plus facile à executer. .
Pour qu’un pignon foit bien fait, il faut qu il loit
bien poli , que les faces dé cès ailes tendent bien au
centre, & que l’axe fe trouvé dans leurs plans prolongés.
. .
Comme les diamètres des pignons doivent etre à
ceux des roues dans lefquelles ils engrenent, comme
leur nombre à celui de ces dernieres , il s’enfuit que
les dents de lun & de l'autre font toujours égalés,
c ’eft-à-dire que la corde d’une dent du pignon doit
être égale à celle d’une dent de la roue ; or comme
dans les pendules & dans les montres, les roues font
ordinairement faites les premières , & que c’eft fur
leurs diamètres que fe déterminent ceux des pignons ,
il en réfulte qu’un nombre quelconque de dents de la
roue étant pris pour le diamètre du pignon, ce diamètre
en formant cétte analogie, 7 eft à 2.2 comme
le nombre des dents de cette roue eft à ce que je
cherche ; le quatrième terme qui viendra par cette
réglé de trois, fera le nombre du pignon : ou lorfque
le nombre eft donné en reriverfant cette analogie ,
& difant 1 1 eft à 7 comme le nombre du pignon eft à
c e que je cherche, on aura le nombre des dents de
la roue qu’il faudra prendre pour le diamètre du pignon.
Les" Horlogers cfifputent fouvent fur la véritable
groffenr despigno'ns & là maniéré de là prendre j
mais c’eft faute dé bien favoir de quoi il eft queftion,
car lorfqu’une fois le nombre d’un pignon &c d une
rouequi engrènent l’un dans Pâutre,font donnes auffi-
bien que le diamètre de la roue, le diametre^du pi-^
gnon l’eft aüflî invariablement, Sc ne peut etre ni
plus grand ni plus petit qu’une certaine grandeur,
puifque c'e's deux 'diaiiietres doivent etre entr eux
comme les nombres du pignon & de la roue. La feule
difficulté feroit au füjet de cette partie de furplüs dé
la roife & dü pignôti qui font arrondis ; mais quand
une fois les diamètres réels de l’un & de l’autre font
déterminés , if eft facile dé trouver celles-ci, car le
pignon né doit être ârrôridi que pour que les angles
des faces né foiènt pa$ trop aigus.
Pignon dé renvoi eft 'un pignon qui fert à communiquer
lé mouvement d’üne partie de l’horloge à une
autre , comme dü mouvement à la quadr'âture, &c.
Pignon du volant eft dans un rouage de fonnerie ou
de répétition, le dernier pignon dans les montres- à
P I L
'répétition ; oh le nommé délai. On l’appelle pignon
■ du volant, parce que dans les horloges, les pendules,
& quelquefois dans les montres, il porte lur fa tige
une piece à laquelle on donne le nom de volant.
Voyt{ V o l a n t , S o n n e r ie , &c.
P i g n o n , ( Arckitecl.) c’eft le haut d’un mur mitoyen
ou d’un mur de face, qui fe termine en pointe
& oîi vient finir le comble. Le pignon de la falle du
légat de l’hôteh-Dieu de Paris, très-orné de feupture,
eft un des plus grands qu’il y ait. Il a été bâti fous
François I. par ordre du cardinal Antoine Duprat.
Pignon à redents ; c’eft la tête d’uh comble a deux
égouts ;unpignon dont les côtés font par retraites en
maniéré de degrés, & qu’on faifoit anciennement
pour monter fur le faîte du comble, lorfqu’il en fal-
loit réparer la couverture. Cela fe pratique aujourd’hui
dans les pays froids , oîi les combles font fort
pointus, mais plutôt pour ornement que pour les
réparations.
Pignon tntrapeté; c’eft un bout de mur à la tête d’un
comble , dont le profil n’ eft pas triangulaire , mais
qui a cinq pans comme celui d’une manlarde, ou même
quatre comme Un trapeze.
PiGNON, ( Ckanvrerie.) ce mot fe dit de tout ce qui
fort du coeur du chanvre quand on l’apprête & qu’on
l’habille, en le paffant par les ferans.
P i g n o n , Ou P e i g n o n , (Lainage.) c’ eft une laine
de médiocre qualité, qui tombe de la laine fine iorti
qu’on la peigne avec les cardes & cardafles.il y a trois
fortes de pignons de laine, favoir de bons & fins pignons
, de moyens & de gros, qui chacun félon leur
qualité, peuvent être employés dans diverfes natures
d’étoffes de laine. Savary.
P i g n o n , (Serrurerie.) piece qui fert dans les ferrures
à faire mouvoir les verrous quand elles en ont,
& à ouvrir ôc fermer les doubles penes des cofres-
forts.
PIGNONNÉ , (Blafon.) il fe dit de la repréfenta-
tion d’un pignon de muraille, quife termine en pointe
par briques ou carreaux les uns fur les autres, en forme
de plufieurs montans ou efcaliers. Il porte d’argent
à un lion naiffant de fable, d’une campagne maçonnée
,pignonnée de deux montans de gueules. Dicl.
de TrevOux. (Z). J.)
PIGNORATIF, ( C o n t r a t ) adjeft. (Jurifprud.)
Voye[ au mot CO N T R A T , Carticle C o n t r a t PIGNO R
A T IF . (A )
PIGO, voyei Bise.
P1G O U , ou PICOU, f. m. (Marine.) c’eft une forte
de chandelier de fer à deux pointes, dont on fe fert
dans les navires, & qui eft fort propre à tenir une
chandelle. L’une de ces pointes eft pour piquer de
côté , & l’autre pour piquer debout.
PIGRIECHE, voyei P i e g r i e c h e .
PIKE , f. f. ( Mefure de longueur. ) mefure égyptienne
dont on diftingue deux efpeces ; le grand pike
& le petit pike. Le granàpihe autrement nommé pike
de Conftantinople, eft de 17 pouces d’Angleterre
; c’eft avec ce pike qu’on mefure toutes les mar-
ehandifes étrangères , excepté celles qui font faites
de laine & de coton ; on mefure ces dernieres avec
le petit pike, qu’on appell epike du pa ys, parce qu’on
s’én fért pour âuner toutes les manufaéhires du lieu ;
ee petit pike eft de 25 jU i pouces d’Angleterre. Po-
co c k , defeript. £ Egypte. (D . J.)
PILASTRE, f.m. (Arckit.) colonne quarrée, à laquelle
ori donne la même mefure, le même chapiteau
, la même bafe, & les mêmes ornemens qu’aux
autres colonnes, & cela fuivantles ordres. Lepila-
lire eft quelquefois ifolé ; mais il eft plus fouvent engagé
dans le mur. Dans cé fécond cas, on le fait for-
tir du tiers, du quart, du fixieme, ou de la huitième
partie de fa largeur, félon les ouvrages. On cannele
les piUJlres comme les colonnes, & on leur donne
fëpt cannelures dans chaque face dufuft.
Le pilaßre a la même origine que les Colonnes,
c’eft- à-dire, qu’il repréfente des arbres équarris. Voy.
C o l o n n e . Ce mot vient de l’italien pilaflro qui a là
même lignification.
Pilaßre attique. C ’eft un petit pilaßre d’une proportion
particulière , & plus courte qu’aucune de ceux
des cinq ordres. Il y a deux .fortes de yilaflres attaques
, de fimples, & de ravalés. On voit un modele
‘des premiers à la porte de l’hôtel de Jars, du deffein
de François Manfard , rue de Richelieu, à Paris ; &
un modele du fécond, au château de Verfailles.
Pilaßre bandé. Pilaßre q u i, à l’imitation des colonnes
bandées, a des bandes fur fon fuft, uni ,ou cannelé.
Tels font lespilaßrestofean de la galerie du Louvre
du côté de la riviere.
Pilaßre cannelé. C ’eft un pilaßre qui a des cannelures.
Pilaßre cciniré. Pilaßre dont le plan eft curviligne,
parce qu’il fuit le contour du mur circulaire d’unè
four ronde ou creufe, comme les pilaflres du chevet
d’une églife, d’un dôme, &c.
Pilaßre cornier ou angulaire. Pilaßre qui cantonne
l ’angle ou l’encôignure d’un bâtiment, comme au portail
du Louvre, par exemple.
Pilaßre cokpé. C’eft un pilaßre qui eft traverfé par
une impofte qui paffe par-dêfîus ; Ce qui fait un mauvais
effet. On en peut juger par les pilaflres ioniques
des portiques du château des Tuilleries. ,
Pilaßre dans l'angle. Pilaßre qui ne préfente qu’u-
tie encoignure, & qui n’a’ de faillie de chaque côté
■ que le fixieme ou le feptieme de fon diamètre. Il y a
de ces pilaflres au portail du Louvre.
Pilàfire de rampe. On appelle ainfi tous 1 espiläßres
& hauteur d’appui, qui ont quelquefois des bafes &
des chapiteaux, & qui fervent à retenir les travées
des baluftres, des rampes d’efcàliers, & des balcons.
Pilàfire diminué. C ’eft un pilaßre qui étant dèrrier e
©u à côté d’une colonne, en retient le même contour
, & eft diminué par le haut, pour empêcher qu’il
n’excéde l’aplomb de l’entablement. Tel eft le portail
de l’églife de S. Gervâis, & celui du collège Mazàrin,
à Paris.
P Haßte doublé. Pilaßre formé dé deux pilaflres entiers,
qui fe joignent a angles droits & rentrans, &
qui ont leurs bafes & leurs chapiteauxconfonduSjeom-
ine , par exemple , les pilaflres corinthiens au grand
fall on de Clagny, ou en angle obtus , tels que ceux
qui font derrière les huit colonnes corinthiennes du
dedans de l’églife des Invalides.
Pilaßre èbrafè. Pilaßre plié en angle obtus, par fu-
jétion d’un pan coupé , comme on le pratique aux
églifes qui ont un dôme fur leurs eroifées.
. Pilaßre engagé. C’eft un pilaßre q ui, quoique placé
derrière une colonne auquel elle eft adofl.ee, n’en
fuit cependant pas le contour ; mais qui eft contenu
entre deux lignes paralleles, & a fa bafe & fon chapiteau
CÔnfondus avec ceux de la colonne. Tels font
les pilaflres des quatre chapelles d’encoignure dé l’églife
des Invalides.
Pilaßre en gaine de terme. Pilaßre qui eft plus étroit
par le bas que par le haut. C ’eft ainfi que font les
grands pilaflres ruftiques de la haute terraffe de Meu-
don.
Pilaßre flanqué. Pilaßre accompagné de deux de-
mi-pilaflres avec une médiocre faillie. Tels fpnt les
pilaßres conrinthiens de l’églife de S. André délia
Valle, à Rome.
Pilaßre grêle. Pilaßre placé derrière une colonne,
& qui eft plus étroit qu’il ne devroit être, s’il çtoit
proportionné à cette colonne, parce qu’il n’a de largeur
parallele que le diamètre de la diminution de la
colonne, pour éviter un reffaut dans l’entablement.
Tome X I I .
P I L . |||
K y a dés pilaflres grêlés à l’ordre dorique du gfos pavillon
du château de Clagny, & au grand, portail dé
l’églifê de S. Louis des Invalides.
On nomme auflî pilaßre grêle un pilaßre qui a dé
hauteur plus de diamètre que.le carattere de fon ordre.
C’eft ainfi que font les pilaflres grêles corinthiens
de l’églife des religieufes Feuillantines du fauxbourg
S. Jacques, à Paris, quiont plus de douze diamètres,
au lieu qu’ils devroient n’en avoir que dix.
Pilaßre lié. On peut àppeller ainfi non-feulement
un pilaßre qui eft joint à une colonne par une languette,
comme le cavalier Bernin l’a pratiqué à la colonnade
de S. Pierre de Rome; .mais encore les pi-
laflres qui ont quelques parties de lëurS bafes & de
leurs chapiteaux jointes enfemble. On a des pilafire's
doriques de cette efpèce au portail des Minimes de
la place royale ,.à Paris.
Pilafireplié. Pilaßre qui eft partagé en deux moitiés
dans un angle rentrant. Il y a de ces pilaflres
.dans les angles de la place de Louis le Grand, à
Paris.
Pilaßre rampant. Il y a deux pilaflres ainfi nommés.
Le premier, quoiqu’à plomb, üiivant la rampe
d’un efcalier, fe trouve d’équerre fur les paliers, &
fert pour la décoration des murs de la cage , ou de
l’échiffre. Le fécond pilaßre eft affujetti par quel-
qti’àutre pente. De cette derniere efpeçe de pilàfire
rampant, font les pilaflres doriques des alles qui communiquent
la colonade avec le portail de S. Pierre de
Rome..
Pilaßre ravalé. C ’eft un pilàflrt dont le parement
eft refouillé & mcmfté d’une table de marbre bordée
d’uné moulure, ou avec des ornemens, comme on
en v o it, par exemple, aux pilaflres des arcs des orfèvres
, ou avec des compartimens en relie f, ou dé
marbre de diverfes couleurs. Il y a aux chapelles
Sixte & Pauline de fainte Marie Majeure, à Rome,
des pilaflres ravalés de cette fécondé efpéce.
Pilaßre Tùienté. Pilaßre dont les cannelures font
remplies jufqu’au tiers d’une redenture , comme les
pilaflres de la grande galerie du Louvre , ou d’uné
ru denture plate , tël que ceux du Val-de-Grace, à
Paris ; ou enfin ‘d’ornemens femblables à ceux des
colonnesrudentées.
Pilaflres accouplées. Pilaflres qui fôht deux-à-d eux;
Tels font les pilaflres compofites de la grande galerie
du Louvre. D i cl. d'arckitecl. (D. J.)
P i l a s t r e de fer, (Serrur.) c’eft le nom qu’on don-1
ne à certains montans à jour, qu’on met d’efpace en
efpace > pour entretenir les travées des grilles avec
des ornemens convenables. Tels font,par exemple,
les pilaflres des grilles du château de Verfailles & de
fes écuries. ( D . J . ) .
P i l a s t r e de lambris, (Menuif.) efpece de montant
, ordinairement ravalé entre les panneaux de
lambris d’appui & de revêtement.
P i l a s t r e de vitre , (Vitré) efpece de montant de
verre qui a bafe & chapiteau , avec des oînemens
peints, & qui termine les côtes de la forme d’un vitrail
d’églife.
P i l a s t r e de treillage , (Jardinage.') corps d’archi-
tefture long & étroit, fait d’échalas en compartiment
, pour décor.er les portiques & cabinets de treillage
dans les jardins.
P i l a s t r e , (Àntiq. rom.) entre les fépulchres médiocres
des Romains, on y comprend lés pilaflres &:
les coffres, qui ont fervi pour des perfonnes d’uné
condition Ordinaire, & quelquefois pour des princes
même. Ces pilaflres font ou ronds ou quarrés.
Pline appelle les pilaflres quarrés qui font de pierre ,
fielas lapidèas. De la première efpece eft le gros pilier
du tombeau de Pacuvius, qui fe trouve encore
à Rome , tel qu’il nous £ft repréfenté; dans le livre
des tombeaux de Fondt , graveur polonois. Ce pi