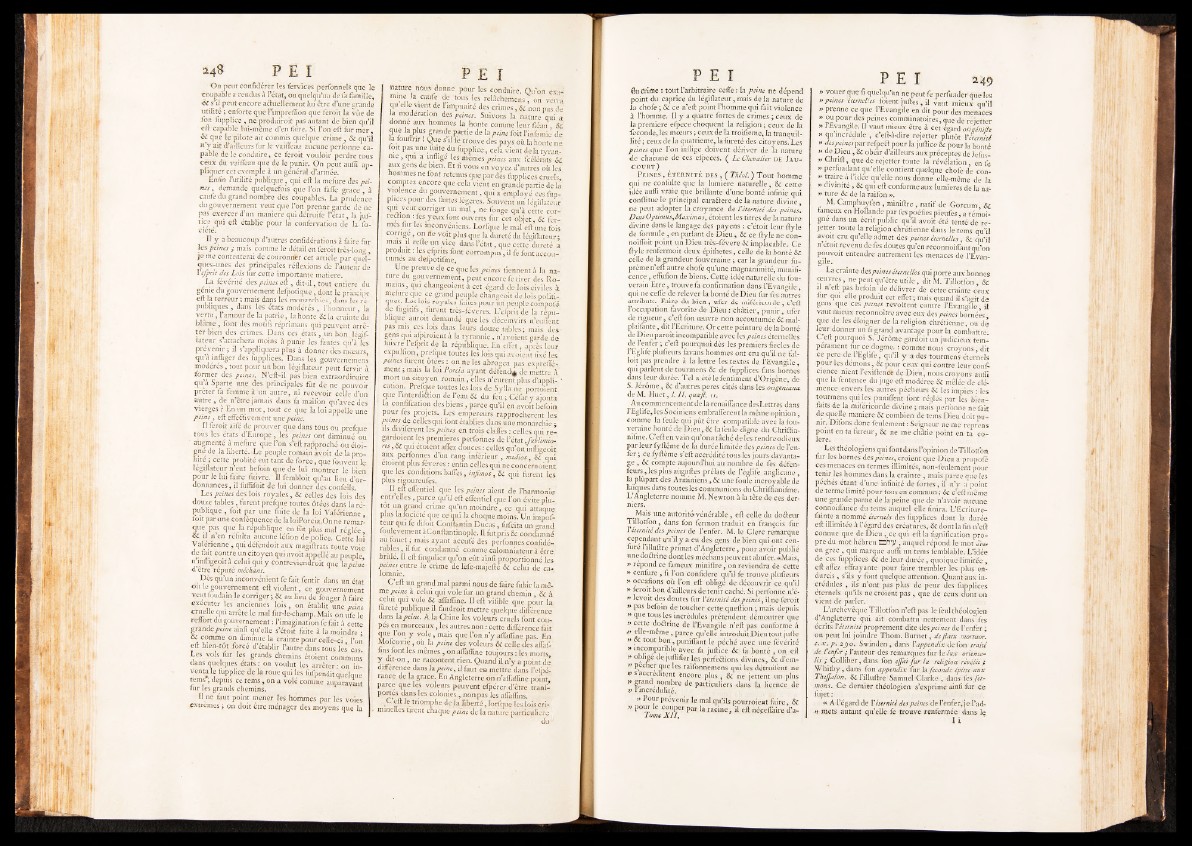
On peut conîidérer les fervices perfonnels que le
eoupgble a rendus à l’état, ou quelqu’un de fa famille,
Sc s’il peut encore afluellement lui être d’une grande
utilité ; enforte que l’impreffion que feroit la vue de
fon fupplice , ne produirait pas autant de bien qu’il
eft capable lui-même d’en faire. Si l’on eft fur m er,
que le pilote ait commis quelque crime , & qu’il
n’y ait d’ailleurs fur le vaiffeau aucune perfonne capable
de 1 e conduire ,.ce feroit voulôir perdre: tous
ceux du vaiffeau que de le punir. On peut auflî appliquer
cet exemple à un général d’armée.
Enfin l’utilité publique, qui cil la inclure des pci-
ms , demande quelquefois que l’on faffe grâce '’ à
caufe du grand nombre des coupables. La prudence '
du gouvernement veut que l ’on prenne garde de né
pas exercer d’un maniéré qui dëmiife 1 état, la iul-
tieg qui eft établie pour la confervation de la- ib-
cieté.
Il y a beaucoup d’autres confîdératibns à taire fur
lés peines ; mais comme le détail en feroit très-long
Ie mü contenterai de couronner cet article par quelques
unes des principales réflexions de l’auteur de
ïijprit des Lois mr celte importante màtieré.
La feverite des peines eu:, dit-il , tout entière du
génie du gouvernement despotique, dont le principe
eS la terreur ; mais dans les monarchies, dans les r é -’
publiques , dans les états modérés , l’honneur, la
vertu, l’amour de la patrie, la honte & la crainte du
blâme, font des motifs réprimans qui peuvent arrêter
bien des crimes. Dans ces états, un bon légitiment
s’attachera moins à punir les fautes qu’à les
prévenir ; il s’appliquera plus à donner dés moeurs,
qu’à infliger des fupplicêi Dans tes gouvernémens
modérés, tout pour un bon légiflateur peut fervir à
former des peines. N’clf-il pas bien extraordinaire
qu’à Sparte une des principales fut de ne pouvoir
prêter fa femme à un autre, ni recevoir celle d’un'
autre , de n’être jamais dans Ta màifon qii’avec des
vierges ? En un mot, tout çe qué la loi appelle une
peine , eft effeflivement une peine.
Il feroit aifé de prouver que dans tous ou prefque
tous les états d’Europe, les peines ont diminué ou
augmenté à mefitre que l’on s*étt rapproché oit éloi-
gné de la liberté. L e peuple romain avoit de la probité
; cette probité eut tant de force, que fôuvent le
légiflateur n’eut befoin que de lui montrer le bien
pour le lui faire fiiivre. Il fembloit qu’au lieu d’ordonnances
, il fttffifoit de lui donner dis confeils.
L os peines des lois royales, & celles dès lois des
douze tables, furent pfefquè toutes ôtées dans la république
, foit par une fuite de la loi Valéricmie
loit par une coirfécjuen’ée de laloiPôrcia.Oh ftè remar-'
que pas que la republique; en fut plus mal réglée
& il n’en réfulta aucune léfion de police. Cette lot
Valéricnne, qui défendoit aux magiftrats toute voie
de fait contre un citoyen qui avoit appelle au peuple
n’infligeoità celui qui y eontfeviendroit qtieTapeine
d’être réputé méchant,
, Dès qu’un inconvénient fe fait fentir dans un état
ou le gouvernement eft v iolent, ce gouvernement
veut lointain le corriger ; & au lieu de longer à faire
exécuter les anciennes lo is , on établit une peine
S S f B arrête le mal fur-le-champ. Mais on uie le
reffort du gouvernement : l’imagination fe fait à cette
grande peine àinii qu’elle s’étoit faite à la moindre •
& comme on diminue la crainte pour celle-ci l’on
eft bieri-tôt forcé d’établir l’autre dans tous lès/ cas
Les vols fur les grands chemins étaient communs
dans quelques états: on voulut les arrêter: On inventa
le fupplice de la roue qui les fufpendit quelque
rems ; depuis ce teins, on a volé comme auparavant
fur les grands chemins.
Il ne faut point mener les hommes par les voies
extrêmes ; on doit être ménager des moyens que la
nature nous donne pour les conduire. Ou’ori exa-‘
1 la .caule * tous les relâchemens, on verra
qu elle vieiit de l’impunité des crimes, & non pas dé
la modération des peines. Suivons la nature qui a
donne aux hommes la honte comme leur fléau 8c
que lapins grande partie de la peine foit l’infamie’ de
la louttrir . Que s’il fe trouve des pays, oîi la honte ne
loit pas une fuite du fupplice, cela vient delà tyrannie
, qui a inflige les memes peines aux fcéiérats &
aux gens de bien. Et ii vous en voyez d’autres oii les
hommes ne font retenus que par dés fupplices cruels,
comptez encore que cela vient en grande partie de la
violence du gouvernement, qui a employé ces fup-
plices pour des fautes légères. Souvent un légiflateur
I <ïlIÀ.veu t50rriger MM mal, ne fonge qu’à cette cor-
retnon : fes yeux font ouverts fur cet objet, 8c fermes
fur les inconvéniens. Lorfque le mal eft une fois
corrige, on rte voit plus que la dureté du légiflateur;
mais il refte un vice dans l’état, que cette.dureté a
produit : les efpnts font corrompus, il fe font accoutumes
au delpotifme,
Une preuve de ce que les'peines tiennent à la nature
du gouvernement, peut encore fe tirer des Romains,
qui changeoient à cet égard de lois civiles à
meiure que ce grand peuple changeoit de lois politi-
ques. Les lois royales faites pour un peuple, compofé
d£ fugitifs, furent très-féveres. L’efpritde la république
auroit demandé que les décemvirs n’euflent
. pas mis ces lois dans leurs douze tables; mais des
gens qui afpiroient à la tyrannie, n’avoient garde de
liuvre l’efprit de la république. En effet, après leur
expulfion, prefque toutes les lois qui avoient fixé les
peines furent ôtées : on ne les abrogea pas expreffé-
ment ; mais la loi Porcia ayant défend^ de mettre à
mort un citoyen romain, elles n’eurent plus d’appli- *
cation. Prefque toutes, lés lois de SyJla ne portoient
, que 1 interdiction de l’eau 8c du feu ; C é fary ajouta
la confifeation des biens, parce qu’il en avoit befoin
pour fes projets. Les empereurs rapprochèrent les
peines de celles qui font établies dans une monarchie ;
ils diviferent. les peines en trois claffes : celles qui regardaient
les premières perfonnes de l’état Jublimio-
res, & qui étoient affez douces : celles qu’on infligeoit
aux perfonnes d’un rang inférieur , medios, 8c qui
etoient plus feveres : enfin celles qui ne concernoient.
que les conditions baffes, injîmos, 8c qui furent les
plus rigoureufes.
H? e“ effentiel que les peines aient de l’harmonie
entr’elles, parce qu’il eft effentiel que l’on évite plu-
tot un grand crime qu’un moindre, ce qui attaque
plus la fociete que ce qui la choque moins. Un impof-
teur qui fe difoit Conftantin D iicas, fufeita un grand
: foulevement àConftàntinople. Il flitpris 8c condamné
? M w n I mais ay ant accufé des perfonnes confidé-
rables ,ilfut condamné comme calomniateur à être,
brillé. Il eft fingulier qu’on eut ainfi proportionné les
peines entre le crime de lèfe-majefte 8c celui de calomnie.
C ’eft un grand mal parmi nous de faire fubir la mê-
me peine à celui qui vole fur un grand chemin & à
celui qui-vole 8c aflafline. Il eft vifible que pour la,
fureté publique il faudrait mettre quelque différence
dans h peine. A la Chine les voleurs cruels font coupes
en morceaux, les autres non : cette différence fait
que l’on y v o le , mais que l’on n’y aflafline pas. En
Molcovie, oii^la peine clés voleurs 8c celle clés affaf-
fjns font les memes , on aflafline toujours : les morts
y d it -o n , ne racontent rien. Quand il n’y a point de
différence dans la peine,, il faut en mettre dans l’efpé-
rance de la grâce. En Angleterre on n’affaflïne point,
parce que les voleurs peuvent efpérer d’être tranf-
portes dans les colonies, non pas les affaffins.
C’eft le triomphe de la liberté, lorfque les lois criminelles
tirent chaque peine de la nature particulière
' du ■'
flu crime : tout l’arbitraire ceffe : la peine ne dépend
point du caprice du légiflateur , mais de la nature de
la chofe ; 8c ce n’ eft point l’homme qui fait violence
à l’homme. Il y a quatre fortes de crimes ; ceux de
la première efpece choquent la Religion ; ceux de la
fécondé, les moeurs ; ceux de la troifieme, la tranquillité
; ceux de la quatrième, la fureté des citoyens. Les
peines que l’on inflige doivent dériver de la nature
de chacune de ces efpeces. ( Le Chevalier de Jau-
co u r t )
Peines , éternité des , ( Thiol. ) t o u t homme
qui ne confulte que la lumière naturelle, & cette
idée aufli vraie que brillante d’une bonté infinie qui.
conftitue lé principal caraflere de la nature divine
ne peut adopter la croyance de l'éternité des peines.
DeusOptimuSjMaximus, étoient les titres de la nature
divine dans le langage des payens : c’étoit leur ftyle
de formule , en parlant de D ieu , & ce ftyle ne con-
noiffoit point un Dieu très-févere & implacable. Ce '
ftyle renfermoit deux épithetes, celle de la bonté 8c I
celle de la grandeur fouveraine ; car la grandeur fu-
prème n’eft autre chofe qu’une magnanimité, munificence
, effufion de biens. Cette idée naturelle du fou-
verain Etre, trouve fa confirmation dans l’Evangile
qui ne ceffe de relever la bonté de Dieu fur fes autres
attributs. Faire du bien, ufer de miféricorde , c’eft
l’occupation favorite de Dieu : châtier, punir, ufer
de rigueur, c’eft fon oeuvre non accoutumée 8c mal-
plaifante, dit l’Ecriture. O r cette peinture de la bonté
de Dieu paroît incompatible avec les peines éternelles
dé l’enfer ; c’eft pourquoi dès les premiers fiecles de
l’Eglife plufieurs favans hommes ont cru qu’il ne fal-
loit pas prendre à la lettre les textes de. l’Evangile,
qui parlent de tourmens & de fupplices fans bornes
dans leur durée. Tel a é téle fentiment d’Origène, de
S. Jérôme, 8c d’autres peres cités dans les origeniana
de M. Huet, L. II. quoefl. n.
Au commencement de la renaiffance desLettres dans
l’Eglife, les Sociniens embrafferent la même opinion,
comme la feule qui pût être compatible avec la fouveraine
bonté de Dieu, & la feule digne du Chriftia-
nifme. C ’eft en vain qu’ona tâché de les rendre odieux
par leur fyftême de la durée limitée des peines de l’enfer
; ce fyftème s’eft accrédité tous les jours davantage
, & compte aujourd’hui au nombre de fes défen-
leure, les plus aûguftes prélats de l’églife anglicane ,
la plupart des Arminiens, 8c une foule incroyable de
laïques dans toutes les communions duChriftianifme.
L’Angleterre nomme M. Newton à la tête de ces derniers.
Mais une autorité-vénérable, eft celle du do fleur
Tillotfon, dans fon fermon traduit en françcis fur
1 eternite des peines de l’enfer. M. le Clerc remarque
cependant qu’il y a eu des- gens de bien qui ont cen-
fure l’illuftre primat d’Angleterre, pour avoir publié
une doftrine dont les méchanspeuvent abufer. «Mais,
» répond ce fameux miniftre, on reviendra de cette
» cenfure, fi l ’on confidere qu’il fè trouve plufieurs
» occafions oii l’on eft oblige de découvrir ce qu’il
» feroit bon d’ailleurs de tenir cachée Si perfonne n’é-
» levoit des doutes fur Y éternité des peines, il ne feroit
» pas befoin de toucher cette queftion ; mais depuis
» que tous les incrédules prétendent démontrer que
» cette doflrine de l’Evangile n’eft pas conforme à
p elle-même, parce qu’elle introduit Dieu tout jufte :
» oc tout bon, puniffant le péché avec, une févérité
» mcompatible avec fa juftice 8c. fa bonté , on eft
» oblige de juftifier les perfeflions divines, 8c d’em-
» pecher que les raifonnemens qui les détruifent ne
o s accréditent encore plus, 8c ne jettent un plus i
i> grand nombre de particuliers dans la licence de ■
y 1 mereduhté.
» Pour prévenir le mal qu’ils pourroient faire, &
” P0^ e cJ l‘Per P « la jacine, il eft néceffaire d’a-
Tome XIJ,
w vouer que fi quelqu’un ne peut fie perfiiadei- que les
« pcims Humatts-.-Usât juftes , il vaut mieux qu’il
» prenne ee que l’Evangile en dit pour des menaces
i ».Ou pour des peines comminatoires, que de rejette»
. » tEvangile. 11 vaut mieux être à cet égard originilit
: » qu incrédule -, e’eft-à-dire rejetter plutôt l'éternité
■ « despeinesparrefpeft pour la juftice & pour la bonté
» de D ieu , & obéir ("ailleurs aux préceptes' de Jefus-
\ » Chrift, que de rejetter toute -la révélation, eii lé
» persuadant cpTelle contient quelque chofe de
* trairevà l’idee qu’elle nous donne elle-même de la
» divinité, & qui eft conforme aux lumïereside là âa:
» ture 8c de la raifon ».
M. Camphuyfen , miniftre , natif de Gorcum &
fameux en Hollande par fespoéfies pieufes, a témoigne
dans un écrit public qu’il avoit été tenté de rejetter
toute la religion chrétienne dans le tems qu’il
avmt cru qu’elle admet des peines éternelles, & qU’il
n etoit revenu de fes doutes qu’en reconnoiffant qu’on
pouvoit entendre autrement les menaces de l’Evangile.
La crainte des peines éternelles qui porte aux bonnes
oeuvres, ne peut qu’être utile, dit M. Tillotfon, 8c
il n elt pas befoin de délivrer de cette crainte-ceux
lur qui elle produit cet effet; mais quand ils’arit de
gens que ces peines^révoltent contre l’Evangile, il
vaut mieux reconnoître avec eux des peines bornées
que de les éloigner de la religion chrétienne, ou de
leur donner un fi grand avantage pour la combattre.
C ’eft pourquoi S. Jérôme gardoit un judicieux tempérament
fur ce dogme. : comme nous croyons, dit
.ce pere de l’Eglife, qu’il y a des tourmens éternels
pour les démons, & pour ceux qui contre leur confidence
nient Pexiftence de Dieu, nous croyons aufli
que la fentence du juge eft modérée 8c mêlée de clémence
envers les autres pécheurs 8c les impies : les
tourmens qui les puniffent font réglés par les bienfaits
de la miféricorde divine ; mais perfonne ne fait
de quelle maniéré & combien de tems Dieu doit punir.
Difons donc feulement : Seigneur ne me reprens
point en ta fureur, 8c ne me châtie point en ta colère.
Les théologiens qui font dans l’opinion de Tillotfon
fur les bornes des peines, croient que Dieu a propofé
ces menaces en termes illimités, non-feulement pour
tenir les hommes dans la crainte , mais parce que les
péchés étant d’une infinité de fortes, il n’y a point
de terme limité pour tous en commun ; & c’eft même
une grande partie de la peine que de n’avoir aucune
connoiflànce du tems auquel elle finira. L’Ecriture-
fainte a nommé éternels des fupplices dont la durée
eft illimitée à l’égard des créatures, 8c dont la fin n’eft
connue que de D ie u , ce qui eft la fignifîcation propre
du mot hébreu o S ’y , auquel répond le mot «î«r
en grec , qui marque aufli un tems femblable. L’idée
de ces fupplices & de leur durée, quoique limitée ,
.eft affez effrayante pour faire trembler les plus endurcis
, s’ils y font quelque attention. Quant aux incrédules
, ils n’ont pas pliis de peur des fupplices
éternels qu’ils ne croient pas , que de ceux dont on
vient dé parler.-
L’archevêque Tillotfon n’eft pas le feul théologien
d’Anglëterre qui ait.combattu nettement dans fes
écrits l'éternité proprement dite des peines de l’enfer ;
on peut lui joindre Thom. Burnet, defiàtu mortuor.
c. x . p.:2go. Swinden y dans l'appendix àe fon traité
de C enfer i l’auteur des remarques fur le lux orienta-
lis } Colliber, dans fbn ejfai fur la religion révélée y
Whitby, dans fon appendix fur. la féconds èpitre aux
Theffalon. 8c l’illuftre Samuel Clarke , dans fes ferr
nions. Ce dernier théologien s’exprime ainfi fur ce
fujet :
« A l’égard de Yéternité des peines de l’enfer,jeil’ad-
» mets autant qu’elle fe trouve renfermée dans le
U