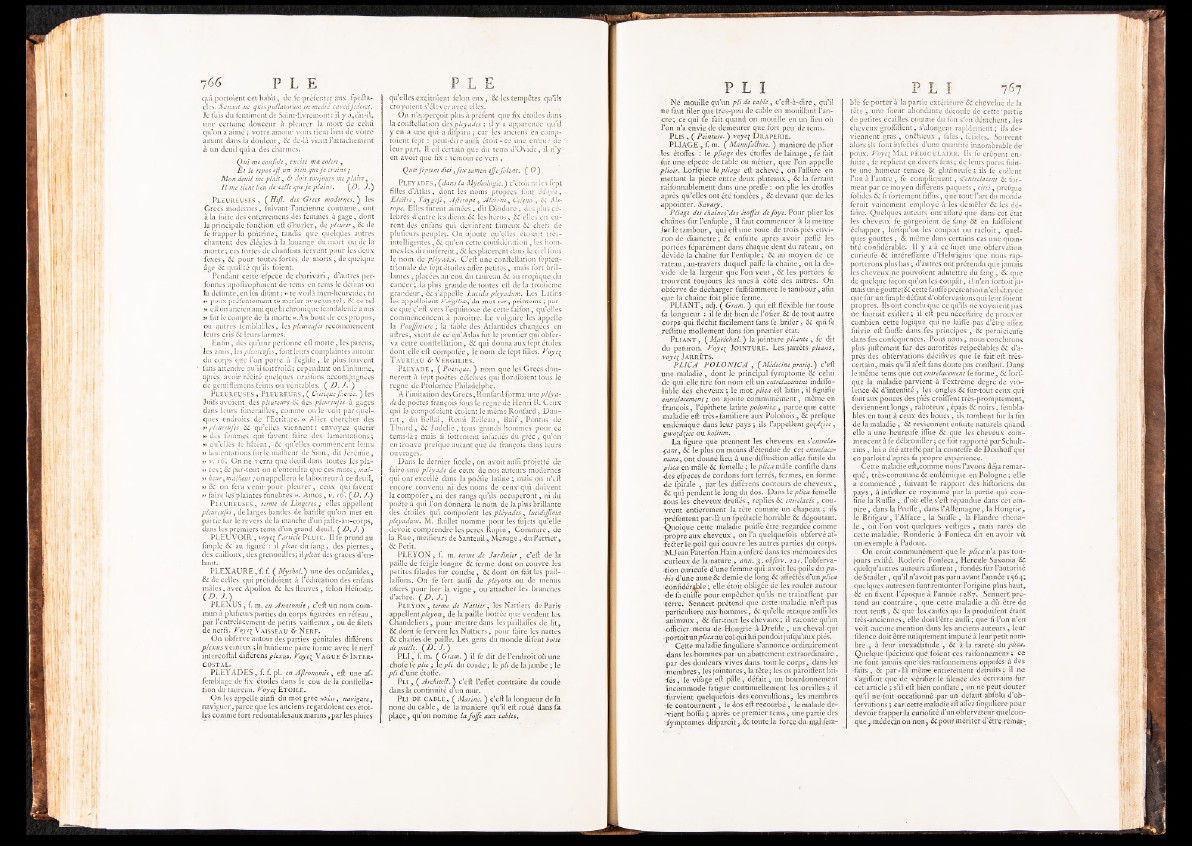
qui portoient cet habit, de fe préfenter.aux fpe£ta-
cles. Sanxit ne quis pullatorum in mediiî caveâJederet.
Je fuis du fentiment de Saint-Evremont : il y a, dit-il,
une certaine douceur à pleurer la mort de celui
qu’on a aimé ; votre amour vous tient lieu de votre
amant dans la douleur, 6c de-là vient l’attachement
à un deuil qui a des charmes.
Qui me confole, excite ma colere,
E t Le repos eß un bien que je crains ;
Mon deuil me plaît, & doit toujours me plaire,
I l me tient lieu de celle que je plains. (D . J.)
Pl e u r e u s e s , (Hiß . des Grecs modernes.') les
Grecs modernes, luivant l’ancienne coutume, ont
à la fuite des enterremens des femmes à gage, dont
la principale fonction eft d’hurler, de pleurer, & de
fe frapper la poitrine, tandis que quelques autres
chantent des élégies à la louange du mort ou de la
morte ; ces fortes de chanfons fervant pour les deux
fexes, 6c pour toutes fortes de morts, de quelque
âge 6c qualité qu’ils foient.
Pendant cette efpece de charivari, d’autres per-
fonnes apoftrophoient de tems en tems le défunt ou
la défunte, en lui difant : <» te voilà bien-heureufe; tu
» peux préfentement te marier avec un tel ; & ce tel
» eft un ancien ami que la chronique fcandaleule a mis
» furie compte de la morte ».Au bout de ces propos,
ou autres fembîables, les pleureufes recommencent
leurs cris 6c leurs larmes.
Enfin, dès qu’une perfonne eft morte, les parens,
les amis, les pleureufes, font leurs complaintes autour
du corps que l’on porte à l’églife, le plus fou vent
fans attendre qu’il foit froid; cependant on l’inhume,
après avoir récité quelques oraifons accompagnées
de gémifl’emens feints ou véritables. ( D . J . )
P leu re use s , Pleu r e u r s , ( Critiquefacrée. ) les
Juifs avoient des pleureurs 6c des pleureufes à gages
dans leurs funérailles, comme on le voit par quelques
endroits de l’Ecriture. « Allez chercher des
» pleureufes 6c qu’elles viennent : envoyez quérir
» des femmes qui fa vent faire des lamentations ;
» qu’elles fe hâtent, 6c qu’elles commencent leurs
» lamentations fur le malheur de Sion, dit Jérémie,
» v. iG. On ne verra que deuil dans toutes lespla-
» ces ; 6c par-tout on n’entendra que ces mots, mal-
» heur, malheur ; on appellera le laboureur à ce deuil,
» 6c on fera venir pour pleurer, ceux qui favent
» faire les plaintes funèbres ». Amos, v. iG. ( D . J.)
Pleu reuse s , terme de Lingeres ; elles appellent
pleureufes, de larges bandes de batifte qu’on met en
partie fur le revers delà manche d’un jufte-au-corps,
dans les premiers tems d’un grand deuil. ( D . J. )
PLEUVOIR, voyeç Üarticle Pluie. Il fe prend au
fimple 6c au figuré : il pleut du fang, des pierres,
des cailloux, des grenouilles; il pleut des grâces d’en-
haut.
PLEXAURE, f. f. ( Mythol.) une des océanides,
6c de celles qui préfidoient à l’éducation des enfans
mâles, avec Apollon & les fleuves, félon Héfiode.
W M È
PLEXUS, f. m. en Anatomie, c’eft un nom commun
à plufieurs parties du corps figurées en réfeau ,
par l’entrelacement de petits v a iffe au x , ou de filets
de nerfs. Foyt{ V a is se au & N e r f .
, On obferve autour des parties génitales différens
p lm.kj veineux ;la huitième paire forme avec le nerf
intercoftal différens plexus. Poye^ V a g u e & In t er c
o s t a l .
PLEYADES, f. f. pl. en Aßronomie, eft une af-
fembiage de fix étoiles dans le cou de la conftellation
du taureau. Voye[ Et o il e .
On les appelle ainfi du mot grec »x*V, navigare,
naviguer,parce que les anciens regardoient ces étoiles
comme fort redoutablesaux marins, par les pluies
qu’elles excitoient félon eu x, 6c les tempêtes qu’ils
croyoient s’élever avec elles.
On n’apperçoit plus à préfent que fix étoiles dans
la conftellation des pleyades : il y a apparence qu’il
y en a une qui a difparu ; car les anciens en comp-
toient fept : peut-être aufii étoit - c e une erreur de
leur part. Il eft certain que du tems d’Ovide, il n’y
en avoit que fix : témoin ce v ers,
Quoe feptem dici ,f e x tamen ejje foient. ( O )
Pl e y a d e s , ( d a n s la M y th o log ie .) c’étoicntlesfept
filles d’Atlas, dont les noms propres font M a y a ,
E le c tr e , T a ygefe, Afierope , A lc ia n e , Celeno , 6c Me-
rope. Elles furent aimées , dit Diodore , des plus célébrés
d’entre les dieux 6c les héros, 6c elles-en eurent
des enfans qui devinrent fameux 6c chefs de
plufieurs peuples. On ajoute qu’elles étoient très-
intelligentes , 6c qu’en cette confidération, les hommes
les diviniferent, 6c les placèrent dans le ciel fous
le nom de pleyades. C’eft une conftellation fepten-
trionale de fept étoiles affez petites, mais fort brillantes
, placées au cou du taureau 6c au tropique, du
cancer ; la plus grande de toutes eft de la troifieme
grandeur, 8c s’appelle L u c id a pleyadum. Les Latins
les appelloient Vergilice, du mot v e r , printems ; parce
que c’eft vers l’équinoxe de. cette faifon, qu’elles
commencencent à paroître. Le vulgaire les appelle
la Pouffîniere ; la fable des Atlantides changées en
aftres, vient de ce qu’Atlas fut le premier qui obfer-
va cette conftellation, 6c qui donna aux fept étoles
dont elle eft compofée, le nom de fept filles. Voyeç
T a u r e a u & V e r g il ie s .
Pl e y a d e , ( Poétique. ) nom que les Grecs donnèrent
à fept poètes célébrés qui florifloient fous le
régné de Ptolomée Philadelphe.
A l’imitation des Grecs, Ronfard forma une pléya-
de de poètes françois fous le régné de Henri IL Ceux
qui la compofoient étoient le même Ronfard, Dau-
r a t , du Bellai, Remi Belleau, Baïf , Pontus de
Thiard , 6c Jodelle , tous grands hommes pour ce
tems-là ; mais fi fortement infatués du grec , qu’on
en trouve prefque autant que de françois dans leurs
ouvrages.
Dans le dernier fiecle, on avoit aufii projetté de
faire une pléyade de ceux de nos auteurs modernes
qui ont excellé dans la poéfie latine ; mais on n’eft
encore convenu ni des noms de ceux qui doivent
la compofer, ni des rangs qu’ils occuperont, ni du
poète à qui l’on donnera le nom de la pius brillante
des étoiles qui compofent les pleyades, lucidijjîma
pleyadum. M. Baillet nomme pour les fujets qu’elle
devoit comprendre les peres Rapin , Commire, de
la Rue, meilleurs de Santeuil, Ménage, du Perrier ,
6c Petit.
PLE YON, f. m. terme de Jardinier, c’eft de la
paille de feigle longue & ferme dont on couvre les .
petites falades fur couche , & dont on fait les pail-
laflons. On fe fert aufii de pleyons ou de menus
ofiers pour lier la vigne, ou attacher les branches
d’arbre. (D . J .)
Pl e y o n , terme de Nattier, les Nattiers de Paris
appellent pleyon, de la paille bottée que vendent les
Chandeliers , pour mettre dans les paillafîes de lit,
6c dont fe fervent les Nattiers, pour faire les nattes
6c chaifes de paille. Les gens du monde difent botte
de paille. ( D . J. )
P L I, f. m. ( Gram. ) il fe dit de l’endroit oîi une
chofe fe plie ; le pli du coude ; le pli de la jambe ; le
pli d’une étoffe.
Pli , ( Architecl. ) c’eft l’effet contraire du coude
dans la continuité d’un mur.
P li d e c a b l e , ( Marine. ) c’eft la longueur de là
noue du cable, de la maniéré qu’il eft roué dans fit
place, qu’on nomme La foffe aux cables.
Ne mouille qu’un pli de cable, c’eft-à-dire, qu’il
ne faut filer que très-peu de cable en mouillant l’ancre;
ce qui fe fait quand on mouille en un lieu où
l’on n’a envie de demeurer que fort peu de tems.
P l i s , ( Peinture. ) voye[ DRAPERIE.
PLIAGE, f. m. ( Manufacture. ) maniéré de plier -
•les étoffes : le pliage des étoffes de lainage, fe fait
fur une efpece de.table ou métier, que l’on appelle
plioir. Lorfque le pliage eft achevé, on l’afliire en
mettant la piece entre deux plateaux, 6c la ferrant
raifonnablement dans une preffe : on plie les étoffes
après qu’elles ont été fondées, 6c devant que de les
appointer. Savary.
Pliage des chaînesjies étoffes de foye. Pour plier les
chaînes fin l’enfuple, il faut commencer à la mettre
fur le tambour, qui eft une roue de trois piés environ
de diamètre; 6c enfuite après avoir pafle les
portées féparément dans chaque dent du rateau, on
dévide la chaîne fur l’enfuple ; 6c au moyen de ce
rateau, au-travers duquel .pafle la chaîne, on la dévidé
de la largeur que l’on v eu t , 6c les portées fe
trouvent toujours les unes à côté des autres. On
obferve de décharger fuflifamment le tambour, afin
que la chaîne foit pliée ferme.
PLIANT, adj. ( Gram. ) qiii eft fléxible fur toute
fa longueur : ilfe dit bien de l’ofier 6c de tout autre
corps qui fléchit facilement fans fe brifer, 6c qui fe
.reftitue mollement dans fon premier état.
Pliant >, ■ ( Maréchal. )-la jointure pliante , fe dit
du paturon. V.oye^ Jointure. Les jarrets plians,
voye^ Jarrêt s.
PLICA POLONICA , (Médecinepratiq.) c’eft
une. maladie , dont le principal fymptome & celui
de qui elle tire, fon nom eft un entrelacement indiffo-
■ luble des cheveux ; le mot plica eft latin, il fignifie
entrelacement ; on ajoutevCommunément, même en
françois, l’épithete latine polonica , parce que cette
•maladie eft très - familière aux Polonois, 6c .prefque
^endémique dans leur pays ; ils l’appellent go^dftec,
gwo\d{iec ou kolium.
La figure que prennent les cheveux en.s’entrelaçant,
6c le plus .ou moins d’étendue de cet entrelacement
ont donné lieu à une diftinètion affez futile du
plica en mâle 6c femelle ; le plica mâle confifte dans
•des efpeees de cordons fort ferrés, fermes, en forme
-de fpirale , par.les différens contours de cheveux ,
6c qui pendent le long du dos. Dans le plica femelle
itous-les cheveux drefîes., repliés 6c entrelacés., couvrent
entièrement la tête, comme un chapeau ; ils
-préfentent par-là un fpeftacle horrible .6c dégoûtant.
-Quoique cette maladie puifle être regardée comme
-propre aux cheveux, on Ta quelquefois obferve afi-
fefter le-poil qui couvre les autres .parties - du corps.
"M.Jean PaterfonHain a inféré dansfles mémoiresdes
-curieux de la mature , ann. g..obferv. xxi. l’obferva-
Jtion curieifie d’une femme qui . avoit les poils du pubis
•d’une aune & demie de long 6c affeâésid’unplica
-confidérable ; elle étoit obligée de les rouler autour
-de fa-eüile- pour empêcher qu’ils ■ ne traînafiènt par
terre. 'Sennert-prétend.que cette:maladie, n’eft pas
-particulière auxihommes , & qu’elle attaque aufii les
-animaux, 6c fur-tout les chevaux ; i l raconte qu’un
=officier mena de Hongrie à Drefde , un cheval qui
-portoit un plica au colqui lui pendoit jufqu’aux piés.
Gette-maladie finguliere s’annonce ordinairement
-dans leS'hommes par un abattement extraordinaire-,
par des douleurs vives ,dans-tout:le corps ,-dans des
membres,'les jointures y la tête ;-les os paroiflent bri-
-fés, le vifage eft pâle y défait:; un bourdonnement
incommode fatigue continuellement-les oreilles*;^Tl
-furvient quelquefois «'des cqnvulfions., les membres
-fe contournent, le dos eft recourbé, lemalade .dév
ien t boffu y après ce premier tems, une partie des
fymptomes difparoît, -êc toutefa fore© dumalfemble
fe porter à la partie extérieure & chevelue de la
tête , une fueur abondante découle de cette'partie
de petites écailles comme du fon s’en détachent, les
cheveux grofliflent, s’alongent rapidement ; ils deviennent
gras , onftueux , fales , fétides. Souvent
alors ils font infeâés d’une quantité innombrable de
poux. Foyei Mal p édiculaire. Ils fe crêpent en-
fuite , fe replient en divers fens ; de leurs pores fuin-
te une humeur tenace & glutineufe ; ils fe collent
l’un à l’autre , fe compliquent, s’entrelacent & forment
par ce moyen différens paquets, cirri, prefque
folides 6c fi fortement tiffus, que tout l’art du monde
feroit vainement employé à les démêler &: les défaire.
Quelques auteurs ont affuré que dans cet état
les cheveux fe gorgeoient de fang 6t en laifloient
échapper, lorfqu’on les coupoit ou racloit, quelques
gouttes , & même dans certains cas une quantité
confidérable. Il y a à cefiijet une obfervation
curieufe 6c intéreflante d’Helwigius que nous rapporterons
plus bas ; d’autres ont prétendu que jamais
les cheveux ne pouvoîent admettre du fàng, & que
de quelque façon qu’on les coupât, i l n’^en fortoit jamais
une goutte;&: cette fauffe prétention n’eft étayée
que fur un fimple défaut d’obfer valions qui leur foient
propres. Ils ont conclu que cequ’ils ne voyoient pas
ne lauroit exifter ; il eft peu néceflaire de prouver
combien cette logique qui ne laiffe pas d’être affez
fuivie eft fauffe dans fes principes , 6c pernicieufe
dans fes conféquences. Pous nous, nous conclurons
plus juftement fur des autorités refpeftables 6c d’après
des obfervations décifives que le fait eft très-
certain, mais qu’il n’eft fans do.ute pas confiant. Dans
le même tems que cet entrelacement fe forme, 6c lorfque
la maladie parvient à l’extrême degré de violence
6c d’intenfité , les ongles 6c fur-tout ceux qui
font aux pouces des piés croiffent très-promptement,'
deviennent longs, raboteux, épais 6c noirs, fembla-
bles en tout à ceux des boucs , ils tombent fur la fin
de la maladie, & reviennent enfuite naturels quand
elle a une-heureufe iffue -6c que les cheveux commencent
à fe débrouiller ; ce fait rapporté parSchult-
zius, lui a été attefté par la comteffe dë Dqnhoff qui
en parlôit d’après fa propre expérience.
Cette maladie eft,comme nous l’avonsàdéja remarqué
, très-commun© 6c endémique en Pologne ; elle
a commencé , fuivant le rapport .des.hiftoriens du
.pays, à infefter ce royaume pat-la..partie qui con-
-fine la Ruflie , d’où elle, s’eft répandue dans cet empire,
dans la Prufle ,. dans l’Allemagne, la Hongrie,
-le Brifgaw, l’A lface, la Suiffe , la Flandre rhena-
ie ., où l’on, voit quelques veftiges , mais .rares de
.cette maladie. Ronderic à Fonfeca dit en avoir vu
un exemple.à Padoiie. -
On croit communément que, le plifain’a pas toujours
exifté. Roderic Fonfeca, Heroule SaXonia 6c
-quelqu’autres auteurs aflùrent, - fondés fiir l’autorité
deStadler, qu’iln’avoitpas paru.avantTannée 1564;
quelques autres en font remonter-l’origine plus haut,
6c en-fixent l ’époque à l’année 4 x8-7. Sennert prétend
au contraire , que cette maladie a-dû-être de
tout tems, & que des^caufes qui laproduifent étant
très-anciennes, elle ù o itl’être aufii ; que fi Ton n’en
- voit- aucune.mentionidans les anciens .auteurs, leur
.filence doit être uniquement.imputé à leur petit nom*
bre. ; à' leur inexaékitude,, & à la rareté du plica.
. Quelque fp é c ie u x -q u è foi,ent ces raifonnemens ; ce
-ne font jamais que-des‘taifonnemens dppofés. à des
-faits par - là même entièrement détruits ; i l ne
s’agifibit que de vérifier le filence des écrivains fur
-cet article ; s’ibeft bien conftaté, on ne peut-douter
-qu?il n e •fo it oC c a fio n n é - p a r un défaut a b fo lu d’ob-
fervâtions ; car cette maladie eft affez finguliere pour
. devoir frapperla curiofité.d’un obfervateur quelconqu
e y médecin ou^non, 6c pour-mériter^d’êtreTémar