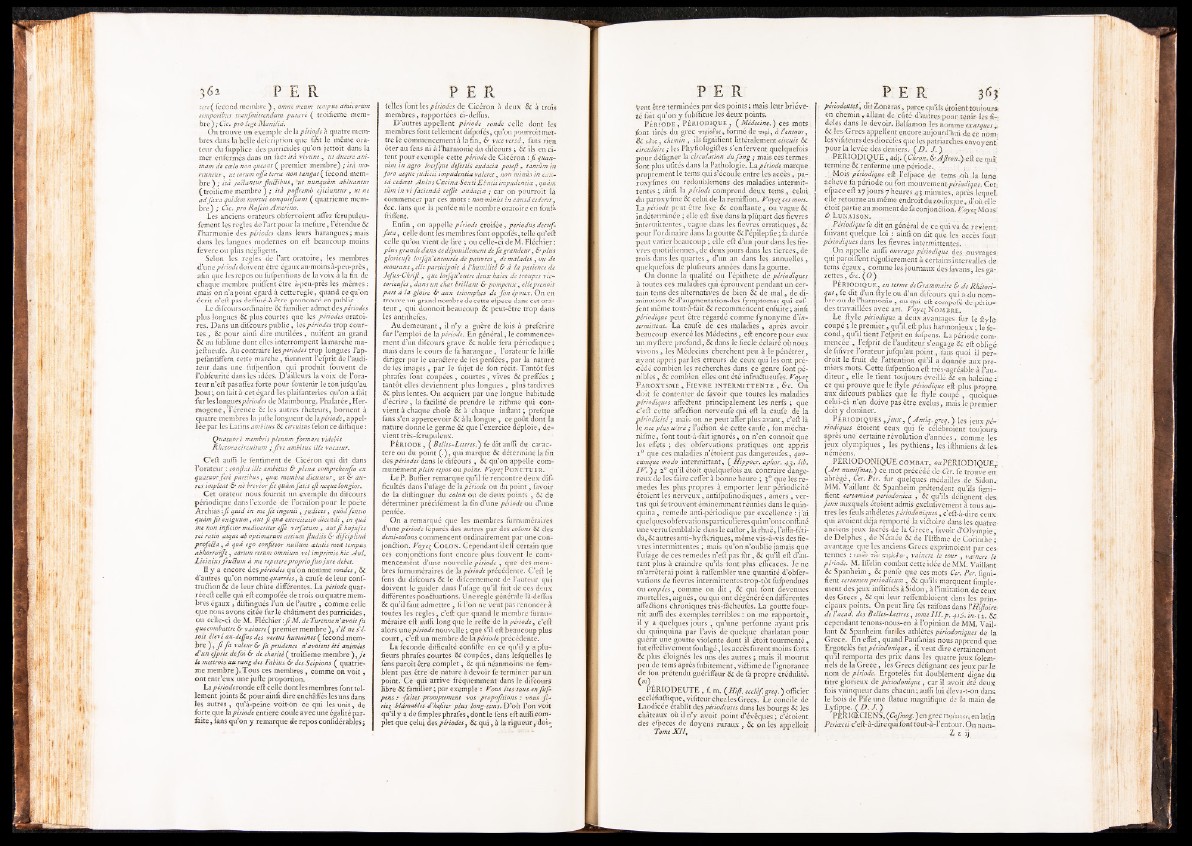
cire ( fécond membre ) , omit meum tempùs amicortun
timporïbits iranfmittendum putavi ( troifieme membre
) ; Cic. pro lege Maniluî.
On trouve un exemple de la période à quatre membres
dans la belle defcription que fait le même orateur
du fupplice des parricides qu’on jettoit dans la
mer enfermés dans un face ità vivunt, ut ducere animant
de coelo non queant ( premier membre) ; ità mo-
nuntur -, ut eorum oJJ'a terra non tangat ( fécond memb
r e ) ; ità jaclantur fluclibus 9*ut nunquàm abluantur
(troifieme membre j ; ità pofiremo ejiciuntur, ut ne
adfaxa quïdem mortui conqüiefcant ( quatrième membre
) ; Cic. pro Rofiio Amerino.
Les anciens orateurs obfervoient affez fcrupuleu-
fement les réglés de l’art pour la mefure, l’étendue &
J’harmonie des périodes dans leurs harangues ; mais
dans les langues modernes on eft beaucoup moins
fevere ou plus négligent.
Selon les réglés de l’art oratoire, les membres
d’une période doivent être égaux au-moins à-peu-près,
afin que les repos ou fufpenlions de la voix à la fin de
chaque membre puiffent être à-peu-près les mêmes :
mais on n’a point égard à cette réglé, quand ce qu’on
écrit n’eft pas deftiné-à être prononcé en public.
Le difeours ordinaire & familier admet des périodes
plus longues & plus courtes que les périodes oratoires.
Dans un difeours public, les périodes trop courtes
& pour ainfi dire mutilées , nuifent au grand
& au fublime dont elles interrompent la marche ma-
jeftueufe. Au contraire les périodes trop longues l’ap-
pefantiffent cette marche, tiennent l’efprit de l’auditeur
dans une fufpenfion qui produit fouvent de
l’obfcurité dans les idées. D’ailleurs la voix de l’orateur
n’eft pas affez forte pour foutenir le ton jufqu’au
bout ; on fait à cet égard les plaifanteries qu’on a fait
fur les longues périodes de Maimbourg. Phalarée, Her-
mogene,Térence & les autres rhéteurs, bornent à
quatre membres la jufte longueur de la période, appel-
lée par les Latins ambitus & circuitus félon ce diftique :
Quatuor è membris plénum formare videbis
Rhetora circuitum ; Jive ambitus ille vocatur.
C’eft aufîi le fentiment de Cicéron qui dit dans
l ’orateur : confiât ille ambitus & plena comprehenjio ex
quatuor ferb partibus, quee membra dicuntur, ut <S* au-
res impleat & né breviorfit quàm fiatis ejl neque longior.
Cet orateur nous fournit un exemple du difeours
périodique dans l’exorde de l’oraifon pour le poète
Archias : f i quid in me fit ingenii , judices, qubdfintio
quàm fit exiguum, aut fiqua exercitaùo dicendi, in quâ
me non inficior mediocriter ejfe vtrfatum , aut f i hujufce
rei ratio atque ab optimarum artium fiudiis & difciplinâ
profecla, à quâ ego confiteor nullum atatis méat ternpus
abhorritifife, earum rerum omnium vel imprimis hic Aul.
Licinius fruclum à me repetere proprio fuo jure debet.
Il y a encore des périodes qu’on nomme rondes, &
d’autres qu’on nomme q narrées, à caufe de leur conf-
tru&ion & de leur chute différentes. La période quar-
xéeeft celle qui eft compofée de trois ou quatre membres
égaux, diftingués l’un de l’autre , comme celle
que nous avons citée fur le châtiment des parricides,
ou celle-ci de M. Fléehier :f i M. de Turennen avoit fu
que combattre & vaincre.( premier membre ) , s'il ne s'é-
toit élevé au-de(fus des vertus humaines ( fécond membre
) , f i fa valeur 6* fa pnidence n’avoient été animées
d" un efiprit de foi & de charité ( troifieme membre ) , je
le mettrois au rang des Fabius & des Scipions ( quatrième
membre ) . Tous ces membres , comme on v o i t ,
.ont entr’eux une jufte proportion.
La période ronde eft celle dont les membres font tellement
joints & pour ainfi dire enchâffés lesunsdans
les autres, qu’à-peine voit-on ce qui les unit, de
forte que la période entière coule avec une égalité parfaite
, fans qu’on y remarque de repos confidérables;
telles font lès périodes de Cicéron à deux & à trois
membres, rapportées ci-deffus.
D ’autres appellent période ronde celle dont les
membres font tellement difoofés, qu’on pourroitmettre
le commencement à la fin, & vice versa, fans rien
ôter au fens ni à l’harmonie du difeours ; èi ils en citent
pour exemple cette période de Cicéron : f i quantum
in agro locifque définis audacia potefi , tantum in
Joro atque judicii impudentia valeret. non minus in causa
cederet Aulus Ccecina Sexii Ebutii impndentice, quàm
tum in vi faciendâ cefiît audacice ; car on pourroit là
commencer par ces mots : non minus in causa cederet,
&c. fans que la penfée ni le nombre oratoire en foufi»
frifîent.
Enfin, on appelle période croifée , périodus deeuf.
fata, celle dont les membres font oppofés, telle qu’eft
celle qu’on vient de lire ; ou celle-ci de M. Fléehier :
plus grande dans ce dépouillement de fa grandeur, & plus
glorieufe lorfqu'entourée de pauvres, de malades, ou de
mourans, elle participait à l'humilité & à la patience de
Jefus-Chrifi , que lorfqu'entre deux haies de troupes vie1-
torieufes, dans un char brûlant & pompeux, elleprenoït
part à la gloire & aux triomphes de fon époux. On en
trouve un grand nombre de cette efpece dans cet ora1-
teur , qui donnoit beaucoup & peut-être trop dans
les antithèfes.
Au demeurant, il n’y. a guère de lois à preferire
fur l’emploi de la période. En général, le commencement
d’un difeours grave & noble fera périodique ;
. mais dans le cours de fa harangue, l’orateur fe laiffe
diriger par le cara&ere de fes penfées, par la naturè
defes images , par le fujet de fon récit. Tantôt fes
phrafes font coupées , courtes , vives & preffées ;
tantôt elles deviennent plus longues , plus tardives
& plus lentes. On acquiert par une longue habitude
d’écrire , la facilité de prendre le rithme qui convient
à chaque chofe & à chaque inftant ; prefquè
fans s’en appercevoir & à la longue , ce goût dont la
nature donne le germe & que l’exercice déploie, devient
très-fcrupuleux.
PÉRIODE, ( B elles-Lettres. ) fe dit auffi du caractère
ou du point ( .) , qui marque & détermine la fin
des périodes dans le difeours , & qu’on appelle communément
plein repos ou point. Voye^ PONCTUER.
Le P. Buffier remarque qu’il fe rencontre deux difficultés
dans l’ufage de la période ou du point, favoir
de la diftinguer du colon ou de deux points , & de
déterminer précifément la fin d’une période ou d’une
penfée.
On a remarqué que les membres furnuméraires
d’une période féparés des autres par des colons & des
demi-colons commencent ordinairement par une conjonction.
Voye^ C olon. Cependant il eft certain que
ces conjonftions font encore plus-fouvent le commencement
d’une nouvelle période , que des mem- .
bres furnuméraires de la période précédente. C’eft le
fens du difeours & le difeerneinent de l’auteur qui
doivent le guider dans l’ufage qu’il fait de ces deux
différentes ponctuations. Une réglé générale là-deffus
& qu’il faut admettre , fi l’on ne veut pas renoncer à
toutes les réglés, c’eft que quand le membre furnu-
méraire eft aufii long que le refte de la période, c’eft
alors une période nouvelle ; que s’il eft beaucoup plus
court, c’eft un membre de la période précédente.
La fécondé difficulté confifte en ce qu’il y a plu-
fieurs phrafes courtes & coupées * dans lefquelles le
fens paroît être complet, & qui néanmoins ne fem-
blent pas être de nature à devoir fe terminer par un
point. Ce-qui arrive fréquemment dans le difeours
libre & familier ; par exemple : Vous êtes tous enfufi
pens : •faites promptement vos propositions : vous fi*
rie{ blâmables d’héfiter plus long-tems. D ’oîl l’on voit
qu’il y a de fimples phrafes , dont le fens eft auffi complet
que celui despériodes, 6c qui, à la rigueur , doi-
Vent être terminées par des points ; mais leur briéve-.
té fait qti’on y fubftitue les deux points.
PÉRIODE, PÉRIODIQUE , ( Médecine. ) ces mots
font tirés du grec mpioS'ac, formé de mpi, à tentour,
& oS'oç, chemin , ils fignifient littéralement circuit &
circulaire ; les Phyfiologiftes s’en fervent quelquefois
pour défigner la circulation du fiang ; mais ces termes.
font plus ufités dans la Pathologie. La période marque,
proprement le tems qui s’écoule entre les accès , pa-
roxyfines ou redoublemens des maladies, intermittentes
; ainfi la période comprend deux tems,, celui,,
du paroxyfme & celui de la remiffion. Voye? ces mots.
La période peut être fixe & confiante, ou vague &
indéterminée ; elle eft fixe dans la plupart des nevres
intermittentes, vague dans les fievres erratiques, & -
pour l’ordinaire dans la goutte & l ’épilepfie ;la durée
peut varier beaucoup ; elle eft d’un jour dans les fie-.
vres quotidiennes, de deux jours dans les tierces, de
trois dans les quartes, d’un an dans les annuelles , :
quelquefois de plufieurs années dans la goutte.
On donne la qualité ou l’épithete de périodiques
à toutes ces maladies qui éprouvent pendant un certain
tems des alternatives de bien & de mal, de diminution
& d’augmentation»des fymptomes qui cef-
fent même tout-à-fait & recommencent enfuite ; ainfi
périodique peut être regardé comme fynonyme d'intermittent.
La Caufe de ces maladies , après avoir
beaucoup exercé les Médecins, eft encore pour eux
un myftere profond, & dans le fiecle éclaire oiinous
vivons, les Médecins cherchent peu à le pénétrer,
ayant appris par les erreurs de ceux qui les ont précédé
combien les recherches dans ce genre font pénibles
, & combien elles ont été infruéhieufes. Voye^
P a r o x y s m e , F i e v r e i n t e r m i t t e n t e , &c. On
doit fe contenter de favoir que toutes les maladies
périodiques affectent principalement les nerfs ; que
c ’eft cette affeétion nerveufe qui eft la caufe de la
périodicité ; mais on ne peut'aller plus avant, c’eft là
le nec plus ultrà ; l’action de cette caufe , fon mécha-
nifme, font tout-à-fait ignorés, on n’en connoît que
les effets ; des obfer varions pratiques ont appris
i ° que ces maladies n’étoient pas dangereufes, quo-
cumque modo intermittant, ( Hippocr. aphor. 43. lib.
IV . ) ; 20 qu’il étoit quelquefois au contraire dangereux
de les faire ceffer à bonne heure ; 30 que les re-
rnedes les plus propres à emporter.leur périodicité
étoient les nerveux, antifpafmodiques, amers , vertus
qui fe trouvent éminemment réunies dans le quinquina,
remede anti-périodique par excellence : j ’ai
quelques obfervations parti culier es qui m’ont conftaté
une vertufemblable dans le caftor, larhuë, l’affa-féti-
da, & autres anti-hyftériques, même vis-à-vis des fievres
intermittentes ; mais qu’on n’oublie jamais que
l’ufage de ces remedes n’eft pas lïir, & qu’il eft d’autant
plus à craindre qu’ils font plus efficaces. Je ne
m’arrêterai point à raffembler une quantité d’obfer-
vations de fievres intermittentes trop-tôt fufpendues
ou coupées, comme on d i t , & qui font devenues
mortelles, aiguës, ou qui ont dégénéré en différentes
affeétions chroniques très-fâcheufes. La goutte fournit
auffi des exemples terribles : on me rapportoit,
il y a quelques jours , qu’une perfonne ayant pris
du quinquina par l’avis de quelque charlatan pour
guérir une goutte violente dont il étoit tourmenté,
fut effe&ivement foulagé, les accès furent moins forts
& plus éloignés les uns des autres ; mais il mourut
peu de tems après fubitement-, viftime de l’ignorance
de fon prétendu guériffeur & de fa propre crédulité.
PÉRIOD EUTE , f. m. ( Hifi. eccléf. greq.') officier
eccléfiaflicjue, vifiteur chez les Grecs. Le concile de
Laodicee établit des périodeutes dans les bourgs & les
châteaux ou il n’y avoit point d’évêques j c’é.toient.
des efpeces de doyens ruraux , & on les appelloit
Tome XJI%
periodeüteS, ditZônaraS , pajrce qu’ils étoient-toujourS?
en chemin , allant de. côté d’autres pour, tenir lesffir:
deles dans le devoir. Balfàmon les nomme exarques
&.les Grecs appellent encore .aujourd'hui dg Çe nom;
les vifiteur s clés diocèfes que les patriarches ènvoyénri
pour la levée des deniers. ( D . J. , ,
• PÉRIODIQUE, ad]. \Chron. &\ Aftro'njjçQ. çq quî[
termine & renferme une période., : l : - - ,
-.Mpi?:'Périodique eft l’efpace de tems .Ou la lune
achevé fa période où ton mouvement-périodique. C e t
efpace eft 27 jours 7 heures 43 minutes, après lequel,
elle retourne au même endroit du zodiaque, cToii elle
étoit partie au moment d,e fa conjonction. Voyez Mois:
& L unaison. -
; .Périodique fe dit en général de ce qui va & jrevient-
fuivant quelque loi ; ainfi on dit que. les: accès font;
périodiques dans les fievres intermittentes. .
On appelle auflî ouvrage périodique des, ouvrages-
qui paroiffent régulièrement à certains intervalles de
tems égaux, comme les journaux des favans£ les ea-'
zettes,, 6c. (O ) ■
PERIODIQUE, en terme deGrammaire & de Rhétori-
quelle dit d’un ftyle ou d’un difeours qui ardu nombre
ou de l’harmonie , ou qui eft çompofé de périodes
travaillées avec art. Voye^ Nombre.
Le ftyle périodique, a deux avantages fur le ftyle
coupé ; le premier, qu’il.eft plus harmonieux ; le fécond
, qu’il tient ï’efprit,en fufpens. La période com-,
mencée , l’efprit de l’auditeur s’engage & eft obligé
de fu'ivre l’orateur jufqu’au p oint, fans quoi il per-
droit le fruit de l’attention qii’il a dpnnée aux premiers
mots. Cette, fufpenfion eft très-agré,able à l’auditeur
, elle le tient toujours éveillé & en,haleine ;r
ce qui prouve que le ûyle.périodique eft plus propre
aux difeours publics que le ftyle coupe, quoique-
celui-ci n’en doive pas être exclus, mais le premier
doit y dominer.
PERIODIQUES fieu x , ( Antiq. greq. ) }es )e\.\x périodiques
étoient ceux qui fe célébroient; toujours
après-une certaine révolution d’années, comme les
jeux olympiques , les pythiens, les ifthmiens & les
néméens.
PÉRIODONIQUE combat, ou PÉRIODIQUE*
{Art numifinat.) ce. mot précédé de Cer. fe trouve en
abrégé, Cer. Per. fur quelques médailles-de,Sidon.;
MM. Vaillant & Spanheim prétendent, qu’ils fignifient
certamina periodonica , & qu’ils défirent des
jeux auxquels étoient admis exclufivement a tous autres
les feuls athéletes périodoniques. , c’eft-à-dire ceux
qui avoient déjà remporté la vi&oire dans les quatre-
anciens jeux facrés de la G rece, favoir d’Olympie '
de Delphes , de Némée & de l’Ifthme de Corinthe ;
avantage que les anciens Grecs exprimoient par ces-
termes : vinav mr TtîpioS'ev, vaincre le tour , vaincre le
pénode. M. Iffelin combat cette idée de MM. Vaillant
& Spanheim, & penfe que ces mots Cer. Per. fignifient
certamen periodicum , & qu’ils marquent fimple-,
ment des jeux inftitués à Sidon, à l’imitation de ceux
des Grecs , & qui leur reflembloient dans les principaux
points. On peut lire fes raifons dans YHifioire-
de l'acad. des B elles-Lettres, tome III.p. 41 S. in-12. &
cependant tenons-nous-en à l’opinion de MM. Vaillant
& Spanheim finales athlètes périodoniques de la
Grece. En effet, quand Paufanias nous apprend que
Ergotelès fut périodonique, il veut dire certainement
qu’il remporta des prix dans les quatre jeux folem-
nels de la Grece, les Grecs défignant ces jeux par le
nom de période. Ergotelès fut doublement digne du
titre glorieux de périodonique , car il avoit été deux
fois vainqueur dans chacun; auffi lui éleva-t-on dans,
le bois de Pife une fiatue magnifique de la main de
Lyfippe. ( D . ƒ. )
PÈRKECIENS, (Cofinog.)en grec nep/Wo/, en latin
Perioecei c’eft-à-dire qui font tout-à-l’entour. On nom-
Z z ij