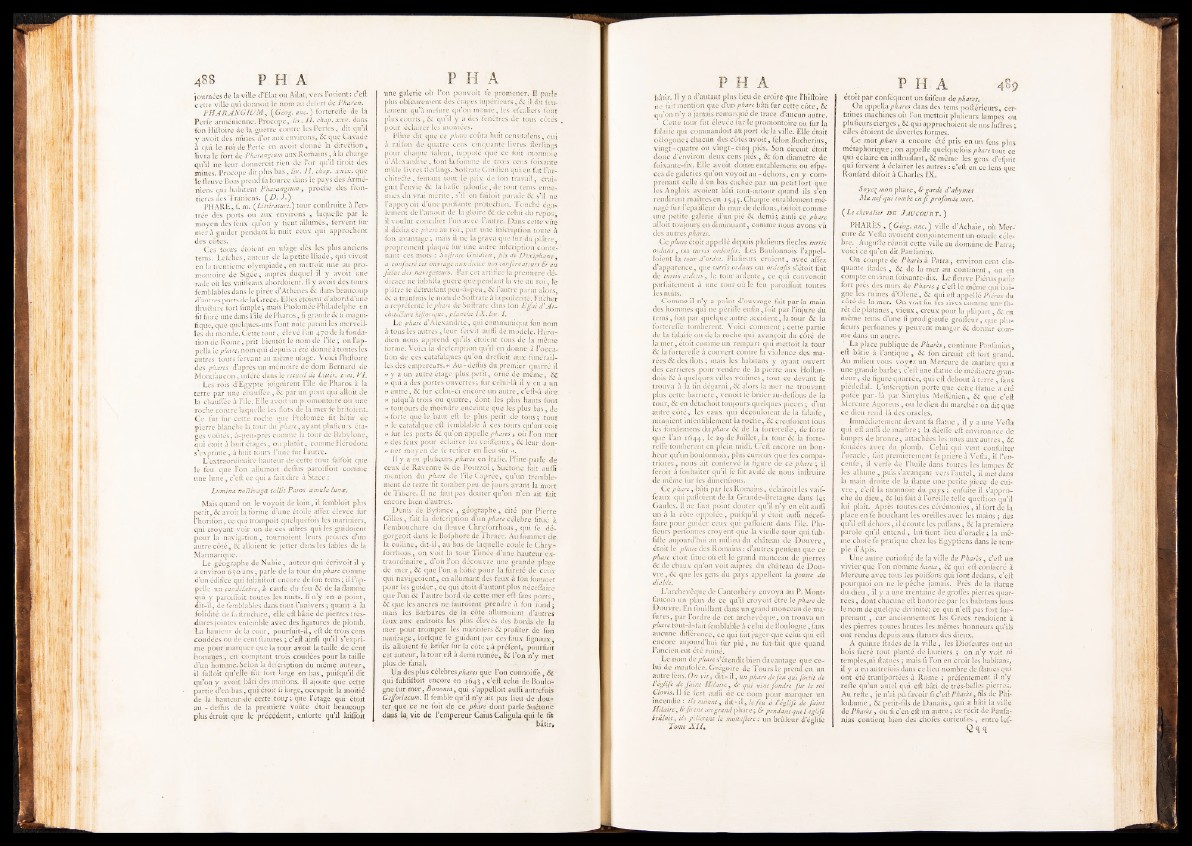
journées de la ville d’Elat ou Allât-, vers l’orient: c’ eft
cette ville qui donnoit le nom au delert de Pharan.
PH A 11AN GIUM , ( Gèog.anc.) fortereffe de la
Perfe arménienne. Procope, AV. IL chap.xxv. dans
fon Hiftoire de la guerre contre les Perlés, dit quil
y avoit des mines d’or aux ènvirons, 6c que Cavade
à qui le roi de Perfe en avoir donné la direftiôn,
livra le fort de Pharangium aux Romains, à la charge
qu’il ne leur donneroit rien de l’or qu’il tiroit des
mines. Procope dit plus bas, liv. U. chap. xxix. que
le fleuve Boas prend 1a fource dans le pays des Arméniens
qui habitent Pharangium, proche des frontières
des Traniens. ( D. J.')
PHARE, f. m! ( Littérature.) tour conftruite à l’entrée
des ports ou aux environs , laquelle par le
moyen des feux qu’on y tient allumés, fervent fur
mer à guider pendant la nuit ceux qui approchent
des côtes.
Ces tours étoient en ufage dès les plus anciens
tems. Lefchès, auteur de la petite Iliade, qui vivoit
en la trentième olympiade, en mettoit une au promontoire
de Sigée, auprès duquel il y avoit une
rade oii les vailleaux abordoient. Il y avoit des tours
femblables dans le pirée d’Athènes 6c dans beaucoup
d’autres ports de laGrece. Elles étoient d’abord d’une
ftru&ure fort fimple ; mais Ptolomée Philadelphe en
fit faire une dans n ie de Pharos, fi grande & fi magnifique,
que quelques-uns l’ont mife parmi les merveilles
du monde. Cette tour, eleve l’an 470 de la fondation
de Rome, prit bientôt le nom de l’île ; on l’ap-
pella le phare, nom qui depuis a été donné à toutes les
autres tours fervant au même ufage. Voici l’hiftoire
des phares d’après un mémoire de dom Bernard de
Montfaucon, inféré dans le recueil de Littèr. u>m.
Les rois d’Egypte joignirent l’île de Pharos à la
terre par une chauffée , 6c par un pont qui alloit de
la chauffée à l’ile. Elle avoit un promontoire ou une
roche contre laquelle les flots de la mer le briloient.
Ce fut fur cette roche que Ptolomée fit bâtir dé
pierre blanche la tour du phare, ayant plufieurs étages
voûtés, à-peu-près comme la tour de Babylone,
qui étoit à huit étages, ou plutôt, comme Hérodote
s’exprime , à huit tours l’une fur l’autre.
L’extraordinaire hauteur de cette tour faifoit que
le feu que l’on allumoit deffus. paroiffoit comme
une lune, c’eft ce qui a fait dire à Stace :
Lumina noclivagce tollit Paros (émula lunoe.
Mais quand on le voyoit de loin, il fembloit plus
petit, & avoit la forme d’une étoile affez élevée fur
l’horifon, ce qui trompoit quelquefois les mariniers,
qui croyant voir un de ces aftres qui les guidoient
pour la navigation, tournoient leurs proues d’un
autre côté, 6c alloient le jetter dans les fables de la
Marmarique.
Le géographe de Nubie, auteur qui écrivoit il y
a environ 650 ans, parle de la tour du phare comme
d’un édifice qui fubfiftoit encore de fon tems ; il l’appelle
un candélabre, à caufe du feu 6c de la flamme
qui y paroiffoit toutes les nuits. Il n’y en a point,
dit-il, de femblables dans tout l’univers; quant à la
folidité de fa ftruêhire, elle eft bâtie de pierres très-
dures jointes enfemble avec des ligatures de plomb.
La hauteur de la cour, pourfuit-il, eft de trois cens
coudées ou de cent ftatures ; c’eft ainli qu’il s’exprime
pour marquer que la tour avoit la taille de cent
hommes , en comptant trois coudées pour la taille
d’un homme. Selon la defeription du même auteur -,
il falloit qu’elle fût fort 'arge en bas, puifqu’i l dit
qu’on y avoit bâti des maifons. Il ajoute que cette
partie d’en bas, qui étoit fi large, occupoit la moitié
de la hauteur-de cette touj- ; que l’étage qui étoit
au - deffus de la première voûte étoit beaucoup
plus étroit que le précédent, enlorte qu’il laiffoit
une galerie où l’on pouvoit fe promçner. Il parle
plus obfcurement des etages lupérieurs, 6c il dit feulement
qu’à melure qu’on monte, les efcaliers font
plus courts , & qu’il y a des fenêtres de tous côtés
pour eclairer les montées.
Pline dit que ce phare coûta huit cens-ftalens, qui
à raifon de quatre cens cinquante livres fterlings
pour chaque talent, fuppolé que ce f'oit monnoie
d’Alexandrie , font la fomme de trois cens foixante
mille livres fterlings. Softrate Gnidien qui en fut l’ar-
chite&e , fentant tout le prix de Ion travail, craignit
l’envie 6c la balle jaloulie, de tout tems ennemies
du vrai mérite, s’il en faifoit parade 6c s’il ne
l’appuyoit d’une puiffante protection. Touché également
de l’amour de la gloire 6c de celui du repos,
il voulut concilier l’un avec l’autre. Dans cette vûe
il dédia ce phare au ro i, par une infeription toute à
fon avantage ; mais il ne la grava que liir du plâtre,
proprement plaqué fur une autre infeription contenant
ces mots : Sofirate Gnidien , Jils de Dixiphane,
a conficre cet ouvrage aux dieux nos confirvatcurs & aie
falut des navigateurs. Par cet artifice la première dédicace
ne fubiifta guere que pendant la vie au ro i, le
plâtre fie détruifant peu-à-peu, & l’autre parut alors,
6c a tranimis le nom de Softrate à la poftérité. Filcher
a reprélènté le phare de Softrate dans fon EJJ'ai d 'Architecture
hijlonque, planche IX. liv. I.
Le phare d’Alexandrie, qui communiqua fon nom
à tous les autres, leur fervit aulli de modèle. Héro-
dien nous apprend qu’ils étoient tous de la même
forme. Voici la drefeription qu’il- en donne à l’occa-
fion de ces catafalques qu’on dreffoit aux funérailles
des empereurs.« Au-deffus du .premier quarré il
» y a un autre étage plus petit, orpé de meme, 6c
» qui a des portes ouvertes ; fur celui-là il y en a un
» autre, 6c fur celui-ci encore un autre, c’eft-à-dire
.» julqu’à trois ou quatre, dont les plus hauts font
» toujours de moindre enceinte que les plus bas, de
» forte que le haut eft le plus petit de tous ; tout
» le catafalque eft feinblable à ces tours qu’on' voit
» fur les ports 6c qu’on appelle phares, où l’on met
» des feux pour éclairer les yaifl'eaux, 6c leur don-
» ner moyen de fe retirer en lieu sûr ».
Il y a eu plufieurs phares en Italie. Pline parle de
ceux de Ravenne 6c de Pouzzol ; Suétone fait auflï
mention du phare de l’île Caprée, qu’un tremblement
de terre fit tomber peu de jours ayant la mort
de Tibere. Il ne faut pas douter qu’on n’en ait fait
encore bien d’autres. 1
Denis de Byfance , géographe, cité par Pierre
Gilles, fait la defeription d’un phare célébré fitué à
l’embouchure du fleuve Chryforrhoas, qui fe dé-
gorgeoit dans le Bofphore de Thrace. Au fommet de
la colline, dit-il, au bas de laquelle coule le Chryforrhoas
, on voit la tour Timée d’une hauteur extraordinaire,
d’où l’on découvre une grande plage
de mer, 6c que l’on a bâtie pour la fureté de ceux
qui navigeoient, en allumant des feux à fon fommet
pour les guider, ce qui étoit d’autant plus néceffaire
que l’un 6c l’autre bord de cette mer eft fans ports,
6c que les ancres ne fauroient prendre à fon fond ;
mais les Barbares de la côte allumoient d’autres
feux aux endroits les plus élevés des bords de la
mer pour tromper les mariniers 6c profiter de fon
naufrage, lorfque fe guidant par ces faux fignaux,
ils alloient fe brifer fur la côte ; à préfent, pourfuit
cet auteur, la tour eft à demi ruinée, Zc l’on n’y met
plus de fanal.
Un des plus célébrés phares que l’on connoiffe, 6c
qui fubfiftoit encore en 1643 » c’eft celui de Boulogne
fur mer, Bononia, qui s’appêlloit aufli autrefois
Gefforiacum. Il femble qu’il n’y ait pas lia i de douter
que ce ne foit de ce phare dont parle Suétone
dans la. vie de l’empereur Caïus Caligula qui le fit
bâtir«
bâtir. Il y a d’autant plus lieu de croire que I’hiftoire
ne fait mention que d’un phare bâti fur cette côte, 6c
qu’on n’y a jamais remarqué de trace d’aucun autre.
Cette tour fiit élevée fur le promontoire ou fur la
falaife qui commandoit aùport delà ville. Elle étoit
o&ogone ; chacun des côtés a voit, félon Bucherius,
vingt-quatre ou vingt-cinq piés. Son circuit étoit
donc d’environ deux cens piés , & fon diamètre de
foixante-fix. Elle avoit douze entablcmens ou efpe-
ces de galeries qu’on voyoit au - dehors, en y comprenant
celle d’en bas cachée par un petit fort que
les Anglois avoient bâti tout-autour quand ils s’en
rendirent maîtres en 1545. Chaque entablement ménagé
fur l’épaiffeur du mur de deffous, faifoit comme
une petite galerie d’un nié &: demi ; ainff ce phare
alloit toujours en diminuant, comme nous avons vû
des autres phares.
Ce phare étoit appelié depuis plufieurs fiecles turris
ordans, ou turris ordenfis. Les Boulonnois l’appel-
loient la tour d'ordre. Plufieurs croient, avec affez
d’apparence, que turris ordans ou ordenfis s’étoit fait
de turris ardens, la tour ardente, ce qui convenoit
parfaitement à une tour où le feu paroiffoit toutes
les nuits.
Comme il n’y a point d’ouvrage fait par la main
des hommes qui ne périffe enfin, foit par l’injure du
tems, foit par quelque autre accident, la tour 6c la
fortereffe tombèrent. Voici comment ; cette partie
de la falaife ou de la roche qui avançoit du côté de
la m er, étoit comme un rempart qui mettoit la tour
6c la fortereffe à couvert contre la violence des marées
& des flots ; mais les habitans y ayant ouvert
des carrières pour vendre de la pierre aux Hollan-
dois 6c à quelques villes voifines, tout ce devant fe
trouva à la fin dégarni, 6c alors la mer ne trouvant
plus cette barrière, venoit fe brifer au-deffous de la
tour, 6c en détachoit toujours quelques pièces ; d’un
autre cô té, les eaux qui découloient de la falaife,
minoient infenfiblement la roche, 6c creufoient fous
les fondemens du phare 6c de la fortereffe, de forte
que l’an 1644, le 29 de Juillet, la tour 6c la fortereffe
tombèrent en plein midi. C’eft encore un bonheur
qu’un boulonnois, plus curieux que fes compatriotes
, nous ait confervé la figure de ce phare ; il
feroit à fouhaiter qu’il fc fût avifé de nous inftruire
de même fur fes dimenfions.
Ce phare, bâti par les Romains, éclairoit les vaif-
feaux qui paffoient de la Grande-Bretagne dans les
Gaules. Il ne faut point douter qu’il n’y en eût aufli
un à la côte oppofée, puifqu’il y étoit aufli néceffaire
pour guider ceux qui paffoient dans l’île. Plufieurs
perfonnes croyent que la vieille tour qui fub-
fifte aujourd’hui au milieu du château de Douvre
étoit le phare des Romains : d’autres penfent que ce
phare étoit fitué où eft le grand monceau de pierres
6c de chaux qu’on voit auprès du château de Douvre
, 6c que les gens du pays appellent la goutte du
diable.
L’archevêque de Cantorbéry envoya au P. Mont-
faucon un plan de ce qu’il croyoit être le phare de
Douvre. En fouillant dans un grand monceau de ma-
fures, par l’ordre de cet archevêque, on trouva un
phare tout-à-fait feinblable à celui de Boulogne, fans
aucune différence, ce qui fait juger que celui qui eft
encore aujourd’hui fur p ié , ne fut* fait que quand
l ’ancien.eut été ruiné.
Le nom dc phare s’étendit bien davantage que celui
de maufolée. Grégoire de Tours le prend en un
mitre fens. On vit, dit - i l , un phare de feu qui fortit de
l èglife de faint Hilaire, & qui vint fondre fur le roi
Clovis. Il fe fért aufli de ce nom pour marquer un
incendie : ils mirent, dit-il , le feu à l'èglife de faint
Hilaire, & firent un grand phare; & pendant que lèglife
bruloit, ils pillèrent le monafiere: un brûleur d’é«lil'e
Tome X I I . 0
étoit par confequent un faifeur de phares.
Qn a p p e l l a d a n s des tems poftérieurs, certaines
machines où l’on mettoit plufieurs lampes ou
plufieurs cierges, 6c qui approchoient de nos luftres ;
elles étoient de diverfes formes.
Ce mot phare a encore été pris en un fens plus
métaphorique ; on appelle quelquefois phare tout ce
qui éclaire en mftruifant, 6c même les gens d’efprit
qui fervent à éclairer les autres : c’eft en ce fens que
Ronfard difoit à Charles IX.
Soye{ mon phare, & garde d'abymes
Ma nef qui tombe en f i profonde mer.
( Le chevalier DE J AU COU R T . )
PHARÈS , ( Géog. anc. ) ville d’Achaïe, où Mercure
6c Vefta avoient conjointement un oracle célébré.
Augufte réunit cette ville au domaine de Patra;
voici ce qu’en dit Paufanias.
On compte de Pharès à Patra, environ cent cinquante
ftades , & de la mer au continent, on en
compte environ foixante-dix. Le fleuve Piériis paffe
fort près des murs de Phares ,* c’eft le même qui baigne
les ruines d’Olene , 6c qui eft appelié PUnis du
cote de la mer. On voit fur les rives comme une forêt
de platanes, vieux, creux pour la plûpart, 6c en
meme tems d’une fi prodigieufe groffeur, que plufieurs
perfonnes y peuyent manger 6c dormir comme
dans un antre.
La place publique de Pharès, continue Paufanias,
eft bâtie à l’antique , 6c fon circuit eft fort grand.
Au milieu vous voyez un Mercure de marbre qui a
une grande barbe ; c’eft une ftatue de médiocre grandeur
, de figure quarrée, qui eft debout à terre , fans
piédeftal. L’infcription porte que cette ftatue a été
pofée par-là par Simylus Meflénien, 6c que c’eft
Mercure Agoreus, ou le dieu du marché : on dit que
ce dieu rend là des oracles.
Immédiatement devant fa ftatue , il y a tme Vefta
qui eft aufli de marbre ; la déeffe eft environnée de
lampes de bronze, attachées les unes aux autres, &:
foudées avec du plomb. Celui qui veut confulter
l’oracle, fait premièrement fa priere à Vefta, il l’en**
cenfe, il verle de l’huile dans toutes les lampes 6c
les allume , puis s’avançant vers l’autel, il met dans
la main droite de la ftatue une petite piece de cuivre
, c’eft la monnoie du pays ; enfuite il s’appro*
che du dieu, 6c lui fait à l’oreille telle queftion qu’il
lui plaît. Après toutes ces cérémonies , il fort de la
place en fe bouchant les oreilles avec les mains ; dès
qu’il eft dehors, il écoute les paffans, 6c la première
parole qu’il entend , lui tient lieu d’oracle ; la même
chofe fe pratique chez les Egyptiens dans le temple
d’Apis.
Une autre curiofité de la ville de Phares, c’eft un
vivier que l’on n'omme hama, 6c qui eft confacré à
Mercure avec tous les poiffons qui font dedans, c’eft:
pourquoi on ne le pêche jamais. Près de la ftatue
du d ieu, il y a une trentaine de groffes pierres quar-
rées, dont chacune eft honorée par les habitans fous
le nom de quelque divinité; ce qui n’eft pas fort fur-
prenant , car anciennement les Grecs rendoient à
des pierres toutes brutes les mêmes honneurs qu’ils
ont rendus depuis aux ftatues des dieux.
A quinze ftades de la v ille , les Diofcures ont un
bois facré tout planté de lauriers ; on n’y voit ni
temples,ni ftatues ; mais fi l’on en croit les habitans,
il y a eu autrefois dans ce lieu nombre de ftatues qui
ont été tranfpcrtées à Rome ; préfentement il n’y
refte qu’un autel qui eft bâti de très-belles pierres.
Au refte, je n’ai pû lavoir fi c’eft Phares, fils de Phi-
lodamie, 6c petit-fils de Danaiis, qui a bâti la v ille
de Pharls , ou fi c’en eft un autre ; ce récit de Paufanias
contient bien des chofes curieufes , entre lef-
Q ï q