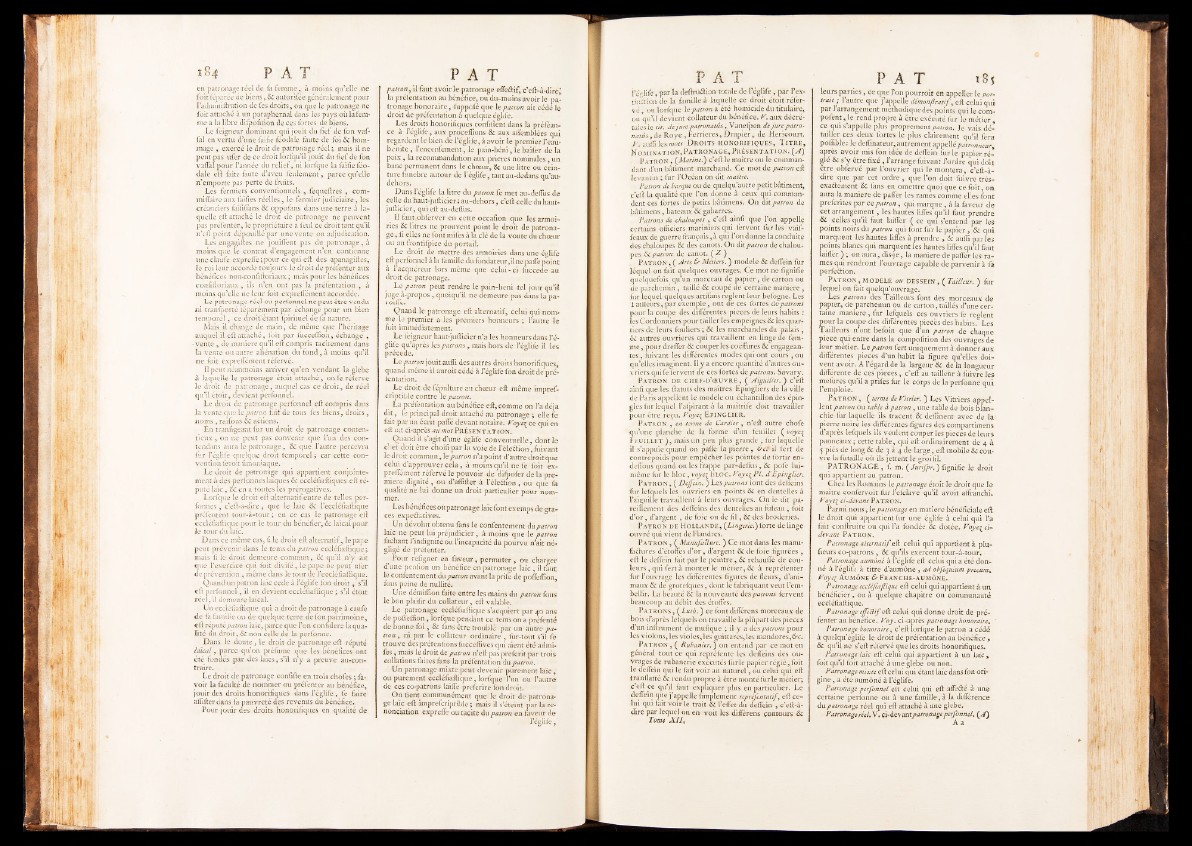
en patronage réel de fa femme, à moins qu’elle ne
foit féparée de biens, Sc autorifée généralement pour
l’adininiftration de fes droits, ou que le patronage ne
foit attaché à un paraphernal dans les pays oit la femme
a la libre difpofition de ces fortes de biens.
Le feigneur dominant qui jouit du fief de fon vaf-
fal en vertu d’une faifie féodale faute de foi & hommage
, exercé le droit de patronage réel ; mais il ne
peut pas ufer de ce droit lorfqu’il jouit du fief de fon
vaflal pour l’année du relief, ni lorfque la faifie féodale
eft faite faute d’aveu feulement, parce qu’elle
n’emporte pas perte de fruits.
Les fermiers conventionnels , fequeftres , com-
miffaire aux faifies réelles, le fermier judiciaire, les
créanciers faififl’ans &c oppol'ans dans une terre à laquelle
eft attaché le droit de patronage ne peuvent
pas préfenter, le propriétaire a feul ce droit tant qu’il
n’eft point dépouillé par une vente ou adjudication.
Les engagiftes ne jouiffent pas du patronage, à
moins que le contrat d’engagement n’en contienne
une claufe exprefie ; pour ce qui eft des apanagiftes,
le roi leur accorde toujours le droit de prefenter aux
bénéfices non-confiftoriaux ; mais pour les bénéfices
confiftoriaux, ils n’en ont pas la préfentation , à
moins qu’elle ne leur foit expreflement accordée.
Le patronage réel ou perfonnel ne peut être vendu
ni tranfporté léparément par échange pour un bien
temporel, ce droifétant lpirituel de fa nature.
Mais il change de main, de même que l’héritage
auquel il eft attaché, foit par fucceflion, échange ,
■ yente , de maniéré qu’il eft compris tacitement dans
la vente ou autre aliénation du fond, à moins qu’il
ne foit expreflement réfervé.
Il peut néanmoins arriver qu’en vendant la glebe
à laquelle le patronage étoit attaché, on fe rélèrve
le droit de patronage, auquel cas ce droit, de réel
qu’il étoit, devient perfonnel.
Le droit de patronage perfonnel eft compris dans
la vente que le patron fait de tous fes biens, droits,
noms , raifons & a&ions.
En tranfigeant fur un droit de patronage contentieux
, on ne peut pas convenir que l’un des con-
tendans aura le patronage, 6c que. l’autre percevra
fur l’églife quelque droit temporel ; car cette convention
feroit ftmoniaque.
Le droit de patronage qui appartient conjointement
à des perfonnes laïques 6c eccléfiaftiques eft réputé
laïc, & en a toutes les prérogatives.
Lorfque le droit eft alternatif entre de telles perfonnes
, c’eft-à-dire, que le laïc 6c l’eccléfiaftique
préfentent tour-à-tour ; en ce ças le patronage eft
eccléfiaftique pour le tour, du bénéfier, 6c laïcalpour
le tour du laïc.
Dans ce même cas, fi le droit eft alternatif, le pape
peut prévenir dans le tems du patron eccléfiaftique ;
mais fi le droit demeure commun, 6c qu’il n’y ait
que l’exercice qui foit divifé, le pape ne peut ufer
de prévention , même dans le tour de l’eecléfiaftique.
Quand un patron laïc cede à l’églife fon droit, s’il
eft perfonnel., il en devient eccléfiaftique ; s’il étoit
rée l,il demeure laïcal.
Un eccléfiaftique qui a droit de patronage à caufe
de fa famille ou de quelque terre de fon patrimoine,
eft réputé patron laïc, parce que l’on confidere la qualité
du droit, & non celle de la perfonne.
Dans le doute, le droit de patronage eft réputé
làical, parce qu’on préfume que les bénéfices ont
été fondés par des laïcs, s’il n’y a preuve au-con-
traire.
Le droit de patronage confifte en trois chofes ; fa-
voir la faculté de nommer ou préfenter au bénéfice,
jouir des droits honorifiques dans l’églife , fe faire
alïifter dans fa pauvreté des revenus du bénéfice.
Pour jouir des droits honorifiques en qualité de
patron, il faut avoir le patronage effe&if, c’ eft-à-dire^
la préfentation au bénéfice, ou du-moins avoir le patronage
honoraire, fuppofé que le patron ait cède le
droit de préfentation à quelque églife.
Les droits honorifiques confiftent dans la préféan-
ce à l’églife, aux proceflions & aux afîeinblées qui
regardent le bien de l’églife, à avoir le premier l’eau-
benite, l’encenfement, le pain-béni, le baifer de la
pa ix, la recommandation aux prières nominales, un
banc permanent dans le choeur, & une litre ou ceinture
funebre autour de l’églife, tant au-dedans qu’au-
dehors.
Dans l’eglife la litre du patron fe met au-deflus de
celle du haut-jufticier ; au-dehors, c’eft celle du haut-
jufticier, qui eft au-defliis.
Il faut.obferver en cette occafion que les armoiries
6c litres ne prouvent point le droit de patronage
, fi elles ne font mifes à la clé de la voûte du choeur
ou au frontifpice du portail.
Le droit de mettre des armoiries dans une églife
eft perfonnel à la famille du fondateur ,il ne pafle point
à l’acquéreur lors même que celui - ci fuccede au
droit de patronage.
Le patron peut rendre le pain-beni tel jour qu’il
juge à-propos , quoiqu’il ne demeure pas dans la parodie.
Quand le patronage eft alternatif, celui qui nom*
me le premier a les premiers honneurs ; l’autre le
fuit immédiatement.
Le feigneur haut-jufticier n’a les honneurs dans l’églife
qu’après les patrons , mais hors de l’églife il les
précédé.
Le patron jouit aufli des autres droits honorifiques,
quand même il auroit cédé à l’églife fon droit de pré-
lentation.
Le droit de fépulture au choeur eft même impref-
criptible contre le patron.
La préfentation au bénéfice eft, comme on l’a déjà
dit, le principal droit attaché au patronage ; elle fe
fait par un écrit paffé devant notaire. Voye^ ce qui en
elt ait ci-après au mot Pr é sen ta t io n .
Quand il s’agit d’une églife conventuelle, dont le
chef doit être choifi par la voie de lete&ion, fuivant
le droit commun, le patron n’a point d’autre droit que
celui d’approuver c ela, à moins qu’il ne fe foit expreflement
réfervé le pouvoir de difpofer de la première
dignité , ou d’aflifter à l’éleftion , ou que là
qualité ne lui donne un droit particulier pour nommer.
Les bénéfices où patronage laïc font exemps de grâces
experiatives.
Un dévolut obtenu fans le confentement du patron
laïc ne peut lui préjudicier, à moins que le patron
fâchant l’indignité ou l’incapacité du pourvu n’ait négligé
de préfenter.
Pour refigner en faveur, permuter, ou charger
d’une penfion un bénéfice en patronage laïc , il faut
le confentement du patron avant la prife de pofleflïon,
fous peine de nullité.
Une démiflion faite entre les mains du patron fous
le bon plaifir du collateur, eft valable.
Le patronage eccléfiaftique s’acquiert par 40 ans
de pofleflïon, lorfque pendant ce tems on a préfenté
de bonne f o i , 6c fans être troublé par un autre patron
, ni par le collateur ordinaire , fur-tout s’il fe
trouve des prétentions fucceflives qui aient été admi-
fe s , mais le droit de patron n’eft pas preferit par trois
collations faites fans la préfentation du patron.
Un patronage mixte peut devenir purement laïc,
ou purement eccléfiaftique, lorfque l’un ou l’autre
de ces co-patrons laifle preferire fon droit. '
On tient communément que le droit de patronage
laïc eft impreferiptibie ; mais il s’éteint par la renonciation
exprefle ou tacite du patron en faveur de
P A T
i’églife, par la deftru&ion totale de l’églife, par l’ex-
tinftion de la famille à laquelle ce droit étoit réfervé
, ou lorfque le patron a été homicide du titulaire,
ou qu’il devient collateur du bénéfice, V . aux décrétales
le tit. de. jure paironatus,_ Vanefpen de jure patro-
natûsyôs. R oye , Ferrieres, Drapier,, de Hericourt.
F . aufli les.mots D roits h o no rif iq ues, T it r e ,
N omination, Pa tro n ag e , Pr é sen ta t io n . ( A )
Patron , (Marine.) c’eft le maître ou le commandant
d’un bâtiment marchand. Ce mot de patron eft
levantin ; fur l’Océan on dit maître.
Patron de barque ou de quelqu’autre petit bâtiment,
c’eft la qualité que l’on donne à ceux qui commandent
ces fortes de petits bâtimens. On dit patron de
bâtimens , bateaux 6c gabarres.
Patrons de chaloupes , c’eft ainfi que l’on appelle
certains officiers mariniers qui fervent fur les vaif-
feaux de guerre françôis ,à qui l’on donne la conduite
des chaloupes 6c. des canots. On dit patron de chalou-
pes 6c patron de canot. ( Z )
Patron > ( Arts & Métiers. ) modèle 6c deflein fur
lequel on fait quelques ouvrages. Ce mot ne lignifie
quelquefois qu’un morceau de papier, de carton ou
de parchemin, taillé 6c coupé de certaine maniéré ,
fur lequel quelques artifans règlent leur befogne. Les
Tailleurs,par exemple, ont de ces fortes depatrons
pour la coupe des différentes pièces de leurs habits :
les Cordonniers pour tailler les empeignes 6c les quartiers
de leurs fouliers ; 6c les marchandes du palais ,
6c autres ouvrières qui travaillent en linge de femme
, pour drefl’er & couper les coëffures 6c engageantes
, fuivant les différentes modes qui ont cours , ou
qu’elles imaginent. Il y a encore quantité d’autres ouvriers
qui fe f ervent de ces fortes de patrons•. Savary.
Patron de chef-d’oe u v r e , ( Aiguiller. ) c’eft
ainfi que les ftatuts des maîtres Epingliers de la ville
de Paris appellent le modèle ou échantillon des épingles
fur lequel l’afpirant à la maîtrife doit travailler
pour être reçu. Voye^ Epinglier.
Patron , en terme de Cardier, n’eft autre chofe
qu’une planche de la forme d’un feuillet ( voye^
Feuillet ) , mais un peu plus grande , fur laquelle
il s’appuie quand on pafle la pierre, & cf il f'ert de
contrepoids pour empêcher les pointes de fortir en-
deflbus quand on les frappe par-defliis, 6c pofe lui-
même fur le bloc, voÿeç ÊLOC. Voye^Pl. d'Epinglier.
Pa t r o n , ( Deffcin» ) Les patrons font des defleins
fur lefquels les ouvriers en points 6c en dentelles à
l’aiguille travaillent à leurs ouvrages. On le dit pa*
reillement des defleins des dentelles au fufeau , loit
d’o r , d’argent , de foie ou de f i l , & des broderies.
Patron de Hollande, (Lingerie.') forte de linge
ouvré qui vient de Flandres.
Pa tro n , ( Manufacture. ) Ce mot dans les manu-
faftures d’étoffes d’o r , d’argent 6c de foie figurées ,
eft le deflein fait par le peintre, 6c rehaufle de couleurs
-, qui fert à monter le métier, 6c à repréfenter
fur l’ouvrage les différentes figures de fleurs, d’animaux
6c de grotefques, dont le fabriquant veut l’embellir.
La beauté & la nouveauté des patrons fervent
beaucoup au débit des étoffes.
Patrons , ( Luth. ) ce font différens morceaux de
bois d’après lefquels on travaille la plupart des pièces
d un infiniment de mufique ; il y a des patrons pour
les violons, les violes, les guittares,les mandores,&c.
Patro n , ( Rubanier. ) on entend par ce mot en
général tout ce qui repréfente les defleins des ouvrages
de rubanerie exécutés furie papier réglé, foit
le deflein qui le fait voir au naturel, ou celui qui eft
tranflatté 6c rendu propre à être monté f ur le métier;
c’eft ce qu’il faut expliquer plus en particulier» Le
deflein que j’appelle Amplement repréfentatif ', eft celui
qui fait voir le trait 6c l’effet du deflein , c’eft-à-
dire par lequel on en voit les différens contours 6c
Tome X I I ,
P A T 185
leurs parties, ce que l’on pourroit en appeller le portrait
$ 1 autre que j’appelle démonjlratif\ eft celui qui
par l’arrangement méthodique des points qui le com-
pofent, le rend propre à être exécuté fur le métier ,
ce qui s’appelle plus proprement patron. Je vais détailler
ces deux fortes le plus clairement qu’il fera
poffible: le deflinateur, autrement appellé patronneur
après avoir mis fon idée de deflein fur le papier ré-
§lé & s’y être fixé , l’arrange fuivant l’ordre qui doit
etre obfervé par l’ouvrier qui le montera, c’eft-à-
dire que par cet ordre , que l’on doit fuivre très-
exa&ement & fans en omettre quoi que ce foit, on
aura la maniéré de paffer les rames comme elles font
preferites par ce patron, qui marque , à la faveur de
cet arrangement, les hautes lifles qu’il faut prendre
& celles qu’il faut laifler ( ce qui s’entend par les
points noirs du patron qui font fur le papier, & qui
marquent les hautes lifies à prendre > & aufli par les
points blancs qui marquent les hautes lifles qu’il faut
laifler ) ; on aura, dis-je, la maniéré de paffer les rames
qui rendront l’ouvrage capable de parvenir à fa
perfection.
PATRON j MODELE ou DESSEIN , ( Tailleur. ) fur
lequel on fait quelqu’ouvrage.
Les patrons des Tailleurs font des morceaux de
papier, de parchemin ou de carton, taillés d’une certaine
maniéré , fur lefquels ces ouvriers fe retient
pour la coupe des différentes piecès des habits. Les
Tailleurs n’ont befoin que d’un patron de chaque
piece qui entre dans la compofition des ouvrages de
leur métier. Le patron fert uniquement à.donner aux
différentes pièces d’un habit la figure qu’elles doivent
avoir. A l’égard de la largeur & de la longueur
différente de ces pièces , c’eft au tailleur à fuivre les
mefures qu’il a prifes fur le corps de la perfonne qui
l’emploie.
Pa tro n , ( terme de Vitrier. ) Les Vitriers appellent
patron ou table à patron, une table de. bois blanchie
fur laquelle ils tracent & deflinent avec de la
pierre noire les différentes figures des compartimens
d’après lefquels ils veulent couper les pièces de leurs
panneaux ; cette table, qui eft ordinairement de 4 à
5 piés de long & de 3 à 4 de large, eft mobile & couvre
la futaille oii ils jettent le groifil,.
PATRONAGE , f. m. ( Jurifpr. ) fignifie le droit
qui appartient au patron.
Chez les Romains le patronage étoit le droit que le
maître confervoit fur l’efclave qu’il avoit affranchi*
Voyei ci-devant PATRON."
Parmi nous, le patronage en matière bénéficiai eft
le droit qui appartient fur une églife à celui qui l’a
fait conftruire ou qui l’a fondée 6c dotée. Voye^ cir
devant PATRON.
Patronage alternatif eft celui qui appartient à plu-
fieurs co-patrons , & qu’ils exercent tour-à-tour.
Patronage aumône à l’églife eft celui quia été donne
à l’églife à titre d’aumône, ad obfequium precum*
yoye^ A umône & Franche-aumône.
Patronage eccléfiaftique eft celui qui appartient à un
bénéficier, ou à quelque chapitre ou communauté
eccléfiaftique.
Patronage effectif eft celui qui donne droit de préfenter
au bénéfice. Voy. ci-après pàtrotïdge honoraire. ’
Patronage honoraire, c’eft lorfque le patron a cédé
à quelqu’églife le droit de préfentation au bénéfice ,
& qu’il ne s’ eft réfervé que les droits honorifiques.
Patronage laïc eft celui qui appartient à un laïc ,
foit qu’il foit attaché à une glebe ou non.
Patronage mixte eft celui qui étant laïc dans fon origine
, a été aumôné à l’églife*
Patronage perfonnel eft celui qui eft affeété à une
certaine perfonne ou à une famille, à la différence
du patronage réel qui eft attaché à une glebe.
Patronage réeh, V. ci-de v antpatronage perfonnel. (A)
A a