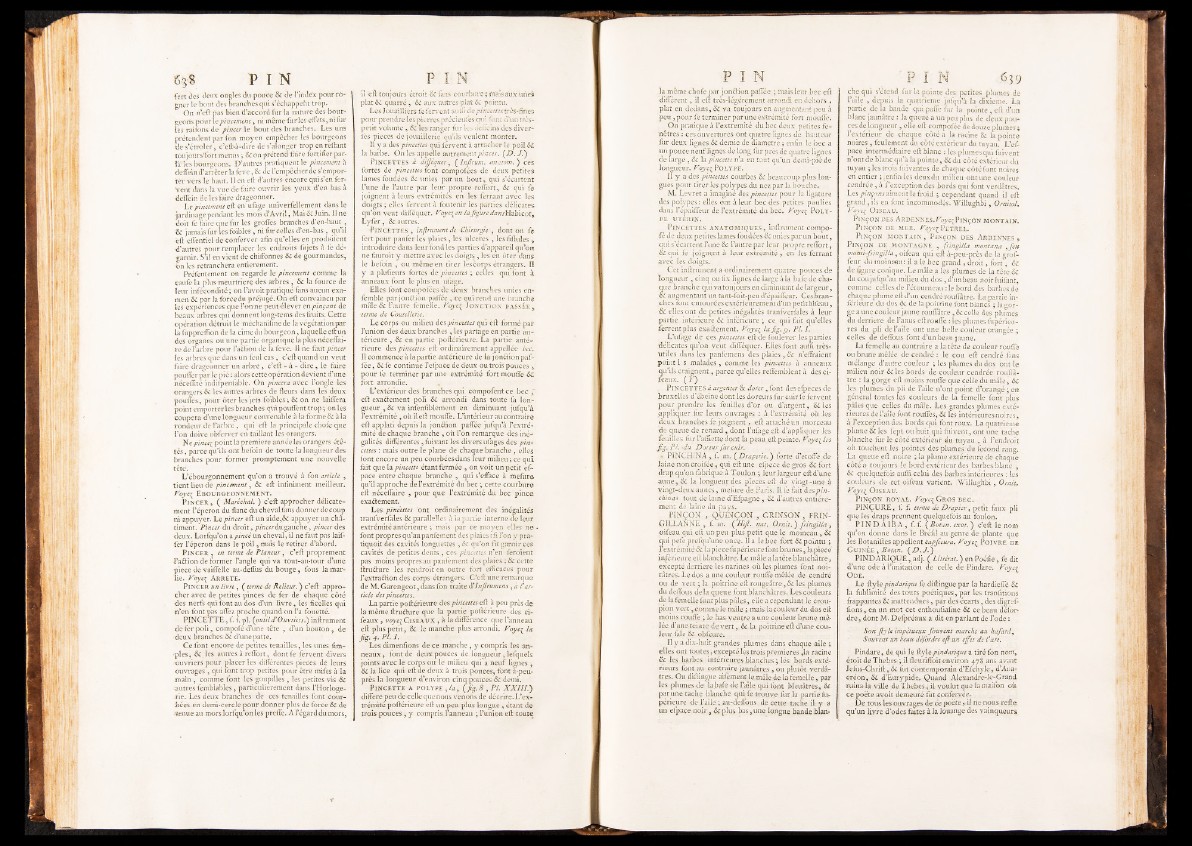
fert des deux ongles du pouce & de l’index pour rogner
le bout des branches qui s’échappent trop.
On n’eft pas bien d’accord fur 1a nature des bourgeons
pour le pincement, ni même furies effets, ni fur
lès railons de pincer le bout des branches. Lès uns
prétendent par fon moyen empêcher les bourgeons
de s’étroler, c’eft-à-dire dé s’alonger trop en reliant
tôujoürs'fort menus ; &on prétend faire fortifier paro
le s bourgeons. D’autres pratiquent le pincement à
deffein d’arrêter la feve, Sc de l’empêcher de s'emporter
vers le haut. Il en eft d’autres encore qui s’en fervent
dans la vue de foire ouvrir les yeux d’en bas à
delfein dé lesTaire drageonner.
Le pincement eft en' ufage univërfellement dans le
jardinage pendant les mois d’A vril, Mai & Juin. Il ne
doit fe faire que fur les groffes branches d’en-haut ,
& jamais fur les foibles, ni fur celles d’ en-bas-, qu’il
eft effentiel de Cônferver afin qu’elles en prodttiiént
d’autres pour remplacer les endroits fujets à fe dégarnir.
S’il en vient de chiffonnes Sc de gourmandes,
On les retranchera entièrement.
Préfentement on regarde le pincement comme la
caufe la plus meurtrière des arbres , Sc la fource de
leur infécondité ; on Pavoit pratiqué fans aucun examen
& par là force du préjugé. On eft convaincu par
k s expériences que Bonne peut élever en pinçant de
beaux arbres qui donnent long-tems- des fruits. Cette
opération détruit le méchanifmede la végétation par
la liippreftion de la cime du bourgeon, laquelle eft un
des organes ou une partie organique la plus néceffai-
re de l’arbre pour l’a&ion de la feve. Il ne faut pincer
les arbres que dans un feul cas, c’eft quand on veut
faire drageonner un arbre, c’eft - à - dire, le faire
pouffer par le pié : alors cette opération devient d’une
nécefîité indifpenfable. On pincera avec l’ongle les
orangers de les autres arbres de fleurs dans les deux
pouffes, pour ôter les jets foibles; Sc on ne biffera
point emporter les branches qui pouffent trop ; on les
coupera d’une longueur convenable à la forme & à la
rondeur de l’arbre, qui eft la principale chofe que
l ’on doive obferver en taillant les orangers.
Nepince^ point la première année les orangers étê-
tés, parce qu’ils ont befoin de toute, la longueur des
branches pour, former promptement une nouvelle
tête.
L’ébourgonnement qu’on a trouvé à fon article ,
tient lieu de pincement, Sc eft infiniment meilleur.
Voye^ E b o u r g e q n n em e n t .
P in c e r , ( Maréchal. ) c’eft approcher délicatement
l’éperon du flanc du cheval fans donner de coup
ni appuyer. Le pincer eft un aide,& appuyer un châtiment.
Pincer du droit, pincer du gauche, pincer des
deux. Lorfqu’on a pincé Un cheval, il ne faut pas biffer
l’éperon dans le p o il, mais le retirer d’abord.
P in c e r , en terme de Planeur, c’eft proprement
l ’aélion de former l’angle qui va tout-au-tour d’une
piece de vaiffelle au-deffus du bouge, fous lamar-
lie. Voye^ A r r ê t e .
Pin c e r un livre, ( terme de Relieur. ) c’eft approcher
avec de petites pinces de fer de chaque côté
■ des nerfs qui font au dos d’un liv r e , les ficelles qui
n’en font pas affez proche quand on l’a fouetté.
PINCETTE, f. f. pl. (outild'ouvriers.} infiniment
de fer p oli, compofé d’une tête , d’un bouton , de
■ deux branches Sc d’une patte.
Ce font encore de petites tenailles, les unes fim-
•ples, Sc les autres à reffort, dont fe fervent divers
'Ouvriers pour placer les différentes pièces de leurs
ouvrages , qui font trop petites pour être mifes à la
main , comme font les goupilles, les petites vis Sc
■ autres femblables, particulièrement dans l’Horlogerie.
Les deux branches de ces tenailles font cour-
bées-.en demi-cercle pour donner plus de force & de
&enue au mors Jorfqu’on les preffe. A l’égard du mors,
il ;eft toujours étroit Sc fans courbure ; biais àux'unêè
plat Sc quarré, Sc aux autres plat Sc pointu.
Les Jouailliers fe fervent auffi de pincettes très-fineô
pour prendre les pierres précieufes qui font d’un très-
petit volume , & les ranger fur les deffeins des diver-
les pièces de jouaillerie qu’ils veulent monter.
Il y a des pincettes qui fervent à arracher le poil Si.
b barbe. On les appelle autrement pinces. (D . ƒ.)
Pincet tes ~à difféquer, ( Irijlrum. anatom. ) ces
fortes de pincettes font compofees de deux petites
laines fondées & unies par un bout* qui s’écartent
l’une de l’autre par leur propre reffort, Sc qui fe
joignent à leurs extrémités en les ferrant avec les
doigts ; elles fervent à foutenir les parties délicates
qu’on veut difféquer. Ft>ye\_ en la figure dansRûÀcot,
L y fe r , & autres.
-Pin c e t t e s , infiniment de Chirurgie-, dont on fe
fert pour panfer les plaies-, les ulcérés , les fiftules *
introduire dans leur fond les parties d’appareil qu’on
ne fauroit y mettre avec les doigts , les en ôter dans
le befoin , ou même en tirer lescorps étrangers. Il
y a plufieurs fortes de pincettes ; celles qui font à
anneaux font le plus en ufage.
Elles font compofées de deux branches unies en-
femble par jondion paffée R ce qui rend une branché
-mâle Sc l’autre femelle. Voye{ Jo nct ion passée*
-terme de Coutellerie.
Le corps ou milieu Ses.pincettes qui eft formé par
l’union des deux branches , les partage en partie antérieure
, & en partie poftérieure. La partie antérieure
des pincettes eft ordinairement appellée bec.
Il commence à 1a partie antérieure de la jonction paf-
fée, Sc fe continue l’efpace de deux ou trois pouces *
pour fe terminer par une extrémité fort mouffe Sc
fort arrondie.
L’extérieur des branches qui compofent ce bec f-,
eft exa&ement poli Sc arrondi dans toute fa longueur
, Sc va infenfiblement en diminuant jufqu’à
l’extrémité, oii il eft mouffe. L’intérieur au contraire
eft applati depuis la jondion paffée jufqu’à l’extrémité
de chaque branche , oii l’on remarque des inégalités
différentes, fuivant les divers ufages des pin*
cettes : mais outre le plane de chaque branche, elles
font encore un peu courbées dans leur milieu; ce qui
fait que 1a pincette étant fermée , on voit un petit espace
entre chaque branche , qui s’efface à mefur©
qu’il approche de l’ extrémité du bec ; cette courbure
eft néceffaire , pour que l’extrémité du bec pince
exadement.
Les pincettes "ont ordinairement des inégalités
tranfverfales & parallelles à la partie interne de leur
extrémité antérieure ; mais par ce moyen elles ne
font propres qu’aupanfement des plaies : fi l’on y pra*
tiquoit des cavités longuettes , Sc qu’on fit garnir ces
cavités de petites dents, ces pincettes n’en feroient
pas moins propres au panfement des plaies ; Sc cette
ftrudure les rendroit en outre fort efficaces pour
l’extradion des corps étrangers. C’eft une remarque
de M. Garengeot, dans fon traite d’Infirumens , à l'article
des pincettes.
La partie poftérieure des pincettes eft à peu près de
la même ftrudure que 1a partie poftérieure des ci-
feaux, voyei C iseaux , à la différence que l’anneau
eft plus petit, Sc le man.che plus arrondi. Foye^ la
f ig .^ .P l . l.
Les dimenfions de ce manche , y compris les anneaux
, font de deux pouces de longueur, lefquels
joints avec le corps ou le milieu qui a neuf lignes ,
Sc 1a lice qui eft de deux à trois pouces, font a-peu-
près 1a longueur d’environ cinq pouces Sc demi.
Pin cet te a polype , la, (fig. 8 , Pl. X X I I I .)
différé peu de celle que nous venons de décrire. L’extrémité
poftérieure eft un peu plus longue , étant de
trois pouces, y compris l’anneau ; l’union eft toute
ïa m êm e c h o ie p a r jo n d io n p a ffé e ; m a is le u r b e c e ft
d i f f é r e n t , i l e ft t r è s - lé g é rem e n t a r ro n d i en d e h o r s ,
p la t en d e d a n s , & v a to u jo u r s en au gm entan t p e u à
p e u , p o u r f e t e rm in e r p a r u n e e x t rém ité fo r t m o u ffe .
On pratique à Fextremité du bec deux petites fenêtres
: ces ouvertures ont quatre lignes de hauteur
fur deux lignes Sc demie de diamètre ; enfin le bec a
un pouce neuf lignes de long fur près de quatre lignes
de large , Sc 1a pincette n’a en tout qu’un demi-pié de
longueur. Foyeç Po lype.
Il y a des pincettes courbes Sc beaucoup plus longues
pour tirer les polypes du nez par b bouche.
M. Levret a imaginé des pincettes pour b ligature
des polypes : elles ont à leur bec des petites poulies
dans l’epaiffeur de l’extrémité du bec. Foye%_ P o l y p
e u t é r i n .
P i n c e t t e s a n a t o m i q u e s , in ftrum en t c om p o f
é de d e u x p e t ite s lam es fo n d é e s Sc u n ies p a r u n b o u t ,
q u i s ’é c a r ten t l ’u n e Sc l ’a u t r e p a r le u r p ro p r e r e f f o r t ,
Sc q u i fe jo ig n e n t à le u r e x t r ém ité , en le s fe rran t
a v e c le s d o ig ts .
Cet inftrument a ordinairement quatre pouces de
longueur , cinq ou fix lignes de large à la bafe de chaque
branche qui va toujours en diminuant de largeur,
Sc augmentant un tant-foit-peu d’épaiffeur. Cesbran-
ches font entourées extérieurement d’un petitbifeau,
Sc elles ont de petites inégalités tranfverfales >à. leur
partie intérieure Sc inférieure ; ce qui fait qu’elles
ferrent plus exadement. Foye^ lafig.c). Pl. I.
L ’ufage de ces pincettes eft de foulever les parties
délicates qu’on veut difféquer. Elles font auffi très-
utiles dans les panfemens des plaies , Sc n’effraient
point 1 s malades , comme les pincettes à anneaux
qu’ils craignent, parce qu’elles reffemblent à des ciseaux.
( F )
P in c e t t e s à argenter & dorer, font des efpeces de
Bruxelles d’ébeine dont les doreurs fur cuir fe fervent
pour prendre les feuilles d’or ou d’argent, Sc les
appliquer fur leurs ouvrages : à l’extremité oii les
deux branches fe joignent, eft attaché un morceau
de queue de renard, dont l’ufage eft d’appliquer les
feuilles fur l’affiette dont b peau ,eft peinte. Foye^ les
fig. P l. 'du Doreur, fur cuir.
• PINCHîNA , f. m. ( Draperie. ) forte d’étoffé de
laine noncroifée, qui eft une efpece de gros Sc fort
drap qu’on fabrique à Toulon ; leur largeur eft d’une
aune, Sc la longueur des pièces eft de vingt -une à
vingt-deux aunes, mefure de Paris. Il fe fait despin-
chinas tout de laine d’Efpagne , & d’autres entièrement
dé laine du pays.
PINÇON , QÙINÇON , GRINSON, FRIN-
GILLANNE , f. m. (Hiß. nat. Omit. ) fringilla ,
oifeau qui eft un peu plus petit que le moineau , Sc
qui pefe prefqu’une once. Il a le bec fort Sc pointu ;
l’extrémité Sc la piece fupérieure font brunes ,.la piece
inférieure eft blanchâtre. Le mâle a 1atête blanchâtre,
excepté derrière les narines oti les plumes font noirâtres.
Le dos a une couleur roiiffe mêlée de cendré
ou de vert ; la poitrine eft rougeâtre,& les plume's
du deffous delà queue font blanchâtres. Les couleurs
de 1a femelle font plus pâles, elle a cependant le erpu-
pion v e r t , comme le mâle ; mais la couleur du dos eft
moins rouffe ; le bas ventre a une couleur brune mêlée
d’une teinte de v e r t, Sc la poitrine eft d’une couleur,
fale Sc obfeure, ;
Il y a dix-huit grandes plumes dans chaque aile ;
elles ont tout es, excepté les-trois premières ,1a racine
oc les barbes intérieures bbnçhes ; lés bordé extéy
rieurs font au contraire jaunâtres , ou plutôt verdâtres.
On diftingue aifément le mâle de lafemejle, par
les plumes de b bafe de Faite qui font bleuâtres, Sc
par une tache blanche qui fe troùve fur lapartiefib-
périeure de Falle ; au-deffous, de çette tache i f y a
un efpaçe noir, & plus bas, une longue bande blanche
qui s’étend fur 1a pointe des petites plumes de
l’aîle , depuis la quatrième jufqu’à 1a dixième. La
partie de la bande qui paffe fur la pointe , eft d’un
blanc jaunâtre: 1a queué. a un peu plus de deux pouces
de.longueur, elfe eft compofée de douze plumes ;
l’extérieur de chaque côté a la racine Sc b pointe
noires , feulement du côté extérieur du tuyau. L’el-
pace intermédiaire eft blanc : les plumes qui fuivent
n’ont de blanc qu’à b pointe, Sc du côté extérieur dù
tuyau ; les trois fuivantes de chaque côté font noires
en entier ; [enfin les deuxdu milieu ont une Couleur
cendrée, à T exception des bords qui font verdâtres.
Les pinçons aiment le froid ; cependant quand il eft
grand, ils en font incommodés. Willtighbi, Ornitol.
F oyei O i s e a u .
P in ç o n d e s A r d e n n e s .F b y c^ P iN çoN m o n t a i n .
P in ç o n d e m e r . Foye{ P e t r e l .
P in ç o n m o n t a i n , P in ç o n d e s A r d e n n e s *
P lN çO N DE MO NTAGN E , fringilla montana ,feu
mohti-fringilla, oifeau qui eft à-peU-près de 1a grof-
feur du moineau: il a le bec grand , droit, fo r t , Sc
de figure conique. Le mâle a les plumes de la tête Sc
du cou jufqu’au milieu du dos , d’unbeau noir luifant,
comme celles de l’étourneau : le bord des barbes de
chaque plume eft d’un cendré rouffâtre. La partie inférieure
du dos Sc de 1a poitrine font blancs ; 1a gorge
a une couleur, jaune rouffâtre , Sc celle des plumes
du derrière de l’anus eft rouffe : les plumes fupérieu-
res du pli del’aîle ont une belle couleur orangée ;
celles de deffous font d’un beau jaune.
La femelle au contraire a 1a tête de couleur rouffe
ou brune mêlée de cendré : le <çqu eft cendré fans
mélange d’autre couleur ; les plumes du dos ont le
milieu noir & les bords de couleur cendrée rouftà-
tre : b gorge eft moins rouffe que celle du mâle, Sc
les plumes du pli de l’aile n’ont point d’orangé; en
général toutes les couleurs de 1a femelle font plus
pâles que celles du mâle. Les grandes plumes extérieures
de l’aile font rouffes, Sc les intérieures noires,
à l’exception des bords qui font roux. La quatrième
plume Sc les fept ou huit .qui fuiveiit, Ont une tache
blanche fur le côté extérieur du tuyau , à l’endroit
oh touchent les pointes des plumes du fécond rang.
La queue eft noire ; la plume extérieure de chaque
côté a toujours le bord extérieur des barbes bbnc ,
Sc quelquefois auffi, celui des barbes intérieures : les
couleurs de cet oifeau varient. Willughbi, Omit.
Foye^ O i s e a u .
P in ç o n r o y a l . FoyeiG^os b e c .
PINÇURE, i. f. terme de Drapier, petit faux pli
que les draps prennent quelquefois au foulon.
P IN D A IB A , f. f. ( Botan. exot. ) c’eft le nom
qu’on donne dans le Bi'éfil au genre de plante que
les Botaniftes appellent çapjicura. Foyeç P o i v r e d e
G u in é e , Botan. (D . J .}
PINDARIQUE, adj. ( Littéral. ) en Poéfiè, fe dit
d’une ode à l’imitation de celle de Pindare. Foyer
Ode.
Le ftyle pindarique fe diftingue par 1a hardieffé Sc
1a fublimité des tours poétiques, par les tranfitions
frappantes Sc inattendues, par des écarts, des digrefi
fions, en un mot cet enthoufiafme Sc ce beau defor-
dre, dont M. Defpréaux a dit en parlant de l’ode :
Son Jlyle impétueux fouvent marche au hafardf
Souvenran beau: défendre eft un effet de Part,
Pindare, de qui le ftyle pindarique a tiré fon nom,
©toit dé Thebes; ; il fleuriffoit environ 478 ans avant
Iefus-Chrift, Sc fut contemporain d’Efchyle, d’Anacréon,
& d’Eurypide, Quand Alexandre-le-Grand
ruina la ville de Thebes,! ,if voulut que la maifon oit
ce poëte avoit demeuré fut con'fervée.
De tous les ouvrages de ce.poëte « il ne nous refis
qu’un livre d’odes faites à 1a louange des vainqueurs