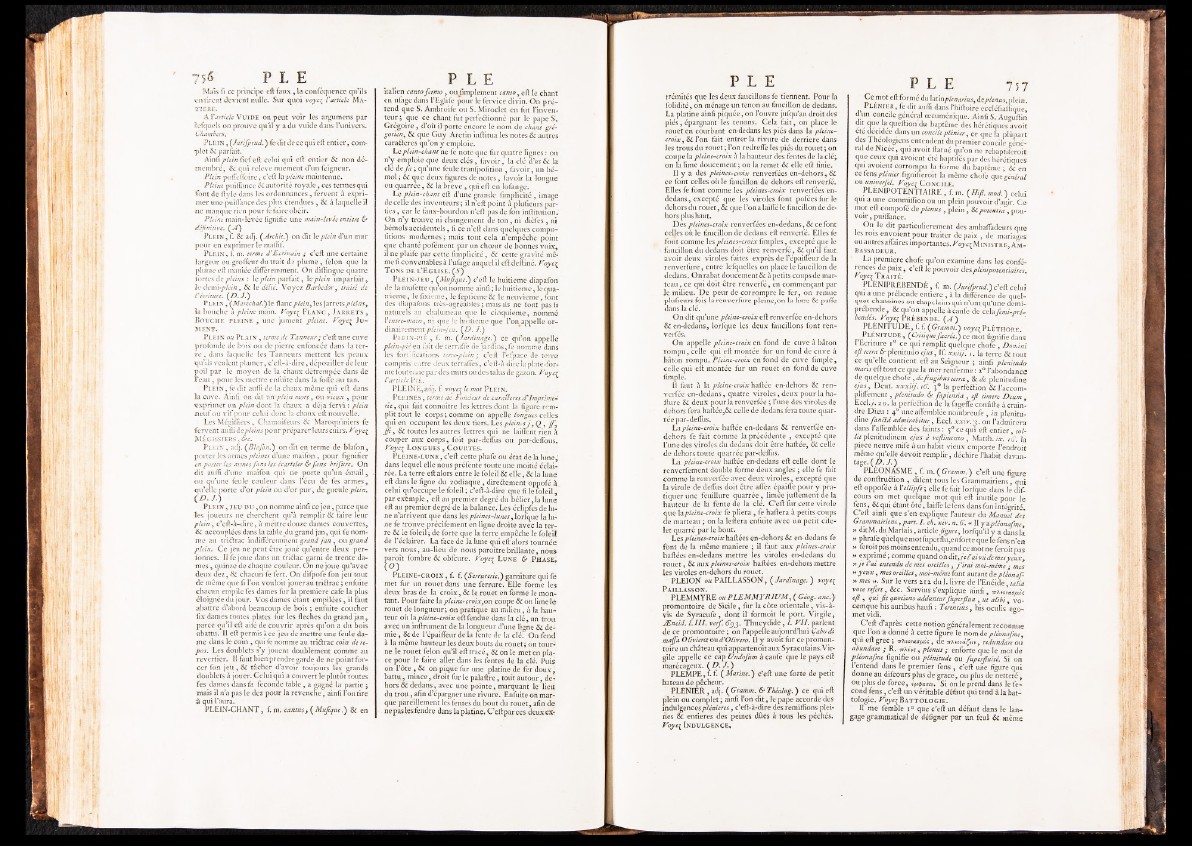
Mais fi ce principe eft faux, la conféquence qu’ ils
■ entirent devient nulle» Sur quoi voyez L'article Ma-
TI ERE.
A Y article V u id e o n p e u t v o i r le s a rgum en s p a r
îe fq u e ls o n p r o u v e q u ’i l y a d u v u id e dans l ’u n iv e r s .
Ckambers«
P l e in , (.lurifprud.) fe dit de ce qui eft entier, complet
& parfait.
Ainfi plein fief eft celui qui eft entier & non démembré,
& qui releve nuement d’un feigneur.
Plein p o f fe f fo ir e , c ’ eft la 'pleine m a in ten u e .
Pleine puiflance & autorité royale, ces termes qui
font de ftyle dans les ordonnances, fervent à exprimer
une puiflance des plus étendues, & à laquelle il
ne manque rien pour fe faire obéir.
Pleine main-levée lignifie une main-levée entière &
définitive, (-d)
P l e in , f . & adj. ( Archit.) on dit le plein d’un mur
pour en exprimer le maflif.
P l e i n , f. m. terme dé Ecrivain ; c’eft une certaine
largeur ou groffeur du trait de plume, félon que la
plume eft maniée différemment. On diftingue quatre
fortes de pleins : le plein parfait, le plein imparfait,
le demi -plein, & le délié. Voyez Barbedor, traité de
Vécriture. (D. J.)
P l e in , (Maréchal'.) le flanc plein, les jarrets pleins
la bouche à pleine main. Voyez F l a n c , Ja r r e t s ,
B o u c h e p l e in e , une jument pleine. Voye* J u m
e n t .
P l e in ou P l a in , terme de Tanneur; c’eft une cuve
profonde de bois ou de pierre enfoncée dans la terre
, dans laquelle les Tanneurs mettent les peaux
qu’ils veulent plamer, c’eft-à-dire, dépouiller de leur
poil par le moyen de la chaux détrempée dans de
l’eau , pour les mettre enfuite dans la fofle au tan.
P l e i n , fe d it au fli d e la ch a u x m êm e q u i e ft dans
la c u v e . Ainfi o n d it un plein mort, o u vieux , p o u r
e x p r im e r u n plein d o n t la ch a u x a d é jà f e r v i : plein
n e u f o u v i f p o u r c e lu i d o n t la ch a u x e ft n o u v e lle .
Les Mégifliers, Chamoifeurs & Maroquiniers fe
fervent aufli de pleins pour préparer leurs cuirs. Voyez
M é g i s s i e r s ,,& c.
P l e i n , adj. (Blafon.) on dit en terme de blafon,
porter les armes pleines d’une maifon, pour lignifier
en porter les armes fans les écarteler & fans brifure. On
dit aufli d’une maifon qui ne porte qu’un émail,
ou qu’une feule couleur dans l’écu de fes armes,
qu’elle porte d’or plein ou d’or pur, de gueule plein.
( D - J -5
P l e in , jexj d u , on nomme ainfi ce jeu, parce que
•les joueurs ne cherchent qu’à remplir & faire leur
plein, c’eft-à-dire, à mettre douze dames couvertes,
& accouplées dans la table du grand jan, qui fe nomme
au triCtrac indifféremment grand jan , ou grand
plein. Ce jeu ne peut être joué qu’entre deux per-
fonnes. Il fe joue dans un tri&ac garni de trente dames
, quinze de chaque couleur. On ne joue qu’avec
dexix dez, & chacun fe fert. On difpofe fon jeu tout
de même que fi l’on vouloit jouerau tri&rac ; enfuite
chacun empile fes dames fur la première café la plus
éloignée du jour. Vos dames étant empilées, il faut
abattre d’abord beaucoup de bois ; enfuite coucher
fix dames toutes plates lur les fléchés du grand jan,
parce qu’il eft ailé de couvrir après qu’on a du bois
abattu. Il eft permis à ce jeu de mettre une feule dame
dans le coin , qui fe nomme au tri&rac coin de repos.
Les doublets s’y jouent doublement comme au
revertier. Il faut bien prendre garde de ne point forcer
fon jeU, & tâcher d’avoir toujours les grands
doublets à jouer. Celui qui a couvert le plutôt toutes
fes dames dans fa fécondé table , a gagné la partie ;
mais il n’a pas le dez pour la re venene, ainfi l’on tire
à qui l’aura.
PLEIN-CHANT, f. m. cantus, ( Mufique. ) & en
italien canto fermo, ouJimplement canto, eft le chant
en ufage dans l’Eglile pour le fervice divin. On prétend
que S. Ambroife ou S. Miroclet en fut l’inventeur
; que ce chant fut perfectionné par le pape S.
Grégoire, d’oii il porte encore le nom de chant grégorien,
& que Guy Aretin inftitua les notes & autres
caratteres qu’on y emploie.
Le plein-chant ne fe note que lur quatre lignes : on
n’y emploie que deux clés, favoir, la clé déut & la
clé de fa ; qu’une feule tranfpofition , favoir, un bémol
; & que deux figures de notes, favoir la longue
•ou quarree, & la breve , qui eft en lofange.
Le plein-chant eft d’une grande fimplicité , image
de celle des inventeurs ; il n’eft point à plufieurs parties
, car le faux-bourdon n’eft pas de fon inftitution.'
On n’y trouve ni changement de ton, ni dièfes , ni
bémols accidentels, fi ce n’eft dans quelques compo-
fitions modernes'; mais tout cela n’empêche point
que chanté pofément par un choeur de bonnes voix,
il ne plaife par cette fimplicité, & cette gravité même
fi convenables à l’ufage auquel il eft deftiné. Voyeç
T o ns d e l ’E g l is e . (S)
P l e in -je u , ( Mufique.) c’eft le huitième diapafon
de la mufette qu’on nomme ainfi ; le huitième, le quatrième
, le fixieme, le feptieme & le neuvième, font
des diapafons très-agréables ; mais ils ne font pas fi
naturels au chalumeau que le cinquième, nommé
Ventre-main, ni que le huitième que l’on appelle ordinairement
plein-jeu. (JD. J.)
P l e in -p ie , i. m. (Jardinage.') ce qu’on appelle
plein-piéen fait de terraffe de ja rdin s ,fe nomme dans
les fortifications terre-plein ; c’eft l’efpace de terre
compris entre deux terraffes, c’eft-à dire la plate-forme
foutenue par des murs ou des talus de gazon. Voyez
P article PiÉ.
PLEINE, adj. f. voyez le mot P l e in .
P L E I N E S , terme de Fondeur de caractères d'Imprime-
rie, qui fait connoître les lettres dont la figure remplit
tout le corps ; comme on appelle longues celles
qui en occupent les deux tiers. Les pleines j , <2, JJ,
f i t , & toutes les autres lettres qui ne laiffent rien à
couper aux corps, foit par-deffus ou par-deffous.
Voyez L o n g u e s , C o u r t e s .
Pl e in e -lu n e , c’eft cette phafe ou état de la lune,’
dans lequel elle nous préfente toute une moitié éclairée.
La terre eft alors entre le foleil & e lle, & la lune
eft dans le ligne du zodiaque , directement oppofé à.
celui qu’occupe le foleil ; c’eft-à-dire que fi le loleil,
par exemple, eft au premier degré du bélier,la lune
eft au premier degré de la balance. Les éclipfes de lune
n’arrivent que dans les pleines-lunes, lorfque la lune
fe trouve précifement en ligne droite avec la terre
& le foleil; de forte que la terre empêche le foleil
de l’éclairer. La face de la lune qui eft alors tournée
vers nous, au-lieu de nous paroître brillante, nous
paroît fombre & obfcure. Voye7 L u n e & Ph a s e ,
■
Pl e in e - c r o ix , f . f. (Serrurerie.) garniture qui fe
met fur un rouet dans une ferrure. Elle forme les
deux bras de la croix, & le rouet en forme le montant.
Pour faire la pleine-croix,on coupe & on lime le
rouet de.longueur; on pratique au milieu, à la hauteur
oîi la pleine-croix eft fendue dans la clé, Un trou
avec un inftrument de la longueur d’une ligne & demie
, & de l’épaiffeur de la fente de la clé. On fend
à la même hauteur les deux bouts du rouet ; on tourne
le rouet félon qu’il eft tracé, & on le met en place
pour le faire aller dans les fentes de la clé. Puis
on l’ôte , & on pique fur une platine de fer doux,
battu, mince, droit fur le palaftre, tout autour, dehors
& dedans, avec une pointe, marquant le lieil
du trop, afin d’épargner une rivure. Enfuite on marque
pareillement les fentes du bout du rouet, afin de
nepaslesfendre dans la platine. C ’eftparces deux ex*.
trémïtés que les deux faucillons fe tiennent. Pour la
folidité, on ménage un tenon au faucillon de dedans.
La platine ainfi piquée, on l’ouvre jufqu’au droit des
piés, épargnant les tenons. Cela fait, on place le
rouet en courbant en-dedans les piés dans la pleine-
croix , & l’on fait entrer la rivure de derrière dans
les trous du rouet ; l’on redreffe les piés du rouet ; on
coupe la pleine-croix à la hauteur des fentes de la clé;
on la lime doucement ; on la remet & elle eft finie.
Il y a des pleines-croix renverfées en-dehors, &
ce font celles oîi le faucillon de dehors eft renverfé.
Elles fe font comme les pleines-croix renverfées en-
dedans , excepté que les viroles font pofées fur le
dehors du rouet, & que l’onalaiffé le faucillon de dehors
plus haut.
Des pleines-croix renverfées en-dedans, & ce font
celles oîi le faucillon de dedans eft renverfé. Elles fe
font comme les pleines-croix fimples, excepté que le
faucillon du dedans doit être renverfé, & qu’il faut,
avoir deux viroles faites exprès de l’épaifleur de la
renverfure, entre lefquelles on place le faucillon de
dedans. On rabat doucement & à petits coups de marteau
, ce qui doit être renverfé, en commençant par
le milieu. De peur de corrompre le fer, on remue
plufieurs fois la renverfure pleine,on la lime & paffe
dans la clé.
On dit qu’une pleine-croix eft renverfée en-dehors
& en-dedans, lorfque les deux faucillons font ren-
verfés.
On appelle pleine-croix en fond de cuve à bâton
rompu, celle qui eft montée fur un fond de cuve à
bâton rompu. Pleine-croix en fond de cuve fimple,
celle qui eft montée fur un rouet en fond de cuve
fimple.
Il faut à la pleine-croix haftée en-dehors & renverfée
en-dedans, quatre viroles, deux pour la ha-
fture & deux pour la renverfée ; l’une des viroles de
dehors fera haftée,& celle de dedans fera toute quarrée
par-deffus.
La pleine-croix haftée en-dedans &C renverfée en-
dehors fe fait comme la précédente , excepté que
l ’une des viroles du dedans doit être haftée, ô£ celle
de dehors toute quarrée par-deffus.
La pleine-croix haftée en-dedans eft celle dont le
renverfement double forme deux angles ; elle fe fait
comme la renverfée avec deux viroles, excepté que
la virole de deffus doit être affez épaifle pour y pratiquer
une feuillure quarrée, limée juftement de la
hauteur de la fente de la clé. C’eft fur cette virole
que la pleine-croix fe pliera , fe haftera à petits coups
de marteau ; on la leftera enfuite avec un petit cilè-
let quarré par le bout.
Les pleines-croix haftées en-dehors & en-dedans fe
font de la même maniéré ; il faut aux pleines-croix
haftées en-dedans mettre les viroles en-dedans du
rouet & aux pleines-croix haftées en-dehors mettre
les viroles en-dehors du rouet,
PLEION ou PAILLASSON, ( Jardinage. ) voyez
P a il l a s s o n .
PLEMMYRE ou PLEMMYRIUM, ( Géog. anc.)
promontoire de S icile, fur la côte orientale, vis-à-
vis de Syracufe, dont il formoit le port. Virgile,
Æneid. l.I I I . verf. C j j . Thucydide, l. VII. parlent
de ce promontoire; on l’appelle aujourd’hui Cabodi
majfa Olivieroe ou d'Olivero. Il y avoit fur ce promontoire
un château qui appartenoit aux Syraculàins.Virgile
appelle ce cap Undofum à caufe que le pays eft
marécageux, f D .J .)
PLEMPE, 1. f. ( Marine. ) c’eft une forte de petit
bateau de pêcheur.
PLÉNIER, adj. (Gramm. & Théolog. ) ce qui eft
plein ou cqmplet ; ainfi l’on d it, le pape accorde des
indulgences plénier es , c’ eft-à-dire des remiflions pleines
oc entières des peines dues à tous les péchés.
Voyez In d u l g e n c e ,
Ce mot eft forme du latinplenarius, dzplenus, plein.
Plénier, fe dit aufli dans l’hiftoire eccléfiaftique,
d un concile général oecuménique. Ainfi S. Auguftin
dit que la queftion du baptême des hérétiques avoit
etc decidee dans un concile plénier, ce que la plupart
des Théologiens entendent du premier concile général
de N icée, qui avoit ftatué qu’on ne rebaptiferoit
que ceux qui avoient été baptifés par des hérétiques
qui avoient corrompu la forme du baptême ; & en
ce fens plénier fignifieroit la même chofe que général
OU univerfel. Voyez CONCILE.
PLÉNIPOTENTIAIRE, f. m. (Hiß. mod.) celui
qui a une commiflion ou un plein pouvoir d’agir. Ce
mot eft compofé deplenus , plein, & potentia pouvoir
, puiflance.
On le dit particulièrement des ambaffadeurs que
les rois envoient pour traiter de paix , de mariages
ou autres affaires importantes. Voyez Min is t r e A mb
a s sa d e u r .
La première chofe qu’on examine dans les conférences
de paix, c’eft le pouvoir des plénipotentiaires*
Voyez T r a it é .
PLÉNIPRÉBENDÉ, f. m. (Jurifprud.) c’eft celui
qui a une prebende entière , à la différence de quelques
chanoines ou chapelains qui n’ont qu’une demi-
prebende, & qu’on appelle à caufe de cela femi-pré-
bendés. Voyez PRÉBENDE. (A )
PLÉNITUDE, f. f. (GrammA voyez PLÉTHORE.
Pl é n itu d e , (Critique facrée.) ce mot fignifie dans 1 Ecriture i ° ce qui remplit quelque choie, Domini
eft “ "a & plenitudo ejus, If. xxiij. , . la terre & tout
ce qu’elle contient eft au Seigneur ; ainfi plenitudo
maris eft tout ce que la mer renferme : z° l’abondance
de quelque chofe, de,frugibusterras, & de plenitudine
ejus, Deut. xxxü j. 16. 30 la perfection & l’accom-
phffement, plenitudo & fapientia , ejl timere Deum ,
Eccl.y. 20. la perfection de la fageffe confifte à craindre
Dieu : 40 une affemblée nombreufe , in plenitudine
fancîâ admirabitur, Eccl. xxiv. 3. on l’admirera
dans l’affemblée des faints : 50 ce qui eft entier, toi-
lit plenitudinem ejus à vefiimento , Matth, ix. 1 G. la
piece neuve mife à un habit vieux emporte l’endroit
même qu’elle devoit remplir, déchire l’habit davantage.
(D . J . )
PLÉONASME , f. m. (Gramm.') c’eft une fùuire
de conftruCtion , dil'ent tous les Grammairiens ,°qui
eft oppofée à Vellipfe ; elle fe fait lorfque dans Je dif-
cours on met quelque mot qui eft inutile pour le
fens, & qui étant ôte , laiffe le fens dans fon intégrité.
C’eft ainfi que s’en explique l’auteur du Manuel des
Grammairiens, part. I. ch. xiv. n. G. « II yzpléonafme,
» ditM. duMarfais, article figure, lorfqu’il y a dans la
» phrafe quelque mot fuperflu,enforte que le fens n’en
» feroit pas moins entendu, quand cemotne feroitpas
» exprimé ; comme quand on dit, je l ’ai vu de mesyeux,
»je L'ai entendu de mes oreilles , j'irai moi-jnême • mes
»y eu x, mes oreilles, moi-même font autant de pléonaf-
» mes ». Siii* le vers 21 z du I. livre de l’Enéide, talia
voce refert, &c. Servius s’explique ainfi, 7r\tovcLrp.oc
eft , qui fit quotiens adduntur fuperflua , ut alibi, vo-
cemque his auribus haufi : Terentius, his oculis ego-
met vidi. 6
C’eft d’apres cette notion généralement reconnue
que l’on a donné à cette figure le nom de pléonafme,
qui eft grec ; vMovaa[xoç, de vMovd^uv., redundare ou
abundare ; R. 7r\ioç, plenus ; enforte que le mot de
pléonafme fignifie ou plénitude ou fuperfluité. Si on
l’entend dans le premier fens , c’eft une figure qui
donne au difeours plus de grâce, ou plus de netteté,
ou plus de force , i[x<pa.mv. Si on le prend dans le fécond
fens, c’eft un véritable défaut qui tend à la bat-
tologie. Voyez Ba t t o l o g i e .
Il me femble i ° que c ’eft un défaut dans le lan-
gage grammatical de défigner par un feul & même