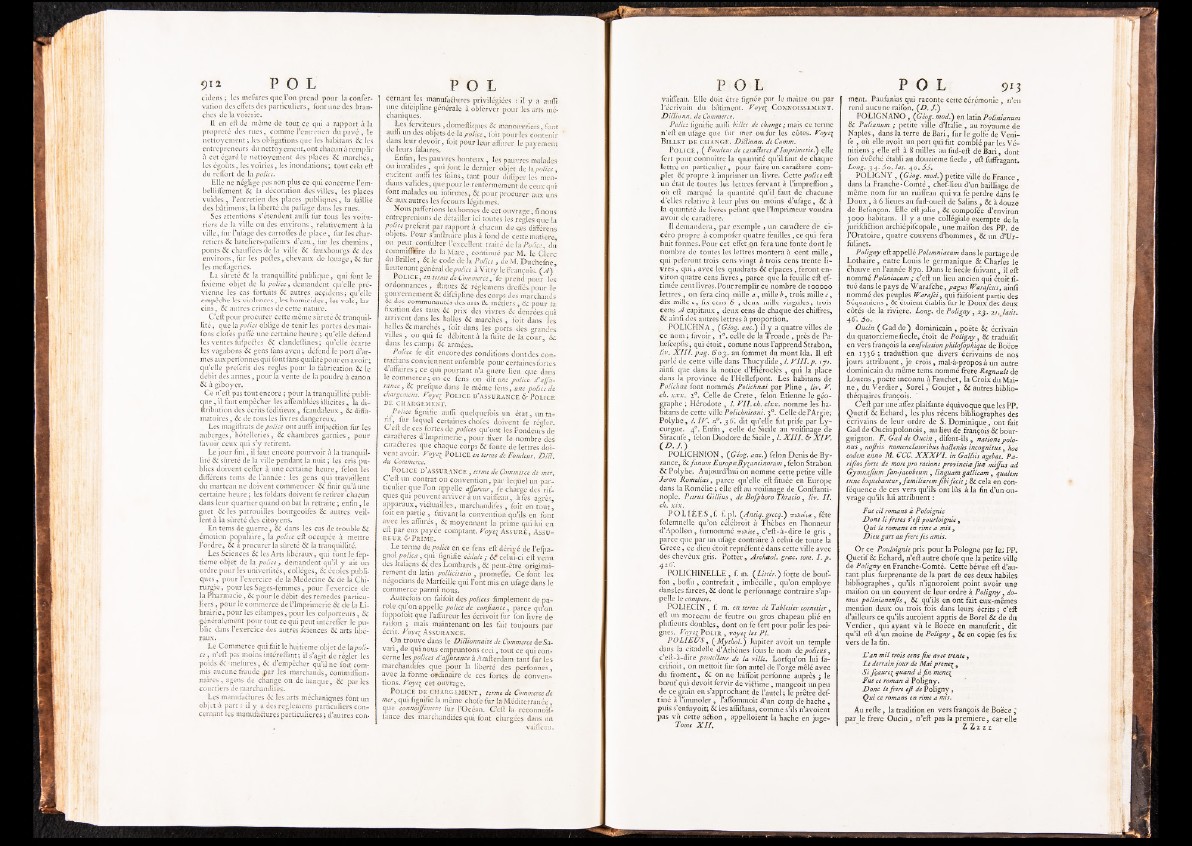
cidens ; les mefures que l’on prend pour la confer-
vation des effets des particuliers, font une des branches
de la voierie.
Il en eft de même de tout ce qui a rapport à la
propreté des rues, comme l’entretien du pavé , le
nettoyement ; les obligations que les habitans 8c les
entrepreneurs du nettoyement, ont chacun à remplir
à cet égard le nettoyement des places 8c marchés ,
les égouts, les voiries, les inondations ; tout cela eft
du reffort de la police.
Elle ne néglige pas non plus ce qui concerne l’em-
belliflèment 8c la décoration des villes, les places
vuides, l’ entretien des places publiques, la faillie
des bâtimens-, la liberté du partage dans les rues.
Ses attentions s’étendent auffi fur tous les voituriers
de la ville ou des environs , relativement à la
ville, fur l’ufage des carroffes de place, fur les charretiers
8c bateliers-pafleurs d’eau, fur les chemins,
ponts 8c chauffées de la ville 8c fauxbourgs 8c des
environs, fur les portes, chevaux de louage, 8c fur
les meflageries.
La sûreté 8c la tranquillité publique, qui font le
fixieme objet de la police, demandent qu’elle prévienne
les cas fortuits 8c autres acçidens ; qu’elle
empêche les violences, les homicides, les vols, larcins
, 8c autres crimes de cette nature.
C’eft pour procurer cette même sûreté Sc tranquillité
, que la police oblige de tenir les portes des mai-
ions clofes parte une certaine heure ; qu’ elle défend
les ventes fufpe&es 8c clandeftines; qu’elle écarte
les vagabons 8c gens fans aveu ; défend le port d’armes
auxperfonnes qui font fans qualité pour en avoir;
qu’elle prefcrit des réglés pour la fabrication 8c le
débit des armes, pour la vente de la poudre à canon
8c à giboyer.
Ce n’eft pas tout encore ; pour la tranquillité publique
, il faut empêcher les affemblées illicites, la di-
rtribution des écrits féditieux , fcandaleux, 8c diffamatoires
, 8c de tous les livres dangereux.
Les magiftrats de police ont auffi infpeclion fur les
auberges, hôtelleries, 8c chambres garnies, pour
lavoir ceux qui s’y retirent.
Le jour fini, il faut encore pourvoir à la tranquillité
8c sûreté de la ville pendant la nuit ; les cris publics
doivent ceffer à une certaine heure, félon les
différens tems de l’année : les gens qui travaillent
du marteau ne doivent commencer 8c finir qu’à une
certaine heure ; les foldats doivent fe retirer chacun
dans leur quartier quand on bat la retraite ; enfin, le
guet 8c les patrouilles bourgeoifes 8c autres veillent
à la sûreté des citoyens.
En tems de guerre, 8c dans les cas de trouble 8c
émotion populaire, la police eft occupée à mettre
l’ordre, 8c à procurer la sûreté 8c la tranquillité.
Les Sciences 8c les Arts libéraux, qui font le fep-
tieme objet de la police, demandent qu’il y ait un
ordre pour les univerlités, collèges, 8c écoles publiques
, pour l’exercice de la Médecine 8c de la Chirurgie,
pour les Sages-femmes, pour l’ exercice de
la Pharmacie, 8c pour le débit des remedes particuliers
, pour le commerce de l’Imprimerie 8c de la L ibrairie
, pour les eftampes, pour les colporteurs, 8c
généralement pour tout ce qui peut intéreffer le public
dans l’exercice des autres fciences 8c arts libéraux.
Le Commerce qui fait le huitième objet de la police
, n’efl pas moins intéreffant ; il s’agit de régler les
poids 8c • mefures, 8c d’empêcher qu’il ne foit commis
aucune fraude #ar les marchands, commiffion-
naires , agens de change ou de banque, 8c par les
courtiers de marchandifes.
Les manufattures 8c les arts méchaniques font un
objet à part : il y a desreglemens particuliers concernant
les manufactures particulières ; d’autres concernant
les manufactures privilégiées : il y a auffi
une dilcipline générale à obferver pour les arts mé-
chamques.
Les ferviteurs , domeftiques 8c manouvriers, font
auffi un des obj ets« de la police, foit pour les contenir
; dans leur devoir, foit pour leur aflûrer le payement
j de leurs falaires.
Enfin, les pauvres honteux, les pauvres malades
ou invalides , qui font le dernier objet de la police,
excitent auffi fes foins, tant pour diffiper les men-
dians valides, que pour le renfermement de ceux qui
font malades ou infirmes, 8c pour procurer aux uns
8c aux autres lesfecours légitimes.
Nous partirions les bornes de cet ouvrage, fi nous
entreprenions de détailler ici toutes les réglés que la
police prefcrit par rapport à chacun de qes différens
objets. Pour s’inrtruire plus à fond de cette matière,
on peut confulter l’excellent traité delà Police, du
commiflsire de la Mare, continué par M. le Clerc
411 B rillet, 8c le code de la Police , de M. Duchefne,
lieutenant général de police à Vitry le François. (A )
Po l ic e , en terme de Commerce, fe prend pour les
ordonnances , ftatuts 8c réglemens drefles pour le
gouvernement 8c difcipline des corps des marchands
8c des communautés des arts 8c métiers , 8c pour la
fixation des taux 8c prix des vivres 8c denrées qui
arrivent dans les halles 8c marchés , loit dans les
halles 8c marchés, foit dans les ports des grandes
villes , ou qui fe débitent à la fuite de la cour, 8c
dans les camps 8c armées.
Police fe dit encore des conditions dont des con-
traéians conviennent enfemble pour certaines fortes
d’affaires ; ce qui pourtant n’a guere lieu que dans
le commerce ; en ce fens on dit une police- d'affu-
rance, 8c prefque dans le même fens, une police de
chargement. Foyc{ POLICE D’ASSURANCE & POLICE
DE CHARGEMENT.
Police fignifîe auffi quelquefois un état, un tarif,
fur lequel certaines chofes doivent fe régler.
C-eft de ces fortes de polices qu’ont les Fondeurs de
cara&eres d’imprimerie, pour fixer le nombre des
carafteres que chaque corps 8c fonte de lettres doivent
avoir. V?ye{ P o l ic e en terme de Fondeur. Dict.
du Commerce.
P o l ic e d ASSURANCE -, terme de Commerce de mer.
Ç’eft un contrat ou convention, par leqïiel un particulier
que l’on appelle ajjiifeur, fe charge des risques
qui peuvent arriver à un vairtTeau, à fes agrès
apparaux, vicluailles, marchandifes , foit en tout \
foit en partie , fuivant la convention qu’ils en font
avec les affurés, 8c moyennant la prime qui lui en
eft par eux payée comptant. Voye^ A s s u r é , A ssu r
e u r & Pr im e .
Le terme de police en ce fens eft dérivé de l’efpa-
gnol polica, qui fignifîe cédule; 8£ celui-ci eft venu
des Italiens 8c des Lombards, 8c peut-être originairement
du latin pollicitatio , promeflè. Ce font les
négocians de Marfeille qui l’ont mis en ufage dans le
commerce parmi' nous.
Autrefois on faifoit des polices fimplement de parole
qu’on appelle police de confiance, parce qu’on
fuppofoit que l’affureur les écrivoit fur fon livre de
raifon ; mais maintenant on les fait toujours par
écrit. Voye^ A s su r a n c e .
On trouve dans le Dictionnaire de Commerce deSa-
vari, de qui nous empruntons ceci, tout ce qui concerne
les polices d'afiurance à Amfterdam tant fur les
marchandifes que pour la liberté des perfonnes,
avec la forme ordinaire de ces fortes de conventions.
Foye^ cet ouvrage.
Po l ic e d e c h a r g em e n t , terme de Commerce de
mer, qui fignifie la même chofe fur la Méditerranée,
que connoijjement fur l’Océan. C’eft la- reconnoif-
fance des marchandifes qui font chargées dans un
vaifieau.
vaifieau. Elle doit être fignée par le maître ou par
l ’écrivain du bâtiment. Voye{ C o n n o is sem e n t .
Diclionn. de Commerce.
Police fignifie auffi billet de change; mais ce terme
n’eft en ufage que fur mer ou fur les côtes. Voye[
Bil l e t d e c h a n g e . Diclionn. de Comtn.
POLICE, ( Fondeur de caractères d'imprimerie?) elle
fert pour connoître la quantité qu’il faut de chaque
lettre en particulier, pour faire un carattere complet
6c propre à imprimer un livre. Cette police eft
un état de toutes las lettres fervant à l’impreffion ,
où eft marqué la quantité qu’il faut de chacune
d’elles relative à leur plus ou « moins d’ufage, 8c à
la quantité de livres pefant que l’Imprimeur voudra
avoir de caraétere.
Il demandera, par exemple » un cara&ere de ci-
céro propre à compofer quatre feuilles, ce qui fera
huit formes. Pour cet effet „on fera une fonte dont le
nombre de toutes les lettres montera à cent mille,
qui peferont trois cens vingt à trois cens trente livres
, qui, avec les quadrats 8c efpaces , feront environ
quatre cens livres , parce que la feuille eft ef-
timée cent livres. Pour remplir ce nombre de iooôoo
lettres , on fera cinq mille a , mille b , trois mille c ,
dix mille e, fix Cens & , deux mille virgules, trois
cens A capitaux, deux cens de chaque des chiffres,
8c ainfi des autres lettres à proportion.
POLICHNA , (Géog. anc.) il y a quatre villes de
ce nom ; favoir, i°. celle de la Troade , près de Pa-
læfcepfis, qui étoit, comme nous l’apprend Strabon,
liv. X I I I . pag. 6 03. au fommet du mont Ida. Il eft
parlé de cette ville dans Thucydide, /. VIII.p . i j i .
ainfi que dans la notice d’Hieroclès , qui la place
dans la province de l’Hellefpont. Les habitans de
Polichna font nommés Polichncei par Pline , liv. V.
ch. xxx. i° . Celle de Cre te, félon Etienne le géographe
; Hérodote , l. VII. ch. clxv. nomme les habitans
de cette ville Polichnitani. 30. Celle del’Argie;
P o lyb e, L IV . n°. 3 6'. dit qu’elle fut prife par Lycurgue.
40. Enfin , celle de Sicile au voifinage de
Siracufe, félon Diodore de Sicile, l. X I I I . & X IV . BH POLICHNION, {Géog. anc?) félon Denis de Byzance,
8c fanum EuropceBy\antinorum, félon Strabon
8c Polybe. Aujourd’hui on nomme cette petite ville
Jeron Romelias, parce qu’elle eftfituée en Europe
dans la Romélie ; elle eft au voifinage de Conftanti-
nople. Petrus Gillius, de Bofphoro Thracio, liv. II.
ch. xix.
PO L IÉ E S , f. f. pl. (Antiq. grecq?) noXnia., fête
folemnelle qu’on célébrait à Thèbes en l’honneur
d’Apollon, furnommé noxioç, c’eft-à-dire le gris ,
parce que par un ufage contraire à celui de toute la
Grece, ce dieu étoit repréfenté dans cette ville avec
des cheveux gris. Potter, Archaol. grcec. tom. I. p.
42C.
POLICHINELLE , f. m. (Littèr.) forte de bouffon
, boflu , contrefait , imbécille, qu’on employé
dans les farces, 8c dont le perfonnage contraire s’appelle
le compere.
POLIECIN, f. m. en terme de Tabletier cornetier,
eft un morceau de feutre ou gros chapeau plié en
plufieurs doubles, dont on fe fert pour polir les peignes.
Voye[ Po l ir , voye^ les P l.
PO L IE D S , (-Mythol.) Jupiter avoit un temple
dans la citadelle d’Athènes fous le nom de polieus,
. c’çft-û“dire protecteur de la ville. Lorfqu’on lui fa-
crifioit, on mettoit fur fon autel de l’orge mêlé avec
du froment, & on ne laiffoit perfonne auprès ; le
boeuf qui devoit fervir de viélime, mangeoit un peu
de ce grain en s’approchant de l’autel; le prêtre def-
tiné à l’immoler , l’afïommoit d’un coup de hache ,
puis s’enfuyoit; & les affiftans, comme s’ils n’avoient
pas vu cette action, appelaient la haçhe en juee-
Torne X I I . '
ment. Paufanias qui raconte cette cérémonie , n’en
rend aucune raifon. (D. J.)
POLIGNANO , (Géog. mod.) en latin Polinianum
8c Pulianum ; petite ville d’Italie , au royaume de
Naples, dans la terre de Bari, fur le golfe de Veni-
fe , oîi elle avoit un port qui fut comblé par les V énitiens
; elle eft à 8 milles au fud-eft de Bari, dont
fon évêché établi au douzième fiecle , eft fuffragant.
Long. 3 4 . 5o. lat. 40. 65.
POLIGNY , (Géog. mod.) petite ville de France,
dans la Franche-Comté , chef-lieu d’un bailliage de
même nom fur un ruiffeau qui va fe perdre daps le
D o u x , à 6 lieues au fud-oueft de Salins , 8c à douze
de Befançon. Elle eft jo lie, 8c compofée d’environ
3000 habitans. Il y aune collégiale exempte delà
jurifdi&ion archiépifcopale, unemaifon des PP. de
l’Oratoire, quatre couvens d’hommes, & un d’Ur-
fulines.
Poligny eft appellé Polemniacum dans le partage de
Lothaire, entre Louis le germanique & Charles le
chauve en l’année 870. Dans le fiecle fuivant, il eft
nommé Poliniacum ; c’eft un lieu ancien qui étoit fi-
tué dans le pays de Warafehe, pagus Warafcus, ainfi
nommé des peuples Warafci, qui faifoient partie des
Sequaniens , 8c étoient établis fur le Doux des deux
côtés de la riviere. Long, de Poligny, 23 . zi. latit. 4<f. io.
ùucin ( Gad de ) dominicain , poète & écrivain
du quatorzième fiecle, étoit de Poligny, 8c traduifit
en vers françois la confolation philofophique de Boëce
en 1336; tradu&ion que divers écrivains de nos
jours attribuent, je crois, mal-à-propos à un autre
dominicain du même tems nommé frere Régnault de
Louens, poète inconnu à Fauchet, la Croix du Maine
, du V erdier, S o r e lG o u je t , 8c autres biblio-
théquair es,françois.
C ’eft par une affez plaifante équivoque que les PP.
Quetif 8c Echard, les plus récens bibliographes des
écrivains de leur ordre de S. Dominique, ont fait
Gad de Oucin polonois, au lieu de françois 8c bourguignon.
F. Gad de Oucin, difent-ils , natione polo-
nus , nofiris nomenclatoribus haclenùs incognitus , hoc
eodem anno M. CCC. X X X V I . in Gàlliis agebat. Pa-
rifios forte de more pro ratione provincia fuæ mijfus ad
Gymnajium fan-jacobeum , linguam gallicam, qualem
tune loquebantur, familiarem Jibi fecit ; 8c cela en con-
féquence de ces vers qu’ils ont lûs à la fin d’un ouvrage
qu’ils lui attribuent :
Fut cil romans a Poloignie
Dont li freres s7eft pourloignie ,
Qui le romans en rime a mis ,
Dieu g art au frere fes amis.
Or ce Pouloignie pris pour la Pologne par les PP.
Quetif 8c Echard, n’eft autre chofe que la petite ville
de Poligny en Franche-Comté. Cette bévue eft d’autant
plus furprenante de la part de ces deux habiles
bibliographes, qu’ils n’ignoroient point avoir une
maifon ou un couvent de leur ordre à Poligny, do-
mus polinianenfîs, 8c qu’ils en ont fait eux-mêmes
mention deux ou trois fois dans leurs écrits ; c’eft
d’ailleurs ce qu’ils auroient appris de Borel 8c de du
Verdier, qui ayant vû le Boëce en manuferit, dit
qu’il eft d’un moine de Poligny , 8c en copie fes fix
vers de la fin.
U an mil trois cens f i x avec trente,
Le derrain jour de Mai preneç ,
Si fçaure{ quand à fin mene[
Fut ce roman à Poligny.
Donc le frere eft de Poligny,
Qui ce romam en rime a mis.
Au refte, la tradition en vers françois de Boëce >
par le frere Oucin , n’eft pas la première, ca r elle
Z Z z z z