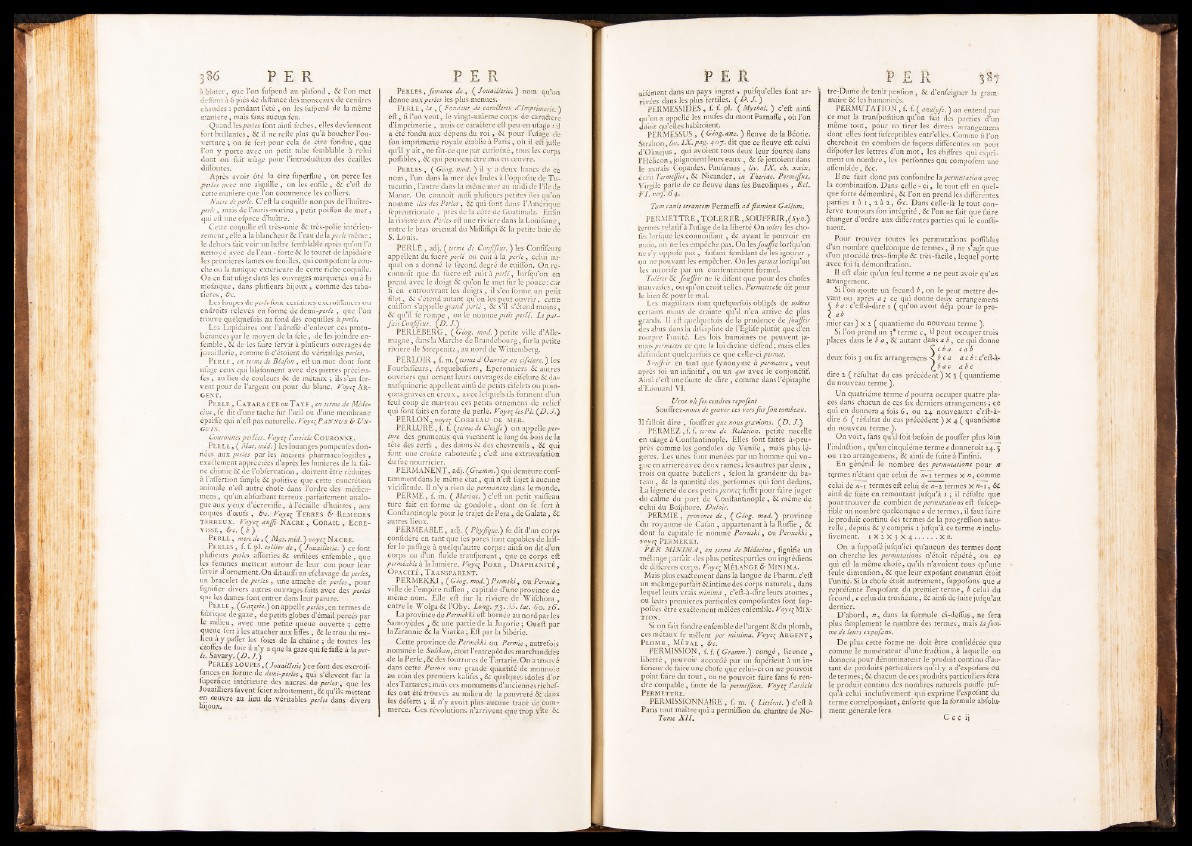
à bluter, que l’on fufpend au délions à 6 pies de diftance des mploafnocneda u, x &de l’coenn dmreest cmhaanudiéersé ,: pmeanids afnant sl’ éatuéc u, no nfe lue.s fufpend de la même forQt burainllda nletse pse, r&les iflo nnet arienlfiei fpelcuhse sq,u e’àll ebso duecvhieern ln’oeunt
lv’eornt uyre p ;o ortne faev efecr tu pno puer tcite ltau bdee fceimreb lfaobnled uàe ,c qeluuei ddiolfnotu otens .fait ufage pour l’introduélion des écailles Après avoir ôté la cire fuperflue , on perce les pceertltees mavanecié ruén qe uaei gl’uoinll ec o, momn elnecs ee lnefsi lceo,l l&ier sc.’ell de Nacre de perle. C’eft la coquille non pas de l’huître-
pqeuril ee,l l munaies edfep le’caeu rdi’sh-umîtarrei.na, petit poiffon de mer, remCeenttte , celolqe uai lllae b elfatn tcrhèse-uurn ie 6c très-polie intérieule
dehors fait voir un lullre 6fec ml’ebalaub dlee laàp prèersl eq um’oênm Tea ; nleest tporyemé iaèvreecs ldaem le’es aouu - ffeouritlele 6sc, qleu tio cuormetp odfee lnatp liad caoirue
Ochne eonu flaai tt uufnaigqeu ed aenxst élersie ouurev rdaeg ecse mttea rrqicuheeté cso oquui àll ela. tmièorleàsïq, u&ec,. dans plufieurs bijoux, comme des tabaendLreosi
tlso urpeelesv dées peernl ef foornmte c deret adienmeis- /e>xwc/reo i,f fqanucee sl’ oonu trouve quelquefois au fond des coquilles kperle. bérLaensc eLsa ppaidra lier ems ooynetn l ’daed rleaf ffec ide’,e ndlee vleesr joceins dprreo etun
jfoeumabilllee,r &ie ,d ceo lmesm fea ifrie c f’éetroviiern àt pdleu fviéeruirtsa boluevs rpaegrleess .de
ufaPgee rcleeu x, qenu it ebrlmaef odne nBelnatf oanv e, ce fdt eusn p mierorte sd oprnétc fieoun-t vfeesn ,t paouu lire due dle’a crgoeunlet uorus 6pco udre dmué tbaluanxc ;. ils s’en ferVoye^
A r g
e n t . / ; PERLE ,-CATARACTE okTaye ,.en terme de Médecéipnaei
f, ffee qduiit nd’’eufnt ep atasc nhaet ufurerl lle’oe. il ou d’une membrane Voye^P a n nu s & U n -
g u i s .
Couronnes perlées. Voye«; Ü article COURONNE.
néePse raul ex ,( Mat. mèd. ) les louanges pompeufes donexactemenpte
arlpeps répcairéleess d ’aanpcrièesn lse sp lhuamrmièarecso ldoeg liaft efasi ,
àn el ’acfhfiemrtiieo 6nc f dime pl’loeb 6fce rpvoafîiitiovne, qduoei vceenttt eê trceo nrécdréutiitoens maneimnsa,l eq un’’eufnt aabuitorerb cahnot ftee rdreaunsx lp’oarrdfariet edmees nmt aéndaicloa
cgouqe uaeusx dy’eoeuuxf sd ’,é c&recv. iVffoe.y, eà[ l’écaille d’huitres , aux T e r r e s & R e m e d e s
t e r r e u x . Voye^ aujji Nacre , C o r a i l ,. E c r e v
i s s e , &c. ( b )
P e r l e , mere de, ( Mat. mèd. ) voye^ N a c r e .
pluPfieerulrse s , f. f. pl. collier de, ( Jouaillerie. ?) ce font les femmepse rmlese tateflnbtr taieust o6uc r ednef illéeeusr ecnofeum pbolue r, lqeuuer fervir d’ornement. On ditaufliun efclavage de perles, ufing nbifriaecr edleivt edres paeurtlreess , ouunvera agtetsa cfahiet sd aev epce rdleess, pour perles que les dames font entrer dans leur parure.
fabPrieqrulee d ,e (gGaazleer, ied.e') p oenti atsp gpleolblee ps edr’léems, aeinl pteerrmcéess p daer qleu emuiel iefeur ,t àa lvees ca tutanceh epre atuitxe lqilufeesu ,e &ou lve etrroteu ;d uc emttie
éliteouff eas y d pea floieire ille sn ’yfo aie qs udee l al ag aczhea qînuei f;e d feal fteo uàt elas pleers
le. Savary. (D . J.) n ^ M y
fanPceesr leens f loormu ep edse , ( Jouaillerie) ce font des exoroif- fuperficie intérieured edmeis- pnearlcerse, sq, udei s’élèvent fur la Jouailliers favent fcier adroitement, perles', que les en oeuvre au lieu de véritables 6c qu’ils mettent bijoux. perles dans divers
PERLES, femence de , ( Jouaillerie. ) nom qu’on
donne aux perles les plus menues. *
PERLE , la , ( Fondeur de caractères dlImprimerie.^
eft, fi l’on veut, le vingt-unieme corps de caraélere
d’imprimerie , mais ce cara&ere eft peu en ufage : il
a été fondu aux dépens du r o i , 6c pour l’ufage de
fon imprimerie royale établie à Paris ,-oîi il eft jufte
qu’il y ait, ne fut-ce que par curioiité., tous les corps
poflibles, 6c qui peuvent être mis en-oeuvre.
Perles , ( Géog. mod. ) il y a deux bancs de ce
nom, l’un dans la mer des Indes à l’oppofite de Tu-
tucurin, l’autre dans la même mer au midi de Pîlede
Manar. On cônnoît aufli pluliéurs petites îles qu’on
nomme îles des Ferles , 6c qui font dans l’Amérique
feptentrionale , près de la côte de Guatimala. Enfin
la riviere aux Ferles eft une riviere dans laLouifiane,
entre le bras oriental du Mifliflipi 6c la petite baie de
S. Louis.
PERLÉ , adj. ( terme de Confifeur. ) les Confifeurs
appellent du fucre perlé ou cuit à la perle , celui auquel
on a donné le fécond degré de cuiflbri. On re-
connoît que du fucre eft cuit à perlé, lorfqu’on en
prend avec le doigt 6c qu’on le met fur le pouce : car
fi en entrouvrant les doigts, il s’en forme un petit
filet, 6c s’étend autant qu’on les peut ouvrir, cette
cuiffon s’appelle grand perlé , 6c s’il s’étend moins,
6c qu’il fe rompe , on le nomme petit perlé. Le parfait
Confifeur. (.D .J .)
PERLEBERG, ( Géog. mod. ) petite ville d’Allemagne,
dans la Marche de Brandebourg, fur la petite
riviere de Strepenitz, au nord de "NVittemberg.
PERLOIR , f. m. ( terme d'Ouvrier-en cifelure.') les
Fourbifleurs, Arquebufiers, Eperonniers 6c autres
ouvriers qui ornent leurs ouvrages de cifelure 6c da-
mafquinerie appellent ainfi de petits cifelets ou poinçons
gravés en creux, avec lefquels ils forment d’un
feul coup de marteau ces petits ornemens de relief
qui font faits en forme de perle. Voyelles Pl. (D . ƒ.)
PERLON, voye{ C orbeau de mer.
PERLURE, f. f. (terme de Chajfe ) on appelle per-
lure des grumeaux qui viennent le long du bois de la
tête des cerfs , des. daims 6c des chevreuils , 6c qui
font une croûte raboteufe ; c’eft une extrayafation
du fuc nourricier.
PERMANENT, adj. (GrammJ) qui demeure conf-
tamment dans le même état ., qui n’eft fujetà aucune
viciffitude. Il n’y a rien de permanent dans le monde.
PERME, f. m. ( Mariné. ) c’ eft un petit vaiffeau
turc fait en forme de gondole , dont on fe fert à
Conftantinople pour le trajet dePera, de Galata , 6c
autres lieux.
PERMÉABLE, adj. ( Phyjique.) fe dit d’un corps
confidéré en tant que fes pores font capables de laif-
fer le paflage à quelqu’autre corps : ainfi on dit d’un
corps nu d’un fluide tranfparent,' que ce corps eft
perméable k lalumiere. Voye^ Po r e , D iàPHANITÉ,
O pacité , T ransparent.
PERMEKKI, (Géog. mod. ) Permski, où Permie J
ville de l ’empire ruifien, capitale d’une province de
même nom. Elle eft fur la riviere de Wlfchora,
entre le V o lg a 6c l’Oby. Long. 7 3 .55. lac. 6b. 2 6 .
La province de Permekki eft bornée au nord par les
Samoyèdes , 6c une partie de la Jugorie ; Oueft par
laZirannie & la Viatka ;-Eft par la Sibérie.
Cette province de Permekki ou Permie , autrefois
.nommée le Solikan, étoit l’entr.epôtdes marchandifes
de laPerfe, & des fourrures de Tartarie. On a trouvé
dans cette Permie une grande'quantité de morinoie
au coin des premiers kalifes, & quelques idoles d’or
des Tartares.; mais ces monumens d’anciennes rithef-
.fes ont été trouvés au milieu de la pauvreté de dans
les deferts ; il n’y avoir plus aucùne trace de Com-
merce* Ce& révolutions n’arrivent que trop vite de
aifément dans un pays ingrat, puifqu’elles font arrivées
dans les plus fertiles. ( D. J. ).
PERMESSIPES , f. f. pl. ( Mythol. ) c’eft ainfi
qu’on a appellé les mufes du mont Parnaffè, où l’on
difoit qu’elles habitoient.
PERMESSUS , ( Géog. anc. ) fleuve de la Béotîe.
Strabon, liv. IX.pag. 407. dit que ce fleuve eft celui
d’Olmejus , qui avoient tous deux leur fource dans
l’Hélicon, joignoientleurs eaux , 6c fe jettoient dans
le marais Çopaïeles. Paufanias , liv. IX . ch. xxix.
écrit Termeffus, 6c Nicander, in Theriac. Permeffus.
Virgile parle de ce fleuve dans fes Bucoliques, F cl.
V I. verf. 64.
Tum canit errantem Permeffi ad fiumina Gallurn.
PERMETTRE, TOLERER, SOUFFRIR, (Syn.)
fermes relatif à l’ufage de la liberté On toléré les choies
lorfque les connoiflant, 6c ayant le pouvoir en
main, on ne les empêche pas. On les foujfre lorfqu’on
ne s’y oppofe pas , faifant femblant de les ignorer ,
ou ne pouvant les empêcher. On les permet lorfqu’on
les autorife par un confentement formel.
Tolérer 6c foujfrir ne fe difent que pour des chofes
mauvaifes, ou qu’on croit telles. Permettre fe dit pour
le bien & pour le mai.
Les magiftrats font quelquefois obligés de tolérer
certains maux de crainte qu’il n’en arrive de plus
grands. Il eft quelquefois de la prudence de foujfrir
des abus dans la dilcipline de l’Egiife plutôt que d’en
rompre l’unité. Les lois humaines ne peuvent jamais
permettre ce que la loi divine défend ; mais elles
défendent quelquefois ce que celle-ci ptrmet.
Souffrir ' en tant que fynonyme à permettre , veut
après Toi un infinitif, ou mi que avec le conjonûif.
Ainfi c’eft une faute de dire , comme dans l’épitaphe
d’Edouard VI.
Urne où fes cendres repofent
Souffrez-noi/s de-graver ces vers furfoh tombeau.
Il falloit dire , fouffrez que nous gravions. (D . ƒ.)
. PERMEZ , f. f. terme de Relation. petite nacelle
en ufage à Conftantinople. -Elles font faites à-peu-
près comme les gondoles de Venife , mais plus légères.
Les unes font menées par un homme qui vogue
en arriéré avec deux rames ; les autres par d eux,
trois ou quatre bateliers , feion la grandeur du bateau
, 6c la quantité des, perfonrtes qui font dedans.
La légèreté de ces petitsperrne^fuffit pour faire juger
du calme du port de Conftantinople, & même de
celui du Bofphore. Duloir.
PERMIE , province de, ( Géog. mod. ) province
du royaume de Cafan , appartenant à la Riiflie , 6c
dont la capitale fe nomme Perruski, ou Permekki,
yoye[ Perm ekk i.
PER MINIM A , en terme de Médecine , fignifie un
mélange parfait des plus petites parties ou ingrédiens
de difïerens corps. Voye^ Mélange & Min im a .
Mais plus exaôement dans la langue de Pharm. c’eft
un mélangëparfait&intimedes corps naturels, dans
lequel leurs vrais minima , c’eft-à-dire leurs atomes,
ou leùrs premières particules compofantes font fup-
pofées être exactement mêlées enfemble. Voye^ Mixt
io n .
Si on fait fondre enfemble de l’argent 6c du plomb,
ces métaux fe mêlent per minima. Voye1 ARGENT,
Plomb , Mét al , &c.
PERMISSION, f .f. ( Gramm.') congé, licence ,
liberté , pouvoir accordé par un fupérieur à un inférieur
de faire une chofe que celui-ci ou ne pouyoit
point faire du tout, ou ne pouvoit faire fans fe rendre
coupable, faute de la permiffion. Voye£ Ü article
Permettre.
PERMISSIONNAIRE , f. m. ( Littéral. ) c’eft à
Paris tout maître qui a permiffion du chantre de No-
Tome X I I .
tre-Dame ce tenir penfion, 6c d’enleigher la grammaire
& les humanités.
PERMUTATION, f. f. ( a n a ly fe on entend par
ce mot la tranfpofition qu’on fait des parties d’un
même tout, pour en tirer les divers arranoemens
dont elles font fufceptibles entr’elles. Comme fi l’on
cherchoit en combien de façons différentes on peut
difpofer les lettres d’un mot, les chiffres qui expriment
un nombre, les perfonrtes qui compofent unè
affemblée, 6cc.
H ne faut donc pas confondre la permutation avec
la combinaifon. Dans celle - c i , le tout eft en oueR
que forte démembré, 6c l’on en prend les différentes
parties 1 à 1 , a à i , &c. Dans celle-là le tout con-
lerve toujours fon intégrité, 6c l’on ne fait que fairé
changer d’ordre aux différentes parties qui le confti-
tuent.
Pour trouver toutes les permutations poflibles
d’un nombre quelconque de termes, il ne s’agit que
d’un procédé très-fimple 6c très-facile, lequel porté
avec foi fa démonftration.
Il eft clair qu’un feul terme a ne peut avoir qu’un
arrangement.
Si l’on ajoute un fécond b, on le peut mettre devant
ou après a ; ce qui donne deux arrangement
5 b a: c’eft-à-dire 1 ( qu’on ayoit déjà pour le preé
ab
mier cas ) X z ( quantieme du nouveau terme ).
Si l’on prend un 3* terme c , il peut occuper trois
places dans le b a , & autant dans a b , ce qui donne
\ c b a c a b
deux fois 3 ou fix arrangemens ^.b c a acb: c’eft-à-
I b a c ab c
dire z ( réfultat du cas précédent ) X 3 ( quantieme
du nouveau terme ).
Un quatrième terme d pourra occuper quatre places
dans chacun de ces fix derniers arrangemens ; ce
qui en donnera 4 fois 6 , ou 14 nouveaux : c’eft-à-
dire 6 ( réfultat du cas précédent ) X 4 ( quantième
du nouveau terme ).
On v o it , fans qu’il foit befoin de pouffer plus loin
l’induftion, qu’un cinquième terme e donneroit 24.5
ou 110 arrangemens, & ainfi de fuite à l’infini.
En général le nombre des permutations pour n
tqrmes n’étant que celui de n-\ termes X comme
celui de n- 1 termes eft celui de n- 2 termes x n - i , 6c
ainfi de fuite en remontant jufqu’à 1 ; il réfulte que
pour trouver de combien de permutations eft fufeep-
tjble Un nombre quelconque u de termes, il faut faire
. le produit continu des termes de la progreffion naturelle,
depuis & y compris 1 jufqu’à ce terme n inclu-
fivèment. 1 x 2 X 3 X 4 ............Xn.
On a fuppofé jufqu’ici qu’aucun des termes dont
on cherche les permutations n’étoit répété, ou ce
qui eft la même chofe, qu’ils n’avoient tous qu’une
feule dimenfion, 6c que leur expofant commun étoit
l’unité. Si la chofe étoit autrement, fuppofons que a
repréfente l’expofant du premier terme, b celui du
fécond, c celui du troifiéme, 6c ainfi de fuite jufqu’au
dernier.
D ’abord, n , dans la formule çi-deffus, ne fera
plus Amplement le nombre des termes , mais la fonü
me de leurs expofans.
De plus cette forme ne doit être confidérée que
comme le numérateur d’une ffaûion, à laquelle on
donnera pour dénominateur le produit continu d'autant
de produits particuliers qu’il y a d’expofans ou
de termes ; 6c chacun de ces produits particuliers fera
le produit continu des nombres naturels pouffe jufqu’à
celui inclufivement qui exprime l’expofant du
terme correfpondant, enforte que la formule abfolu*
ment générale fera
C c c ij