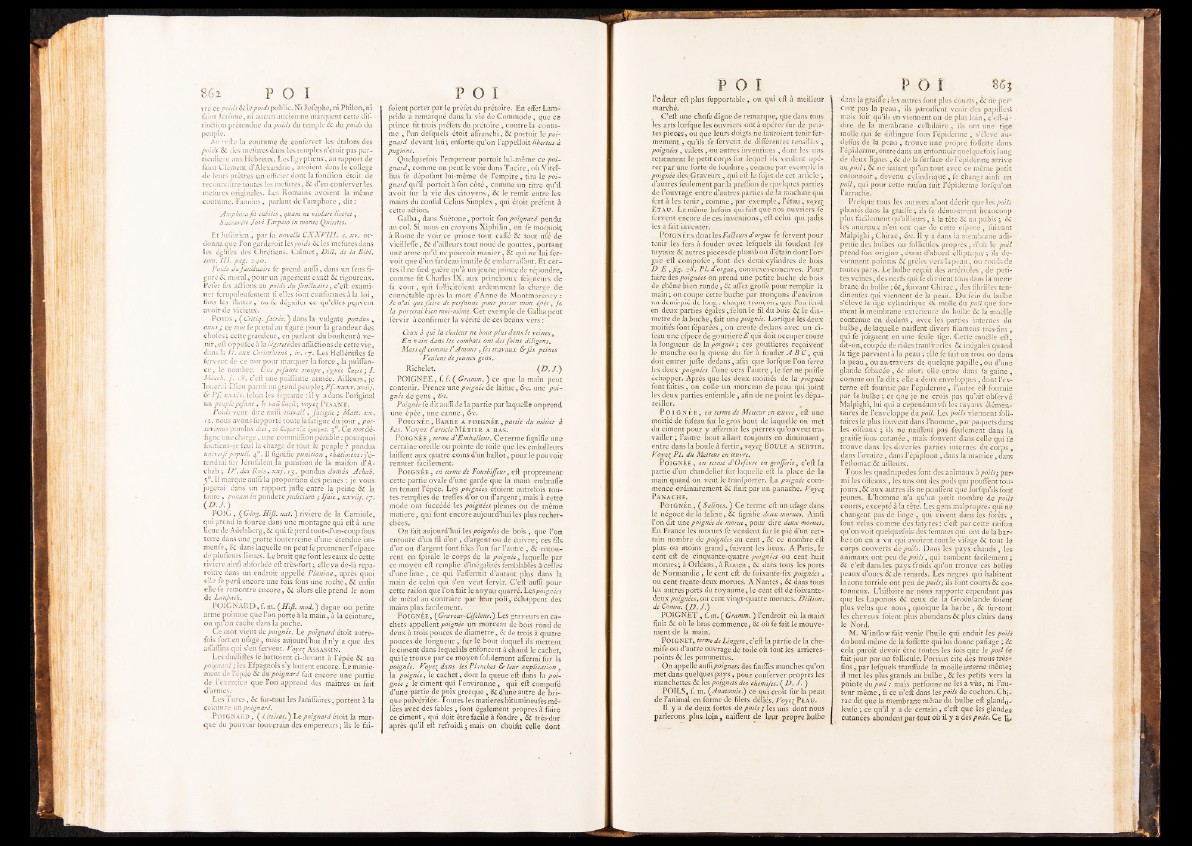
trè ce poids & le poids public. Ni Jofephe, ni Philon, ni
Paint Jérôme, ni aucun ancien ne marquent cette dif-
tinftion prétendue du poids du temple & du poids du
peuple. , , .
Au refie la coutume de conferver les étalons des
poids & des mefures dans les temples n’étoit pas particulière
aux Hébreux. Les Egyptiens, au rapport de
Paint Clément d’Alexandrie, avoient dans le college
de leurs prêtres un officier dont la fonction étoit de
reconnoître toutes les mePures, Bc d’en conPerverles
mePures originales. Les Romains avoient la même
coutume. Fannius, parlant de l’amphore , dit :
Ampkora fit cubitis, quant ne. violart liceret,
Sacravêre Jovi Tarpeio in monte Quiritcs.
Et Juftinien , par Pa novelle CXXVI1I. c. xv. ordonna
que l’on garderoit les poids & les mePures dans
les égliPes des Chrétiens. Calmet, D i cl. de la Bibl.
tom. III. pag. 240.
Poids dufanctuaire Pe prend auffi, dans un Pens figuré
& moral, pour un jugement exact & rigoureux.
Pefer Pes aérions au poids du fanctuaire, c’eft examiner
PcrupuleuPement Pi elles Pont conformes à la lo i,
Pans les flatter, ou Pe déguiPer ce qu’elles peuvent
avoir de vicieux.
P o id s , ( Critiq. facrée. ) dans la vulgate pondus ,
omis ; ce mot Pe prend au figuré pour la grandeur des
choPes; cette grandeur, en parlant du bonheur à venir
, eft oppofee à la légeretèdes affligions de cette v ie ,
dans la II. aux Corinthiens, iv. \y. Les Helléniftes Pe
Pervent de ce mot pour marquer la force, la puiffan-
c e , le nombre. Une pejante troupe, é^Xoç C*pos;I.
Macch. j . 18. c’eft une puiffante armée. Ailleurs, je
louerai Dieu parmi im grand peuple ; Pf. xxxv. xvüj.
& Pf. xxxiv. félon les leptante : il y a dans l’original
un peuplepefant, tv Aaw C*pt*-; voye{ PESANT.
Poids veut dire aufii travail, fatigue ; Matt. x x .
12. nous avons fupporté toute la fatigue du jour ,por-
tavimus pondus diei, to Cdpcç ths 30. C e motdé-
Pigne une charge, une commiftîon pénible : pourquoi
foutiens-je Peul la charge de tout le peuple ? pondus
umvaji populi. 40. Il lignifie punition , châtiment .'j’étendrai
Pur Jérufalem la punition de la maifon d’A-
chab ; /V. des Rois, xxj. 13. pondus domûs Achab.
50. Il marque aufii la proportion des peines : je vous
jugerai dans’ un rapport jufte entre la peine & la
faute , ponant in pondéré judicium • Ifàie , xxviij. iy.
. -
POÏG, ( Géog. Hifi. nat. ) riviere de la Carniole,
qui prend fa fource dans une montagne qui eft à une
lieue de Adelsberg, & qui Pe perd tout-d’un-coup fous
terre dans une grotte fouterreine d’une étendue im-
menfe, &C dans laquelle on peut Pe promener l’efpace
de plufieurs lieues. L e bruit que font les eaux de cette
riviere ainfi abforbée eft très-fort ; elle va de-là repa-
roître dans un endroit appelle Planina, après quoi
elle fe perd encore une fois fous une roche, & enfin
elle fe remontre encore, & alors elle prend le nom
de Laupach.
POIGNARD, f. m. {Hifi. mod.') dague ou petite
arme pointue que l’on porte à la main, à la ceinture,
ou qu’on cache dans la poche.
Ce mot vient de poignée. Le poignard étoit autrefois
fort en ufage, mais aujourd’hui il n’y a que des
affaflins qui s’en fervent. Voyez A s sa s s in .
Les duéliftes fe battoient ci-devant à l’épée & au
poignard ; les Efpagnols s’y battent encore. Le maniement
de l’épée & du poignard fait encore une partie
de l’exercice que l’on apprend des maîtres en fait
d’armes.
Les Turcs, Bc fur-tout les Janiffaires, portent à la
ceinture un poignard.
P o ig n a r d , ( Littéral. ) Le poignard étoit la marque
du pouvoir iouvprain des empereurs ; ils le faifoient
porter par le préfet du prétoire. En effet Lam-
pride a remarqué dans la vie de Commode, que ce
prince fit trois préfets du prétoire , contre la coutume
, l’un defquels étoit affranchi, & portoit le poignard
devant lui ; enforte qu’on l’appelloit libertus à
pugione.
Quelquefois l’empereur portoit lui-même ce poignard,
comme on peut le voir dans Tacite, oîi Vitel-
lius fe dépofant lui-même de l’empire, tira le poignard
qu’il portoit à fon côté, comme un titre qu’il
avoit fur la vie des citoyens, Bc le remit entre les
mains du conful Celius Simplex, qui étoit préfent à
cette action.
Galba, dans Suétone, portoit fon poignard pendu
au col. Si nous en croyons X iphilin, on Pe moquoit
à Rome de voir ce prince tout cafte Bc tout ufé de
vieilleffe, Bc d’ailleurs tout noué de gouttes, portant
une arme qu’il ne pouvoit manier, Bc qui ne lui fer-
voit que d’un fardeau inutile & embarraftant. Et certes
il ne fied guère qu’à un jeune prince de répondre,
comme fit Charles IX. aux principaux feigneurs de
fa cou r, qui follicitoient ardemment la charge de
connétable après la mort d’Anne de Montmorency :
Je n'ai que faire de perfonne pour porter mon épée . je
la porterai bien moi-même. Cet exemple de Galba peut
fervir à confirmer la vérité de ces Seaux vers :
Ceux a qui la chaleur ne bout plus dans le veines ,
En vain dans les combats ont des foins diligens.
Mars efi comme V Amour , fes travaux G fis peines
Veulent de jeunes gens.
Richelet. (JD. ƒ .)
POIGNÉE, f. f. ( Gramm. ) ce que la main peut
contenir. Prenez une poignée de laitue, &c. une poignée
de gens, &c.
Poignee fe dit auffl de la pa rtie par laquelle on prend
une épée, une canne, &c.
Po ig n é e ,,.Ba r r e a p o ig n é e , partie du métier à
bas. Voyez l'article MÉTIER A BAS.
P o ig n é e , terme d'Emballeur. Ce terme fignifie une
certaine oreille ou pointe de toile que les emballeurs
laiffent aux quatre coins d’un ballot, pour le pouvoir
remuer facilement.
Po ig n é e , en terme de Fourbiffeur, eft proprement
cette partie ovale d’une garde que la main embraffe
en tenant l’épée. Les poignées etoient autrefois toutes
remplies de treffes d’or ou d’argent ; mais à cette
mode ont fuccédé les poignées pleines ou de même
matière, qui font encore aujourd’hui les plus recher-
chéeSi-
On fait aujourd’hui les poignées de bois , que l’on
entoure d’un fil d’or , d’argent ou de cuivre ; ces fils
d’or ou d’argent font filés l’un fur l’autre , Bc entourent
en fpirale le corps de la poignée, laquelle par
ce moyen eft remplie d’inégalités femblables à celles
d’une lime , ce qui l’affermit d’autant plus dans la
main de celui qui s’en veut fervir. C’eft aufli pour
cette raifon que l’on fait le noyau quarré. Les poignées
de métal au contraire par leur p oli, échappent des
mains plus facilement.
Po ig n é e , ( Graveur-Cifileur.) Les graveurs en cachets
appellent poignée un morceau de bois rond de
deux à trois pouces de diamètre, & de trois à quatre
pouces de longueur , fur le bout duquel ils mettent
le ciment dans lequel ils enfoncent à chaud le cachet,
qui fe trouve par ce moyen folidement affermi fur la
poignée. Vjye[ dans les Planches & leur explication ,
la poignée, le cachet, dont la queue eft dans la poignée
; le ciment qui l’environne, qui eft compofé
d’une partie de poix grecque , Bc d’une autre de brique
pulvérifée. Toutes les matières bitumineufes mêlées
avec des fables , font également propres à faire
ce ciment, qui doit être facile à fondre , & très-dur
après qu’il eft refroidi ; mais on choifit celle dont
P O I
rocîeur eft plus fupportable, ou qui eft à meilleur
marché.
C’eft une chofe digne de remarque, que dans tous
les arts lorfque les ouvriers ont à opérer fur de petites
pièces, ou que leurs doigts ne faitroient tenir fermement
, qu’ils fe fervent de différentes tenailles ,
poignées, valets, ou autres inventions , dont les uns
retiennent le petit corps fur lequel ils veulent opérer
par une forte de foudure, comme par exemple la
poignée des.Graveurs, qui eft le fujet de cet article ;
d’autres feulement par la preflion de quelques parties
de l’ouvrage entre d’autres parties de la machine qui
fert à les tenir, comme, par exemple, l’étau, voye[
É t a u . Le même befoin qui fait.que nos ouvriers Pe
fervent encore de ces inventions, eft celui qui jadis
les a fait inventer.
. Poignées dont les Facteurs d'orgue fe fervent pour
tenir les fers à fouder avec lefquels ils foudent les
tuyaux & autres pièces de plomb ou d’étain dont l’orgue
eft.compofée, font des demi-cylindres de bois
D E ,fig. 28. PI. d'orgue, convexes-concaves. Pour
faire des poignées on prend une petite bûche de bois
de chêne bien ronde, Bc affez groffe pour remplir la
main ; on coupe cette bûche par tronçons d’environ
un demi-pié de long : chaque tronçon, que l’on fend
en deux parties égales , félon le fil du bois &c le diamètre
de la bûche, fait une poignée. Lorfque les deux
moitiés fôntféparées , on creule dedans avec un ci-
feau une efpece de gouttière E qui doit occuper toute
la longueur de la poignée ; ces gouttières reçoivent
le manche ou la queue du fer à fouder A B C , qui
doit entrer jufte dedans, afin que lorfque l’on ferre
les deux poignées, l’une vers l’autre, le fer ne puiffe
échapper. Après que les deux moitiés de la poignée
Pont faites , on colle un morceau de peau qui joint
les deux parties enfemble., afin de ne point les. dépareiller
»
P 0 1 G N e E, en terme de Metteur en oeuvre , eft une
moitié de fuféau fur le gros bout de laquelle on met
du ciment pour y affermir les pierres qu’on veut travailler
; l’autre bout allant toujours en diminuant,
entre dans la boule à fertir, voyez Boule à sertir.
Voyez PL du Metteur en oeuvre.
POIGNÉE, en tenue d'Orfivrc en grojferie, c’eft là
partie d’un chandelier fur laquelle eft la place de la
main quand on veut le tranfporter. La poignée commence
ordinairement Bc finit par un panache. Voyez
P a n a c h e .
Poignée , ( Salines. ) Ce terme eft un ufage dans
le négoce delà faline, & fignifie deux morues. Ainfi
l’on dit une poignée de morue, pour dire deux morues.
En France lés morues fe vendent fur le pié d’un certain
nombre de poignées au cent, Bc ce nombre eft
plus ou moins grand, fuivant les lieux. A Paris, le
ceiit eft de cinquante-quatre poignées ou cent .huit
morues ; à Orléans, à Rouen, Bc dans tous les ports
de Normandie, le cent eft de foixante-fix poignées,
ou cent trente-deux morues. A Nantes, & dans tous1
les autres ports du royaume, le cent eft de foixante-
deux poignées, ou cent vingt-quatre morues. Diction.-
de Comm. (JD. / .)
POIGNET , f. m. ( Gramm. ) l’endroit oii la main
finit Bc oii le bras commence, & oh fe fait le mouvement
de la main.
Poignet, terme de Lingere, c’eft la partie de la che-
mife ou d’autre ouvrage de toile oii font les arrieres-
points Bc les pommettes»..
On appelle auffi poignets des fauffes manches qu’on
met dans-quelques pa ys, pour conferver propres les
manchettes & les poignets des chern •fis. (D . J. )
POILS, f. m. ( Anatomie.) eê qui croit fur la peau
de l’animal en forme de filets déliés. Voye^ Peau.
Il y a de deux fortes de poils ; les uns dont nous
parlerons plus loin, naiffent de leur propre bulbe
P O 1 $6}
' dans la graille ; les autres font plus courts, Bc fié percent
pas la peau, ils paroiffent venir des papilles»
mais foit qu’ils en viennent oti de plus loin, c’eft-à-
dire, de la membrane cellulaire , ils ont une tige
molle qui fe diftinguè fous l’épiderme, s’élevé au-
• deffus de la peau , trouve une propre foffette dans
l’epiderme, entre daris un entonnoir quelquefois long
de deux lignes , & de la furface de l’épiderme arrive
au poil ; & ne raifant qu’un tout avec ce même petit
-entonnoir, devenu cylindrique , fe change ainfi eii
poil, qui pour cette raifon fuit l’épiderme lorfqu’on
l’arrache.
Prefqiie tous les auteurs n’ont décrit que les poilè
plantés dans la graiffe ; ils fe démontrent beaucoup
plus facilement qu’ailleürs , à^-la tête & au pubis’; &:
les animaux n’en ont que de cette efpece , fuivant
Malpighi, Chirac, &c. Il y a dans la membrane adi-
peulè des bulbes ou follicules propres $ d’où le poit
prend fon origine , etant d’abord elliptique ; ils deviennent
pointus & grêles Vers la peau, ou ronds de
toutes parts. Le bulbe reçoit des artérioles/ de pétri
tes veines ,des nerfs qui fe divifent tous dans la membrane
du bulbe ; & , fuivant Chirac , des fibrilles ten-
dineufes qui viennent de la peau. Du fein du bulbe
s’élève la tige cylindrique & molle du poil que forment
la membrane extérieure du bulbe Bc la moelle
contenue en dedans , avec les parties internes dit
bulbe, de laquelle naiffent divers filamens très-fins ,
qui fe joignent en une feule tige» Cette moelle eft,
ciit-on, coupée de rides tranfverïès & inégales quand
la tige parvient à la peau ; elle fe fait un trou où dans
la peau, ou au-travers de quelque papille, Ou d’uné
glandé febacée, & alors elle entre dans fà gaîne j
• comme on l’a dit ; elle a deux enveloppes , dont l’externe
eft fournie par l’épiderme, l’autre eft fburnié
par le bulbe ; ce que je ne crois pas qu’ait obfervé
Malpighi, lui qui a Cependant vu les tuyaux élémentaires
de l’enveloppe du poil. Les poils viennent foli-
taireS le plus fouvent dans l’homme, par paquets dans
les oifeaux ; ils ne naiffent pas feulement dans la
graiffe fous cutanée , mais fouvent dans celle qui fe
trouve dans les diverfes parties internes du-corps ,
dans l’ovaire, dans l’épiploon, dans la matrice, dans
l’eftomac & ailleurs.
Tous les quadrupèdes font des animaux à poils; par-»
mi les oifeaux, les uns ont des poils qui pouffent tou-»
jours, & aux autres ils ne pouffent que Jorfqu’ils font
jeunes. L’homme n’a qu’un petit nombre de poils
courts, excepté à la tête. Les gens malpropres qui ne
changent pas de linge , qui vivent dans les forêts *
font velus comme des fatyres : c’eft par cette raifon
qu’on voit quelquefois des femmes qui ont de la barbe
: on en a vu qui avoiént tout le vifage & tout lê
corps couverts de poils. Dans les pays, chauds , les
animaux ont peu de poils, qui tombent facilement 5
& c’eft dans les pays froids qu’on trouve ces belles
; peaux d’ours & de renards. Les negres qui habitent
la zone torride ont peu de poils; ils lont courts & co-1
. tonneux. L’hiftoire ne nous rapporte cependant pas
que les Laportois & ceux de la Groënlande foient
plus velus que nous, quoique la barbe , & fur-tout,
les cheveux foient plus abondans & plus clairs dans
le Nord;
M. Winflow fait venir l’huile qui enduit les poils
du bord même de la foffette qui lui donne paffage ; Bc
cela paroît devoir être toutes les fois qüe le poil. fe
fait jour par un follicule. PorriuS cite des trous très-»
fins, par lefquels tranffude la moelle interne même;
il met les plus grands au bulbe, & les petits vers là
pointe du poil : mais perfonne ne les a vus, ni l’aiu
teur même, fi ce n’eft dans les poils de cochon. Chri
rac dit que la membrane même du bulbe eft glandu-
- leufe ; ce qu’il y a de certairî , c’eft qüe les glandes
cutanées abondent par tout où il y a des poils. C e ri*