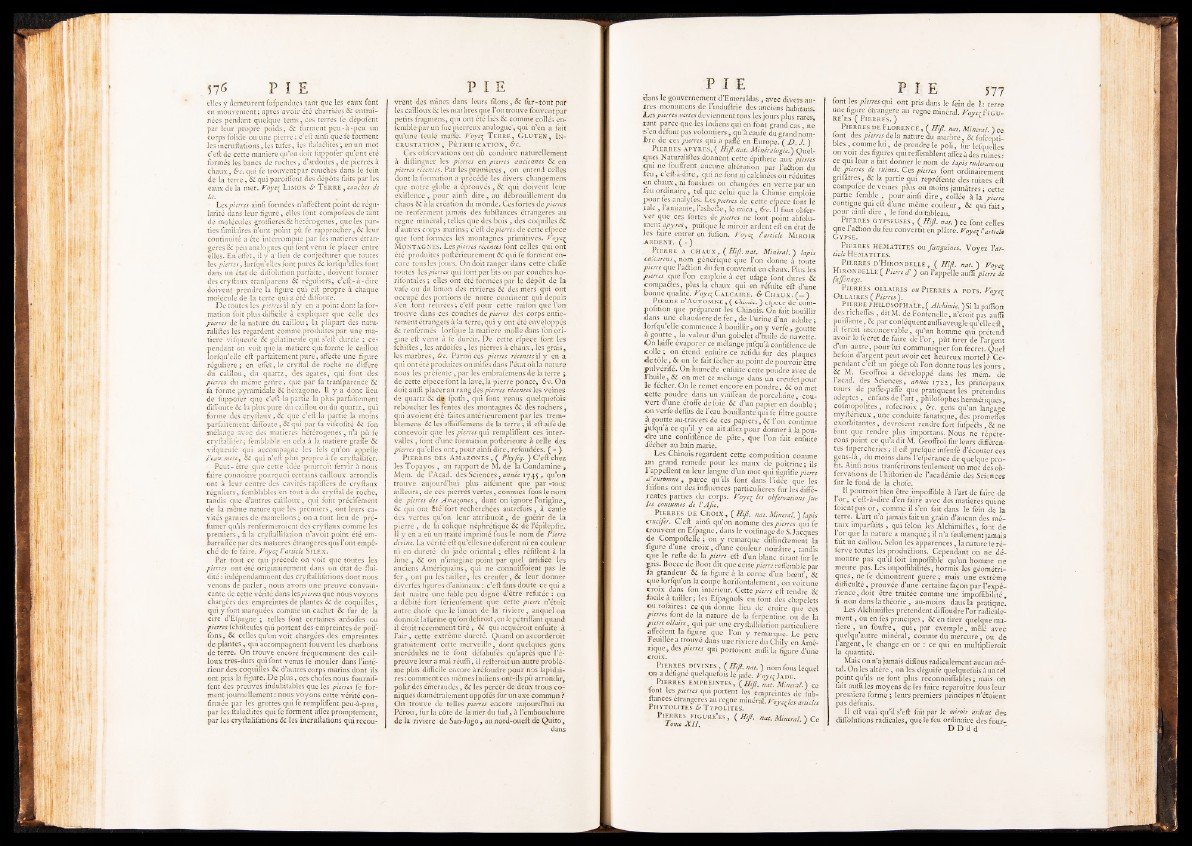
elles y demeurent fufpendués tant que les eaux font
en mouvement ; après avoir été charriées & entraînées.
pendant quelque tems, ces terres fe dépofent
par leur propre poids, & forment peu-à-peu un
corps folide ou une pierre ; c’eft ainfi quefe forment
les incruftations, les tufes, les ftala&ites ; en un mot
c’eft de cette maniéré qu’on doit fuppofer qu’ont été
formés les bancs de roches , d’ardoiles, de pierres à
chaux, &c. qui fe trouvent par couches dans le fein
de la terre, & qui paroiffent des dépôts faits par les
eaux de la mer. Foyeç L im o n & T e r r e , couches de
la.
• Les pierres ainfi formées n’affe&ent point de régularité
dans leur figure, elles font compofées de tant
de molécules groftieres& hétérogènes, que les parties
fimilaires n’ont point pu fe rapprocher, & leur
continuité a été interrompue par les matières étrangères
& peu analogues qui font venu fe placer entre
elles. En effet, il y a lieu de conjeéhirer que toutes
les pierres, lorfqu’elles font pures & lorfqu’elies font
dans un état de diffolution parfaite, doivent former
des cryftaux tranfparens & réguliers,- c’eft-à-dire
doivent prendre la figure qui eft propre à chaque
molécule de la terre qui a été diffoute.
De toutes les pierres il n’y en a point dont la formation
foit plus difficile à expliquer que celle des
pierres de la nature du caillou; la plupart des natu-
raliftes les regardent comme produites par une matière
vil'queufe & gélatineufe qui s’eft durcie ; cependant
on voit que la matière qui forme le caillou
lorfqu’elle eft parfaitement pure, affecte une figure
régulière ; en effet, le cryftal de roche ne différé
du caillou, du quartz, des agates, qui font des
pierres du même genre, que par fa tranfparence &
fa forme pyramidale & héxagone. Il y a donc lieu
de fuppofer que c’eft la partie la plus parfaitement
diffoute & la plus pure du caillou ou du quartz, qui
forme des cryftaux, & que c’eft la partie la moins
parfaitement diffoute, & qui par fa vifcofité & fon
mélange avec des matières hétérogènes, n’a pû fe
cryftallifer; femblabîe en cela à la matière grade &
vifqueufe qui accompagne les fels qu’on appelle
Veau merey & qui n’eft plus propre à fe cryftallifer.
Peut-être que cette idée pourroit fervir à nous
faire connoître pourquoi certains cailloux arrondis
ont à leur centre des cavités tapiffées de cryftaux
réguliers, femblables en tout à du cryftal de roche,
tandis que d’autres cailloux, qui font précifément
de la même nature que les premiers, ont leurs cavités
garnies de mamellons ; on a tout lieu de préfumer
qu’ils renfermeroient des cryftaux comme les
premiers, fi la cryftallifation n’avoit point été em-
barraffée par des matières étrangères qui l’ont empêché
de fe faire. Foye^ Varticle S i l e x .
Par tout ce qui précédé on voit que toutes les
pierres ont été originairement dans un état de fluidité
: indépendamment des cryftallifations dont nous
venons de parler, nous avons une preuve convaincante
de cette vérité dans les pierres que nous voyons
chargées des empreintes de plantes & de coquilles,
qui y font marquées comme un cachet & fur de la
cire d’Efpagne ; telles font certaines ardoifes ou
pierres fchifteufes qui portent des empreintes de poif-
fons, & celles qu’on voit chargées des empreintes
de plantes, qui accompagnent fouvent les charbons
de terre. On trouve encore fréquemment des cailloux
très-durs qui font venus fe mouler dans l’intérieur
des coquilles & d’autres corps marins dont ils
ont pris la figure. De plus, ces chofes nous fournif-
fent des preuves indubitables que les pierres fe forment
journellement: nous voyons cette vérité confirmée
par les grottes qui fe rempliffent peu-à-peu,
par les ftalaôites qui fe forment affez promptement,
par les cryftalifations & les incruftations qui recouvrent
des mines dans leurs filons, & fur-tout par
les Cailloux & les marbres que l’on trouve fpuventpar
petits fragmens, qui ont été liés & comme collés en-
femble par un fuc pierreux analogue'* qui n’en a fait
qu’une feule mafl'e. Voye\[ T e r r e , G l u t e n , In c
r u s t a t io n , PÉTRIFICATION, &C.
Ces obfervations ont du. conduire naturellement
à diftinguer les pierres en pierres anciennes & en
pierres récentes. Par les premières, on entend celles
dont la formation a précédé les divers changemens
que notre globe a éprouvés, & qui doivent leur
exiftence, pour ainfi dire, au débrouillement du
chaos & à la création du monde. Ces fortes de pierres
ne renferment jamais des fubftances étrangères au
régné minéral, telles que des bois , des coquilles Sc
d’autres corps marins ; c’eft de pierres de cette efpece
que font formées les montagnes primitives. Foye^
Mo n t a g n e s . Les pierres récentes font celles qui ont
été produites poftéfieurement & qui fe forment encore
tous les jours. On doit ranger dans cette claffe
toutes les pierres qui font par lits ou par couches ho-
rifontales ; elles ont été formées par le dépôt de la
vafe ou du limon des rivières & des mers qui ont
occupé des portions de notre continent qui depuis
s’en font retirées ; c’eft pour cette raifon que l’on
trouve dans ces couches de pierres des corps entièrement
étrangers à la terre, qui y ont été enveloppés
& renfermés lorfque la matière molle dans fon origine
eft venu à fe durcir. De cette efpece font les
lchiftes , les ardoifes , les pierres à chaux , les grais,
les marbres, &c. Parmi ces pierres récentes il y en a
qui ont été produites oumifes dans l’état oîila nature
nous les préfente , par les embrafemens de la terre ;
de cette efpece font la lave, la pierre poncé, &c. On
doit auffi placer au rang des pierres récentes les veines
de quartz & de fpath, qui font venus quelquefois
reboucher les fentes des montagnes & des rochers,
qui avoient été faites antérieurement par les trem-
blemens & les affaiffemens de la terre ; il eft aifé de
concevoir que les pierres qui rempliffent ces intervalles
, font d’une formation poftérieüre à celle des
pierres qu’elles ont, pour ainfi dire, refoudées. ( - )
Pie r r e s d e s A m a z o n e s , ( Phyjîq. ) C’eft chez
les Topayos , au rapport de M. de la Condamine ,
Mem. de l’Acad. des Sciences, année 1745 , qu’on
trouve aujourd’hui plus aifément que par -tout
ailleurs, de ces pierres vertes, connues fous le nom
de pierres des Amazones y dont on ignore l’origine,
& qui ont été*fort recherchées autrefois , à caufe
des vertus qu’on leur attribuoit, de guérir de la
pierre , de la colique néphrétique & de l’épilepfie.
Il y en a eû un traité imprimé fous le nom de Pierre
divine. La vérité eft qu’elles ne different ni en couleur
ni en dureté du jade oriental ; elles réfiftent à la
lime , & on n’imagine point par quel artifice les
anciens Amériquains, qui ne connoiffoient pas le
fer , ont pu les tailler, les creufer, & leur donner
diverfes figures d’animaux : c’eft fans doute ce qui a
fait naître une fable peu digne d’être refutée : on
a débité fort férieufement que cette pierre n’étoit
autre chofe que le limon de la riviere, auquel on
donnoit la forme qu’on defiroit, en le pétrifiant quand
il étoit récemment t iré , & qui acquéroit enfuite à
l’a ir , cette extrême dureté. Quand on accorderoit
gratuitement cette merveille, dont quelques gens
incrédules ne fe font défabufés qu’après que l’épreuve
leur a mal réuffi, il refteroit un autre problème
plus difficile encore à réfoudre pour nos lapidaires
: comment ces mêmes Indiens ont-ils pû arrondir,
polir des émeraudes, &c les percer de deux trous coniques
diamétralement oppofés fur un axe commun ?
On trouve de telles pierres encore aujourd’hui au
Pérou, fur la côte de la mer du fud, à l’embouchure
de la riviere de San-Jago, aunord-oueft de Quito,
dans
«3ans le gouvernement d’Emeraldas ,-avec divers au-
ires monumens ,de l’induftrie des anciens habitans.
•Les pierres vertes deviennent tous les jours plus rares,
lant parce que les Indiens qui en font grand cas ne
s ’en défont pas volontiers, qu’à caufe du grand nombre
de ces pierres qui a paffé en Europe. ( D . J. )
P i e r r e s a p y r e s , ( Hifi.nat. Minéralogie,} Quelques
Naturaliftes, donnent cette épithete aux pierres
qui ne foiiffrent aucune altération par l’a&ion du
feu , c eft-a-dire, qui ne font ni calcinées ou réduites
«n chaux,;ni fondues ou changées en verre par un
feu ordinaire, tel que celui que la Chimie emploie
pour fes anàlyfes; Les pierres de cette efpece font le
Talc , l ’amiante, I’asbefte, le mica , &c. Il faut obfer-
,ver que ces fortes de pierres ne font point abfolu-
ment apyres, puifque le miroir ardent eft en état de
les faire entrer en fufion. Foye^ Varticle M i r o i r
ARDENT. ( - )
. P i e r r e a C H A U X , ( Hiß. nat. Minéral. ) lapis
calcareus, nom generique qiie l’on donne à toute
pierre que l’aftion du feu convertit en chaux. Plus les
pierres que l’on emploie à cet ufage font dures &
compares, plus la chaux qui en réfulte eft d’une
bonne qualité. Voye{ C a l c a i r e . & C h a u x . (—)
P i e r r e d ’A u t o m n e , ( Chimie. ) efpece de com-
pofition que préparent les;Chinois. On fait bouillir
dans une chaudière de fer, de l’urine d’un adulte ;
lorfqu’elle commence à bouillir, on y verfe , goutte
à goutte , la valeur d’un gobelet d’huile de navette.
On laiffe évaporer ce mélange jufqu’à confiftence de
'»colle ; on étend enfuite ce réfidu fur des plaques
<le tôle, & on le fait fécher au point de pouvoir etre
pulvérifé. On humette enfuite cette poudre avec de
l ’huile, & on met ce mélange dans un creufetpour
le fécher. On le remet encore en poudre , & on met
cette poudre dans un vaiffeau de porcelaine, couvert
d’une étoffe de foie, & d’un papier en double ;
©n verfe deffus de l’eau bouillante qui fe filtre goutte
à goutte au-travers de ces papiers, & Ton continue
jufqu’à ce qu’il y en ait affez pour donner à la poudre
une confiftence de pâte, que l’on fait enfuite
fécher au bain marie.
Les Chinois regardent cette compofition comme
jin grand remede pour les maux de poitrine; ils
l ’appellent en leur langue d’un mot qui fignifie pierre
d'automne , parce qu’ils font dans l’idee que les
faifons ont des influences particulières fur les différentes
parties du corps. Voyelles obfervationsJ'ur
les coutumes de VAfie.
P i e r r e s d e C r o i x , ( Hiß. mu.Mineral.)lapis
'crucifie. C’eft ,ainfi, qu’on nomme âesjùerres qui fe
trouvent en Efpagne, dans le voifinage de S. Jacques
de Compoftellc ; on y remarque diftinftement là
figure d une c ro ix, d une .couleur noirâtre, tandis
que le refte de la pierre eft d’un blanc tirant fur le
gris. Boece de Boot dit que cette pierre reffemble par
ïa grandeur & fa figuré JJ la corne d’un boeuf, &
que lorfqu’on la coupe horifontalement , on voitune
croix dans fon intérieur. Cette pierre eft tendre &
facile â tailler ;■ le? Efpagnols en font des chapelets
ou rofaires : ce qui donne lieu de croire que, cés
pierres font de la nature de la ferpentine ou de la
purre ollaire qui par une cryftallifation particulière
aftectent la figure que l’on y remarque. Le pere
Feuillee a trouve dans une riviere du Chily en Amérique
, des pierres qui portoient auffi la figure d’une
croix.
P i e r r e s d i v in e s , ( Hiß. „at. ) nom fous lequel
on a defigne quelquefois le jade. Voyes, Ja d e
P i e r r e s e m p r e i n t e s , (H iß . riat. Minerai.) ce
font les pierres qui portent les empreintes de fubftances
étrangères au regnemiinéral.iroy<? les articles
P h v t o u t e s 6- T ï p o l i t k s ..
B lomDp D H ( H nat. Minerai. ) Ce . X f i *
font les-pierres xpn ont pris dans le fein de la terre
une figure étrangère au regne minéral. Foyer F i g u -
r e ’ e s ( P i e r r e s . ) r , . ' '
P i e r r e s d e F l o r e n c e , ( Hiß. nat. Minerai. ) ce
font des pierres delà nature du marbre, & fufeepti-
bles , comme lui, de prendre le poli, fur lefqueües
on voit des figures qui reffemblent affez à des ruines :
ce qui leur a fait donner le nom de lapis mderum ou
^ pierres de ruines. Ces pierres font ordinairement
grifâtres , & la partie qui repréfente des ruines eft
compofee de veines plus ou moins jaunâtres ; cette
.partie femble , pour ainfi dire, collée à la pierre
contiguë qui eft d’une même couleur, & qui fait,
pour ainfi dire , le fond du tableau.
P i e r r e s g y p s e u s e s , ( Hiß. nat. ) c e fo n t c e lle s
qne l’ a f t io n du f e u c o n v e r t i t en p lâ t r e . Foyer Varticle
G y p s e .
P i e r r e s h é m a t i t e s Ou fanguines. V o y e z l’article
H é m a t i t e s .
P i e r r e s d ’H i r o n d e l l e , ( Hifl. nat. ) Foyer
H i r o n d e l l e ( Pierre d’ ) o n l ’a p p e lle au ffi pierre de
fafjenage.
P i e r r e s o l l a i r e s ou P i e r r e s a p o t s . Foyer
O l l a i r e s ( Pierres ). v
P i e r r e p h i l o s o p h a l e , ( Alchimie. )Si la paffion
des nchefles , dit M. de Fontenelle, n’étoit pas aufit
puiffante, & par conféquent auffi aveugle qu’elle eft,
il feroit inconcevable, qu’un homme qui prétend
ayoir le fecret de faire de l’or, pût tirer de l’argent
d’un autre, pour lui communiquer fon fecret. Quel
befoin d’argent peut avoir cet heureux mortel? Cependant
c’eft un piège où l’on donne tous les jours ,
& M. Geoffroi a développé dans les mém. dé
lacad. -des Sciences, année 1722, les principaux
tours de paffe-pafie que pratiquent les prétendus
adeptes , enfans de l’art, philosophes hermétiques,
coimopolites, rofecroix , &c. gens qu’un langage
myftérieux, une conduite fanatique, des promefils
exorbitantes, devroient rendre fort fulpeâs , & ne
font que rendre plus importans. Nous ne répéterons
point ce qu’a dit M. Geoffroi furleurs differentes
fupercheries.; il eft préfquë infenfé d’écouter ces
gens-là, du moins dans l ’efperance de quelque profit
Ainfi nous tranferirons feulement un mot des ob-
fervations^ de l’hiftorien de l’académie des Sciences
fur le fond de la chofe.
11 pourroit bien être impoffible à l’art de faire de
l’or, c’eft-à-dire d’en faire avec des matières qui ne
foientpas or , comme il s’en fait dans le fein de la
terre. L’art n’a jamais fait un grain d’aucun des métaux
imparfaits , qui félon les Alchimiftes, font de
l’or que la nature a manqué; il n’a feulement jamais
fait un caillou. Selon les apparences, la nature le ré-
ferve toutes les pro durions. Cependant on ne démontre
pas qu’il foit impoflible qu’un homme ne
meure pas. Les impoffibilités, hormis les'géométriques
, ne fe démontrent guere ; mais une extrême
difficulté, prouvée d’une certaine façon par l’expérience,
doit être traitée comme une impoffibilité
fi non dans la théorie, au-moins daus la pratique.
Les Alchimiftes prétendent diffoudre l’or radicalement
, ou en fès principes, & en tirer quelque mattiere
, un foufre, qui, par exemple, mêlé avec
quelqu’autre minéral, comme du mercure, ou de
l’argent, le change en or : ce qui en multiplieroit
la quantité.
Mais on n’a jamais diffous radicalement aucun métal.
On les altère, on les déguife quelquefois à un tel
point qu’ils ne font plus reconnoiffables ; mais oii
fait auffi les moyens de les faire reparoître fous leur
première forme ; leurs premiers principes n’étoient
pas défunis.
Il eft vrai qu’il s’eft fait par le miroir ardent des
diffolutions radicales, que le feu ordinaire des four-
D D d d