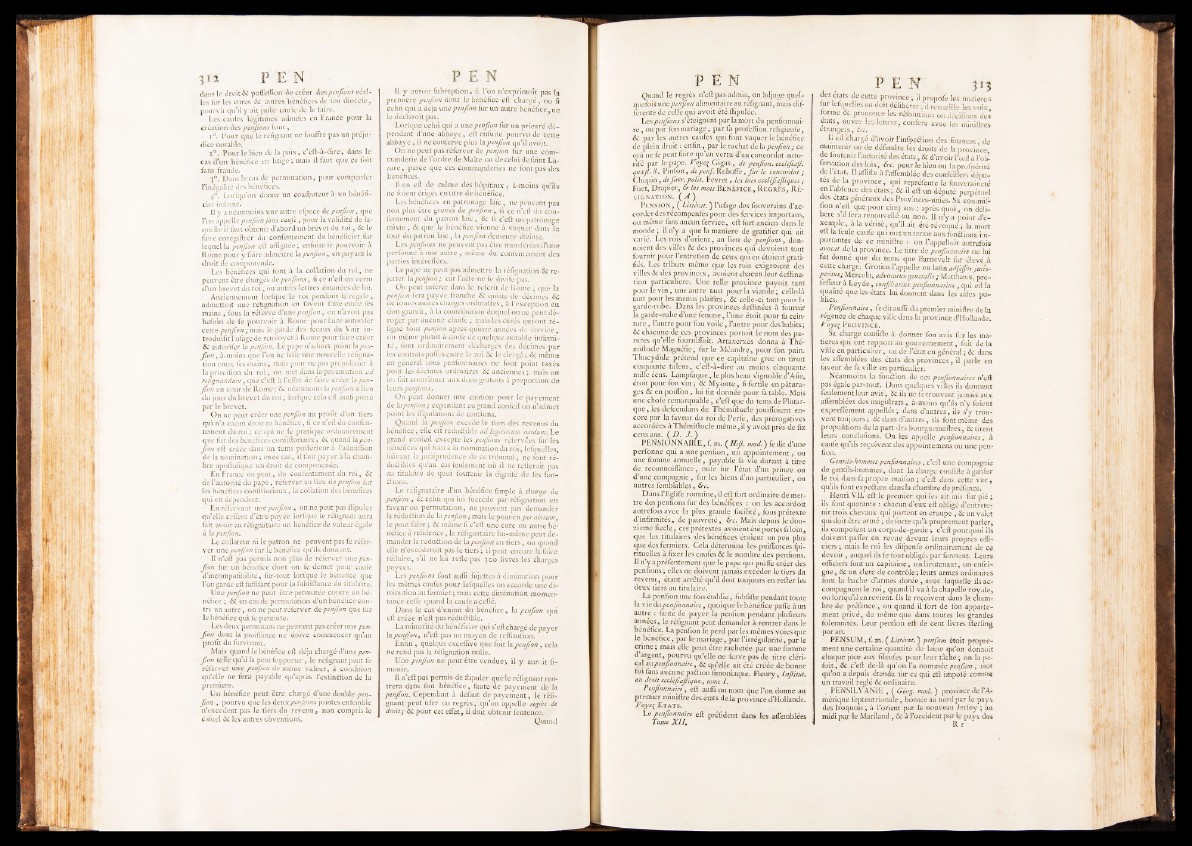
3 i î P E N
dans le droit 6c poffeffion de créer des penfions réelles
fur les cures 6c autres bénéfices de fon diocèfe,
pourvu qu’il y ait ju.fte caufe de le faire.
Les caufes légitimes admifes en France pour la
création des penfions font,
i°. Pour que le réfignant ne fouftre pas un préjudice
notable.
i ° . Pour le bien de la paix, c’eft-à-dire, dans le
cas d’un bénéfice en litige ; mais il faut que ce l'oit
fans fraude.
3°. Dans le cas de permutation, pour compenfer
l’inégalité des bénéfices.
4°. Lorl'qp’on donne un coadjuteur à un bénéficier
infirme.
Il y a néanmoins une autre efpecê de penfion, que
l’on appelle penfion Jans caufe , pour la validité de laquelle
il faut obtenir d’abord un brèvet du r o i, 6c le
faire enregiftrer du confentement du bénéficier fur
lequel la pcnjion eft affignée ; enfuite fe pourvoir à
Rome pour y faire admettre la pcnjion, en payant le
droit de componende.
Les bénéfices qui font à la collation du roi, ne
peuvent être chargés de penjîons, fi ce n’eft en vertu
d’un brevet du ro i, ou autres lettres émanées de lui.
Anciennement lorfque le roi pendant là régale,
admettoit une réfignation en faveur faite entre fes
mains , fous la réfervé d’une pcnjion, on n’avoit pas
befoin de fe pourvoir à Rome pour faire autoriler
cette pcnjion ; mais le garde des fceaux du Vair in-
trôduifit l’ufage de renvoyer à Rome pour faire créer
& autorifer la pcnjion. Le pape n’admet point la pcnjion
^ à-moins que l’on ne rafle une nouvelle réfignation
entre fes mains ; mais pour ne pas préjudicier à
la provifion du ro i, on met dans la procuration ad
rcfignandum, que c’eft à l’ effet de faire créer la pen-
Jion en cour de Rome ; 6c néanmoins la pcnjion a lieu
du jour du brevet du roi, lorfque cela eft ainfi porté
par le brevet.
On ne peut créer une pcnjion au profit d’un tiers
qui n’a aucun droit au bénéfice, fi ce n’eft du confentement
du roi; ce qui ne fe pratique ordinairement
que fur des bénéfices confiftoriaux, 6c quand la penfion
eft créée dans un tems poftérieur à l’admiffion
de la nomination ; en ce cas, il faut payer à la chambre
apoftolique un droit de componende.
En France on peut, du confentement du roi, 6c
de l’autorité du pape, réferver au lieu depenfion fur
les bénéfices-confiftoriaux, la collation des bénéfices
qui en dépendent.
En réfervant une pcnjion , on ne peut pas ftipuler
qu’elle ceffera d’être payée lorfque le réfignant aura
fait avoir au réfignàtaire un bénéfice de valeur égale
à la penfion.
Le collateur ni le patron ne peuvent pas fe réferver
une pcnjion fur le bénéfice qu’ils donnent.
Il n’eft pas permis non plus de réferver une penjion
fur un bénéfice dont on fe démet pour caufe
d’incompatibilité, fur-tout lorfque le bénéfice que
l’on garde eft fuffifant pour la fubfiftance du titulaire.
Une pcnjion ne peut être permutée contre un bénéfice
; 6c en cas de permutation d’un bénéfice contre
un autre, on ne peut réferver de pcnjion que fur
le bénéfice qui fe permute.
Les deux permutans ne peuvent pas créer une pcnjion
dont la jouiffance ne doive commencer qu’au
profit du furvivant.
Mais quand le bénéfice eft déjà chargé d’une pcnjion
telle qu’il la peut fupporter , le réfignant peut fe
réferver une pcnjion de même valeur, à condition
qu’elle ne fera payable qu’après l’extin&ion de la
première.
Un bénéfice peut être chargé d’une double pcnjion
, pourvu que les deuxpenjions jointes enfemble
n’excedent pas le tiers du revenu , non compris le
cafuel 6c les autres obventions.
P E N
Il y auroit fubreption, fi l’on n’exprimoit pas la
première pcnjion dont le bénéfice eft chargé, ou fi
celui qui a déjà une pcnjion fur un autre bénéfice, ne
le déclaroit pas.
Lorique celui qui a une pcnjion fur un prieuré dépendant
d’une abbaye, eft enfuite pourvu de Cette
abbaye, il ne conlerve plus la pcnjion qu’il avoit.
On ne peut pas réferver de pcnjion fur une com-
manderie de l’ordre de Malte ou de celui defaint Lazare
, parce que ces commanderies ne font pas des
bénéfices.
Il en eft de même des hôpitaux , à-moins qu’ils
ne foient érigés en titre de bénéfice.
Les bénéfices en patronage laïc, ne peuvent pas
non plus être grevés de penjion, fi ce n’eft du confentement
du patron laïc, 6c fi c’eft un patronage
mixte, 6c que le bénéfice vienne à vaquer dans le
tour du patron laïc, la pcnjion demeure éteinte.
Les penjions ne peuvent pas être transférées d’une
perfonne à une autre , même du confentement des
parties intéreflees.
Le pape ne peut pas admettre la réfignation & re-
jetter la pcnjion; car l’afte ne fe divife pas.
On peut inférer dans le refcrit de Rome , que la
penjion fera payée franche 6c quitte de décimes 6c
de toutes autres charges ordinaires, à l’exception du
don gratuit, à la contribution duquel on ne peut déroger
par aucune claufe ; mais les curés qui ont ré-
figné ious pcnjion après quinze années de fervice .
ou même plutôt à caufe de quelque notable infirmité
, font ordinairement déchargés des décimes par
les contrats palfés entre le roi & le clergé ; 6c même
en général tous penfionnaires ne font point ta-!xés
pour les décimes ordinaires 6c anciennes ; mais on
les fait contribuer aux dons gratuits à proportion dé
leurs penjiohs.
On peut donner une caution pour le payement
de \apenjion; cependant au grand confeil on n’admet
point les ftipulations de cautions.
Quand la penjion excede le tiers des revenus1 du
bénéfice, elle elt rédu&ible ad legitimum modum.Le.
grand confeil excepte les penjions réfervées fur des
bénéfices qui font à la nomination du roi, lefquelles,
fuivant la juriiprudence de ce tribunal , ne font réductibles
qu’au cas feulement oii il ne refteroit pas
au titulaire de quoi foutenir la dignité de fes fonctions.
Le réfignataire d'un bénéfice fimple à charge de
pcnjion , 6c celui qui lui fuccede par réfignation en
faveur ou permutation, ne peuvent pas demander
la réduction de la pcnjion; mais le pourvu per obitum,
le peut faire ; 6c même fi c’eft une cure ou autre bénéfice
à réfidence, le réfignataire lui-même peut demander
la réduction de la pcnjion au tiers, ou quand
elle n’excéderoit pas le tiers ; il peut encore la faire
réduire, s’il ne.lui refte pas 300 livres les charges
payées.
Les penjions font auffi fujettes à diminution pour
les mêmes caufes pour lefquelles on accorde une diminution
au fermier ; mais cette diminution momentanée
ceffe quand la caufe a cefle.
Dans le cas d’union du bénéfice, la pcnjion qui
eft créée n’eft pas réductible.
La minorité du bénéficier qui s’ eft chargé de payer
la penjion, n’eft pas un moyen de reftitution.
Enfin , quelque exceflive que foit la penjion , cela
ne rend pas la réfignation nulle. 1
Une penjion ne peut être vendue ; il y auroit fi-
monie.
Il n’eft pas permis de ftipuler que le réfignant rentrera
dans fon bénéfice, faute de payement de la
penjion. Cependant à défaut de payement, le réfignant
peut ufer du regrès, qu’on appelle regrès de
droit; 6c pour cet effet, il doit obtenir fentence. .
Quand
P E N
Quand le regrès n’eft pas admis, on àdjuge quelquefois
une pcnjion alimentaire au réfignant, mais différente
de celle qui avoit été ftipulée.
Les penjions s’éteignent par la mort du penfionnai-
re , ou par fon mariage, par fa profeflïon religieufe,
6c par les autres caufes qui font vaquer le bénéfice
de plein droit : enfin, par le rachat de la pcnjion ; ce
qui ne fe peut faire qu’en vertu d’un concordat auto-
nfé par le pape. V Gigas , de penjion. ecclefiafl.
quccjl. 8. Pinfon, de penf. Rebuffe, fur le concordat ;
Chopin, dcj'acr. polit. Fevret, les lois cccUfiafliques ;
Fuet, Drapier, & Us mots Bén éf ice, R é crés, Résignation.
( - 4 )
Pension , ( Littérat. ) l’ufage des fouverains d’accorder
des récompenfes pour des fervices importans,
ou même fans aucun fervice, eft fort ancien dans-le
monde ; il n’y a que la maniéré de gratifier qui ait
varié. Les rois d’orient, au lieu de penjions, don-
noient des villes 6c des provinces qui dévoient tout
fournir pour l’entretien de ceux qui en étoient gratifiés.
Les tributs même que les rois exigeoient des
villes & des provinces, avoient chacun leur deftina-
tion particulière. Une telle province payoit tant
pour le v in , une autre tant pour la viande ; celle-là
tant pour les menus plaiftrs, 6c celle-ci tant pour la
garde-robe. Dans les provinces deftinées à fournir
la garde-robe d’une femme, l’une étoit pour fa ceinture
, l’autre pour fon v o ile, l’autre pour des habits ;
6c chacune de ces provinces portoit le nom des parures
qu’elle fourniffoit. Artaxerxès donna à Thémiftocle
Magnéfie, furie Méandre, pour fon pain.
Thucydide prétend que ce capitaine grec en tiroit
cinquante talens, c’eft-à-dire au moins cinquante
mille écus. Lampfaque, le plus beau vignoble d’Afie,
étoit pour fon vin ; 6c Myonte, fi fertile en pâturages
6c en poifl’on , lui fut donnée pour fa table. Mais
une chofe remarquable , c’eft que du tems de Plutarque
, les defeendans de Thémiftocle jouiffoient encore
par la faveur du roi de Perfe, des prérogatives
accordées à Thémiftocle même, il y avoit. près de fix
cens ans. ( D . J. )
PENSIONNAIRE, f. m. ( Hifi. mod.) fedit d’une
perfonne qui a une penfion, un appointement, ou
une fomme annuelle, payable fa vie durant à titre
de reconnoiffance, mile fur l’état d’un prince ou
d’une compagnie, fur les biens d’un particulier, ou
autres femblables, &c.
Dans l’Eglife romaine, il eft fort ordinaire de mettre
des penfions fur des bénéfices : on les aceordoit
autrefois avec la plus grande facilité, fous prétexte
.d’infirmités, de pauvreté, &c. Mais depuis le douzième
fiecle, ces prétextes avoient été portés fi loin,
que les titulaires des bénéfices étoient un peu plus
que des fermiers. Cela détermina les puiffances Spirituelles
à fixer les caufes 6c le nombre des penfions.
Il n’y a préfentement que le pape qui puiffe créer des
penfions ; elles ne doivent jamais excéder le tiers du
revenu, étant arrêté qu’il doit toujours en relier les
deux tiers au titulaire.
La penfion une fois établie, fubfifte pendant toute
la vie dupcnjionnairc, quoique le bénéfice paffe à un
autre : faute de payer la penfion pendant plufieurs
années, le réfignant peut demander à rentrer dans le
bénéfice. La penfion fe perd parles mêmes voies que
le bénéfice , par le mariage, par l’irrégularité, par le
crime ; mais elle peut être rachetée par une fomme
d’argent, pourvu qu’elle ne ferve pas de titre cléri-
cal ax\ penfionnaire, 6c qu’elle ait été créée de bonne
foi fans aucune paélion fimoniaque. Fleury, Infiitut.
au droit ecclèjiajtique, tome l.
Pcnjionnairc, eft auffi un nom que l’on donne au
premier miniftre des états delà province d’Hollande.
ffoyc^ Etat s.
Le pcnfionnairc eft prëfident dans les affemblées
Tome X I I ,
P E N . 313
des états de celte province ; iipropofc tes matières
lur «quelles on doit délibérer ; il recueille les voix
forme & prononce les. réfolutiom ou décidons des
états3l ouvre les lettres,, conféra avec las minifttes
etrangers, &c.
Il eft .chargé d’avoir l’infpeâion des finances de
maintenir ou de défendre les droits de la province
de loutenir l’autorité des états, 6c d’avoir l’oeil à l’ob-
fervation des lois, &c. pour le bien ou la profpérité
de état. Il aflifte à l’affemblée des Gonfeillers dépu-
i> u/- Prov*nÇe > | ë1 repréfente la fouveraineté
en l abfence des états;. 6c il eft un député perpétuel
des etàts generaux des Provinces-unies. Sa commif-
iion n’eft que pour cinq ans : après quoi, on délibéré
s il fera renouvelle ou non. Il n’y a point d’e-
xernple, à,la vérité, qu’il ait été révoqué ; la mort
eft la feule caufe qui metun terme aux fondions importantes
de ce miniftre : on l’appelloit autrefois
avocat de la province. Le titre de pcnjionnairc ne lui
tut donne que du tems que Barnevelt fut élevé à
cette charge. Grotius l’appelle en latin adfcjforjuris-
peritus;, Mercula, advocMus gencralis; Matthieus, pro-
feffeiir à Leyde, conjiliarius penjionnariu* 3 qui. eft la
qualité que les états lui donnent dans les actes publics.
<
r Penjionnairc, fe dit auffi du premier miniftre de la
régence de chaque ville dans, la province d’Hollande.
Poyc{ Province.
Sa charge confifte à donner fon avis fi:r les matières
qui ont rapport au gouvernement, foit de la
ville en particulier, ou de l’état en général ; & dans
les afl'emblées des états des provinces, il parle en
faveur de fa ville en particulier.
Neanmoins la fonftion de çes pcnjionnaircs n’eft
pas égalé par-tout. Dans quelques villes ils donnent
feulement leur avis, & ils ne fe trouvent jamais aux
affemblées des magiftrats, à-moins qu’ils n’y foient
expreffément appelles ; clans.d’autres, ils s’y trouvent
toujours; 6c dans d’autres, ils font même des
propofitions de la part des bourguemeftres, 6c tirent
leurs eonclufions. On les appelle pcnjionnaircs, à
caufe qu’ils reçoivent des appointemens ou une penfion.
Gentils-hommes penfionnaires, c’eft: une compagnie
de gentils-hommes, dont la charge confifte à garder
le roi dans fa propre maifon ; c’eft dans cette vue,
qu’ils font expeûans dans la chambre depréfence.
Henri VII. eft le premier qui les-ait mis fur pié ;
ils font quarante : chacun d’eux eft obligé d’entretenir
trois chevaux qui portent en croupe , & un valet
qui doit être armé ; de forte qu’à proprement parler,
ils compofent un corps-^de-garde ; c’eft pourquoi ils
doivent paflèr en revue devant leurs propres officiers
; mais le roi les difpenfe ordinairement de ce
devoir, auquel ils fe font obligés par ferment. Leurs
officiers font un capitaine, un lieutenant, un enfei-
gne, 6c un clerc de contrôle ; leurs armes ordinaires
-font la hache d’armes dorée, avec laquelle ils accompagnent
le roi, quand il va à la chapelle royale*
ou lorf qu’il.en revient. Ils le reçoivent dans la chamr
bre de préfence , ou quand il fort de fon appartement
privé , de même que dans toutes les grandes
foiemnités. Leur penfion eft de cent livres fterling
-param
PENSUM, f. m. ( Littcrat. ) ptnfum étoit proprement
une certaine quantité de laine qu’on donnoit
.chaque jour aux fileufes pour leur tâche ; on la pe-
fo i t , 6c .c’eft de-là qu’on l’a nommée penfum, mot
qu’on a depuis étendu fur ce qui eft impofé cornai«
un travail réglé & ordinaire.
, PENSILVANIE , ( Géog. mod. ) province de l’Amérique
feptentrionale, bornée au nord par le pays
des Iroquois ; à l’orient par le nouveau Jerfey ; aii
midi par le Mariland, 6c à l’occident par le pays de*
R r