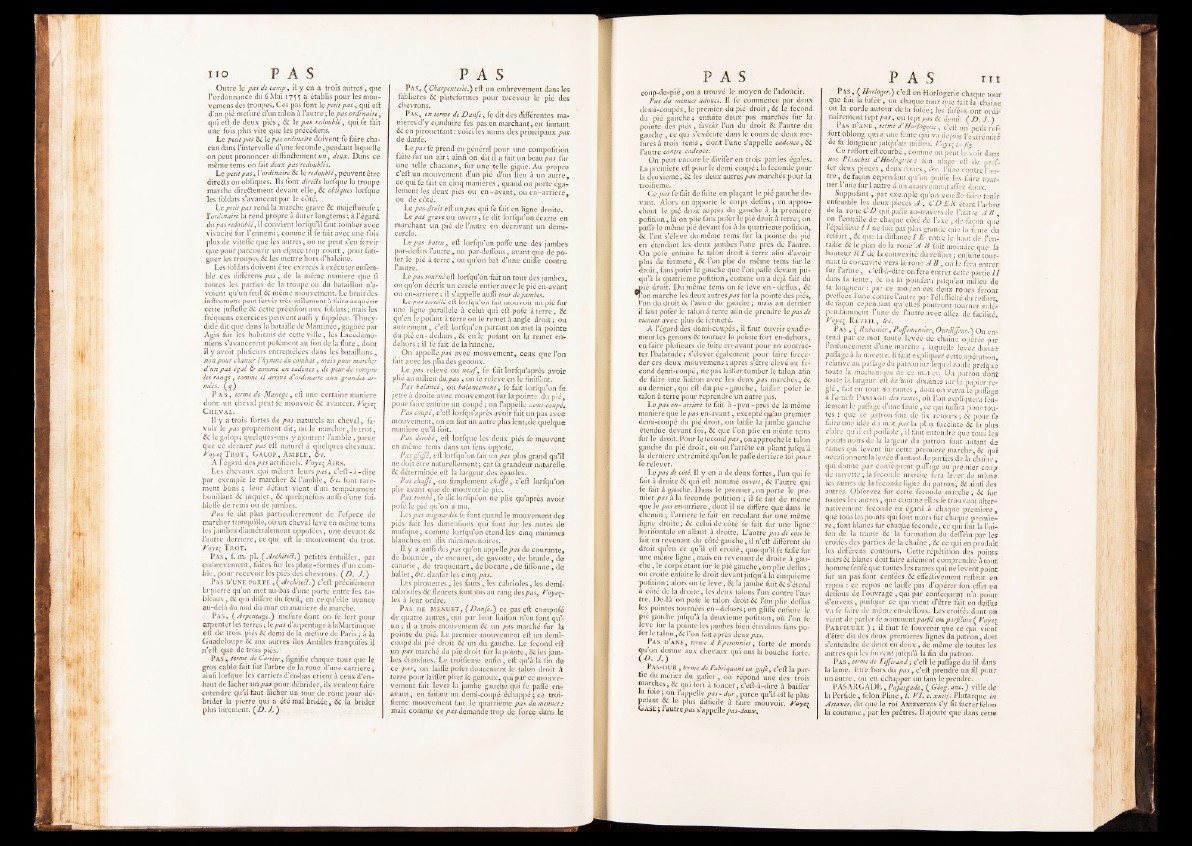
Outre le pas de camp, il y en a trois autres, que
l’ordonnance du 6Mai 1755 a établis pour lesmou-
vemens des troupes. Ces pas font le petit pas, qui eft
d’un pie mefuré d’un talon à l’autre ; le pas ordinaire,
qui eft de deux pies, & le pas redoublé, qui fe fait
une fois plus vite que les précédens. . ,
Le petit pas 8c le pas ordinaire doivent fe faire chacun
dans l’intervalle d’une fécondé, pendant laquelle
on peut prononcer diftinâement un, deux. Dans ce
même tems on fait deux pas redoubles.
Le petit pas, \ 'ordinaire 8c le redoublé, peuvent être
direéls ou obliques. Ils font directs lorfque la troupe
marche direâement devant elle, 8c obliques lorfque
les foldats s’avancent par le côté.
Le petit pas rend la marche grave & majeftueufe ;
l'ordinaire la rend propre à durer longtems ; à l’égard
du pas redoublé, il convient lorfqu’il faut tomber avec
vivacité fur l’ennemi ; comme il fe fait avec une fois
plus de vîtefl'e que les autres, on ne peut s’en fervir
que pour parcourir un efpace trop court, pour fatiguer
les troupes 8c les mettre hors d’haleine.
Les foldats doivent être exercés à exécuter enfem-
ble ces différens pas, de la même maniéré que fi
toutes les parties de la troupe ou du bataillon n’a-
voient qu’un feul 8c même mouvement. Le bruit des
inftrumenspeut fervir très-utilement à faire acquérir
cette juftefl'e 8c cette précifion aux foldats; mais les
fréquens exercices peuvent auffi y fuppléer. Thucydide
dit que dans la bataille de Mantinee, gagnée par
Agis fur les habitanS de cette v ille , les Lacédémoniens
s’avancèrent pofément au fon de la flûte, dont
il y avoit plufieurs entremêlées dans les bataillons ,
non pour chanter l'hymne du combat, mais pour marcher
d'un pas égal & comme en cadence , de peur de rompre
les rangs, comme il arrive d'ordinaire aux grandes ar-
mées. ( ? )
P a s , terme de Manege, eft une certaine maniéré
dont un cheval peut fe mouvoir 8c avancer. Foyer
-Che v al .
-Il y a trois fortes de pas naturels au cheval, fa-
voir le pas proprement dit, ou i? marcher, le trot,
8c le galop; quelques-uns y ajoutent l’amble » parce
que ce dernier pas eft naturel à quelques chevaux.
F o ye[T r o t , Ga l o p , Am ble, &c.
A l’égard des pas artificiels. Voye[ A irs.
Les chevaux qui mêlent leurs pas, c’eft - à - dire
par exemple le marcher 8c l’amble, &c. fqnt rarement
bons ; leur défaut vient d’un tempérament
bouillant 8c inquiet, 8c quelquefois aufii d’une foi-
bleffe de reins ou de jambes.
Pas fe dit plus particulièrement de l’efpece de
marcher tranquille, où un cheval leve en même tems
les jambes diamétralement oppofées, une devant 8c
l’autre derrière, ce qui eft le mouvement du trot.
Foye{ T ro t.
Pas,, f. m. pi. ( Architecl.) petites entailles, par
embrevement, faites fur. les plate-formes d’un comble
, pour recevoir les pies des chevrons. (Z>. J. )
Pas d’une PORTE , ( Architect. ) c’eft précifément
la pierre qu’on met au-bas d’une porte entre fes tableaux,
8c qui différé du feuil, en ce qu’elle avance
au-delà du nud du mur en maniéré de marche.
Pa s , ( Arpçntage.) mefure dont on fe fert pour
arpenter les terres ; le pas d’arpentage à laMartinique
eft de trois pies 8c demi de la mefure de. Paris ; à la
Guadeloupe 8c aux autres îles Antilles françoifes il
n’eft que de trois piés.
Pas , terme de Carrier, fignifie chaque tour que le
gros câble fait fur l’arbre de la roue d’une carrière ;
ainfi lorfque les carriers d’en-rbas crient à ceux d’en-
haut de lâcher un pas'pour[débrider, ils veulent faire
entendre-qu’il faut lâcher un tour de roue pour débrider
la pierre qui a été mal bridée, 8c la brider
plus furement. (D . /. )
Pas, ( Charpenterie.) eft un fablieres embrevement dans les chevrons.8c plateformes pour recevoir le pié des niéPréass d, ’yen c toernmdeu idree Dfeasn pfea,s feen d mit adrecsh dainffté, reenn tfeasu tmanat
8c en pirouettant : voici les noms des principaux pas de danfe.
Le pas fe prend en général pour une compofition
faite fur un air ; ainfi on dit il a fait un beau pas fur
une telle chacone, fur une telle gigue. Au propre
c’eft un mouvement d’un pié d’un lieu à un autre,
ce qui fe fait en cinq maniérés, quand on porte également
les deux piés ou en-avant, ou en -arriéré,
ou de côté.
Le pas droit eft un pas qui fe fait en ligne droite.
Le pas grave ou ouvert, fe dit lorfqu’on écarte en
marchant un pié de l’autre en décrivant un demi-
cercle.
Le pas battu, eft lbrfqu’on paffe une des jambes
par-deffus l’autre, ou par-deffous, avant que de po-
fer le pié à terre, ou qvi’on bat d’une cuiffe contre
l’autre.
Le pas tourné eft lorfqu’on fait un tour des jambes,
ou qu’on décrit un cercle entier avec le pié en-avant
ou en-arriere ; il s’appelle aufii tour de jambes.
Le pas tortillé eft lorfqu’on fait mouvoir un pié fur
une ligne parallèle à celui qui eft pofé à terre, 8c
qu’en le pofant à terre on le remet à angle droit ;. ou
autrement, c’eft iorfqu’en partant on met la pointe
du pié en - dedans, & en le pofant on la remet en-
dehors ; il fe fait de la hanche.
On appelle pas avec mouvement, ceux que l’on
fait avec les plis des genoux.
Le pas relevé ou neuf, fe fait lorfqu’après avoir,
plié au milieu du pas, on fe releve en le finiflànt.
Pas balancé, ou balancement, fe fait lorfqii’on fe
jette à droite avec mouvement fur la pointe du pié,
pour faire enfuite un coupé ; on l’appelle demi-coupé.
Pas coupé, c’eft lorfqu’après avoir fait un pas avec
mouvement, on en fait un autre plus lent, de quelque
maniéré qu’il foit.
Pas dérobé, eft lorfque les deux piés fe meuvent
en même tems dans un fens oppofé.
Pas glijfé, eft lorfqu’on fait un pas plus grand qu’il
ne doit être naturellement ; car fa grandeur naturelle
8c déterminée eft la largeur des épaules.
Pas chajfé, ou Amplement chajfé, c’eft lorfqu’oiî
plie avant que de mouvoir le pié.
Pas tombe, fe dit lorfqu’on ne plie qu’après avoir
pofé le pié qu’on a mu.
Les pas mignardés fe font quand le mouvement des
piés fuit les dimenfions qui font fur les notes de
mufique, comme lorfqu’on étend les cinq minimes
blanches en dix minimes noires» 1
Il y a aufii des pas qu’on appelle /w de courante,
de bourrée, de menuet, de gavotte, de branle, de
canarie , de traquenart „de bocane, de fiffonne, de
ballet, &c. danfer les cinq pas.
Les pirouettes, les fauts, les cabrioles, les demi-
cabrioles 8c fleurets font mis au rang des pas, Voyelles
à leur ordre.
Pas de men uet, {Danfe.') ce pas eft compofé
de quatre autres, qui par leur liaifon n’én font qu’un
; il a trois mouvemens 8c un pas marché fur la
pointe, du-pié. Le premier mouvement eft un demi-
coupé du pié droit 8c un du gauche. Le fécond eft
un pas marché du pié. droit fur la pointe ; 8c les jambes
étendues. Le.troifieme enfin, eft qu’ à la fin de
ce pas, on laiffe pofer doucement le talon droit à
terre pour laiffer plier le genoux, qui par ce mouve-
vement fait lever la jambe gauche qui fe. paffe enr
avant , en faiiant un demi-coupé échappé ; ce troi-
fieme mouvement fait le quatrième pas du menuet.*
mais comme ce pas demande trop de force dans le
coup-de-pié, oh a trouvé le moyen de l’adoitcir.
Pas du menuet adouci. Il fe commence par deux
demi-coupés, le premier du pié droit, 8c le fécond
du pié gauche ; enfuite deux pas marchés fur la
pointe des pié s, lavoir l’un du droit 8c l’autre du
gauche , ce qui s’exécute dans le cours de deux me-
liiresàtrois tems, dont l’une s’appelle cadence, 8c
l’autre contre-cadence.
On peut encore le divifer en trois parties égales.
La première eft pour le demi coupé ; la fécondé pour
la deuxieme, 8c les deux autres pas marchés pour la
troifieme.
Ce pas fe fait de fuite en plaçant le pié gauche devant.
Alors on apporte le corps deffus, en approchant
le pié droit auprès du gauche à la première
pofition, là on plie fans pofer le pié droit à terre ; on
paffe le même pié devant foi à la quatrième pofition,
& l’on s’élève du même tems fur la pointe du pié
en étendant les deux jambes l’une près de l’autre.
On pofe enfuite le talon droit à terre afin d’avoir
plus de fermeté, & l’on plie du même tems fur le
droit, fans pofer le gauche que l’on paffe devant juf-
qu’à la quatrième pofition, comme on a déjà fait du
j f ié droit. Du même tems on fe leve en - deffus, 8c
" ’on marche les deux autres pas fur la pointe des piés,
l’un du droit 8c l’autre du gauche ; mais au dernier
il faut pofer le talon à terre afin de prendre le pas de
menuet avec plus de fermete.
A l’égard des demi-coupés, il faut ouvrir exa&e*
ment les genoux & tourner la pointe fort en-dehors ,
en faire plufieurs de fuite en-avant pour en contracter
l’habitude ; s’élever également pour faire fuccé-
der ces deux mouvemens ; après s’être élevé au fe-*
cond demi-coupé, ne pas laiflèr tomber le talo/i afin
de faire une liaifon avec les deux pas marchés ; 8c
au dernier, qui eft du pié-gauche, laiffer pofer le
talon à terre pour reprendre un autre pas.
Le pas en-arriere fe fait à-peu -prè s de la même
maniéré que le pas en-avant, excepté qu’au premier
demi-coupé du pié droit, on laiffe la jambe gauche
étendue devant foi, 8c que l’on plie en même tems
fur le droit. Pour le fécond pas, on approche le talon
gauche du pié droit, ou on l’arrête en pliant jufqu’à
la derniere extrémité qu’on le paffe derrière foi pour
fe relever»
Le pas de côté. Il y en a de deux fortes, l’un qui fe
fait à d roite 8c qui eft nommé ouvert, 8c l’autre qui
fe fait à gauche. Dans le premier, on porte le premier
pas à la fécondé pofition ; il fe tait de meme
que le pas en-arriere, dont il ne différé que dans le
chemin ; l’arriere fe fait en reculant fur une même
ligne droite ; 8c celui de côté fe fait fur une ligne
horifontale en allant à droite. L’autre pas de côté fe
fait en revenant du côté gauche, il n’eft différent du
droit qu’en ce qu’il eft croifé, quoiqu’il fe faffe fur
une meme ligne, mais en revenant de droite à gauche
, le corps étant fur le pié gauche, on plie deffus ;
on croife enfuite le droit devant jufqu’à la cinquième
pofition ; alors on fe le v e , 8c la jambe fuit 8c s’étend
à côté de la droite, les deux talons l’un contre l’autre
» De-là on pofe le talon droit 8c l’on plie deffus
les^ pointes tournées en-dehors ; on gliffe enfuite le
pie gauche jufqu’à la deuxieme pofition, oti l’on fe
leve fur la pointe les jambes bien étendues fans pofer
le talon, 8c l’on fait après deux pas.
I AS d’ane, terme d'Eperonnier, forte de mords
^ d o n n e aux chevaux qui ont la bouche forte.
. Pas-dur , terme de Fabriquant en gafe, c’eft la partie
du metier du gafier, oli répond une des trois
marches, 8c qui fert à foncer, c’eft-à-dire à baifler
la loie ; on l’appelle pas - dur, parce qu’il eft le plus
pefant & le plus difficile à faire mouvoir. Veye? GASE ; 1 autre pas s’appelle pas-doux*
^ rS-’ f ï ï 0rl 0Ser‘) c’eft en Horlogerie chaque tour
que fait la fufée, ou chaque tour que fait la chaîne
ou la corde autour de la fufée; les fufées ont ordi*
nairement fep t. pas, ou fept pas 8c demi'. (D . J . )
P a s d ’ a n e , terme d'Horlogerie, e’eft un petit reA
fort oblong qui a une fente qui va depuis l’extrémitc
de fa longueur jufqu’au milieu. Voye^ Li.ji«.
Ce reffort eft courbé., comme on peut le voir dans
nos Planches d.'Horlogerie ; fon ufage eft de pre-f-
fer deux pièces , deux roues , &c. l’une contre l ’autre
, de façon cependant qu’on puiffe les faire tourner
l ’une fur l'autre d un mouvement affez doux;
Suppofant, par exemple qu’on veuille faire tenir
enfemble les deux pièces A , CD E R étant l ’arbré
de la roue C D qui paffe au-travers de l’autre A B
on l’entaille de chaque côté de l’axe , de façon qué
l’épaiffeur 1 1 ne foit pas plus grande que la fente du
reffort, 8c que la diftance I E entre le haut de l’entaille
& le plan de la roue A B foit moindre que là
hauteur R T de la convexité du reffort ; enfuite tournant
fa concavité vers la roue A B , on le fera entrer
fur l’arbre, c ’éft-à-dire on fera ëntrer cette partie I I
dans fa fente, 6c on la pouffera jufqu’aù milieu de
fa longueur : par ce moyen ces deux roués feront
preffées l’une contre l’autre par lelafticité du reffort,
de façon cependant qu’ elles pourront tourner indépendamment
l’une de l’autre avec affez de facilité*
Foye{ R é v e i l , &c.
P a s , ( Rubanier, Paffenientièr, Ourdijfeur. ) O i i entend
par ce mot toute levée de chaîne opérée par
l’enfoncement d’une marche , laquelle levée, donne
paffage à la navette. Il faut expliquer cette opération,
relative au paffage du patron fur lequel roule prefque
toute la méchanique de ce métier. Un patron dont
toute la largeur eft de huit dixaines fur leqjapier réglé
, fait en tout 80 rames, dont on verra le paffage
à l'article P a s s a g e des rames, oii l’on expliquera feulement
le paffage d’une feule, ce qui fiilfira pour toutes
: que ce patron foit de fix retours ; 8c pour fe
faire une idée du mot.pas la plus fuccinte 8c la plus
claire qu’il eft poflible , il faut entendre que tous les
points noirs de la largeur du patron font autant de
rames qui lèvent fur cette première marche, 8c qui
occafionnentla levée d’autant de parties de la chaîne,
qui donne par conféquent paffage au premier coup
de navette ; la fécondé marche fera lever de ntême
les rames de la fécondé ligne du patron, & ainfi des
autres» Obfervez fur cette fécondé marche, 8c fur
toutes les autres, que comme elles fe trouvent alter-5
nativement feConde eu égard à chaque première
que tous les points qui font noirs fur chaque première
, font blancs fur chaque fécondé, ce qui fait la liaifon
de la trame 8c la formation du deflein par les
croifés des parties de la chaîne, 8c ce qiii en produit
les différens contours. Gette répétition des points
noirs 8c blancs doit faire aifément comprendre à tout '
homme fenfé que toutes les rames qui ne lèvent point
fur un pas font cenfées 8c effectivement reftent en
repos : ce repos ne laiffe pas d’opérer fori effet en
deffous de l’ouvrage , qui par conféquent n’a point
d’envers, puifque ce qui vient d’être fait en deffus
va fe faire de même en-deffous. Les croifés dont on
vient de parler fe nomment parfit ou parfilure ( Vôye{
P a r f i l u r e ) ; il faut fe fouvenir que ce qui vient
d’être dit des deux premières lignes du patron, doit
s’entendre de deux en deux, de même de toutes les
autres qui les fuivent jufqu’à la fin du patron.
Pas , terme de Tijferand; e’eft le paflage du £1 dans
la lame. Etre hors du pas, c’eft prendre un fil pour
un autre, ou en échapper un farts le prendre»
PASARGADE, Paj'argade, ( Géog. ane. ) ville dé
la Perfide, félon Pline, l. VI. c. xxiij. Plutarque in
Ar taxer, dit que le roi Axtaxerces s’y fit facrer félon
la coutume, par les prêtres; Il ajoute que dans cette