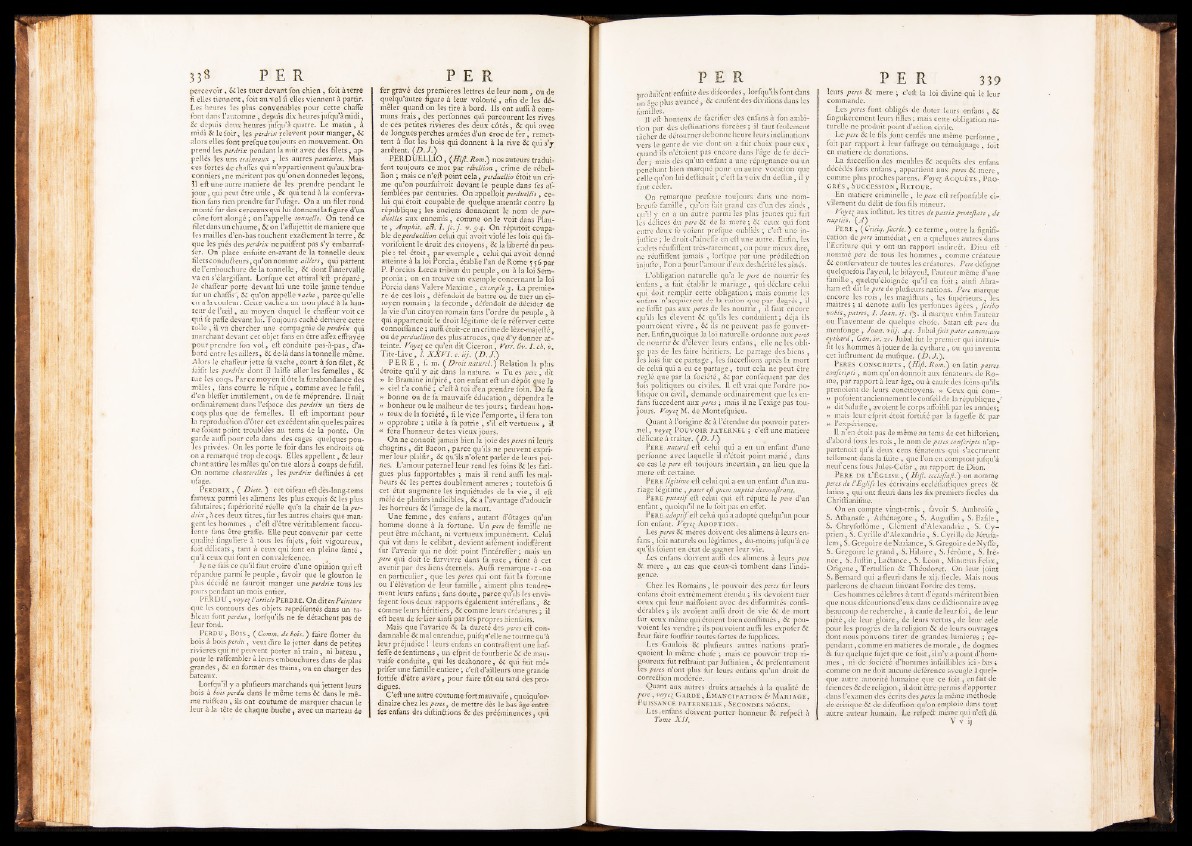
percevoir, 8cles tuer «levant fon chien , foit à terre
fi elles tiennent, foit au vol fi elles viennent à partir.
Les heures les plus convenables pour cette chaffe
font dans l’automne, depuis dix heures jufqu’àmidi,
8c depuis deux heures jufqu’à quatre. Le matin , à
midi & le fo ir , les perdrix relèvent pour manger, 8c
-alors elles font prefque toujours en mouvement. On
prend les perdrix pendant la nuit avec des filets, appelles
les uns traineaux , les autres pantieres. Mais
ces fortes de chafles qui n’appartiennent qu’aux braconniers
, ne méritent pas qu’onen donne des leçons,
II eft une autre maniéré de les prendre pendant le
jou r, qui peut être utile , 8c qui tend à la conferva-
tion fans rien prendre fur l’ufage. On a un filet rond
monté fur des cerceaux qui lui donnent la figure d’un
cône fort alongé ; on l’appelle tonnelle. On tend ce
filet dans un chaume, 8c on l’aflùjettit de maniéré que
les mailles d’en-bas touchent exaftement la terre, 8c
que les pies des perdrix nepuiflent pas s’y embarraf-
fer. On place enfuite en-avant de la tonnelle deux
filets condufteurs, qu’on nomme ailiers, qui partent
de l’embouchure de la tonnelle, 8c dont l’intervalle
va en s’élargiflant. Lorfque cet attirai *eft préparé,
le chafleur porte devant lui une toile jaune tendue
fur un chaflis'', 8c qu’on appelle vache , parce qu’elle
en a la couleur. Cette vache a un trou placé à la hauteur
de l’oe il, au moyen duquel le chafleur voit ce
qui fe paffe devant lui. Toujours caché derrière cette
toile , il va chercher une compagnie de perdrix qui
marchant devant cet objet fans en être affez effrayée
pour prendre fon v o l, eft conduite pas-à-pas, d’abord
entre les ailiers, 8c de-lâ dans la tonnelle même.
-Alors le chafleur jette fa vache, court à fon filet, 8c
faifit les perdrix dont il laifle aller les femelles , 8c
tue les coqs. Par ce moyèn il ôte la furabondance des
mâles , fans courre le rifque, comme avec le fiifil,
d’en blefler inutilement, ou de fe méprendre. Il naît
ordinairement dans l’efpece des perdrix un tiers de
coqs plus que de femelles. Il eft important pour
la reproduftion d’ôter cet excédent afin que les paires
ne foient point troublées au tems de la ponte. On
garde aufli pour cela dans des cages quelques poules
privées. On les porte le foir dans les endroits où
on a remarqué trop de coqs. Elles appellent, 8c leur
chant attire les mâles qu’on tue alors a coups de fiifil.
On nomme chanterelles , les perdrix deftinées à cet
ufage.
P e r d r i x , ( Diete. ) cet oifeau eft dès-long-tems
fameux parmi les alimens les plus exquis & les plus
falutaires ; fupériorité réelle qu’a la chair de la perdrix
, à ces deux titres, fur les autres chairs que mangent
les hommes , c’ eft d’être véritablement fuccu-
lente fans être greffe. Elle peut convenir par cette
qualité finguliere à tous les fujets, foit vigoureux,
foit délicats, tant à ceux qui font en pleine fanté ,
qu’à ceux qui font en convalefcence.
Je ne fais ce qu’il faut croire d’une opinion qui eft
répandue parmi le peuple, favoir que le glouton le
plus décidé ne fauroit manger une perdrix tous les
jours pendant un mois entier.
PERDU, voyeurarticle P e r d r e . OndiUnPeinture
<{ue les contours des objets repréfentés dans un tableau
font perdus, lorfqu’ils ne fe détachent pas de
leur fond.
P e r d u , B o is , ( Comm. de bois. ) faire flotter du
bois à bois perdu, veut dire le jetter dans de petite?
rivières qui ne peuvent porter ni train , ni bateau,
pour le raflembler à leurs embouchures dans de plus
grandes, 8c on former des trains, ou en charger des
bateaux.
Lorfqu’il y a plufieurs marchands qui jettent leurs
bois à bois perdu dans le même tems 8c dans le même
ruifleau, ils ont coutume de marquer chacun le
leur à la tête de chaque bûche, avec un marteau de
fer gravé des premières lettres de leur nom , ou de
quelqu’autre figure à leur volonté, afin de les démêler
quand on les tire à bord. Ils ont auflî à communs
fra is, des perfonnes qui parcourent les rives
de cës petites rivières des deux côtés, & qui avec
de longues perches armées d’un croc de fe r , remettent
à flot les bois qui donnent à la rive 8c qui s’y
arrêtent. (D .J !)
PERDUELLIO, (Hift. Rom!) nos auteurs tradui-
fent toujours ce mot par rébellion , crime de réb e llion
; mais ce n’eft point cela, perduellio étôit un crime
qu’on pourfuivoit devant le peuple dans fes af-
femblées par centuries. On appelloit perduellis, celui
qui étoit coupable de quelque attentât contre la
république ; les anciens donnoient le nom de per-
duelles aux ennemis, comme on le voit dans Plaut
e , Amphit. a cl. I. Je./, v. ^4. On réputoit coupable
deperduellion celui «qui avoit v iolé les lois qùi fa-
vorifoient le droit des citoyens, 8c la liberté du peuple
: tel étoit, par exemple, celui qui avoit donné
atteinte à la loi Porcia, établie l’an de Rome 556 par
P. Porcins Loeca tribun du peuple, ou à la loi Sem-
pronia ; on en trouve un exemple concernant la loi
Porcia dans Valere Maxime , exemple 3. La première.
de ces lo is , défendoit de battre ou dé tuer un citoyen
romain ; la fécondé, défendoit de décider de
la vie d’un citoyèn romain fans l’ordre du peuple , à
qui appartenoit le droit légitime de fe réferver cette
connoiflance ; aufli étoit-ce un crime de lèze-majefté,
ou deperduellion des plus atroces, que d’y donner atteinte.
Vy e{ ce qu’en dit Cicéron, Verr. liv. I . ch. v,
Tite-Live, l. X X F I . c. iij. (D . J.)
P E R E , f. m. ( Droit naturel. ) Relation la plus
étroite qu’il y ait dans la nature. » Tu es pere, dît
» le Bramine infpiré, ton enfant eft un dépôt aue le
» ciel t’a confié ; c’eft à toi d’en prendre foin. De fa
» bonne ou de fa mauvaife éducation, dépendra le
» bonheur ou le malheur de tes jours ; fardeau hon-
» teux de la fociété, fi le vice l’emporte, il fera ton
» opprobre ; utile à fa patrie , s’il eft vertueux , il
« fera l’honneur de tes vieux jours.
On ne connoît jamais bien la joie des peres ni leurs
chagrins, dit Bacon, parce qu’ils ne peuvent exprimer
leur plaifir, 8c qu’ils n’ofent parler de leurs peines.
L’amour paternel leur rend les foins & les fatigues
plus fupportables ; mais il rend aufli les malheurs
8c les pertes doublement ameres ; toutefois fi
cet état augmente les inquiétudes de la v ie , il eft
mêlé de plaifirs indicibles, 8c a l’avantage d’adoucir
les horreurs 8c l’image de la mort.
Une femme, des enfans, autant d’otages qu’un
homme donne à la fortune. Un pere de famille ne
peut être méchant, ni vertueux impunément. Celui
qui vit dans le célibat, devient aifement indifférent
fur l’avenir qui ne doit point l’intéreffer ; mais' un
pere qui doit fe furvivre dans fa race , tient à cet
avenir par des liens éternels. Aufli remarque - 1 - on
en particulier, que les peres qui ont fait la fortune
ou l’élévation de leur famille, aiment plus tendrement
leurs enfàns ; fans doute, parce qu’ils les envi-
fagent fous deux rapports également intéreflans, 8c
comme leurs héritiers, 8c comme leurs créatures ; il
eft beau de fedier ainfi par fes propres bienfaits.
Mais que l’avarice 8c la dureté des peres eft condamnable
&mal entendue, puifqit’elle ne tourne qu’à
leur préjudice ! leurs enfàns en contra&ent une baf-
feffe de fentimens, un efprit de fourberie 8c de mauvaife
conduite, qui les deshonore, 8c qui fait mé-
prifer une famille entière ; c’eft d’ailleurs une grande
fottife d’être avare, pour faire tôt ou tard des prodigues.
C’eft une autre coutume fort mauvaife, quoiqu’or-
dinaire chez les peres, de mettre dès le bas âge entre
fes enfans des diftin&ions 8c des prééminences, qui
vers le genre de vie dont on a fait choix pour eux ,
quand ils n’étoient pas encore dans l’âge «le fe décider
; mais dès qu’un enfant a une répugnance ou un
penchant bien marqué pour un autre vocation que
celle qu’on lui deftinoit; c’eft la voix du deftin, il y
faut ceder.
On remarque prefque toujours dans une nom-
breufe famille , qu’on fait grand cas d’un des aînés ,
qu’il y en a un autre parmi les plus jeunes qui fait
les délices du pere 8c de la mere ; 8c ceux qui font
entre deux fe voient prefque oubliés ; c’eft une in-
juftice ; le droit d’aînefle en eft une autre. Enfin, les
cadets réufîiffent très-rarement, ou pour mieux dire,
ne réuffiflent jamais , lorfque par une prédilection
injufte, l’on a pour l’amour d’eux déshérité les aînés.
L’obligation naturelle qu’a le pere de nourrir fes
enfans, a fait établir le mariage, qui déclare celui
qui doit remplir cette obligation ; mais comme les
enfans n’acquierent de la raifon que par degrés, il
ne fuffit pas aux peres de les nourrir , il faut encore
qu’ils les élevent 8c qu’ils les conduifent; déjà ils
pourroient v iv re , 8c ils ne peuvent pas fe gouverner.
Enfin,quoique la loi naturelle ordonne aux peres
de nourrir 8c d’elever leurs enfans, elle ne les oblige
pas de les faire héritiers. Le partage des biens ,
les lois fur ce partage, les fuccemons après la mort
de celui qui a eu ce partage, tout cela ne peut être
réglé que par la fociété, 8c par conféquent par des
lois politiques ou civiles. Il eft vrai que l’ordre politique
ou civil, demande ordinairement que les enfans
fuccedent aux peres ; mais il ne l’exige pas toujours.
Voye^ M. de Montefquieu.
Quant à l’origine 8c à l’étendue du pouvoir paternel
, voye{ P o u v o i r p a t e r n e l ; c’eft une matière
délicate à traiter. (D. J.)
P e r e naturel e ft c e lu i q u i a e u u n e n fan t d ’u n e
p e r fo n n e a v e c la q u e lle i l n’é to i t p o in t m a r ié , dans
c e ca s le pere e ft to u jo u r s in c e r t a in , au lie u q u e la
m e r e e ft c e r ta in e .
P e r e légitime e ft c e lu i q u i a eu u n e n fan t d’u n m a r
i a g e lé g i t im e , pater ejl quem nuptioe demonliram.
P e r e putatif eft celui qui eft réputé le pere d’un
e n fa n t , q u o iq u ’ il n e le fo i t p as e n effet.
P e r e adoptif eft. c e lu i q u i a a d o p té q u e lq u ’u n p o u r
f o n enfan t. Voye^ A d o p t i o n .
Les peres 8c meres doivent des alimens à leurs enfans
, foit naturels ou légitimes, du-moins jufqu’à ce
qu’ils foient en état de gagner leur vie.
Les enfans doivent aufli des alimens à leurs pere
& mere , au cas que ceux-ci tombent dans l’indigence.
Chez les Romains, le pouvoir des peres fur leurs
enfans étoit extrêmement étendu ; ils dévoient tuer
ceux qui leur naifloient avec des difformités confi-
derables ; ils avoient aufli droit de vie 8c de mort
fur ceux même qui étoient bien conftitués, 8c pou-
voient les vendre ; ils pouvoient aufli les expofer 8c
leur faire fouffrir toutes fortes de fupplices.
Les Gaulois 8c plufieurs autres nations prati-
quoient la même chofe ; mais ce pouvoir trop rigoureux
fut reftraint par Juftinien, 8c préfentement
les peres n’ont plus fur leurs enfans qu’un droit de
correâion modérée.
Quant aux autres droits attachés à la qualité de
pere, voye^ G a r d e , É m a n c i p a t i o n «S* M a r i a g e ,
P u i s s a n c e p a t e r n e l l e , S e c o n d e s n ô c e s .
Les .enfans doivent porter honneur 8c refpett à
Tome XII,
leurs peres 8c mere ; c’eft la loi divine qui le leur
commande.
Les peres font obligés de doter leurs enfans , 8c
fmgulierement leurs filles ; mais cette obligation naturelle
ne produit point d’aûion civile.
Le pere 8c le fils font cenfés une même perfonne '
foit par rapport à leur fuffrage ou témoignage , foit
en matière de donations.
La fuccefîion des meubles 8c acquêts des enfans
décédés fans enfans , appartient aux peres 8c mere ,
comme plus proches parens. Voye^ A cquêts , Progrès
, Succession , Retour.
En matière criminelle , le pere eft f efponfable civilement
du délit de fon fils mineur.
Voyei aux inftitut. les titres de patria proteßate, de
nuptiis. (A )
Pere , ( Critiq. fucrée. ) ce terme, outre la fignifî-
catiôn de pere immédiat, en a quelques autres dans
l’Ecriture qui y ont un rapport indireâ:. Dieu eft
•nommé pere de tous les hommes , comme créateur
8c confervateur de toutes les créatures. Pere défigne
quelquefois l’ayeul, le bifayeul, l’auteur même d’une
famille, quelqu’éloignée qu’il en foit ; ainfi Abraham
eft dit le pere de plufieurs nations. Pere marque
encore les rois , les magiftrats , les fupérieurs , les
maîtres ; il dénote aufli les perfonnes âgées * feribo
■ vobis, patres, I. Joan. ij. 1*3. il marque enfin l’auteur
ou l’inventeur de quelque chofe. Satan eft pere du
menfonge , Joan. vïij. 44 . Jubal fuit pater canemïum
cytharâ, G en. iv. 21. Jubal fut le premier qui inèrut-
fit les hommes à jouer de la cythare, ou qui inventa
cet infiniment de mufique. (D . J.).
Peres conscripts , (Hiß. Rom!) en latin patres,
confcripti, nom .qu’on donnoit aux fénateurs de Rome,
par rapport à leur âge, ou à caufe des foins qu’ils
prenoient de leurs concitoyens. » Ceux qui com-
» pofoient anciennement le confeil de la république
» dit Salufte, avoient le corps affoibli par les années;
» mais leur efprit étoit fortifié par la fagefle 8c par
» l’expérience.
Il n’en étoit pas de même au tems de cet hiftorien;
d’abord fous les rois, le nom de peres confcripts n’ap-
partenoit qu’à deux cens fénateurs qui s’accrurent
tellement dans la fuite , que l’on en comptoir jufqu’à
neuf cens fous Jules-Céfar, au rapport de Dion.
Pere de l’Ég l is e , (Hiß . eccUfiaß.) on nomme
peres de ÜEglife les écrivains eccléfiàftiques grecs 8c
latins , qui ont fleuri dans les fix premiers fiecles du
Chriftianifme. >
On en compte vingt-trois , favoir S. Ambroife > S. Athanafe , Athénagore , S. Auguftin , S. Baffle , S. Chryfoftôme , Clément d’Alexandrie , S. C y -
prien, S. Cyrille d’Alexandrie, S. Cyrille de Jérula-
lem, S. Grégoire de Naziance, S. Grégoire de N y fie, S. Grégoire le grand, S. Hilaire, S. Jérôme , S . Iré-
née, S. Juftin, La&ance, S. Léon, Minutius Felix,'
Origene, Tertullien 8c Théodoret. On leur joint S. Bernard qui a fleuri dans le xij. fiecle. Mais nous
parlerons de chacun fuivant l’ordre des tems.
Ces hommes célébrés à tant d’égards méritent bien
que nous difeourions d’eux dans ce diûionnaire avec
beaucoup de recherche, à caufe de leur fo i, de leur
piété, de leur gloire, de leurs vertus-; de leur zele
pour les progrès de la religion 8c de leurs ouvrages
dont nous pouvons tirer de grandes lumières ; cependant,
comme en matières de morale, de dogmes
& fur quelque fujet que ce foit, il n’y a point d nommes
, ni de fociété d’hommes infaillibles ici - bas ;
comme on ne doit aucune déférence aveugle à quelque
autre autorité humaine que ce fo it , en fait de
fciences 8c de religion , il doit être permis d’apporter
• dans l’examen des écrits des peres la même méthode
de critique 8c de difeuflion qu’on emploie dans tout
autre auteur humain, Le refpett même qui n’eft dû