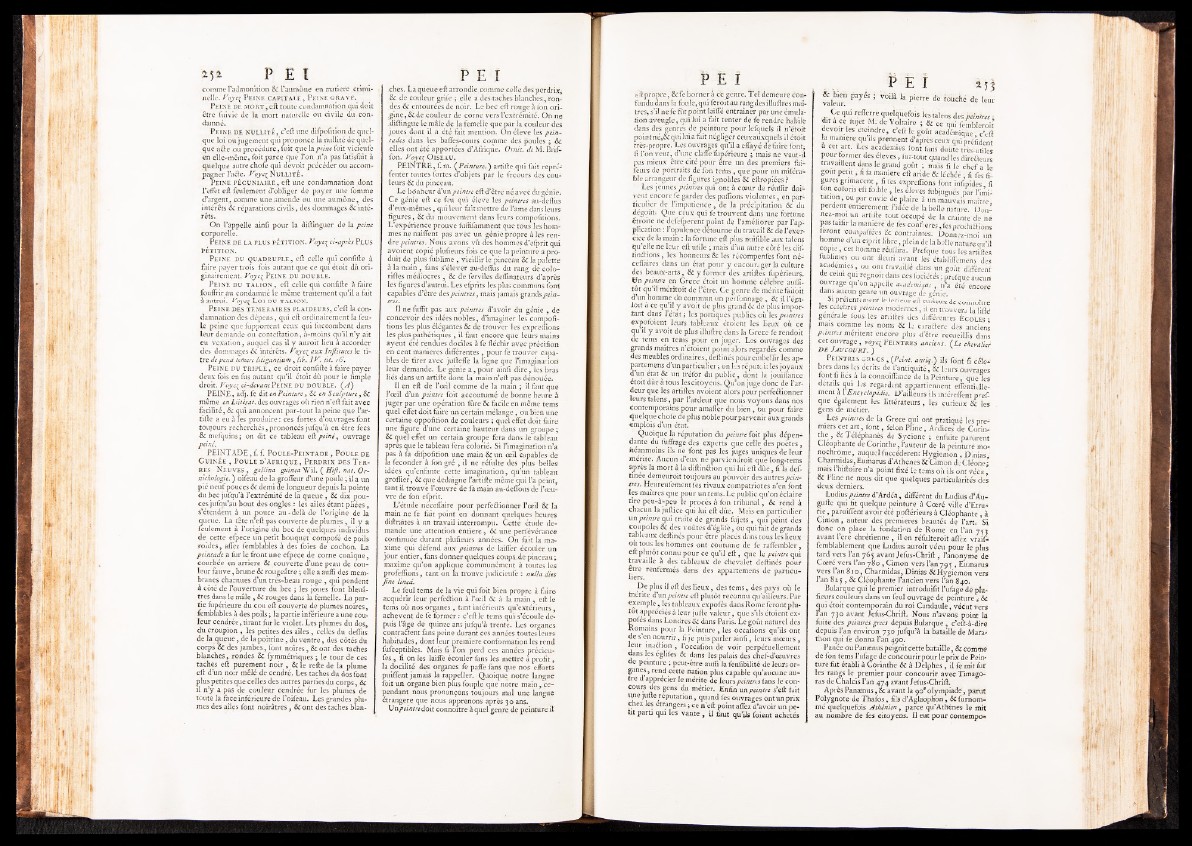
*5* P E T
comme l’admonition & l’aumône eti matière criminelle.
Foyc{ Peine cap itale , Peine g r a v e .
Peiné de mort , eft toute condamnation qui,doit
être fuivie de la mort naturelle ou civile du, condamné.
Peine de nullité, c’eft une difpofition de quelque
loi ou jugement qui prononce la nullité de quelque
a£te ou procédure, foit que la peine Toit vicieufe
en elle-même, foit parce que l’on n’a pas fatisfait à
quelque autre chofe qui devoit précéder ou accompagner
l’afte. Poye^ Nullité.
Peine pécjj.niaire , eft une condamnation dont
l’effet eft feulement d’obliger de payer une fomme
d’argent., comme une amende ou une aumône, des
intérêts & réparations civils, des dommages ôc intérêts.
On l’appelle ainfi pour la diftinguer de la peine
corporelle.
Peine de la plus pétition. Voye^ ci-après Plus
PÉTITION.
Peine du quadruple , eft celle qui confifte à
faire payer trois fois autant que ce qui étoit du originairement.
Voyc{ Peine du double.
Peine du talion , eft celle qui confifte à foire
fouffrir.au condamné le même traitement qu’il a fait
à.autrui, t'oyez L o i DU talion.
Peine des temeraires plaideurs, c’eft la condamnation
des dépens, qui eft ordinairement la feule
peine que fupportent ceux qui fuccombent dans
leur demande ou conteftation, à-moins qu’il n’y .ait
eu vexation, auquel cas il y auroit lieu a accorder
des dommages & intérêts. Vcye{ aux Injlitutes le titre
de pend tcmerelitigantium , lib. IV . tit. iG,
Peine du triple , ce droit confifte à foire payer
deux fois en fus autant qu’il étoit dû pour le fimple
droit. Voye^ ci-devant Peine du double. (A )
PEINE, adj. fe dit en Peinture, & en Sculpture , &
même en Liitérat. des ouvrages où rien n’eft fait avec
facilité, &. qui annoncent par-tout la peine que l’ar-
tifte a eu à les produire : ces fortes d’ouvrages font
toujours recherchés, prononcés jufqu’à en être fecs
Sc mefquins; on dit ce tableau eft peiné, ouvrage
peiné.
PEINTADE, f. f. Poule-Peintade , Poule de
G uinée , Poule d’Afr iq u e , Perdrix des T erres
- Neuves , gallina guinea "Wil. ( Hijl. nat. Ornithologie.
) oifeau de la groffeur d’une poule ; il a un
pié neuf pouces & demi de longueur depuis la pointe
du bec jufqu’à l’extrémité de la queue , & dix pouces
jufqu’au bout des ongles : les ailes étant pliées,
s’étendent à un pouce au-delà de l’origine de la
queue. La tête n’eft pas couverte de plumes, il y a
feulement à l’origine du bec de quelques individus
de cette efpece un petit bouquet compofé de poils
roides, affez femblables à des foies de cochon. La
peintade a fur le front une efpece de corne conique,
courbée en arriéré découverte d’une peau de couleur
fauve, brune & rougeâtre ; elle a aufli des membranes
charnues d’un très-beau rouge , qui pendent
à côté de l’ouverture du bec ; les joues font bleuâtres
dans le mâle, & rouges dans la femelle. La partie
fupérieure du cou eft couverte de plumes noires,
femblables à des poils ; la partie inférieure a une couleur
cendrée, tirant fur le violet. Les plumes du dos,
du croupion , les petites des ailes, celles du defïùs j
de la queue, de la poitrine, du ventre, des côtés du
corps & des jambes, font noires, & ont des taches
blanches, rondes & fymmétriques ; le tour de ces
taches eft purement noir , & le refte de la plume
eft d’un noir mêlé de cendré. Les taches du dos font
plus petites que celles des autres parties du corps, &
il n’y a pas de couleur cendrée fur les plumes de
toute la face inférieure de l’oifeau. Les grandes plumes
des ailes font noirâtres, & ont des taches blan-
P E I
ches. La qüeiie eft arrondie comme celle des perdrix,
ôc de couleur grife ; elle a des taches blanches, rondes,&
entourées de noir. Le bec eft rouge à fon origine
, & de couleur de corne vers l’extrémité. On ne
.diftingue le mâle de la femelle que par la couleur des
joues dont il a, été fait mention. On éleve les pein-
tades dans les baflès-cours comme des poules ; &
elles ont été apportées d’Afrique. Omit, de M. Brif-
fon. Voye{ Oiseau.
PEINTRE, f. m. ( Peinture.) artifte qui fait reprc-
fenter toutes fortes d’objets par le fecours des couleurs
& du pinceau.
Le b.dnheur d’un peintre eft d’être né avec du génie.
Ce génie eft ce feu qui éleve les peintres au-deflùs
d’eux-mêmes, qui leur fait mettre de l’ame dans leurs
figures, & du mouvement dans leurs compositions.
L’expérience prouve llifRfamment que tous les hommes
ne naiffent pas avec un géniè propre à les rendre
peintres. Nous avons vu des hommes d’efprit qui
avoient copié plufieurs fois ce que la peinture a produit
de plus fublime , vieillir le pinceau &c la palette
à là m ain, fans s’élever au-defliis du rang de eolo-
riftes médiocres , & de ferviles deffinateurs d’après
les figures d’autrui. Les efprits les plus communs font
capables d’être des peintres, mais jamais grands peintres.
Il ne fuffit pas aux peintres d’avoir du génie , de
concevoir des idées nobles, d’imaginer les compofi-
tions les plus élégantes & de trouver les expreffions
les plus pathétiques , il faut encore que leurs mains
ayent été rendues dociles à fe fléchir avec précifion
en cent maniérés différentes , pour fe trouver capables
de tirer avec jufteffe la ligne que l’imaginariori
leur demande. Le génie a , pour ainfi dire, les bras
liés dans un artifte dont la main n’eft pas dénouée.
II en eft de l’oeil comme de la main ;■ il faut que
l’oeil d’un peintre foit accoutumé de bonne heure à
juger par une opération lîire & facile en même tems
quel effet doit faire un certain mélange, ou bien une
certaine oppofition de couleurs ; quel effet doit faire
une figure d’une certaine hauteur dans un groupe ;
& quel effet un certain groupe fera dans le tableau
après que le tableau fera colorié. Si l’imagination n’a
pas à la difpofition une main & un oeil capables de
la féconder à fon gré , il ne réfulte des plus belles
idées qu’enfante cette imagination, qu’un tableau
groffier, & que dédaigné l’artifte même qui l’a peint,
tant il trouve l’oeuvre de fa main au-deffous de l’oeuvre
de fon efprit.
L’étude néceffaire pour perfectionner l’oeil & la
main ne fe foit point en donnant quelques heures-
diftraites à un travail interrompu. Cette étude demande
une attention entière, & une perfévérance
continuée durant plufieurs années. On fait la maxime
qui défend aux peintres de laiffer écouler un
jour entier, fans donner quelques coups-de pinceau;
maxime qu’on applique communément à toutes les
profeflions, tant on la trouve judicieufe : niella dits
fine lineâ.
Le feul tems de la vie qui foit bien propre à foire
acquérir .leur perfection à l’oeil & à la main , eft le
tems où nos organes , tant intérieurs qu’extérieurs ,
achèvent de fe former : c’eft le tems qui s’écoule depuis
l’âge de quinze ans jufqu’à trente. Les organes
contractent fans peine durant ces années toutes leurs
habitudes, dont leur première conformation les rend
fufceptibles. Mais fi l’on perd ces années précieu-
fe s , fi on les laiffe écouler fans les mettre à profit,
la docilité des organes fe paffe fans que nos efforts
puiftent jamais la rappeller. Quoique notre langue
foit un organe bien pfus fouple que nôtre main, cependant
nous prononçons toujours mal une langue
étrangère que nous apprenons après 30 ans.
Uu.peintre doit connoitre à quel genre de peinture iL
P E î
eft propre, & fe borner à c;e genre. Tel demeure confondu
dans la foule, qui feroit aii rang des illuftres maîtres,
s’il nefe fût point laiffé entraîner par une émulation
aveugle j qui lui a fait tenter de fe rendre habile
dans des genres de peinture pour lefquels il h’étoit
point né,& qui lui a fait négliger ceuxàuxquels il étoit
très-propre. Les.ouvrages qu’il a effayé dé faire font*
fi l’on veut, d’une claflè fupérieure ; mais ne vaut-il
pas mieux être cité pour être un des premiers foi^
leurs de portraits de fon tems, que pour un miféra-
ble arrangeur de figures ignobles & eftropiées ?
Les jeunes peintres qui ont à coeur de réuffir doivent
encore fe garder des paflioris violentes, en particulier
de l’impatience, de la précipitation & du
dégoût. Que ceux qui fe trouvent dans une fortune
étroite ne defefperent point de l’améliorer par l’application
: l’opulence détourne dii travail & de l’exercice
de lamain : la fortune eft plus nuifible aux talens
qu’elle ne leur eft utile ;.mais d’un autre côté les dif-
tinétions, les honneurs & les réeompenfes font né-
ceflaires dans un état pour y encourager la culture
des beaux-arts, & y former des artiftes fupérieurs.
ün peintre en Grece étoit un homme célébré auffi-
iôt qu’il meritoit de l’être. Ce genre de mérite failbit
d’un homme dti commun un perfonnage , &£ il l’éga-
loit a ce qu’il y avoït de plus grand & de plus important
dans 1 état ; les portiques publics oii les peintres
expofoient leurs tableaux étoieht les lieux où cè
qu’il y avoit dé plus illuftre dans la Grece fe rendoit
de tems en tems pour en juger. Les ouvrages des
grands maîtres n’étoient point alors regardés comme
des meubles ordinaires, deftinés pour embellir les ap-
partemens d’un particulier ; on les reputcit les joyaux
d’un état & un tréfor du public, dont la jouifiance
etoit due à tous les citoyens. Qu’on juge donc de l’ardeur
que les artiftes avoient alors pour perfectionner
leurs talens, par l’ardeur que nous voyons dans nos
contemporains pour amaflèr du bien, ou pour faire
quelque chofe de plus noble pour parvenir aux grands
emplois d’un état.
Quoique la réputation du peintre foit plus dépendante
du fuffrage dés experts que celle des poètes, |
neanmoins ils ne font pas les juges uniques de leur
mérité. Aucun d’eux ne parviendroit que long-tems
après la mort à la diftinCtion qui lui eft due, fi la def-
tinee demeuroit toujours au pouvoir des autres pein-
tres. Heureufémént les rivaux compatriotes n’en font
les maîtres que pour un tems. Le public qu’on éclaire
tire peu-à--peu le procès à fon tribunal, & rend à
chacun la juftice qui lui eft due. Mais en particulier
un peintre qui traite de grands fujets , qui peint des
coupoles des voûtes d’églife, ou qui fait de grands
tableaux deftinés pour être placés dans tous les lieux
ou tous les hommes ont coutume de fe raffembler ,
eft plutôt connu pour ce qu’il e ft , que le peintre qui
travaille à des tableaux de chevalet deftinés pour
etre renfermés dans des appartemens de particuliers.
De plus il eft des lieüJc, des tems, des pays où le
fnente d’un peintre eft plutôt reconnu qu’ailleurs. Par
exemple, les tableaux expofés dans Rome feront plutôt
appréciés à leur jufte valeur, que s’ils étoient ex-
pôles dans Londres & dans Paris. Le goût naturel des
Romains pour la Peinture , les occafions qu’ils ont
de s en nourrir, fi je puis parler ainfi, leurs moeurs ,
leur inaction , l’occafion de voir perpétuellement
dans les églifes & dans les palais des chef-d’oeuvres
de peinture ; peut-être aufli la fenfibilité de leurs organes
, rend cette nation plus capable qu’aucune autre
d apprécier le mérite de leurs peintres fans le con-
cours des gens du métier. Enfin un peintre s’eft fait
Une jufte réputation, quand les ouvrages ont un prix
chez les etrangers ; ce n eft point aflez d’avoir un petit
parti qui les vante , il faut qu’ils foient achetés
P E l in
& K e h payés R Voilà la pie t« W ÊM de ku •
JÜ U’s taîem BBBII
■ S B ■ H ; & ce qui fembleroit
devoir les éteindre, c’eft le, goût a ô ïëm q ùV c’ eft
■ la manière qu ils prennent d’après ceux qui président
cet art. Les académies fbnt fans doüte très-utiles
pour former des eleves, fur-tout quand les direaeurs
travaillent dans le grand goût ; mais fi le chef a lé
goût petit ; fi fa maniéré eft aride &: léchée : fi fes figures
grimacent , fi les expreffions font irtfipides, Ci
ion colons eft foible , l'es élevés iiibjugués parl’imic
talion -ou par envie de plaire à ■ mauvais maître,
peraent entièrement l’idée'de là belle nature Don-
ner-moi nn artifte tout occupé de la 1 1 hé
pas laiftr la manrére;de fes çÆfîèrês/esprBclttaiOns
leront ‘Compaffeés & contraintes: Ddnrtéî-'tiiôi un
homme d îm eipm libre .plein de la bellenaïure W li
copie, tet homme réuffira. Prelque tous f a artiftes
lubhmes ou ont fleuri avant les établifl'emens des
academies, .ou. ont travaillé dans un goftt dïfféfenf
de celui qui regnoit dans ces ibeiétés; prelaiie aucun
ouvrage qu on appelle h cM u tiip ! , , 'h ï é té encore
dans aucun genre un ouvrage de génie.
Si préiemc-ment le leéieur eft curieux de corinoîtré
lès célébrés peintres modernes, il en trouvera la liftd
générale fous les artiftes des différeiires Écoles •
mais comme les noms & U earaélere des anciens
pantres méritent encore plus d’être recueillis dans
cet ouvrage, voye^ PEINTRES anciens. (Le chevalier
t)E J AU COU RT. J '
Peintres grecs , narij.j.îfe font fi céié-a
bres dans les écrits de l’antiqiiité y & leurs ouvrages
font fi lies à la connoiffance de la Peinture, que les
details qui h s regardent appartiennent effèntiellë-
ment a IEncyclopédie. D ’ailleurs ils mtéreffent pref-
que egalement les littérateurs, les curieux & les
gens de métier.
Les peintres de là Grece qui ont pratiqué ieS premiers
cet art, font, félon Pline, Ardices de Corin-
” *e, > ^ Telephanès de Sycione ; enfuite parurent
Cleophante de Corinthe, l’auteur de la peinture monochrome,
auquel fuccéderent Hygiemon , Dinias^
Charmidas, Eumarus d’Athènes & Cimon deCléone;
mais 1 hiftoire n’a point fixé le tems où ils ont v écu,
& Pline ne nous dit que quelques particularités des
deux derniers.
Ludiuspeintre d’Ârdéa, different du Ludiüs d’Au-
gufte qui fit quelque peinture à Coeré ville d’Etru-
r ie , paroiffent avoir été poftérieurs à Cleophante , à
Cimon, auteur des premières beautés dç l’art. Si
donc on place la fondation de Rome en l’an 753
avant l’ere chrétienne , il en réfulteroit âflèz vraif-
femblablement que Ludius auroit vécu pour le plus
tard vers l’an 765 avant Jefus-Chrift ,• l’anortyme de
Coere vers 1 an 780 , Cimon vers l’an 79 ^ , Eùmarüâ
vers 1 an 810, Charmidas, Dinias & Hygiemon vers
l’an 815 , & Cléophante l’ancien vers l’an 840.
Bularque qui le premier introduifit l’ufage dë piu-
fieurs couleurs dans un feul ouvrage de p e in tu ré&
^ui étoit contemporain dü roi Candaule, vécut vers
ran 730 avant Jefus-Chrift. Nous n’avôns point la
fuite des peintres grecs depuis Bularqüe, c’eft-à-dire
depuis l’an environ 730 jufqu’à la bataille de Marathon
qui fe donna l’an 490.
Panée ou Panænus peignit cette bataillé, & comfne
de fon tems l’ufage de concourir pour le prix de Peinture
fut établi à Corinthe & à Delphes, il fe mit fur
les rangs le premier pour Concourir avec Timagô-
ras de Chalcis l’an 474 avant Jefus-Chrift.
Après Panænus , & avant la 90eolympiade, parut
Polygnote de Thal'os, fil9 d’Aglaophon, & furnom-
mé quelquefois Athénien, parce qu’Athènes le mit
au nombre de fes citoyens. Il eut pour contèmp<H