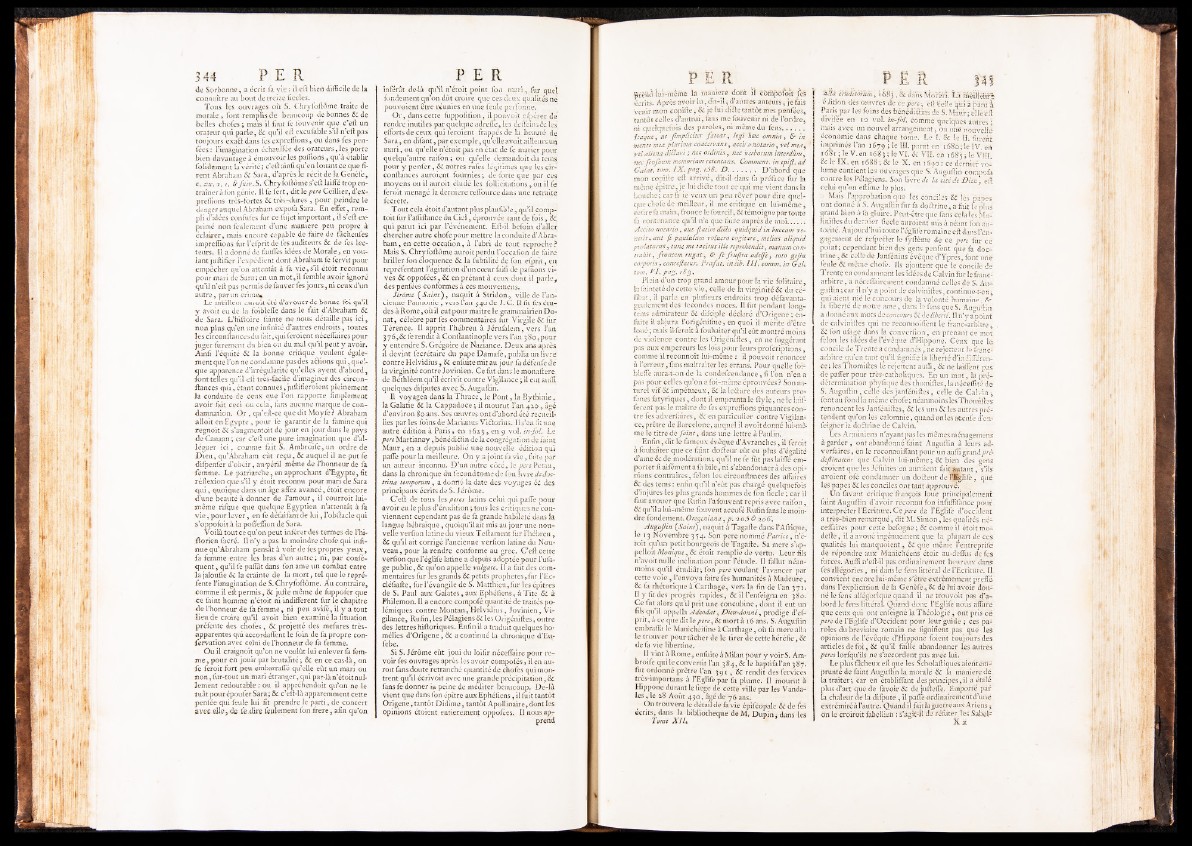
de Sorbonne, a écrit fa vie : il eft bien difficile de ia
connoître au bout de treize fiecles.
Tous les ouvrages où S. Chryfoftôme traite de
morale, font remplis de beaucoup de bonnes 6c de
belles choies ; mais il faut le fouvenir que c’eft un
orateur qui parle, & qu’il eft excul'able s’il n’eft pas'
toujours exaû dans fes expreffions, ou dans fes pensées
: l’imagination échauffée des orateurs, les porte
bien davantage à émouvoir les pallions, qu’à établir
folidement la vérité ; c’eft ainfi qu’en louant ce que firent
Abraham & Sara, d’après le récit de la Genèfe,
t. v. i . & fuiv.S. Chryfoftôme s’eft biffé trop entraîner
à fon génie. 11 fe fert, dit le pere Ceillier, d’ex-
preffions très-fortes Sç très-dures , pour peindre le
danger auquel Abraham expofa Sara. En effet, rempli
d’idées çonfufes fur ce lu jet important, il s’eft ex*-
primé non feulement d’une maniéré peu propre à
éclairer, mais encore capable de faire de fâcheufes
impreflions fur l’efprit de fes auditeurs 6c de fes lecteurs.
Il a donné de fauflès idées de Morale, en voulant
juftifier l’expédient dont Abraham fe fervit pour
empêcher qu’on attentât à fa v ie ,s ’il étoit reconnu
pour mari de Sara;en un mot,il femble avoir ignoré
qu’il n’eft pas permis de fauver fes jours, ni ceux d’un
autre, par un crime*
Le meilleur auroit été d’avouer de bonne foi qu’il
y avoit eu de la foibiefle dans le fait d’Abraham &
de Sara. L’hiftoire fainte ne nous détaille pas ic i,
non plus qu’en une infinité d’autres endroits, toutes
les circonltancesdu fait, quiferoient néceffaires pour
juger furement du bien ou du mal qu’il peut y avoir.
Ainfi l’équité & la bonne critique veulent également
que l’on ne condamne pas des a étions qvii, quelque
apparence d’irrégularité qu’ elles ayent d’abord,
font telles qu’ il eft très-facile d’imaginer des circon-
ftances q u i, étant connues, juftifieroient pleinement
la conduite de ceux que l’on rapporte fimplement
avoir fait ceci ou cela, fans aucune marque de condamnation.
Or , qu’eft-ce que dit M oyfe? Abraham
allait en Egypte , pour fe garantir de la famine qui
regnoit 6c s’augmemoit de jour en jour dans le pays
de Canaan ; car c’eft une pure imagination que d’alléguer
ic i, comme faitS. Ambroife,un ordre de
D ieu , qu’Abraham eût reçu, 6c auquel il ne put fe
difpenfer d’obéir, aivpéril même de l’honneur de fa
femme. Le patriarche, en approchant d’Egypte, fît
réflexion que s’il y étoit reconnu pour mari de Sara
q u i, quoique dans un âge allez avancé, étoit encore
d’une beauté à donner de l’amour, il courroit lui-
même rifque que quelque Egyptien n’attentât à fa
v ie , pour lever, en fe défaifant de lu i, l’obftacle qui
s’oppofoit à la pofîeflion de Sara.
Voilà tout ce qu’on peut inférer des termes de l’hi-
florien facré. Il n’y a pas la moindre chofe qui infinité
qu’Abraham pensât à voir de fes propres yeux,
fa femme entre les bras d’un autre ; n i, par confé-
quent, qu’il fe paflat dans fon ame un combat entre
la jaloufie & la crainte de la mort, tel que le repréfente
l’imagination de S. Chryfoftôme. Au contraire,
comme il eft permis, 6c jufte même de fuppofer que
ce faint homme n’étoit ni indifferent fur le chapitre
de l’honneur de fa femme, ni peu avifé, il y a tout
lieu de croire qu’il avoit bien examiné la fituation
préfente des cnofes , 6c projetté des mefures très-
apparentes qui accordaffent le foin de fa propre con-
fervation avec celui de l’honneur de fa femme.
Ou il craignoit qu’on ne voulût lui enlever fa femme
, pour en jouir par brutalité ; & en ce cas-là, on
fe feroit fort peu embarraffé qu’elle eût un mari ou
non, fur-tout un mari étranger, qui par-là n’étoit nullement
redoutable : ou il apprénendoit qu’on ne le
tuât pourépouferSara; & c’eft-là apparemment cette
penfée qui feule lui fit prendre le parti, de concert
avec elle, de fe.dire feulement fon frere, afin qu’on
inférât de-là qu’il n’érôit point fon mari, fur quel
fondement qu’on dut croire que ces deux qualités ne
pouvoient être réunies en une feule perfonne.
O r , dans cette luppofition, il pouvoit efpérer de
rendre inutiles par quelque adrefle, les cleffems 6c les"
efforts de ceux qui feroient frappés de la beauté de
Sara, en difant, par exemple, qu’elle avoit ailleurs un
mari, ou qu’elle n’étoit pas en état de fe marier pour
quelqu’autre raifon ; ou qu’elle demandoit du tems
pour y penfer, 6c autres rufes légitimes que les cir-*
confiances auroient fournies ; de forte que par ces
moyens ou il auroit éludé les follicitations, ou il fe
feroit ménagé la derniere reflource dans une retraite
fecrete.
Tout cela étoit d’autant plus plaufible, qu’il comp-
toit fur l’affiftance du C ie l, éprouvée tant de fois, 6c
qui parut ici par l’ événement. Eft-il befoin d’aller
chercher autre chofe pour mettre la conduite d’Àbra-
ham, en cette occafion, à l’abri de tout reproche ?
Mais S. Chryfoftôme auroit perdu l’occafion de faire
briller fon éloquence 6c la lubtiiité de fon efprit, en
repréfentant l’agitation d’un coeur faili de pâmons vives
6c oppofées, & en prêtant à ceux dont il parle,
des penfées conformes à ces mouvemens.
Jérôme (Saint'), naquit à Stridon, ville de l’ancienne
Pannonie, vers l’an 340 de J. C , Il fit fes études
à Rome, où il eut pour maître le grammairien Do-
nat, célébré par fes commentaires fur Virgile 6c fur
Térence. Il apprit l’hébreu à Jérufalem, vers l’an
376,&ferendit à Conftantinople vers l’an 380,pour
y entendre S. Grégoire de Naziance. Deux ans après
il devint fecrétaire du pape Damafe ,,publia un livre
contre Helvidius, & enfuite mit au jour fa défenfe dé
la virginité contre Jovinien. Ce fut dans le monaftere.
de Bethléem qu’il écrivit contre Vigilance ; il eut auflî
quelques difputes avec S. Auguftin.
Il voyagea dans la Thrace, le Pont, la Bythinie,
la Galatie & la Cappadoce ; il mourut Pan 4Z0, âgé
d’environ 80 ans. Ses oeuvres ont d’abord été recueil*
lies par les foins de Marianus Viftorius. Il s’en fit une
autre édition à Paris, en 1623 , en 9 vol. in-fol. Le
pere Martianay, bénédictin de la congrégation de faint
Maur, en a depuis publié une nouvelle édition qui
pafle pour la meilleure. On y a joint fa v ie , faite par
un auteur inconnu. D ’un autre côté, le pere Petau,
dans la chronique du fécond tome de fon livre de doc-
trina ttmporum, a donne la date des voyages Sc des
principaux écrits de S. Jérôme.
C ’eft de tous les peres latins celui qui pafle pour
avoir eu le plus d’érudition ; tous les critiques ne conviennent
cependant pas de fa grande habileté dans la
langue hébraïque, quoiqu’il ait mis au jour une nouvelle
verfion latine du vieux Teftament fur l’hébreu ,
& qu’il ait corrigé l’ancienne verfion latine du Nouveau
, pour la rendre conforme au grec. C ’eft cette
verfion que l’églife latine a depuis adoptée pour l’ufà-
ge public, 6c qu’on appelle vulgate. Il a fait des commentaires
fur les grands 6c petits prophètes,fur l’Ec-r
cléfiafte, fur l’évangile de S. Matthieu,fur les épîtres
de S. Paul aux Galates, aux Ephéfiens, à Tite & à
Philemon. Il a encore compofé quantité de traités polémiques
contre Montan, Helvidius, Jovinien, Vigilance,
Rufin, les Pélagiens 6c les Origéniftes, outre
des lettres hiftoriques. Enfin il a traduit quelques homélies
d’Origene ,6 c a continué la chronique d’Eu,-
febe.
Si S. Jérôme eût joui du loifir néceffaire pour re*?
voir fes ouvrages après les avoir compofés, il en au-?
roit fans doute retranché quantité de chofes qui mon*-
trent qu’il écrivoit avec une grande précipitation, 6c
fans fe donner in peine de méditer beaucoup. De-là
vient que dans fon épître aux Ephéfiens, il fuit tantôt
Origene, tantôt Didime, tantôt Apollinaire, dont les
opinions étoient entièrement oppofées. Il nous ap7
^fêftd lui-même là màhieï-é dont il côïftpôfoît ie’s
écrits. Après avoir lu, dit-il * d’àùtres ailtéilrs * je Fais
Venir mon copifte * & je lui di&etâritôt mes peiifées*
tantôt celles d’autrui* fans me fouvenir ni de l’ordre*
ni quelquefois des paroles , ni même du fens. i . . . •.
J raque, ut Jimpltcitcr fatear, legi hoec ornnia, & in
mente tiieii plurimâ càacervans, accit 0 nôtario, vel mecii ”
vel aliéna, diclàvi ; nec ordinis, nec vcrbàrum ihterdùm *
neefenfuurn memoriam retenta ns-. Comment, in epifl. ad
Galàt. tom-. IX . pag. 1S8. D . . . . . . . D ’abord que
mon copifte eft arrivé, dit-il dans fa préface fur la
même épître, je lui dicte tout ce qui me vient dans la
bouche; car fi te veux un peu rêver pour dire quelque
chofe de meilleur, il me critique en lui-même *
retire fa main, fronce le fourcil * 6c témoigne par toute
fa contenance qu’il n’a que faire auprès de moi.. . . . 1
Accito notdrio, dut fatim diclo quidquid in buccam ve-
herit, aitt fi paulûlum voluero cogitare, melius aliquid
prolaturus, tune me tacitus ille reprehendit, manum côn-
trahit, frontem rttgat, & fe fruflra adeffe , tôtô géjiii
’corports-, conteflatur. Prcefat. inlib. IIP. comm. in G al-,
tom. PI. pag. iSc,
Plein d’un trop grand amour pour la vie folitàiré *
ia fainteté de Cette v ie , celle de la virginité 6c du célibat
, il parle en plufieurs endroits trop défàvanta-
geufement des fécondés noces. Il fut pendant long-
tems admirateur & difciple déclaré d’Origene ; en-
fuite il abjura l’origénifme * en quoi il mérite d’être
loué ; mais il feroit à fouhaiter qü’il eut montré moins
de violence contre les Origéniftes, en ne fiiggérant
pas aux empereurs lès lois pour leurs profériptions,
comme il reconnoît lui-même : il pouvoit renoncer
à l’erreur , fans maltraiter les errans. Pour quelle foi-
bleffe aura^t-on de la eondefeendance, fi l’on n’en a
pas pour celles qu’on a foi-même éprouvées? Sonnai
turel v if & impétueux, & la leéhire des auteurs profanes
fatyriques, dont il emprunta le ftyle, ne le b i f fèrent
pas le maître de fes expreffions piquantes contre
fes adverfaires, 6c en particulier contre Vigilant
ce, prêtre de Barcelone, auquel il avoit donné luiimêi
me le titre de faint, dans une lettre à Paulin.
Enfin, dit le fameux évêque d’Avranches, il feroit
à fouhaiter que ce faint do&eur eût eu plus d’égalité
d’ame & de modération; qu’il ne fe fut pas laifle emporter
fi aifémeht à fa bile, ni s’abandonner à des opb
nions contraires, félon les circonftances des affaires
& des tems : enfin qu’il n’eût pas chargé quelquefois
d’injures les plus grands hommes de fon fiecle ; car il
faut avouer que Rufin l’afouvent repris avec raifon *
6c qu’il a lui-même foûvent aceufé Rufin fans le moindre
fondement. Oregeniana, p. iô S & 20C.
Àuguf in (Saint), naquit à Tagafte dans l’Afriqiie*
le 13 Novembre 354. Son pere nommé Patrice, n’étoit
qu’un petit bourgeois de Tagafte. Sa mere s’ap-
pelloit Monique, 6c étoit remplie de vertu. Leur fils
n’avoit nulle inclination pOuir l’étude. Il fallut néanmoins
qu’il étudiât ; fon père voulant l’avancer par
cette voie , l’envoya faire fes humanités à Madeure,
6c fa rhétorique à Carthage* vers la fin de l’an 371.
Il y fit des progrès rapides, 6c il l’enfeigrta en 380.
Ce fut alors qu’il prit une concubine, dont il eut un
fils qu il appélla Adeodai * Dieu-donné, prodige d’ef-
prit, a ce que dit le père * 6c mOrt à i 6 ans; S. Aiiguftin
embrafla le Mahichéifme à Carthage, où fà mere alla
le trouver pour tâcher de le tirer de cette héréfie, &
de fa vie libertine.
Il vint à Rome, enfuite à Milan pour y voir S. Àm-
broife qui le convertit l’an.384,& le baptifa l’an 387;
fut ordonne prêtre l’an 3 9 1 , 6c rendit des fervices
très-importans à l’Eglife par fà plume; Il mourût à
Hipponë dûrant le fiege de cetté ville par les Vandales
, le 28 Août 430, âgé de' 76 ans;
t Ôn trouvera le détail de fa vie épifcOpale 6c de fes '
écrits* dans la bibliothèque de M; Dupin * dans les
Tomé XIU
iYMkbïüm, 't6S3 , fe dans MoréK-, Lâ ïnàiieuf»
;e iiti'oii dès 'oeuvres dé ce ipere - eft telle qui â pâ'rïi \
Paris par les foins dés bénédictins de S. Maùr: ellééft
divifée en io vol. îà~fcrî. commè 'qûèlqücéâuifeS;
mais avec un nouvel arrangement * où une .nouvelle
économie dans 'chaque tOmé; Le I. & le IL furent
imprimés l’an 1679 >Ie ® parut en 1680 ; le IV. ëii
1681 ; lé V .en 16^3 ; le VI. & VIL eh ï6 8 f ; le VIII.
6c le IX. en 1688 ; & lé X. eh 1690 : ce dernier volume
contient les Ouvrages que S. Auguftin cônipofa
contre les Pélagiens. Son livre de la cité de Dieu, eft
celui qu’on eftime le plus;
Mais l’approbation que lés conciles & lès papes
ont donné à S. Auguftin fur fa do&rine, a fait le plus
grand bien à fa gloire. Peut-être que fans cela les Mo-
liniftes du dernier fiecle auroient mis à néant fort autorité.
Aujourd’hui toute l’églife romaine eft dans rengagement
dé refpefter le fyftème de ce perè fur cë
point; cependant bien des gerts penfent que fa doctrine
, & celle de Janfénius évêque d’Ypres, font une
feule & même chofe; Ils ajoüteiit qiie le concile de
T rente en condamnant les idées de Calvin fur le franc-
arbitre , a néeeffairement condamné celles de S. jfjjjf
guftiii ; car il n’y a point de calviniftes, eontinue-r-on*
qui aient nie le concours de b volonté humaine * 6c
b liberté de notre ame, dans le fens que S. Au«niftin
a donné ailx mors de concours 6t dé liberté. Il n’y a point
de calviniftes qui ne reeonnoiflent le franc-arbitre *
& fori ufage dans b converfioii, en prénant Cé mot
félon les idées dé l’évêquë d’Hippone. Ceux que lé
concile deTrenté a condamnés, ne rejettent le franc-
arbitre qu’en tant qu’il fignifie b liberté d’indifférence;
les Thomiftes le rejettent aulfi, & ne biffent pas
de pafler pour très-catholiqües. Eh lin mot, là pré-
détermination phyfique des thomiftes, la néeêffité de
S._Augüftiii, celle des janféniftes, celle de Calvin *
fohtaiifondla même chofe; néanmoins les Thomiftes
renoncent les Janféniftes, & le s uns & les autres prétendent
qu’on les' calomnie, quand on les accufe d’en-
feignêr la db&rine de Calvin.
Les Arminiens n’ayant pas lés mêmes ménàgemens
à garder , ont abandonné faint Auguftin à leurs adverfaires
, èn le reconnoiffant pour un auffi grand pré-
def inàienr que Calvin lui-même ; & bièn des gens
croient qiie les Jéfuitës en auroient faiti.autant, s’ils
avoient ofé condamner un dôReut de l’Églife, qiiê
les papes 6c les conciles ont tarit approuve;.
Un favant critique françois loué principalement
faint Auguftin d’avoir reconnu fon irifuffifànce pouf
interpréter l ’Ecriture; C ë pere de l’Eglife d’occident
a très-bien remarqué, dit M. Simon, les qualités né-
eeflaires pour cetté befogrie ; 6c comme.il étoit mo-
defte, il a avoué ingénuement que là plupart de ces
qualités lui mariquoient * 6c qiie même l’entfeprifë
de répondre aux Manichéens étoit àu-deflùs de fes
forcés. Auffi n’eft-il pas ordinairement heureux dans
fes'allégories , ni dàris lè fens littéral de PEcritürè. Il
convient encore.lui-même s’être extrêmement prefle
dans l’explication de la Genèfe * & de lui avoir d’ôii-
né le fens allégorique quand il ne trpuvôit pas d’abord
le fens littéral. Quand donc l’Eglife nous àfliire
que ceux qui ont enfeigné b Théologie , prit pris cë
pere de l’Eglife d’Occident pour leiir‘guide ; ces paroles
du bréviaire romain ne lignifient pas que les
opinions de L’évéqiie d’Hippone foieiit toujours des
articles de fo i, 6c qu’il faille abandonner lés autres
peres lorfqû’ils hé s’accordent pas avec lui;
Le plus fâcheux eft qiie les Scholaftiquës aient emprunte
de faint Auguftin b morâlë Sc la manière dé
la traiter; Car èn établiflànt des principes, il a étalé
plus d’art quë dé favoir 6c de juftéffe. Emporté par
la.chaleiir dé là difputé , il paffe Ofdinairemehtd’urié
extrémité à l’autre; Quand il fait b giierre aux Ariens *
ôri ie éroiroit fabellieh : s’àgît-il dé réfuter lès Sabelr