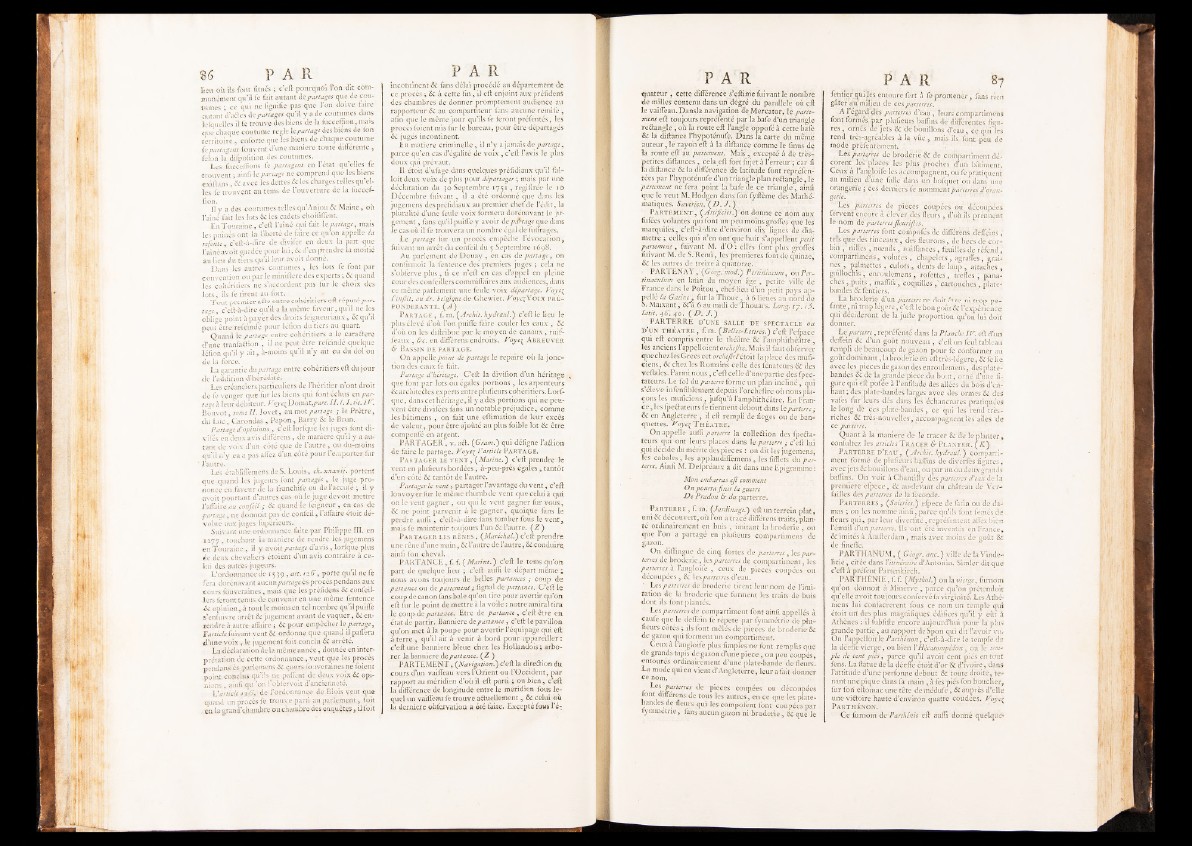
U P A R
lieu où ils font fitué's ; c ’eft pourquoi l'on dit côtn-
inunément qu’il le fait autant de partages que de cousîmes
; ce qui ne fignifie pas que l’on doive faire
•autant d’a&es de partages qu’il y a de coutumes dans
le (quelles il fe trouve des biens de la fucceflion, »
que chaque coutume réglé le partage des biens de fon
territoire., enforte que les biens de chaque coutume
ie partagent fouvent d’une maniéré toute differente ,
félon la difpofition des coutumes.
Les fuccellions fe partagent en l’état qu’elles fe
trouvent ; ainfi le partage ne comprend que les biens
exiftans 6c avec les dettes 6c les charges tellesqu’el-
les fe trouvent au tems de l’ouverture de la fuccef-
fion.
Il y a des coutumes telles qu’Anjou 6c Maine, où
l’aîné fait les lots 6c les cadets choififfent.
En Touraine, c’ eft l’aîné qui fait le partage, mais
les puînés ont la liberté de faire ce qu’on appelle La
refente, c’eft-à-dire de divifer en deux la part que
l’aîné avoit .gardée pour lui, 6c d’en prendre la moitié
au lieu du tiers qu’il leur avoit donné.
Dans les autres coutumes , les lots fe font par
convention ou par le miniftere des experts ; 6c quand
les cohéritiers ne. s’accordent pas fur le choix des
lots, ils le tirent au fort. ^ /
Tout premier a&e entre cohéritiers eft réputé par-
tage c’eft-à-dire qu’ il a la môme faveur, qu’il ne les
oblige point à payer des droits feigneuriaux, 6c qu’il
peut être refcindé pour léfion du tiers au quart.
Quand le partage entre cohéritiers a le cara&ere
d’une tranfaàion , il ne peut être refcindé quelque
léfion qu’il y ait, à-moins qu’il n’y ait eu du dol ou
de la force» ,
La garantie du partage entre coheritiers eft du jour
de l’addition d’hérédité. , . .
Les créanciers particuliers de l’héritier n’ont droit
de-fe venger que fur les biens qui font échus en partage
à leur débiteur. Foye{Domzt,part. II. L. I . tu. 1F
Bouvot, tome IL Jovet, -au mot partage ; le Prêtre,
du Luc-, Carondas jg Papon, Barry 6c le Brun.
Partage d'opinions^ c’eft lorfque les juges font di-
vifés en deux avis différens, de maniéré qu’il y a autant
de voix d’un côté que de l’autre , ou du-moins
qu’il n’y en a pas affez d’un côté pour l’emporter fur
l ’autre» . . .,
Les établiffemens de S. Louis, ch. xxx-oij. portent
que quand les jugeurs font partagés , le juge prononce
en faveur de la franchife ou de l’acculé ; il y
•avoit pourtant d’autres cas ou le juge devoit mettre
l ’affaire au confeil ; 6c quand le feigneur , en cas de
partage, ne donnoit pas de confeil, l’affaire étoit dévolue
aux juges fupérieurs»
Suivant une ordonnance faite par Philippe III. en
.1x77 , touchant la maniere.de rendre les jugemens
en Touraine, il y avoit partage d’avis§ lorfque plus
de deux chevaliers étoient d’un avis contraire à celui
des autres jugeurs.
L’ordonnance de 15 39 , art. izG , porte qu’il ne fe
fera dorénavant zwcwnpartage ès procèspendans aux
-cours fouveraines, mais que les prelidens 6c confeil-
lers feront tenus de convenir en une même fentence
ot)inion,â tout le moins en tel nombre qu’il puiffe
s’enfuivre arrêt & jugement avant de vaquer, 6c entendre
à* autre affaire ; 6c pour empêcher le partage,
Varticle fuivant veut 6c ordonne que quand il paffera
d ’une voix ,< le jugement foit conclu & arrêté.
La déclaration de la même année, donnée en interprétation
de cette ordonnance, veut que les procès
pendans! ès parlemens & çours fouveraines ne foient
point conclus qu’ils ne paffcnt de deux voix 6c opinions
ainfi qu ’on l’obfervoit d’ancienneté.^
U article ,12<&,' de l’ordonnance de Blois veut que
quand un procès fe trouve parti au parlement , loit
en la grand’çhambre ou chambre des enquêtes, iifoit
P A R
incohtinent 6c fans délai procédé au département dè
ce procès ; 6c à cette fin, il eft enjoint aux préfidenè
des chambres de donner promptement audience au
rapporteur 6c au compartiteur fins aucune remife ,
afin que le même jour qu’ils fe feront préfentés, les
procès foient mis fur le bureau, pour être départagés 6c jugés incontinent.
En matière criminelle, il n’y a jamais de partage,
parce qu’en cas d’égalité de v o ix , c’eft l’avis le plus
doux qui prévaut.
Il étoit d’ufage dans quelques préfidiaux qu’il fal-
loit deux voix de plus pour départager ; mais par unè
déclaration du 30 Septembre 1751 , regiftrée le iô
Décembre fuivant, il a été ordonné que dans les
jugemens des préfidiaux au premier chef de l’édit, la
pluralité d’une feule voix formera dorénavant le jugement
, fans qu’il puiffe y avoir de potage que dans
le cas où il fe trouvera un nombre égal de fuffrages.
Le partage fur un procès empêche l’évocation >
fuivant un arrêt du confeil du 5 Septembre 1698.'
Au parlement de Douay , en cas de partage, Oh
confirmoit la fentence des premiers juges ; cela ne
s’obferve plus, fi ce n’eft en cas d’appel en pleine
cour des confeillers commiffaires aux audiences, dans
ce même parlement une feule voix départage. Voyeç
l'injlit. au dr. belgique de Ghewiet. F oyeçVoix prépondérante.
{A )
Pa rtage , f. m. ( Archit. hydraul.') c’eft le lieu le
plus élevé d’où l’on puiffe faire couler les eaux , 6c
d’où on les diftribue par le moyen dé canaux, ruifi-
fieaux , &c. en différens endroits. Voye^ A breuver
& Bassin de partage.
On appelle point de partage le repaire où la jonction
des eaux fe fait.
Partage d'héritage. C’ eft la divifion d’un héritage ,
que font par lots ou égales portions , les arpenteurs
&: architeftes experts entre plufieurs cohéritiers. Lorfque
, dans cet Héritage, il y a des portions qui ne peuvent
être divifées fans un notable préjudice, comme
les bâtimens , on fait une eftimation de leur excès
de valeur, pour être ajouté au plus foible lot 6c être
compenfé en argent.
PARTAGER, v. aft. (Gtam.') qui délîgne l’adion
de faire le partage. Foye{ l'article Par tag e .
Partager le vent , (Marine. ) c’eft prendre le
vent en plufieurs bordées, à-peu-près égales, tantôt
d’un côté & tantôt de l’autre.
Partager le vent » partager l’avantage du vent, c’eft
louvoyer fur le même rhumbde vent que celui à qui
on le veut gagner , ou qui le veut gagner fur vous, 6c ne point parvenir à le gagner, quoique fans le
perdre aulîi, c’eft-à-dire fans tomber fous le vent ,
mais fe maintenir toujours l’un 6c l’autre. ( Z )
Partager les rênes , {Maréchal.') c’eft prendre
une rêne d’une main, 6c l’autre de l’autre, 6c conduira
ainfi fon cheval.
PARTANCE, fi f. ( Marine. ) c’ eft le tems qu’oii
part de quelque lieu ; c’eft aufli le départ meme ;
nous avons toujours de belles partantes ; coup de
partance ou de partement ; fignal de partance. C ’eft le
coup de canon fans baie qu’on tire pour avertir qu’on
eft fur le point de mettre à la voile : notre amiral tira
le coup de partance. Etre de partance , c’eft être eh
état de partir. Bannière de partance , c’ eft le pavillon
qu’on met à la poupe pour avertir l’équipage qui eft
à terre , qu’il ait à venir à bord pour appareiller :
c’eft une bannière bleue chez les Hollandois ; arborer
la bannière de partance. (Z )
PARTEMENT, {Navigation.) c’eft la dire&ion du
cours d’un vaiffeau vers l’Orient ou l’Occident, par
rapport au méridien d’où il eft parti ; ou bien, c’eft
la différence de longitude entre le méridien fous lequel
un vaiffeau fe trouve actuellement, 6c celui où
la derniere obfervatiou a été faite. Excepté fous l’é-
P A R
Cfiiateur , cette différence s’eftimc fuivant le nombre
île milles contenu dans un degré du parallèle où eft
le vaiffeau. Dansla navigation de Mercator, le parlement
eft toujours représenté par la bafe d’un triangle
reCtangle , où la route eft l’anglé 'ôppôfé à Cette baie
6c la diftànce l’hÿpoténufç. Dans la carte du mên\e
auteur, le rayon eft à la diftancé comme le finus çlq
la route eft au partement. Mais, excepté à de très-
petites diftances , cela eft fort fujet à l’erreur'; bar fi
la diftancé 6c la différence de latitude font repréfen-
tées par l’hypoténufe d’un triangle plan reCtangle ,.14'
partement ne fera point la bâfe de ce triangle,. ainfi
que le veut M. Hodgen dans fon fyftème des Mathématiques.
Savèrien. {D .
Partement , {Artificier.y on donne ce Aôin aux
fiifees volantes qui font un1 peu moins groffes qué fés
marquifes, c’eft-à-dire d’environ dix lignés de diâ-
metre ; celles qui n’en ont que huit Rappellent petit
partement, fuivant M. d’O i elles font plus groffeS
fuivant M. de S. Remi, les premières font de quinze,:
6c les autres de treize à quatorze.'
■ PARTENAY ,- {Géog. tttod:) Pcriittiactirri, ou Per-
ïinaculum en latin du moyen âgé ', petite ville dé
France dans le Poitou , chef-lieu d’un petit pays ap-
pellé la Gatine . fur la T libiie, à 6 lieues au nord de
S. Maixant, & a 6 au midi deThouars. Long. r j . ÏS.
lotit, jfà.'ifàï { -D. J. )
PARTERRE d’une salle de spectacle ou
D un THEATRE , f. m. {Belles-Lettrés.) c’eft l’efpace
qui eft compris entre le théâtre & l’amphithéâtre,
les anciens l’appelloientorcheflre. Mais il faut obferver
que chez les Grecs cet. orchefiri étoit biplace des mufi-
ciens, 6c chez les Romains celle dès fénateurs & des
veftales. Parmi nous, c’eft celle d’une partie des fpec-
tateurs. Le fol du parterre forme un plan incliné, qui
s’élève infenfiblement depuis l’orcheftre où nous plaçons
les muficiens , jufqu’à l’amphithéâtre. En France
, les lperiateurs fe tiennent debout dans le parterre;
6c en Angleterre , il eft rempli de fieges ou de banquettes.
Voye^ T héâtre. ;
On appelle aufli parterre la colleftion des fpeûa-
teurs qui ont leurs places dans le parterre ; c’eft lui
tjui décide du mérite des pièces : on dit les jugemens,
les cabales, les applaudiffemens , les fifflets du parterre.
Ainfi M. Defpreaux a dit dans une Epigramme ;
Mon embarras efi comment
On pourra finir la guerre
De Pradon & du parterre.
Parterre , f. m. {Jardinage.) eft un terrein plat,
uni 6c découvert, où l’on a tracé différens traits, planté
ordinairement en buis , imitant la broderie ,-.oü
que l’on a partage en plufieurs compartimens de
gazon.
On diftingue de cinq fortes de parterres, les par-
terres de broderie, les parterres de compartiment, les
parterres fi. l’angloife , ceux de pièces coupées ou
decoupees ,6 c les parterres d’eau.
Les parterres de broderie tirent leur nom de l’imitation
de la broderie que forment les traits de buis
dont ils font plantés.
Les parterres de compartiment font ainfi appellés à
caufe que le deffein fe répété par fymmétrie de plufieurs
côtes ; ils font mêlés de pièces de broderie 6c
de gazon qui forment un compartiment.
Ceux à l’angloife plus fimples ne font remplis que
de grands tapis de gazon d’une pie ce, ou peu coupés,
entoures ordinairement d’une plate-bande de fleurs*
La mode qui en vient d’Angleterre , leur a fait donner
çenom.
c ^ \ .P firterns de pièces coupées ou découpées
lont différens de tous les autres, en ce que les plate*
bandes cle fleurs qui les compofent font coupées par
lymmetne, fans aucun gazon ni broderie, 6c que le
P A R 87
fentier qui)es entoure fert à fe promener, fans rien
gâter aifmilieu de ces parterres.
Parterres d’eau, leurs Compartimens
font fôrinésfpar plufieqrs hâffins de' différentes figures
, orneS aé jets 6c dé bouillons d’eau, cé qui les
rend tres-^greables à la vue., mais ils! font peu de
mode prefentèment.
Les de brofférie 6c de compartiment dc-
C05ent l'fs placés les plîisL proches d’un bâtiment.
Ceux à l’angloife les accompagnent, ou fe pratiquent
au milieu’ d’une falle dans un bofquet pu dans une
orangerie ; 'ces! derniers fe nomment parterres d'or an*
B g H
.Les parterres de pieçés 'Coupées ou découpées
fervènf encore à elever| des fleiirs , d’où ils prennent
lè nom àç parterres fieùrïfiei.
Les parterres font compofés de différens defleîns,
tels qiie dès rinceaux, des fleurons , de beCs de cor-
bin , hilles , noeuds , haiffances , feuilles de réfend,
compartiméns, volutes , chapelets , àgraffes, graines
, palniéttes , culots, dents de loup , attaches ,
guillochis, énroulemens, rofettes, trèfles, pana-
ches , puits , maflifs , coquilles ,vcartouches,, plate-
bandes & féntiérs.
La broderie d’un parterre ne doit être ni trop pé-
fante, ni trop légère , c’eft le bon goût 6c l’expérience
qui décideront de la jufte proportion qii’011 lui doit
donner.
Le parterre, repréfenté dans la Planche IF. éft d’uil
deffein1 6c d’un goût nouveau , c’eft un feul tableau
rempli dé beaucoup de gazon pour fe conformer au
goût dominant, la broderie êii efttrès-légere, & fe lie
avec les pièces de gazon des enroulemeiis, des plate-
bandes 6c de la grande piece du bout,' orné d’une figure
qui eft pofee à l’enfilade des allées du bois d’en-
haut ; des plate-bandes larges avec des Ormes 6c des
vafes fur leurs dés dans les échancrures pratiquées
le long dxé ‘Ces plàté-bandes., ce qui les rend très-
riches 6c très-nouvelles, accompagnent lès aîles de
ce parterre. '
Quant à la maniéré de le tracer & dé le planter,
confiiltez les articles T racer & Planter. {K).
Parterre d’eau , ( Archit. hydraul. ) compartiment‘
formé de plufieitrS baffms de diverfes figures
avec jets 6c bouillons d’eau, ou par un oïl deux grands
badins. On voit à Chantilly des parterres d'eau de la
première efpèce, 6c aii-dévant du château de Ver-
failles des parterres de la féconde.
Parterres , (Soieries.) efpece de fat in OU de damas
; on les nomme ainfi, parce qu’ils font femes de |
fleurs q ui, par leur diverfitc, repréfentent affez bien
l’émail d’un parterre. liro n t été inventés èn France,
6c imités à Amfterdam, mais avec moins de goût 6c
de finefle.
PARTHANUM, f Géogr, anc. ) ville de la Vinde-
licie, citée dans l’itinéraire d’Antonin. Simler dit que
c’eft à préfent Partenkirch.
PARTHÉNIE, 1. f. {Mythol.) ou la vierge, furnorri
qu’on donnoit à Minerve , parce qu’on prétendoit
qu’elle avoit toujours confervé fa virginité. Les Athéj
niens lui Confacrerent fous ce nom un temple qui
étoit tilt des plus magnifiques édifices qu’il y eût à
Athènes : il fubfifte encore aujourd’hui pour la plus
grande partie, au rapport deSpon qui dit l’avoir vu*
On l’appclloit le Parthènon, c’eft-à-dire le temple dsr
la deeffe vierge, ou M\e\\V Hécatompédôn , où le wn*
pie de cent piés, parce qu’il avoit cent piés en tout
fens. La ftatue de la déefîe étoit d’or 6c d’ivoire, dans
l’attitude d’une perfonne debout 6c toute droite, tenant
une pique dans fâ main , à fes pies fon bouclier,
fur fori eftomac une tête de médufe, & auprès d’ellé
une viftoire haute d’environ quatre coudées. Foye%
Parthènon.
Ce furnôm de Parthénk eft aufli donné quelque*