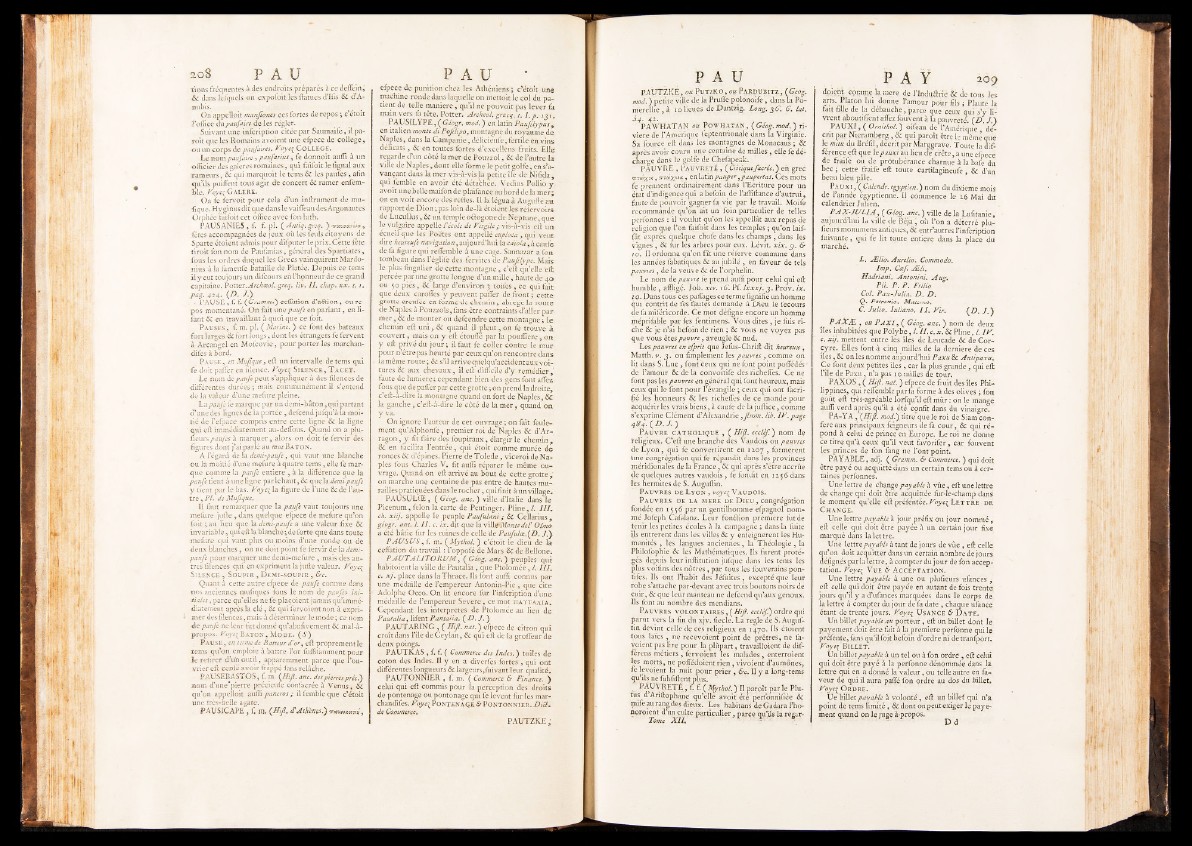
rions frequentes à des endroits préparés à ce deffeinI
&c dans lelqueis on expofoit les ftatues d’Ifis & d’A-
-nubis. - ,
On appelloit manfiones ces fortes de repos ; c’étoit
l’office dupaufaire de les régler.
Suivant une infeription citée par Saumaife, il paroît
que les Romains avoient une efpece de college ,
ou un corps de p'aufaires. F?yeç C o llege.
Le nom paufaire, paufarius, fe donnoit auffi à un
officier des galeres-romaines, qui faifoit le lignai aux
"rameurs, & qui marquoit le teins & les paufes, afin
qu’ils puiffent tous agir de concert & ramer enfem-
ble. Voyei GALERE.
On fe fervoit pour cela d’un infiniment de mu-
fique. Hyginus dit que dans le vaiffeau des Argonautes
Orphée faifoit cet office -avec fon luth.
PAUSANIES, f. f. pl. ( Antiq. greq. )*r*v<r*VU ,
fêtes accompagnées de jeux oîi les feuls citoyens de
Sparte étoient admis pour difputer le prix. Cette fête
tiroit fon nom de Paufanias, général des Spartiates,
fous les ordres duquel les Grecs vainquirent Mardo-
nius à la faineufe bataille de Platée. Depuis ce tems
il y eut toujours un difcours eh l’hçnneur de ce grand
capitaine. Potter.Archoeol. greq. liv. II. chap.xx. t. /.
J>“g-4ï 4- (P - J ) ;■ ;
. PAUSE, f. f. ( Gramm.) çeffation d’aftion, ou repos
momentané. On fait une paufe en parlant, en li-
lant & en travaillant à quoi que ce foit.
Pauses , f. m. pl. ( Marine. ) ce font des bateaux
fort larges & fort longs, dont les étrangers fe fervent
à Arcangel en Mofcovie, pour porter les marchan-
•difes à bord.
Pause , en Muftque, eft un intervalle de tems qui
fe doit paffer en iilence. Foyei Silence , T a c e t .
Le nom de paufe peut s’appliquer à des filences de
différentes durées ; mais communément il s’entend
de la valeur d’une mefure pleine.
La paufe fe marque par un demi-bâton, qui partant
d’ une des lignes de la portée , defeend jufqu’à la moitié
de l'efpace compris entre cette ligne & la ligne
’ qui eft immédiatement au-deffous. Quand on a plu-
lieurs paufes à marquer, alors on doit fe fervir des
figures dont j’ ai parlé au mot Bâ to n .
A l’égard de la demi-paufe, qui vaut une blanche
ou la moitié d’une mefure à quatre tems, elle fe marque
comme la paufe entière , à la différence que la
paufe tient à une ligne par lehaut, & que la demi-paufe
y tient par le bas. Foye^ la figure de Tune & d e l’autre
, PL. de Muftque.
Il faut remarquer que la paufe vaut toujours une
mefure jufte , dans quelque efpece de mefure qu’on
foit ; au lieu que la demi-paufe a une valeur fixe &
invariable, qui eft la blanche ; de forte que dans toute
mefure qui vaut plus ou moins d’une ronde ou de
deux blanches, on ne doit point fe fervir de la demi-
paufe pour marquer une demi-mefure , mais des autres
filences qui en expriment la jufte valeur. Foyer
Silence , Soupir , D emi-soupir , &c.
Quant à cette autre efpece de paufe connue dans
nos anciennes mufiques fous le nom de paufes initiales
, parce qu’elles ne fe plaçoient jamais qu’immé-
diatement après la clé, &. qui fervoient non à exprimer
des filences, mais à déterminer le mode; ce nom
de paufe ne leur fut donné qu’abufivement & mal-à-
propos. Foye{BATON, MODE. (.S)
Pau se , en terme de Batteur d'or, eft proprement le
tems qu’on emploie à battre l’or fuffilàmment pour
le retirer d’uh outil, apparemment parce que l’ouvrier
eft cenfé avoir frappé fans relâche.
PAUSEBASTOS, f. m. (Hift. ane. des pierrespréc.')
nom d’une’pierre précieufe confacrée à Venus, &
qu’on appelloit auffi paneros ; il femble que c’étoit
une très-belle agate.
PAUSICAPE, f. m. (Hift, d'Athènes.) mmmrn,
efpece de punition chez les Athéniens ; c’étoit unè
machine ronde dans laquelle on mettoit le col du patient
de telle maniéré, qu’il ne pouvoit pas lever fa
main vers fa tête. Potter. Archeol. grcecq. 1 .1. p. / * #,
PAUSILYPE, ( Géogr. mod. ) en latin Paujilypus ,
en italien monte di Poftlipo, montagne du royaume de
Naples, dans la Campanie, délicieufe, fertile en vins
délicats , & en toutes fortes d’excellens fruits. Elle
regarde d’un côté la mer de Pouzzol, & de l’autre la
ville de Naples, dont elle forme le petit golfe, en s’avançant
dans la mer vis-à-vis la petite île de Nifida,
qui femble en avoir été détachée. Vedius Pollio y
avoit une belle maifon de plaifance au bord de la mer;
on en voit encore des reftes. Il la légua à Augufté au
rapport de Dion ; pas loin de-là étoient les rélèrvoirs
de Lucullus, & un temple oftogone de Neptune,que
le vulgaire appelle l'école de Firgile; vis-à-vis eft un
écueil que les Poètes ont appellé euploca | qui veut
dire heureufe navigation, aujourd’hui la caiola^k caufe
de fa figure qui reffemble à une cage. Sannazar a fon
tombeau dans l’églife des fervites de Pauftlype. Mais
. le plus fingulier de cette montagne, c’eft qu’elle 'eft:
percée par une grotte longue d’un mille, haute de 40
ou 50 piés, & large d’environ 3 toifes , ce qui fait
que deux caroffes y peuvent paffer de front ; cette
grotte creufée en forme de chemin, abrégé la route
de Naples àPouzzols,fans être contraints d’aller par
mer, & de monter ou defeendre cette montagne ; le
chemin eft uni, & quand il pleut, on fe trouve à
couvert, mais on y eft étouffe par la pouffiere, on
y eft privé du jour ; il faut fe coller contre le mur
pour n’être pas heurté par ceux qu’on rencontre dans
la même route; & s’il arrive quelqu’accident aux voitures
& aux chevaux, il eft difficile d’y remédier,
faute de lumière; cependant bien des gens font affez.
fous que de paffer par cette grotte ; on prend la droite,
c’eft-a-dire la montagne quand on fort de Naples, &
la gauche , c’eft-à-dire le côté de la mer, quand on
y va.
On ignore l’auteur de cet ouvrage ; on fait feulement
qu’Alphonfe, premier roi de Naples & d’A r-
ragon, y fit faire des foupiraux, élargir le chemin ,
& en facilita l’entrée, qui étoit comme murée de
ronces & d’épines. Pierre de Tolede, viceroi de Naples
fous Charles V. fit auffi réparer le même ouvrage.
Quand on eft arrivé au bout de cette grotte ,
on marche une centaine de pas entre de hautes murailles
pratiquées dans le rocher, qui finit à un village.
PAUSULCE , ( Géog. anc. ) ville d’Italie dans le
Picenum, félon la carte de Peutinger. Pline, /. I I I .
ch. xiij. appelle le peuple Paufulani ; & Cellarius ,
géogr. ont. I. 11. c. ix. dit que la vill&Monte deÜ Olmo
a été bâtie fur les ruines de celle de Paufuloe.fD. J.\
P A U SU S , f. m. ( Mythol. ) c’étoit le dieu de la
çeffation du travail : l’oppofé de Mars & de Bellonei
P AU TA L ITO RUM , (Géog. anc. ) peuples qui
habitoient la ville de Pautalia, que Ptolomée, /. III.
c. x j. place dans la Thrace. Ils font auffi connus par
une médaille de l’empereur Antonin-Pie , que cite
Adolphe Occo. On lit encore fur l’infeription d’une
médaille de l’empereur Severe, ce mot ü at ta a ia .
Cependant les interprètes de Ptolomée au lieu de
Pautalia, lifent Pantalia. (D . J. )
PAUTARING , ( Hift. nat. ) efpece de citron qui
croît dans l’île de Ceylan, & qui eft de la groffeur de
deux poings.
PAUTKAS , f. f. ( Commerce des Indes. ) toiles de
coton des Indes. Il y en a diverfes fortes , qui ont
différentes longueurs & largeurs,fuivant leur qualité.
PAUTONNIER , f. m. ( Commerce & Finance. )
celui qui eft commis pour la perception des droits
de pontenage ou pontonage qui fe lèvent fur les mar-
chandifes. Foye{ PONTENAQE & PONTONNIER. Diclu
de Commerce.
PAUTZK.E
P A Ü T Z K E , ou P u t z k o , ou P a r d u b i t z , (Geog,
niod. ) petite ville de la Prufle polonoife , clans la Pô-
merellie , à 10 Üçuqs d'e Dantzig. Long. 3 G. €. lat.
£4. 42.
PAWHATAN ou PoyHATAN, (Géog. mod’. ) rivière
de l’Amérique l'eptentrionale dans la Virginie.
Sa fpurce eft dans les montagnes de Monacaus ; &
après avoir couru une centaine de milles, elle fe décharge
dans le golfe de Chefapeak;
PAUVRE , PAUyRETÉ , (Critiquefacrée.') en grec
, mùùyjiia., en latin pauper ypaupertas. Ces mots
fç prennent ordinairement dans l’Ecriture pour un
état d’indigence qui a befoin de l’affiftance d’autrui,
faute de pouvoir gagner fa vie par le travail; Moïfe
recommande qu’on ait un foin particulier de telles
perfonnes : il voulut qu’on les appellât aux repas de
religion que l’on faifoit dans les temples ; qu’on laif-
fât exprès quelque chofe dans les champs , dans les
vignes', & fiir les arbres pour eux. Lévit. xix. g . &
/o. Il ordonna qu’on fît Une réferve commune dans
les années- fabatiques & au jubilé , en faveur de tels
pauvres, de la veuve &. de l’orphelin.
Le nom de pauvre fe prend auffi pour celui qui eft
humble, affligé. Job. xiv. iC. Pf. Ixxxj. 3 . Prov. ix.
z 0. Dans tous ces paffages ce terme fignifie un homme
qui contrit de fes fautes demande à Dieu le fecours
de familéricorde. Ce mot défigne encore un homme
méprifable par fes fentimens. Vous dites, je fuis riche
& je n’ai befoin de rien ; & vous ne voyez pas
que vous ëtQS pauvre, aveugle & nud.
Les pauvres en efprit que Jefus-Chrift dit heureux,
Matth. v. 3 . ou fimplement les pauvres, comme on
lit dans S. Luc , font ceux qui ne font point poffédés '
de l’amour &ç de la convoitife dés richeffes. Ce ne
font pas les pauvres en général qui font heureux, mais
ceux qui le font pour l’évangile ; ceux qui ont facri-
fié les honneurs & les richeffes de ce monde pour
acquérir les vrais biens, à caufe de la juftice, comme
s’exprime Clément d’Alexandrie yftrom. lib. IF . page
484. (D .J > ) .
Pauvre ca thol iqu e , ( Hift. eccléf. ) nom de
Religieux. Ç ’eft une branche des Vaudois ou pauvres
de L y o n , qui fe convertirent en 1207 , formèrent
line congrégation qui fe répandit dans les provinces
méridionales de la France, & qui après s’être accrue
de quelques autres vaudois, fe fondit en 1256 dans
les nermites de S. Auguftin.
Pauvres de L yon , voye^ V audois.
Pauvres de la mere de D ieu , congrégation
fondée en 1556 par un gentilhomme efpagnol nommé
Jofeph Cafalanz. Leur fonftion première fut de
tenir les petites écoles à la campagne ; dans la fuite
ils entrèrent dans les villes & y enleignerent les Humanités
, les langues anciennes, la Théologie, la
Philofophie & les Mathématiques. Ils furent protégés
depuis leur inftitution jufque dans les tems les
jïlus voilins des nôtres, par tous les fouverains pontifes.
Ils ont l’habit des Jéfuites, excepté que leur
robe s’attache par-devant avec trois boutons noirs de
cuir, & que leur manteau ne defeend qu’aux genoux.
Ils font au nombre des mendians.
Pauvres vo lo n t air e s , (Hift. eccléf.) ordre qui
parut vers la fin dii xjv. fiecle. La réglé de S. Auguftin
devint celle de ces religieux en 1470. Ils étoient
tous laïcs , ne recevoient point de prêtres, ne fa-
voient pas lire pour la plupart, travailloient de dif-
ferens métiers , feryoient les malades, enterroient
k s morts, ne poffédoientrien, vivoient d’aumônes,
fe levoient la nuit pour prier , &c. Il y a long-tems
qu’ils ne fubfiftertt plus.
I PAUVRETÉ , ï f f. ( Mythol. ) Il paroît par le Plu-
tus d Ariftophane qu’elle avoit été perfonnifiée &
mife au rang des dieux. Les habitans deGadara l’ho-
noroient d’un culte particulier, parce qu’ils la regar-
Tome XII.
doieht cornue la mere de l’Induarié & ie tous les
arts. Platon lui donne l’amour pour fils ; Plaute la
fait fille de la débauche , parce que ceux qui s’y livrent
aboutiffent affez foiivent à fa pauvreté. (D . J \
PAU X I, ( Ornithoh ) oifèâu de l’Amérique , décrit
par Nieramberg, & qui paroît être le même que
le mitu du Bréfil, décrit par Marggrave. Toute la différence
eft que lepaiixi au lieu de crête, à une efpecé
de fraife ou de protubérance charnue à la bale du
bec ; cette fraife eft toute cartilagineufe, & d’un
beau bleu pâle.
Pau x i , (Calendr. égyptien.') nom du dixième mois
dé l’année égyptienne. Il commence le 26 Mai du
calendrier Julien.
PA X -JU L IA , ( Géog. anc. ) ville de la Lufitanie,
aujourd’hui la ville de Béja ' où l’on a déterré plu-
fieùrs monumens antiques, & entr’autres l’infcription
fuivapte, qui fe lit toute entière dans la place du
marché.
L. Ælio. Aurelio; Commodo'.
Imp . Ccef Æli.
Hadriani. Antonini. Aug.
Pii. P. P. Frilio
Col. P ax-Julia. D. D.
Q. Petronio. Materno.
C. Julio. Iuliano. I I . FÏr. (D . / . )
^ P AXJE , ou Pa x i , (, Géog. anc. ) nom de deux
îles inhabitées que P olyb e, /. II. c. x . & Pline, l. IF .
c. xij. mettent entre les îles de Leucade & de Cor-
cyre. Elles font à cinq milles de la derniere de ces
îles, & on les nomme aujourd’hui Paxu & Antipaxu.
Ce font deux petites îles , car la plus grande, qui eft
l’île de Paxu, n’a pas 10 milles de tour.
PAXOS , ( Hift. nat. ) efpece de fruit des îles Philippines,
qui refîemble parla forme à des olives ; fon
goût eft très-agréable lorfqu’il eft mur : on le mangé
auffi verd après qu’il a été confît dans du vinaigre.
PA-YA , (Hifl. mod.')ttitre que le roi de Siam con-,
fere aux principaux feigneurs de fà cour, & qui répond
à celui de prince en Europe. Le roi ne donne
ce titre qu’à ceux qu’il veut favorifer, car fouvent
les princes de fon fang ne l’ont point;
PAYABLE, adj. ( Gramm. & Commerce. ) qui doit
être paye ou acquitté dans un certain tems ou à certaines
perfonnes.
Une lettre de change payable à vu e, eft une lettre
de change qui doit être acquittée fur-le-champ dans
le moment qu’elle eft préfentée. Foye^ Le t tr e de
C hange.
Une lettre payabfe à jour préfix ou jour nommé ,
eft celle qui doit être payée à un certain jour fixe
marqué dans la lettre.
Unè lettre payable à tant de jours de vue , eft celle
qu’on doit acquitter dans un certain nombre de jours
défignés parla lettre, à compter du jour de fon acceptation.
Foyei V ue & A cc e p ta t io n .
Une lettre payable à une ou plufieurs ufances *
eft celle qui doit être payée en autant de fois trente
jours qu’il y a d’ufances marquées dans le corps de
la lettre à compter du jour de fa date , chaque ufancé
étant de trente jours. Foyt^ Usance & D a t e .
Un billet payable au portëur, eft un billet dont le
payement doit être fait à la premiere perfonne qui le
préfente, fans qu’il foit befoin d’ordre ni detranfpôrt.
Foye{ Bill et .
Un billet payable à. Un tel ou à foh ordre , eft celui
qui doit être payé à la perfonne dénommée dans la
lettre qui en à donné la valeur, pu jellè autre en faveur
de qui il aura paffé fon Qrdre au dos du billet.
Foye^ ORD RE;
Ue billet payable à yolonté', eft urt billef qui n’a
point de tems limité, & dont on peut exiger le paye-
nient quand on le juge à-propos;