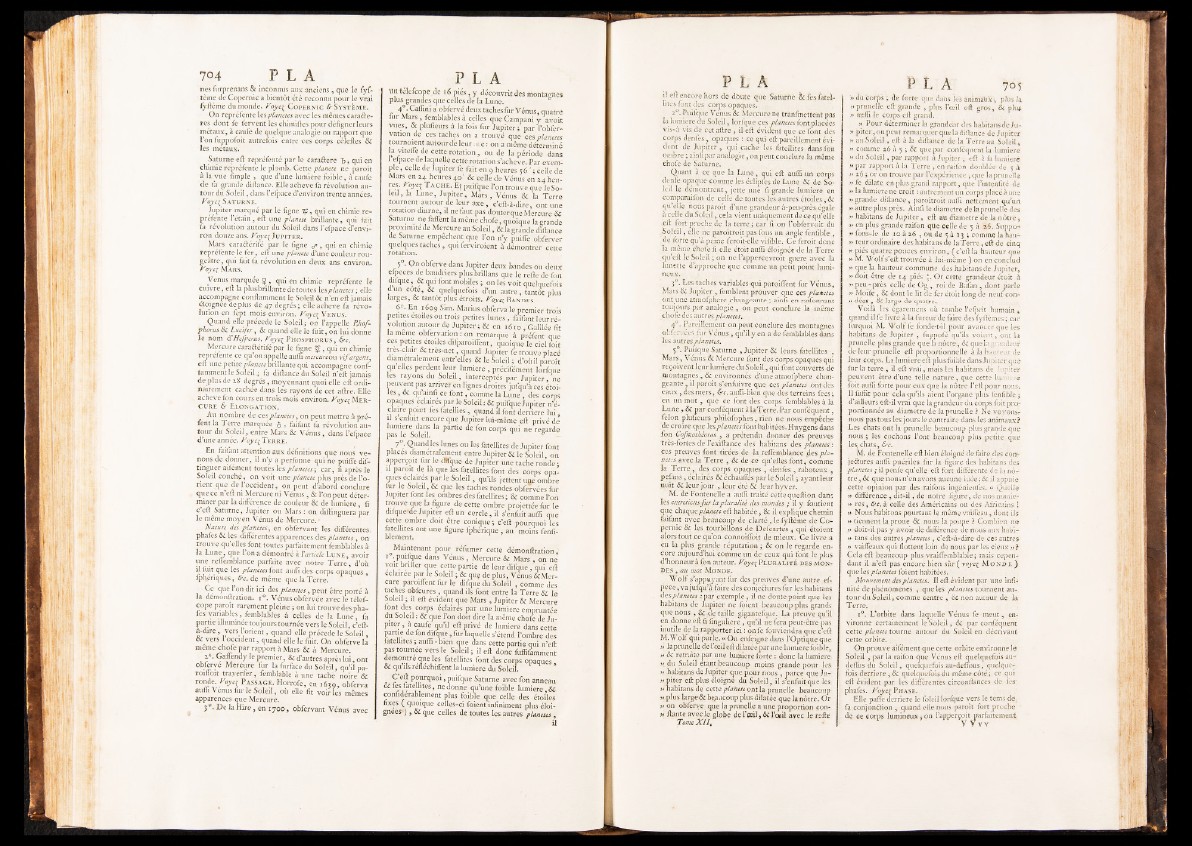
nés furprenans & -inconnus aux anciens; que le fyf-
tème de Copernic a bientôt été reconnu pour le vrai
fyftème du monde. Voye^ C o p e r n i c & S y s t è m e .
On repréfente 1 es-planues avec les mêmes caractères
dont lé fervent les chimiltes pour défigner leurs
métaux, à caufe de quelque analogie ou rapport que
l’on fuppofoit autrefois entre -ces corps céleftes &
les métaux.
Saturne eft repréfenté par le caraétere 1?, qui en
chimie repréfente le plomb. Cette planete ne paroit
à la vue fimple , que d’une lumière foible, à caufe
de fa grande diltance. Elle achevé fa révolution autour
du Soleil, dans l’efpace d’environ trente années.
Voyt^ S a t u r n e .
Jupiter marqué par le ligne % , qui en chimie reprefente
l’étain, eu: une -planete brillante, qui tait
l'a révolution autour du Soleil dans l’efpace d’environ
douze ans. Voye^ Ju p i t e r .
Mars caraCtérifé par le ligne <ƒ>, qui en chimie
reprefente le fer, elt une planete d’une couleur rougeâtre,
qui fait la révolution en deux ans environ.
yoye\ M a r s .
Venus marquée Ç , qui en chimie repréfente le
cuivre, elt la plus brillante de toutes les planètes ; elle
accompagne conftamment le Soleil & n’en elt jamais
éloignée de plus de 47 degrés ; elle achevé fa révolution
en fept mois environ. Voye^ V e n u s .
Quand elle précédé le Soleil; on l’appelle PJiof-
phorus 6c Lucifer, & quand elle le fuit, on lui donne
le nom d'Hefperus. Voye{ P h o s p h o r u S , & c.
Mercure caraCtérifé par le figne £ , qui en chimie
reprefente ce qu on appelle aulîi mercure ou v if argent,
elt une petite planete brillante qui accompagne conf-
tammentle Soleil 4 fa diltance du Soleil n’ elt jamais
de plus de 28 degrés , moyennant quoi elle elt ordinairement
cachee dans les rayons de cet altre. Elle
achevé fon cours en trois mois environ. Voye% M e r c
u r e & E l o n g a t i o n .
Au nombre de ces planètes, on peut mettre à pré-
fent la Terre marquée ô ? faifant fa révolution autour
du Soleil, entre Mars & Vénus, dans l’elpace
d’une année. Voye^ T e r r e .
En faifant attention aux définitions que nous venons
de donner, il n’y a perfonne qui ne puiffe distinguer
aifément toutes les planètes ; car, fi après le
Soleil couchp, on voit une planete plus près de l’orient
que de l’occident, on peut d’abord conclure
que ce n’ell ni Mercure ni Vénus , & l’on peut déterminer
par la différence de couleur & de lumière, fi
^ cll^Saturne, Jupiter ou Mars ■ on diltinguera par
le même moyen Vénus de Mercure. •
Nature des planètes, en obfervant les différentes. I
phafes 6c les différentes apparences des planètes, on
trouve qu elles font toutes parfaitement femblables à
la Lune, que l’on a démontré à l’article L u n e , avoir
une reffemblance parfaite avec notre Terre, d’oii
il fuit que les planètes font auffi des corps opaques ,
Sphériques, &c. de même que la Terre.
f ^ cIue l’01} dit ici des planètes, peut être porté â
la démonstration. i° . Vénus obfervée avec le télef-
cope paroît rarement pleine ; on lui trouve des phafes
variables ^femblables à celles de la Lune, fa
partie illuminée tou jours tournée vers le Soleil, c’elt-
à-dire, vers l’orient, quand elle précédé le S oleil,
& v e r s l’occident, quand elle le fuit. On obferve la
meme chofe par rapport à Mars 6c à Mercure.
-L*. Gaffendy le premier, & d’autres après lui, ont
obferve Mercure fur la furface du Soleil, qu’il pa-
roiffoit trayerfer, Semblable à une taché noire &
ronde. Voye^ P a s s a g e . Horrofe, en 1639, obferva
auffi Venus fur le S oleil, oii elle fit voir les mêmes
apparences que Mercure.
30. De la Hire, en 1700 , obfervant Vénus avec
un telefcope clé ï 6 pies, y découvrit des montagnes
plus grandes eue celles rie la Lune.
4°. Caflini a oblervé deux taches fur Venus, quatre
fur Mars , femblables à celles que Campani y avoir
vu£ ï j & plufieuys à la fois fur Jupiter ; par l’obfer*
vation de ces taches; on a trouvé que ces H H |
tournoient autour db leur utic : on a même déterminé
la yiteffe de cette rotation, ou de la période dans
1 eipace delaquelle cetterotations’acheve. Par exempte
, celle de Jupiter fe fait èn 9 heures 5 6 '; celle de
Mars en 24 heures 40' & celle de Vénus en i 4 heu-
res. Voyt{ T a c h e . Et puifque l’on trouve que lë$o-
letl, la Lune, Jupiter, Mars, Vénus & la Terre
.teurnentvautour de leur a x e , c’eft-à-dire, ont une
rotation diurne, il ne faut pas douterque Mercure &;
Saturne ne faffent la même chofe,. quoique la grande
proximité de Mercure au Soleil, & fa grande .diftancê
de Saturne empêchent que l’on n’y puiffe cibferver
quelques taches, qui ferviroient à démontrer cette
rotation.
5 * On obferve dans Jupiter deux bandes ou deux
elpeces de baudriers plusbrillans que le relie de fon
difque, & qui font mobiles; on les voit quelquefois
dun cote, & quelquefois d’un autre, tantôt plus
larges, & tantôt plus étroits. Bandes.
6°. En 1 609 Sim. Marius obferva le premier trois
petites qtoiles ou trois petites lunes , faifant leur révolution
autour de Jupiter ; & en 1610, Galilée fit
la même obfervation : on îemarquê à préfent que
ces petites étoiles dilparoiffent, quoique le ciel toit
très-clair & très-net, quand Jupiter le trouve placé
diamétralement entr’elles & le Soleil ; d’oilil paroît
qu elles perdent leur lumière , précifémenéterfque
les rayons du Soleil, interceptés par Jupiter ne
peuvent pas arrivefeh.lignës droites julqu’à l S étoi-
l e s ,& qu’ainfi ce fon t, çômme la L une, dès corps
opaques éclairés par le SoIeil:& puifque Jupiter n’é-
.claire point (es latellies, quand il font Jerriere lui',
il s enfuit encore que Jupiter lui-même eft privé de
lumière dans la partie de fon corps qui ni: regarde
pas le Soleil. , —
7 ° . Q u an t ité s lim e s o u le s fà te llite s d e J u p ite r fo n t
p la c e s d iam é t r a lem e n t en t r e J u p ite r & le S o le i l o n
. a p p e r ço it fu r l e düfque de J u p ite r u n e t a c h e r o n d e ';
1 P3™1? <!e Ià que les fàtellites font des corps opaques
éclairés par le Soleil, qu’ils jettent une ombre
fur le Soleil, 6e que les taches rondes obferyéesfuf
Jupiter font les isjôbfes des fàtellites ; Se comme I’oii
trouve que la figure de cette ombré proiettée fur lè
difqueüde Jupiter eft un cercle, il s'enfuit auffi' que '
cette ombre doit être conique ; c’eft pourquoi les
fàtellites ont une figure fpherique , au moins fenli-
blement.
Maintenant pour réfumer cette démonftrationI
1 . puifque dans Vénus , Mercure 6c Mars , on ne
voit briller que cette partie de leur difque, qui eft
éclairée par le Soleil ; & que de plus, Vénus & Mercure
p a r o i fie n t fur le difque du Soleil , comme des
taches cïbfcures , quand ils font entre la Terre 6c le
Soleil ; il eft évident que Mars , Jupiter & Mercure
font des corps éclairés par une lumière empruntée
du Soleil : & que l’on doit dire la même chofe de Jupiter
, à caufe qu’il eft privé de lumière dans cette
partie de fon difque, fur laquelle s’étend l’ombre des
fàtellites ; auffi - bien que dans cette partie qui n’eft
pas tournée vers le Soleil; il eft donc fuffiômment
démontré que les fàtellites font des corps opaques
& qu’ils refléchiffent la lumière du Soleil. j
o H P°?rclU01 > Pmfque Saturne avec fon anneau
lZ les latellites, ne donne qu’une foible lumière 6c
eonfiderablement plus foible que. celle des étoiles
fixes ( quoique celles-ci foient infiniment plus éloignées*)
, 6c que celles de toutes les autres planètes ,il
il eft encore hors de dôute qïie Saturne & fes fatel-
Iites font des corps opaqueSv- _a:
x°’ P>-dfque Vénus 6c Mercure ne trahfmettent pas
la lumière du Soleil, lorfque, ces planètes font placées
vis-à vis de cet aftre , il eft évident que ce font des
corps denfes, opaques : ce qui eft pareillement évident
de Jupiter , qui cache les fàtellites dans fon
ombre ; ainfipar analogie, on peut conclure la même
chofe de Saturne.
Quant à ce que la Luné , qui eft auffi un corps
denfe opaque comme les éclipies de Lune & de Soleil
le démontrent, jette une fi grande litmiere en
comparaifon de celle de toutes les autres étoiles, &
qu’elle nous paroît d’une grandeur à-peu-près égale
à celle du Soleil, cela vient uniquement de ce qu’elle
.eft fort proche, de la terre ; car fi on l’obfervoit du
Soleil, e lle n e paroîtroit pas fous un angle fenfible ,
de forte qu’à peine feroit-elle vifible. Ce feroit donc
la même choie fi elle étoit auffi éloignée de la Terre
qu’eft le Soleil ; on ne l’appercevroit guere avec la
lunette d’approche que comme un petit point lumL
neuxv:
! 30. Les taches variables qui paroifient fur Vénus,
Mars & Jupiter , femblent prouver que ees planètes
ont une atmofphere changeante ; ainfi en raifonnant
toujours par analogie, on peut conclure la même'
chofe des autres planètes.
4°. Pareillement on peut conclure des montagnes
obfervécs fur Vénus, qu’il y en a de femblables dans
les autres planètes.
50. Puifque Saturne , Jupiter & leurs, fàtellites ,
Mars, Venus. & Mercure font des corps opaques qui
reçoivent leur lumière du Soleil, qui font couverts de
montagnes,, Sc .environnés d’une atmofphere changeante
, il paroît s’enfuivre que ces planètes ont des
eaux, des mers, &c. auffi-bien que des terreins fecs ;
en un mot , que ce font des corps femblables à la
Lune , & par conféquent à la Terre. Par conféquent,
félon plufieiu-s philofophes, rien ne nous empêche
de croire que les planètes font habitées. Huygens dans
Ion Gofmothèoros , a prétendu donner des preuves
îres-fortes de l’exiftance des habitans des planetês :
çe.s preuves font tirées de la reffemblance (des planètes
avec la. Terre , & de ce qu’elles font, comme
la Terre , des corps opaques , denfes , raboteux ,
pefhns, éclairés & échauffés par le Soleil ; ayant leur
nuit & leur jour , leur été & leur hyvpr.
M. de Fontenelle a auffi traité cette queftion dans
les entretiens fiir lapluralité des mondes ; il y foutient
que chaque planete eft habitée, & il explique chemin
faifant avec beaucoup de clarté , le fyftème de Co pernic
& les tourbillons de Defcartes * qui étoient
alors tout ce qu’on connoiffoit de mieux. Ce livre a
eu la plus grande réputation ; &: on le regarde encore
aujourd’hui comme un de ceux qui font le plus
d’honneur à fon auteur. Voye^ Pluralité des mondes
, au mot Monde.
W olf s’appuyant fur des preuves d’une autre ef-
pece, va jufqu’A faire des conjectures fur les habitans
des planètes : par exemple , il ne doute point que les
habitans de Jupiter ne foient beaucoup plus grands,
que nous , & de taille gig3ntefque. La preuve qu’il
en donne elt fi finguliere, qu’il ne fera peut-être pas
inutile de la rapporter ici : onfe fouviendra que c’eft
M.Wolf qui parle.« On enfeigne dans l’Optique que
» la prunelle de l’oeil eft dilatée par une lumière foible,
>> & retraite par une lumière forte : donc la lumière.'
>> du Soleil étant beaucoup moins grande pour les j
» habitans de Jupiter cjue pour nous , parce que _Ju-
» piter eft plus éloigné du Soleil, il s’enfuit que les;
»habitans de cette planete ont la prunelle beaucoup
» plus large & b^acoup plus dilatée que la nôtre. Or
» on obferve que la prunelle a une proportion con-
» liante avec le globe de l’oeil, ôc l’oeil avec le refté
Tome X I I ,
'» du corps ; de forte que dans les ànimalix*, plus la
»prunelle eft grande , plus l’oeil eft groSj & plu*
» auffi le corps eft grand.
» Pour déterminer la grandeur des habitahsde Ju-
» piter , on peut remarquer que la diftancê de Jupiter
» au.Soleil, eft à la diftancê de la Terre au Soleil;
» comme 26 à 5 ; & que par conféquent la lumière
» du Soleil, par rapport à Jupiter , eft à fa lumière
»par rapport à la Terre ; enraifon doublée de 5 à
» 26 ; or on trouve par l’expérience ; que la prunelle
» fe dilate en plus grand rapport, que l’intenfité dé
» la lumière ne croît : autrement un corps placé à une
» grande diftancê, paroîtroit auffi nettement qu’un
» autre plus près. Ainfi lé diamètre de la prunelle des
» habitans de Jupiter, eft au diamètre de la nôtre,
» en plus grande raifon que celle de 5 à 26. Suppo-
» fons-le de 10 à 26 , ou de 5 à ï 3 ; comme la hau^
.» teur ordinaire des habitans de la Terre, eft de cinq
» piés quatre pouces environ, ( ç’eft la hauteur que
» M. Wolfs’eft trouvée à lui-même .) on en conciud
,» que la hauteur commune des habitans de Jupiter,
» doit être de 14 piés y, Or cette grandeur étoit à
»peu-près celle de Og , roi de Bafan , dont parle
» Moïfe, & dont le lit de fer étoit long de neuf eon-
.» dées -, & large de quatre.
Voilà les egaremens oh tombe l’efprit humain *
quand il Je livré à la fureur de faire des fyftèmes ; car
furquoi M. Wolf fe fonde-t-il pour avancer que les
habitans de Jupiter , fuppofé qu’ils voient, ont la
prunelle plus grande que la nôtre, & que la grandeur
de leur prunelle eft proportionnelle a la hauteur de
leur corps. La lumière eft plus foible dans Jupiter que
fur la terre , il eft v rai, mais les habitans de Jupiter
peuvent être d’une telle nature, que cette lumière
foit auffi forte pour eux que la nôtre l’eft pour nous.
Il fuffit pour cela qu’ils aient l’organé plus fenfible ;
d’ailleurs eft-il vrai que la grandeur du corps foit proportionnée
au diamètre de la prunelle ? Ne voyons^
nous pas tous les jours le contraire dans les animaux?
Les chats ont la prunelle beaucoup plus grande que
nous ; les, cochons l’ont beaucoup plus petite que
les, chats, &c.
M. de Fontenelle eft bien éloigné de faire des con-
jeôures.auffi puériles fur la figure des habitans des
planètes ; il penfe qu’elle eft fort différente de la nôr
tre, & que nous n’en avons aucune idée ; & il appuie
cette opinion par des raifons ingériieufes. « Quelle
» différence , dit-il, de notre figure, de nos manie-
» res, &c. à celle des Américains où des Africains l
» Nous habitons pourtant le même vaiffeau, dont ils
» tiennent la proue & nous la, poupe ? Combien ne
p doit-il pas y avoir de différence de nous aux habi-
» tans des autres planètes , c’eft-à-dire de ces autres
» vaiffeaux qui flottent loin de nous par les eieux »?
Cela eft beaucoup plus vraiffemblable ; mais cependant
il n’eft pas encore bien sur ( voye[ M o n d e )
que les planètes foient habitées.
Mouvement des planètes. Il eft évident par une i-nfi»
nité de phénomènes , que les planètes tournent autour
du Soleil, comme centre , 6c non autour de la
Terre.
i°. L’orbite dans laquelle Vénus fe meut; environne
certainement le Soleil, 6c par conféquent
cette planete tourne autour du Soleil en décrivant
cette orbite.
On prouve aifément que cette orbite environne lé
Soleil , par la raifon que Vénus eft quelquefois au-
deffus du Soleil, quelquefois au-deffous, quelquefois
derrière , & quelquefois du même côté ; ce qui
eft évident par les différentes circonftances de fes'
phafes. Foye[ Ph a se ,
Elle paffe derrière le foleil fôrfque vers le tems dët
fa conjonêlion ,- quand elle nous paroît fort proche
de ce corps lumineux; on l’apperçoit parfaitement
y v v y