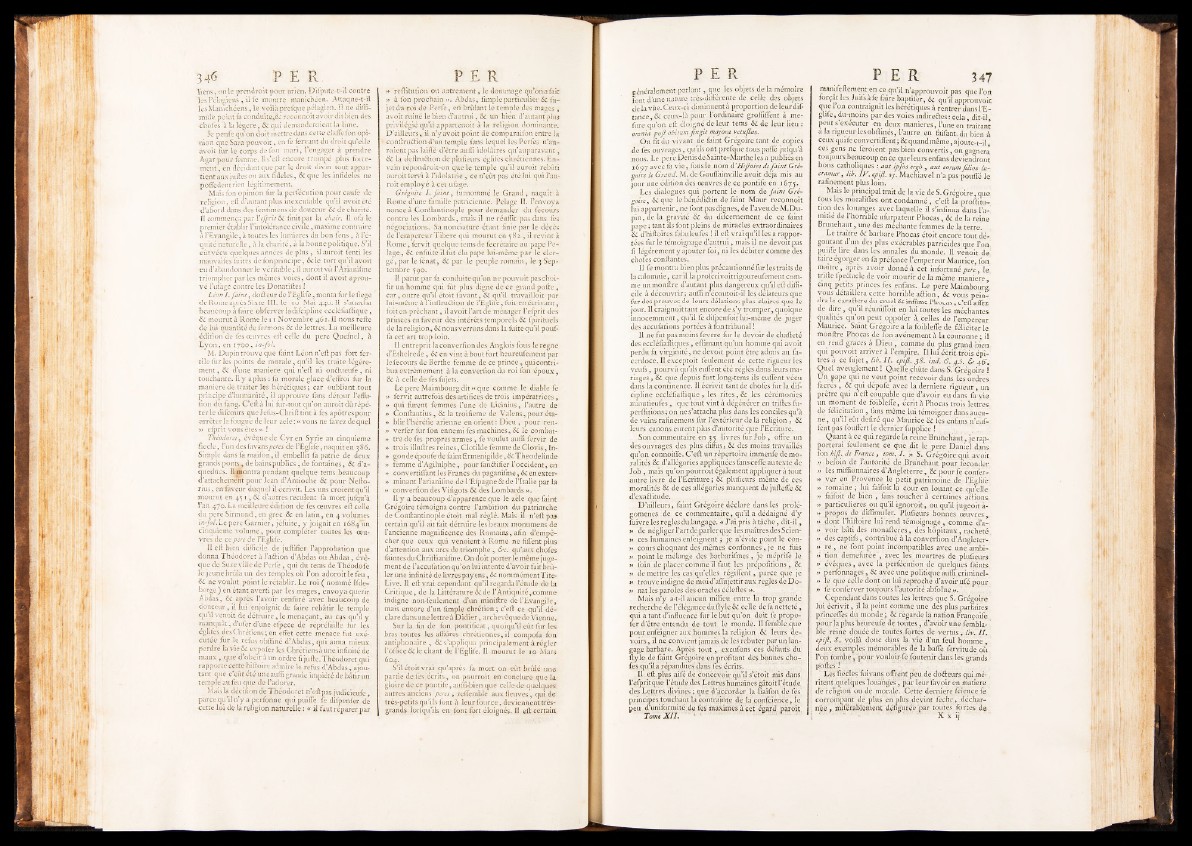
34<S P £ R
liens > on le prendroit pour arien. Difpute-t-il contre
les Pélagiens , il fe montre manichéen. Attaque-t-il
les M anichéens, le voilà prefque pélagien. H ne difti-
mule point fa conduite,6c reconnoît avoir dit bien des
chofes à la lé g è re , 6c qui demanderaientla lime.
Je penfe qu’on doit mettre dans cette claffefon opinion
que Sara p o u v o it , en fe fervant du droit qu’eîie
avo it lur le corps de fon ma ri, l’ engager à prendre
Agar pour femme. Ils’elt encore trompé plus fortement
, en décidant que par le droit divin tout appartien
t aux.iuftes ou aux fideles, & q u e les infidèles ne
pofledentrien légitimement
Mais fon opinion fur la perfécution pour caufe de
religion, eft d’autant plus inexcufable qu’il avo it été
d’abord dans des fentimens de douceur 6c de charité.
ÏI commença par Yefprit 6c finit par la chair. Il ofa le
premier établir l’ intolérance c iv ile , maxime contraire
à l’Evangile, à toutes les lumières du bon fens , à l’équité
naturelle, à la charité, à la bonne politique. S ’il
e û tv é cu quelques années de plus , il auroit fenti les
mauvaifes fuites de fon principe, & l e tort qu’il avoit
eu d’abandonner le véritable ; il auroit vû l’Arianifme
triompher par les mêmes v o ie s , dont il avo it aprou-
v é Finage contre les Donatiftes !
Léon I. faint, doéteur de l’E g life , monta fur le fiege
de Rome après Sixte III. le io Mai 440. Il s’attacha
beaucoup à faire obférver la difcipline eccléfiaftique,
& mourut à Rome le 1 1 Novembre 4 6 1. Il nous relie
de lui quantité de fermons 6c de lettres. La meilleure
, édition de fes oeuvres e ll celle du pere Q u e fn e l, à
L y o n , en 170 0 , in-fol.
M. Dupin trouve que faint L é on n ’e ll pas fort fertile
fur les points de m o rale , qu’ il les traite légèrement
, 6c d’une maniéré qui n’ eft ni o n d u e u fe , ni
touchante. Il y aplus : fa morale glace d’effroi fur la
maniéré de traiter les hérétiques ; car oubliant tout
principe d’humanité, il approuve fans détour l’effii-
fion du fang. C ’eft à lui fur-tout qu’on auroit dû répéte
r le difcours que Jefus-Chrilltint à fes apôtres pour
arrêter la fougue de leur zele : «vous ne favez de quel
■ » efprit vous êtes » !
Théodoret, évêque de C y r en Syrie au cinquième
fie c le , l’un des favansperes de l’Eglife, naquit en 386.
Simple dans fa maifon, il embellit fa patrie de deux
grands ponts^ de bainspub lics, de fontaines, 6c d’aqueducs.
Hgnontra pendant quelque tems beaucoup
d ’attachement pour Jean d’Antioche & pour Nefto-
r iu s , en faveur duquel il écrivit. Les uns croient qu’il
mourut en 451 , & d’autres reculent fa mort jufqu’à
l’an 470. La meilleure édition de fes oeuvres eft celle
du per ë Sirmond, en grec & en latin, en 4 volumes
in-fol. Le pere Ga rn ie r, jé fu ite , y joignit en i684*un
cinquième v o lum e , pour compléter toutes les oeuv
res de ce pere de l’E glife.
Il eft bien difficile de juftifier l’approbation que
donna T héodoret à l’ad ion d’Abdas ou Ab da a, évêqu
e de Suze ville de P e r fe , qui du tems de Théodofe
le jeune brûla un des temples oii l’on adoroit le feu ,
6c ne voulut point le rétablir. L e roi ( nommé Ifde-
b e ra e ) en étant'averti par les mages, en vo ya quérir
Ab aas , & après l’avo ir cenfuré avec beaucoup de
d ouceur, il lui enjoignit de faire rebâtir le temple
qu il venoit de détruire, le m enaçant, au c^s qu’il y
manquât, d’ufer d’une efpece de repréfaille lur les<
egliles des Chrétiens; en effet cette menace fut exécutée
fur le refus obftiné d’Abdas, qui aima mieux
perdre la v ie 6c expofer les Chrétiens a une infinité de
maux , que d’obéir à un ordre fijufte. T héodoret qui ’
rapporte cette hiftoire admire le refus d’Abdas , ajou-.
tant que c’eut ete une aufti grande impiété de bâtir un
temple au feu que de l’adorer.
Mais la décifion de Théodoret n’ eft pas judicieufe,
parce qu’il n’y a perfonne qui puiffe fe difpenfer de
«ette lo i de la religion naturelle : « ü faut reparer par
P E R
» "reftîtution ou autrement, le dommage qu’ôhafah
» à fon prochain ». Abdas, fimple particulier 6c fu-
jet du roi de Perfe, eh brûlant le temple des mages f
avoit ruiné le bien d’autrui, 6c un bien d’autant plus
privilégié qu’il appartenoit à la religion dominante.
D ’ailleurs, il n’y aVoit point de comparaifon entre la
I conftrudiond’un temple fans lequel les Perles n’au-
roient pas laiffé d’être aufti idolâtres qu’auparavant,
6c la deftrudion de .plufieurs églifes chrétiennes. En-
vain répondroit-on que le temple qu’il auroit rebâti
auroit lervi à l’idolâtrie, ce n’eût pas été lui qui l’au-
roit employé à cet ufage.
Grégoire I. faint, furnommé le Grand, naquit à
Rome d’une famille patricienne. Pelage II. l’envoya
nonce à Conftantinople pour demander du fecours
contre les Lombards, mais il ne réufîit pas dans fes
négociations. Sa nonciature étant finie par le décès
de l’empereur Tibere qui mourut en 582 , il revint à
Rome, fervit quelque tems de fecrétaire au pape Pelage
, 6c enfuite il fut élu pape lui-même par le clergé,
par le fénat, 6c par le peuple romain, ie 3 Septembre
590^
Il panit par fa conduite qu’on ne pouvoit pas choi-
fir un homme qui fût plus digne de ce grand pofte ,
car, outre qu’il étoit favant, 6c qu’il travailloit par
lui-même à l’inftradion de l’Eglife, foit en écrivant,
foit en prêchant, il avoit l’art de ménager l’efprit des
princes en faveur des intérêts temporels 6c fpirituels
de la religion, 6c nous verrons dans la fuite qu’il pouffa
cet art trop loin.
Il entreprit la converfion des Anglois fous le régné
d’Ethelrede, 6c en vint à bout fort heureufement par
le fecours de Berthe femme de ce prince , qui contribua
extrêmement à la converfion du roi fon epoux,
6c à celle de fes fujets.
Le pere Maimbourg dit « que comme le diable fe
» fervit autrefois des artifices de trois impératrices,
» qui furent femmes l’une de Licinius, l’autre de
» Conftantius, 6c la troifieme de Valens, pour éta-
» blir l’héréfie arienne en orient : Dieu , pour ren-
» verfer lur fon ennemi fes machines, 6c le combat-
» tre de fes propres armes , fe voulut aufti fervir de
» trois illuftres reines, Clotilde femme de Clovis, In-
» gonde époufe de faint Ermenigilde, 6c Theodelinde
» femme d’Agilulphe, pour fandifier l’occident, en
» convertiffant les Francs du paganifme, & en exter-
» minant l’arianifme de l’Efpagne & de l’Italie par la
» converfion des Vifigots & des Lombards».
Il y a beaucoup d’apparence que le zèle que faint
Grégoire témoigna contre l’ambition du patriarche
de Conftantinople étoit mal réglé. Mais il n’eft pas
certain qu’il ait fait détruire les beaux monumens de
l’ancienne magnificence des Romains, afin d’empêcher
que ceux qui venoient à Rome ne fiffent plus
d’attention aux arcs de triomphe , &c. qu’aux chofes
faintesdu Chriftianifme. On doit porter le même jugement
de l’accufation qu’on lui intente d’avoir fait brûler
une infinité de livres payens, 6c nommémentTite-
Live. Il eft vrai cependant qu’ il regarda l’étude de la
Critique, de la Littérature & de l’Antiquité,comme
indigne non-feulement d’un miniftre de l’Evangile,
mais encore d’un fimple chrétien ; c’eft ce qu’il déclare
dans une lettre à Didier, archevêque de Vienne.
Sur la fin de fon pontificat, quoiqu’il eût fur les
bras toutes les affaires ; chrétiennes, il compofa fon
antiphonaire , 6c s’appliqua principalement à régler 1 office & le chant de f Eglife. Il mourut le 10 Mars
604.
S’il étoit vrai qu’après fa mort on eût brûlé une
partie de fes écrits, on pourroit en conclure que la
gloire de ce pontife, aufîi-bien que celle de quelques,
autres anciens peres, reffemble aux fleuves, qui de
très-petits qu’ils font à leur fource, deviennent très-
grands lorfqu’ils en font fort éloignés. Il eft certain
P Ë R
généralement parlant, que les objets de la mémoire
font d’une nature très-différente de celle des objets
delà vûe. Ceux-ci diminuent à proportion deleurdif-
tance, 6c ceux-là pour l’ordinaire grofîiffent à me-
fiure qu’on eft éloigné de leur tems 6c de leur lieu :
emnia poft obicum fingit majom vetuflas.
On fit du vivant de faint Grégoire tant de copies
de fes ouvrages, qu’ils ont prefque tous pafle jufqu’à
nous. Le pere Denis de Sainte-Marthe les a publiés en
1607 avec fa v ie , fousle nom à'Hijloire de faint Grégoire
le Grand. M . de Gouffainville avoit déjà mis au
jour une édition des oeuvres de ce pontife en 1675.
Les dialogues qui portent le nom de faint Grégoire
, 6c que le benédidin de faint Maur reconnoît
lui appartenir, ne font pas dignes, de l’aveu de M.Du-
pin, de la gravité 6c au difcernement de ce faint
pape ; tant ils font pleins de miracles extraordinaires
6c d’hiftoires fabuleufes ! il eft vrai qu’il les a rapportées
fur le témoignage d’autrui, mais il ne devoit pas
fi légèrement y ajouter foi, ni les débiter comme des
chofes confiantes. .. . ’
Il fe montra bien plus précautionné fiir les traits de
la calomnie, car il la-profcrivoitrigoureufement comme
unmonftre d’autant plus dangereux qu’il eft .difficile
à découvrir ; aufti n’écoutoit-il les délateurs que
fur des preuves de leurs délations plus claires que le
jour, Il craignoittant encore de s’y tromper, quoique
'innocemment, qu’il fe difpenfoit lui-même de juger
des accufations portées à fon tribunal,! ....
Il ne fut pas moins fevere fur le devoir de chafteté
des eccléfiaftiques, eftimant qu’un homme qui avoit
perdu fa virginité, ne devoit point être admis au fa-
cerdoce. Il exceptoit feulement de cette, rigueur les
veufs, pourvû qu’ils euffent été réglés dans leurs mariages
, 6c que depuis fort long-tems il^ euffent vécu
dans la continence. Il écrivit tant de chofes fur la difcipline
eccléfiaftique,Jès^rites, 6c les cérémonies
minutieufes , que tout vint à dégénérer en triftes fu-
perftitions ; on ne s’attacha plus dans les conciles qu’à
de vains rafinemens fur l’extérieur de la religion, 6c
leurs canons eurent plus d’aiitorité que-l’Ecriture..
Son commentaire en 3 5 livres fur Job , offre un
des ouvrages des plus diffus* 6c des moins travaillés
qu’on connoiffe. C’eft un répertoire iinmenfe de moralités
6c d’allégories, appliquées fans ceflé au texte de
Job , mais qu’on pourroit également appliquer àtput
autre livre de l’Ecriture; oc plufieurs ’même de ces
moralités 6c de ces allégories manquent de jufteffe 6c
d’exaditude.
D ’ailleurs, faint Grégoire déclare dans les prolégomènes
de, ce commentaire, qu’il a dédaigné d’y
fuivre les réglés duiangage. « J*ai pris à tâche, dit-il,
>> de négliger l’art de parler que les maîtres des Scien-
» ces humaines enfeignent ; 'je n’évite, point le cç»n-
» cours choquant des mêmes, confondes, je ne fuis
» point le mélange des batbarifines , je méprife le
» foin de placer comme il faut les prépofitions, 6c
» de mettre les cas qu’elles régiffent, parce que je
» trouve indigne de moid’affujettir aux réglés de Do-
» nat les parolès des oracles çéleftes ».,
Mais n’y a-t-il aucun milieu entre la trop grande
recherche de l’élégance duftylè 6c celle de fa netteté,
qui a tant d’influence furie but qu’on doit fe prapo-
fer d’être entendu de • tout le mondé. Il femmefque
pour enfejgn.er aux hommes la religion 6c leurs cle-;
voirs, il ne, convient jamais, de les rebuter par u p i a lisage
barbare. Après tout , excufons ces défauts du;
ftyle de fairtt Grégoire en profitant dès bonnes chofes
qu’il a répandüesjdans fes, écrits..
Il eft .plus aifé de copçèvçir qii’il s’étoit mis dans,
l’efpritquè l’étude des Lettreshumaines gâtoit l’étude,
des Lettres divines,; que d’accorder la liaifon. dejfeY
principes touchant la contrainte de la.sqnfçiencé, le
peu d’uniformité de fes' maximes à cèt égard paroît
Tome X I I , * " " " "
P E R 3 4 7
mamfeftement en ce^qu’il n’approuvoit pas que l’on
forçat les Juifs à fe faire haptifer, 6c qu’il approuvoit
que l’on contraignît les hérétiques à rentrer dans l’Eglife
, du-moins par des voies indirectes : cela dit-il
peut s’exécuter en deux maniérés, l’une en traitant
à la rigueur les obftinés, l-’autre en fàifant.du bien à
ceux quife convertiffent ; 6c quandmême, ajoute-t-il
ces gens ne feroient pas bien convertis, on gagnera
toujours beaucoup en ce que leurs enfans deviendront
bons catholiques : aut ipfos ergb , aut eorum filios lii-
cramur, lib. I V , epifl. vj. Machiavel n’a pas pouffé le
rafinement plus loin.
Mais le principal trait de la vie de S. Grégoire, que
tous les môraliftes ont condamné, c’eft la proftitu-
tion des louanges avec laquelle il s’infinua dans l’a-’
initié de l’horrible ufuroateur Phocas, 6c de la reine
Brunehaut, une des méchante femmes de la terre.
Le traître 6c barbare Phocas étoit encore tout dégoûtant
d’un des plus exécrables parricides que l’on
puiffe lire dans les annales du monde. Il venoit de,;
faire egorger en fa préfence l’empereur Maurice, fon
maître, après avoir donné à cet infortuné pere, le,
trille fpeétaçle de voir mourir de la même maniéré
cinq petits princes fes enfans. Le pere Maimbourg.,
vous détaillera cette horrible aûion, 6c vous peindra
le caraélere du cruel & infâme Phocas ; c’eft affez
de dire, qu’il réuniffoit en lui.toutes les méchantes
qualités qu’on peut oppofer à celles de l’empereur
Maurice. Saint Grégoire a la foibleffe de féliciter le
monftre Phocas de fon avenement à la couronne ; il
en rend grâces à Dieu , comme du plus grand bien
qui pouvoit arriver à l’empire. Il lui écrit-trois épî-
riès à ce fujét, lib. IL epifl. 38. ind. 6. 46. . & 4 6 :
Quel aveuglement ! Quelle chute dans S/Grégoire 1
Un .pape qui ne veut point recevoir dans les ordres
facres , & qui dépôfé. avec la derniere rigueur, un
prêtre qui n’eft coupable que d’avoir eu dans fa vie
un moment de foibleffe, écrit à Phocas trois lettres-
de félicitation, fans même foi témoigner dans aucune
, qu’il eût defiré que Maurice 6c f is 'enfans n’euf--
fënt pas fouffert le dernier fupplice ! i
Quant à ce qui regarde la réine Rriinêhàut, je rapporterai
feulement ce que .dit le pere Daniel dans
Ion hift. de France , tom. 1. » S. GrégQipe qui avoit
» : bëlbin de l’autorité de .Brunehaut pour leçonder
» lès millionnaires d'Angleterre, 6c pour fo confer-i
» ver en. Provence le petit patrimoine de. l’Eglife-
» romaine; lui faifoitlà çôur en louant ce qu’elle
» faifoit de bien , fans toucher à certaines aérions
». particulières ou qu’il ignorpit, ou qu’il jugeoit à-
» propos de diftiinuler. Plufieurs bonnes oeuvres
» dont l’hiftoire lui rend témoignage , comme d’a-.
» voir bâti des monafteres, des hôpitaux, racheté.
» des captifs , contribué à la converfion d’Angieter-
» re , ne font point incompatibles avec une ambi-
>> tion demefurée', avec les meurtres de plufieiirs
» évêques, avec la perfécution de quelques faints
» perfonnages, & avec une politique aufti çriminel-
» le que celle dont on lui reproche d’avoir ufé pour
» fe conferver toujours l’autorité abfolue ».,* Ç.,.
Cependant d’ans toutes les lettres que S. Grégoire
lui écrivit, il la peint comme une des plus parfaites
princeffes dit monde.; 6c regarde la nation Françoife
pour la plus héûreufe de toutes, d’avoir une fembla-
blé -reiriè douéè. de. toutes.; fortes de vertus, liv. II.
epifl. 8. voilà, donc dans ia; yie. d’un feul homme ,
deux exemples mémorables de la baffe fervitude oîi
l’on tombe , pour vouloirfè fqutenir dans les grands
pbfte§T’ ' * f " .* “.'‘f: .
' Les fieçiës fuivans offrent peu,dé doéleurs qui mé-.
ritenl quelques louanges', par leur favoir en matière
de religion ou de morale. Cette derniere feience fe
corrompant de .plus en plus,devint feçfie, décharnée
, misérablement déngurée pàr toutes fortes de
X x ' î j