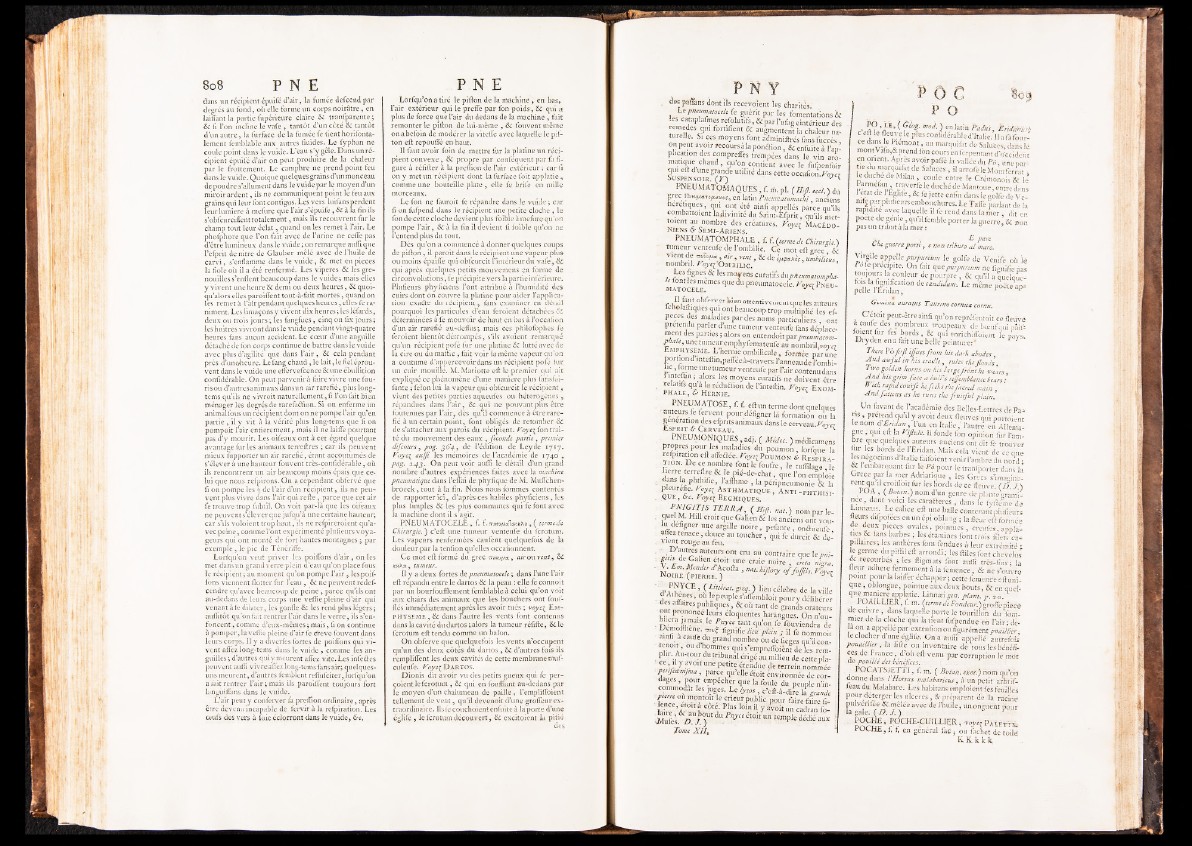
dans un récipient épuifé d’air, la fumée defcend par
degrés au fond, oîi elle forme un corps noirâtre, en
laiffant la partie fupérieure claire 6c tranfparente ;
6c fi l’on incline le vafe , tantôt d’un côté 6c tantôt
d ’un autre, la lurface de la fuméefe tient horifonta-
lement femblable aux autres fiuides.^Le fyphon ne
coule point dans le vuide. L’eau s’y gèle. Dans un récipient
épuifé d’air on peut produire de la chaleur
par le frottement. Le camphre ne prend point feu
dans le vuide. Quoique quelques grains d’un monceau
de poudre s’allument dans le vuide par le moyen d’un
miroir ardent, ils ne communiquent point le feu aux
grains qui leur font contigus. Les vers luifans perdent
leur lumière à mefure que l’air s’épuife, & à la fin ils
s’obfcurcifl'ent totalement, mais ils recouvrent fur le
champ tout leur é clat, quand on les remet à l’air. Le
phofphore que l’on fiait avec de l’urine ne ceffe pas
d’être lumineux dans le vuide; on remarque auffique
l’efprit de nitre de Glauber mêlé avec de l ’huile de
ca rvi, s’enflamme dans le vuide, & met en pièces
la fiole oii il a été renfermé. Les viperes 6c les grenouilles
s’enflent beaucoup dans le vuide ; mais elles
y vivent une heure 6c demi ou deux heures, & quoi-
qu’alors elles paroiflent tout-à-fait mortes, quand on
les remet à l’air pendant quelques heures, elles fe raniment.
Les limaçons y vivent dix heures ; les léfards,
deux ou trois jours ; les fangfues, cinq ou fix jours ;
les huîtres vivront dans le vuide pendant vingt-quatre
heures fans aucun accident. Le coeur d’une anguille
détaché de fon corps continue de battre dans le vuide
avec plus d’agilité que dans l’air , 6c cela pendant
près d’unejheure. Lefang chaud , le lait, le fiel éprouvent
dans le vuide une eftèrvefcence&une ébullition
confidérable. On peut parvenir à faire vivre une fou-
ris ou d’autres animaux dans un air raréfié, plus long-
tems qu’ils ne -vivroit naturellement, fi l’on fait bien
ménager les degrés de rarefa&ion. Si on enferme ùn
animalfous un récipient dont on ne pompe l’air qu’en
partie , il y vit à la vérité plus long-tems que fi on
pompoit l’air entièrement, mais il ne laifle pourtant
pas d’y mourir. Les oifeaux ont à cet égard quelque
avantage fur les animaux terreflres ; car ils peuvent
mieux liipporterun air raréfié, étant accoutumés de
s’élever à une hauteur fouvent très-confidérable, oit
ils rencontrenr un air beaucoup moins épais que celui
que nous refpirons. On a cependant obfervé que
fi on pompe les f de l’air d’un récipient, ils ne peuvent
plus vivre dans l’air qui refte, parce que cet air
fe trouve trop fubtil. On voit par-là que les oifeaux
ne peuvent s’élever que jufqu’à une certaine hauteur;
car s’ils voloient trop haut, ils ne refpireroient qu’avec
peine, comme l’ont expérimenté plufieurs voyageurs
qui ont monté de fort hautes montagnes ; par
exemple, le pic de Ténériffe.
Lorfqu’on veut priver les poiflons d’a ir , on les
met dansun grand verre plein d’eau qu’on place fous
le récipient; au moment qu’on pompe l’air , lespoif-
fons viennent flotter fur l’eau , 6c ne peuvent redef-
cendre qu’avec beaucoup de peine, parce qu’ils ont
au-dedans de leurs corps une veflie pleine d’air qui
venant à le dilater, les gonfle 6c les rend plus légers;
auflitôt qu’on fait rentrer l’air dans le verre, ils s’enfoncent,
comme d’eux-mêmes ; mais, fi on continue
à pomper, la veflie pleine d’air fe dreve fouvent dans
leurs corps. 11 y a diverfes fortes de poiflons qui vivent
aflfez long-tems dans le vuide, comme les anguilles
; d’autres qui y meurent afîez vite. Les infeétes
peuvent aufîi vivre allez long-tems fans air; quelques-
uns meurent, d’autres lemblentrefîiifciter,lorfqu’on
a fait rentrer l’air ; mais ils paroiflent toujours fort
languiflans dans le vuide.
L’air peut y conferver fa preflion ordinaire, après
erre devenu incapable de fervir à la refpiration. Les
oeufs des vers à l'oie éclorront dans le Yuide, &c.
Lorfqu’on a tiré le pifton de la machine, en bas,
l’air extérieur qui le prefîe par fon poids', 6c qui a
plus de force que l’air du dedans de la machine , fait
remonter le pifton de lui-même , 6c fouvent même
on abefoin de modérer la vitefle avec laquelle le pifton
eft repoufle en haut.
Il faut avoir foin de mettre fur la platine un récipient
convexe, & propre par conféquent par là figure
à réfifter à la preflion de.l’air extérieur; car fi
on y met un récipient dont la furface foit applatie,
comme une bouteille plate , elle fe brife en mille
morceaux.
Le fon ne fauroit fe répandre dans le vuide ; car
fi on fufpend dans le récipient une petite cloche , le
fon de cette cloche devient plus foible àmefure qu’on
pompe l’air, 6c'k la fin il devient fi foible qu’on ne
l’entend plus du tout.
Dès qu’on a commencé à donner quelques coups
de pifton, il paroît dans le récipient une vapeur plus
ou moins ép aille qui obfcurcit l’intérieur du vafe, &;
qui après quelques petits mouvemens en forme de
circonvolutions, le précipite vers la partie inférieure.
Plufieurs phyficiens l’ont attribué à l’humidité des
cuirs dont on couvre la platine pour aider l’application
exa&e du récipient, fans examiner en détail
pourquoi les particules d’eau feroient détachées 6c
déterminées à fe mouvoir de haut en bas à l’occafion
d’un air raréfié au-deflus ; mais ces philofophes fe
feroient bientôt détrompés, s’il? avoient remarqué
qu’un récipient pofé fur une platine & lutté avec de
la cire ou du maftic , fait voir la même vapeur qu’on
a coutume d’appercevoir dans un récipient pofé lur
un cuir mouillé. M. Mariotte eft le premier qui ait
expliqué ce phénomène d’une maniéré plus fatisfai-
fante ; félon lui la vapeur qui obfcurcit le récipient,
vient des petites parties aqueufes ou hétérogènes ,
répandues dans l ’air , 6c qui ne pouvant plus être
foutenues par l ’air, dès qu’il commence à être raréfié
àim certain point, font obligés de retomber 6c
de s’attacher aux parois du,récipient. Voyei fon traité
du mouvement des eaux , fécondé partie , premier
difeours, pog. 564 , de l ’édition de Leyde 1717.
Voye{ aufji les mémoires de l ’académie de 1740 ,
pag. 2 4 3 . On peut voir aufli le détail d’un grand
nombre d’autres expériences faites avec la machine
pneumatique dans l’efîai de phyfique de M. Muflchen-
broeck, tout à la fin. Nous nous fommes contentés
de rapporter ic i, d’après ces habiles phyficiens ., les
plus fimples 6c les plus communes qui fe font avec
la machine dont il s’agit.
PNEUMATOCELE , f. f. , ( terme de
Chirurgie. ) c’eft une tumeur venteufe du ferotum.
Les vapeurs renfermées caufent quelquefois de la
douleur par la tenfion qu’elles occafionnent.
Ce mot eft forme du grec mnupa. , air ou vent, Sc
khXh , tumeur.
Il y a deux fortes de pneumatocele ; dans l’une l’air
eft répandu entre le dartos & la peau : elle fe connoît
par un bourfoufflement femblable à celui qu’on voit
aux chairs des animaux que les bouchers ont fouf-
flés immédiatement après les avoir tués ; voye%_ Emphysème
, 6c dans l’autre les vents font contenus
dans la cavité du dartos ; alors la tumeur réfifte., & le
ferotum eft tendu comme un balon.
On obferve que quelquefois les vents n’occupent
qu’un des deux côtes du dartos , & d’autres fois ils
rempliflent les deux cavités de cette membrane muf-
culeufe. Voye{ D artos.
Dionis dit avoir vu des,petits gueux qui fe per-
çoient le ferotum , 6c qui en foufllant au-dedans par
le moyen d’un chalumeau de paille 'Q0empliffoient
tellement de v ent, qu’il devenoit d’une grofîeur extraordinaire.
Ils fe couchoient enfuite à la porte d’une
églife, le ferotum découvert, 6c excitoient la pitié
. paSahs dont ils reïévo'ièift les cW i t k '
UpntuçpiàceléH W K Ê f e i ÿ Wentatiohs &
!es cataplafiires refoiutifs , & par l’ufag eintérieur des .
remedes qui fpmfieht & augmentent la chaleur naturelle.
Si ces moyens font adminiftrés fans fuécès I 1
onpeutav&iri.ecoursàlaponffion, & enfuite à M j
phcation des comprefles trempées dans le vin aro-
maticpe chaud , — — M l
qm efl d’unegrande utilité dans cette oecafioi .,fW ?
SüSPENSOIR. (T ) J i
p n e u m a t o m à q ü e s , f. A . pi. ( Hijl: cccï.) dû
grec nrt^T^xei^énhtmPneiiingto^iadi ancienf ’’
«erotiques, qui ont été"|iHfi appelles parce qu’ils
cqmbattoient la<livinité du Stùnt-Efprit,,qu’iisûletr
toient au nombre dèk,"qfeà£urès. Paye? Macédo?
-NieNs <§* SeMi -A r ie n s .
PNEUMATOMPHALÊ , f. £. (ternit di Chirurgie )
tumeur venreuféfde l’ombilic C em o te f tg ie c &
Vient dé air, vent 1 6c de M Ê Ê È , urnbilicus,
nombril. Voye^ Om b il ic .
Les lignes 6c les moyens curatifs àupheumatompha-
§■ lont les memes que du pneumatocele. S H Pn e u m
a t o c e l e .
M B ^ r Ii? itPI,^vement que les auteurs.
Ichelaftiques qui ont beaucoup trop multiplié les ef-
I Pef es ” ’ “ adles par dés noms particuliers , ont
prétendu parler d’une tumeur venteufe fans déplace?
— IB | B h Q > entendoit par pneumatonMt
phalt, une tumeur emphyfemateufe au nombril,vovsi I
EMPHYSEME. L’herme ombüicale, formée pârttoe
fortjond inteflm,paffeeà-travW l’anneaudeî’ombidoivent
être
. qu,WaïeduaiOn,de l’tnteftin. Pnytr ExOM-
î’h a l e , & He r n ie . ^
- , • H m S I H h I ^ un terme dont quelques !
auteurs;fe fervent pour défignér 13 formation ou la
génération des efprits animaux dans le-cerveau >orcr ‘
h s p r it & C e r v e a u . j 1
PNEUMONIQUES, adj. ( Mld'c. ) médical nens
proprespour les maladies du poumon, lorfqiîe'la
refpiration efl affeflée. ^oye^PoDMON & R e sw r a -
, t io n . Ue cqnombre font le foufre, le tuffilaae le
lierre terreflre & de pié.devchat, que l’on empliie
,.;dans la phthifie, 1 afthmè^ la péripneumonie & la
A s t h m a t iq u e , A n t i ^p h t h i s l
. q u e , &c. ffpye{ Be c HIQUES. rwiiiimn BS wêkkêêê ; quel M. Hill croit q „e Galien Sé les anciens ont vb’ti- ’
H H une argiiie noire,, pefante , onci.tcnib, .
aliez-tenace, douce au toucher, qui fe durcit & ’dé’ d
. vient rouge.au feu. -• . ■
' H autres autetifs ont crti. au ïtfntfaire jjue'le fini- 1
— — , enta nigia.
I X - H H A t o f l a j o ffo k u : rovtx
N o ir e . i( p ie r r e . .):. J J M ™’l ;
( Aitterat. gréf ) ijeu célébre de la ville
I B B B B H B H délibérer
«es amutes pubhques-, & oii tant de. grands orateurs
ont prononce lents éloquentes harangues. On n’ou-
' B B — | H H qu’on fefëuvioedra de
il fe —
S i i f f i i H B H S S P “ defieges qu’ilcon-
— ■ ^omh>as-qi„E’em'preffoiIrit de les rem-
plii. Au-tpur du tribunal érigé-au milieu de cettepia-
“ B M «ne petite tendue, dé terrein.nommée
. ' ’ Part„e,Ç "U e & i t environnée de corcof,
m’„ ^ U,r H H B S H B l d« peuple n’in-
commodât les juges. Le W , 'c’eft-à-dire la grande
m m Ü H Ü I S ic r ie t r fp u b li c , pour faireÆ ireS
S B i ■ B H 1 1 cadra»' 1
sM u fe l'a^ f ) d é d i é aiix
J'orne X I IK
P O G § ô §
P O
- n ? EU £ H H ) en latin Padus, WÊÈkn
j “ B U e 'olus confidérable d’Italie-, II a fa four?
B— M l ietaor* . ™ marquifat de Salucesj dans lé
montyifo,&prend fon cours enferpentant dVccident
en orient. Apres avoir pafië la vallée du Pô -, Une I f e
tie du marquifat de Saluces , il arrofe le Momfen-at ,
le duché de. Milan coule entre le Crémonois St lé
m U m m ^ verfe le duché de Mantoue, entre dans 1 état de 1Eglife, & fe jette enfin dans le golfe de V e-
pife parplufieuK embouchures. Le Taffe parlant de 'a
rapidité aveç.la'quelle il fe rend dans-Ja mer . dit en
poete de p i e jqu’ilfemble porter la guerre, & non
pas un tribut a la mer t
M I W Ê È Pare
U 'ie guerra porti, e non tributo al mare-.
Virgile a p p e l l e ^ « , , , , ic golfe dé Vehlfé où lé
1 0 le précipité. On fait quepürpùreum rie fieriifie pas
toujours la couleur de pourpre , & qu’il a quelque?
Le même poète ap?
I^^^MËndan, 1 1
G-emina aUratus Taurino cornua cornu-,
\ C W B m ainfi <îl' ’on repréfentoït ce fleüVè
a caule des jiomb^ejiL troüpeatix dëiceufqiii pâif*
foient fur ®s bords , & qui enrichiffoient ïe payst
JJryden en a fait une'belle peinture:'* ‘
Therc Pàfir/l iffua from fiis dark ahodesÊ^
' J “ -1 ™ f “ l in kis crédit, rults thtJloods,
golden horns en /üs large front ht mars.
Jn d his gntn face a bull’s refemUance bcars ■
Wuh rapid courfe he.feèksée/atred main ,
dnijattens as ht nmÿfjtc fimtfid plain.
. Un lavant de l’académie des Belles-Lettres dé Pa?
rts . prétend qu’il y avoielêux fleûyesqui portbieiit
leuom d Endan, l’un en Italie,1 l'autre eii Aliéna?
g n e q u i eli la Pifide. Il fonde fon opinion fur l’aih-
bre que quelques auteurs anciens ont dit fe trouver
lur les b q r d s g l Eridan. Mais cela vient de ce que
les negohans d’Italie ftifoient venir l’ambre du nord -
« 1 embarquant fur le Ed pour-le tranlporter dans la
Greee par la-.mer Adriatique , les- Grecs s’i.-na-iiiô?
rent,qu’ilicroiffoit fur les bdrds de ce Bélive/f i ) J )
POA g fBbtan.) nom d’un genre de plante »rami?
. nee, dont voici les cârafteres^, dans le fyftè^ne dé
-nnaiiis. Le calice cil une balle contenant plufîéuïs
tleurs dtfpofees en un épi èblong ; la fleur 'èftfôgnée
de, doux pièces léÿàlèsy pointues , creufes, applài
- ttes oc lans-barbesplésiétamines font t r ^ filets cd?
pillair.es; les anthères font fendues leur extrémité -
le germe du piftiteffi arrondi; les ffilesifont chevelus
«recourbes; ; lès ftgmats' fô’nf anlfi très'-firtS; la
fleur adhéré termement à la femence, & né s'oiivré
point pour la laiffer échapper ; cetté femeridè-ëft ürii?
qué; oblongue, pomme-allxIfeiix Bmits; &■ en quel?
que.manière applatie. Linnæi gen. plant, p.ao.
. POAILLIER f. nu (ivrmr * AbnAnr.) groflc p;ccè
. de cuivre , .dans laquelle porte le tourillon du Lom?
micsrdejla,cloche qui la tient fufpendiîe en l’air; delà
on a appelle par extenfion ou figurcment bihillicr
lecloeher d’un, églife. On a auffi appéllé'' autrefois
pouaituerla lifte, oir inventaire de tous Ièsbénëfi?
cep., de France y d où eft venu par coniiption lé iii’dt
de pouille des bénéfices..
POCATSJETTI, f. m. ( Botah. txot?) nom qûVii
donne dans LHortus maiabdricus, â;im petit arbrif-
feau du, Malabare. Les habitans emploient fés feuifles
pour deterger les ulcérés , & préparent Üfe ‘la racine'
ptilvérifée &.mêlée avec.de l’huile, ünonguerit pour
[ la gale. ( D. J .) .
. POCHE, POCHE-CUILLIER * v0ye{ P alette,
POCHE, f. £ en général fa c , ou fachet de toild
K K k k k