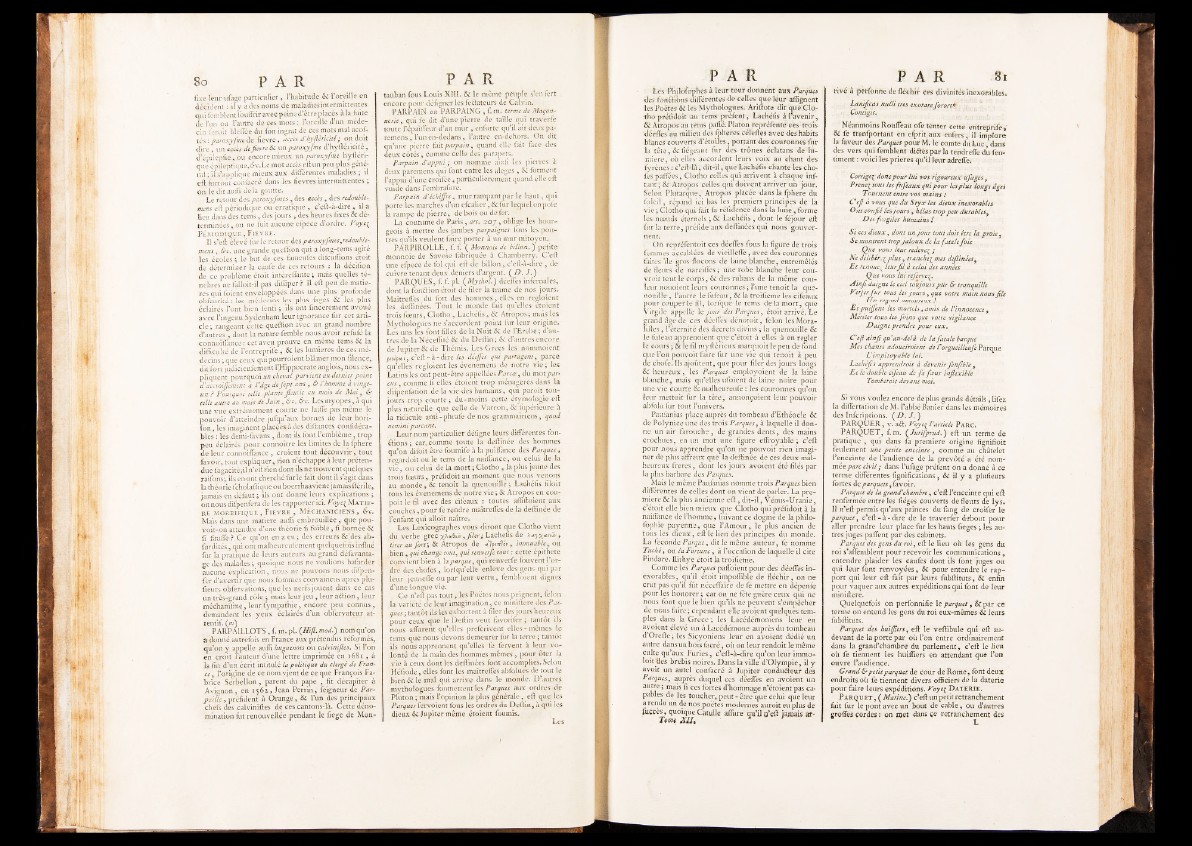
fixe leur ufage particulier, l’habitude & l’oreille en
décident : i f y a des noms de maladiesintermittentes
qui femblent fouffrir avec peine d’être placés à la fuite
de l’un ou l’autre de ces mots : l’oreille d’un médecin
i croit bleffée du fon ingrat de ces mots .mal acof-
tés: paroxyfme de fievre, accès d'kyfléricité ; on doit
dire , un accès de fievre & un paroxyfme d’hyftéiicité,
d’épilepfie, ou encore mieux un paroxyfme hyfteri-
que épileptique, &c.Le mot accès eftun peu plus général
; ils ’aoplique mieux aux différentes maladies ; il
eft furtôut coiïfacré dans les fievres intermittentes ;
on le dit aufïi de la goutte. .
Le retour des paroxyfmes , des accès, des redouble-_
mens eft périodique, ou erratique , c’eft-à-dire , il a
lieu dans des tems, des jours, d,es heures fixes & déterminées,
ou ne fuit aucune efpece d’ordre. Voye^
Périodique , Fievre.
Il s’eft élevé furie retour desparoxyfmts,redoublement
, &c. une grande queftion qui a long-tems agité
' les écoles. ; , le but de ces fameufes difeuffions étoit
de déterminer la caufe de ces retours : la décifion
de ce problème étoit intéreflante ; mais quelles ténèbres
ne fall oit-il pas difîiper ? Il eft peu de matières
qui foient enveloppees dans une plus profonde
obfcurité : les médecins les plus fiages & les plus
éclairés l’ont bien fenti ; ils ont fincerement avoue
avec l’ingenu Sydenham leur ignorance fur cet article
; rangeant cette queftion avec un grand nombre
d’autres , dont la nature femble nous avoir refuie la
connoiffance: cet aveu prouve en meme tems & la
difficulté de l’entreprife , fit les lumières de ces médecins
; que ceux qui pourroient blâmer mon filence,
dit fort judicieufement l’,Hippocrate anglois, nous expliquent
pourquoi un cheval parvient au dernier point
d'accroiïfiment a l ’âge de J’epl ans , & l'homme à vingt-
un ? Pourquoi tille plante fleurit au mois de Mai, &
telle autre au mois de Juin, &c. &c. Les myopes, à qui
une vue extrêmement courte ne laiffe pas meme le
pouvoir d’atteindre iufqu’aux bornes de leur hori-
fon , les imaginent placées à des diftances confidera-
bles : les demi-favans , dont ils font l’emblème, trop
peu éclairés pour connoître les limites de la fphere
de leur connoiffance , croient tout découvrir, tout
lavoir, tout expliquer, rien n’échappe à leur prétendue
fagacité;il n’eftrién dont ils ne trouvent quelques
raifons; ils en ont cherché fur le fait dont il s’agit dans
la théorie fcholaftique ouboerrhaaviene jamais ftérile,
jamais en défaut ; ils ont donné leurs explications ;
on nous difpenfera de les rapporter ici. Voye^ Matière
MORBIFIQUE , FlEVRE , MeCHANICIENS , &C.
Mais dans une matière auffi embrouillée , que pou-
yoit-on attendre d’une théorie fi foible, fi bornée fit
fi fauffe? Ce' qu’on en a eu ; des erreurs &'des ab-
furdités, qui.ont malheureufement quelquefois influé
fur la pratique de leurs auteurs au grand défavanta-
ge des malades ; quoique nous ne voulions hafarder
aucune explication, nous ne pouvons nous difpen-
fer d’avertir que nous fournies convaincus après plu-
iieurs obfervations, que les nerfs jouent dans ce cas
un très-grand rôle ; mais leur je u , leur aêiion, leur
méchanifme, leur fympathie, encore peu connus ,
demandent les yeux éclairés d’un obfervateur attentif.
(m)
PARPAILLOTS , f. m. pl. (Hifi. mod.) nom qu’on
a donné autrefois en France aux prétendus réformés,
qu’on y appelle aufïi huguenots ou calvinifles. Si l’on
en croit l’auteur d’une lettre imprimée en 1681 , à
la fin d’un écrit intitulé la politique du clergé de France
, l’origine de ce nom vient de ce que François Fabrice
Serbellon, parent du pape , fit décapiter à
Avignon, en 1562, Jean Perrin, feigneur de Par-
paille , préfident à Orange , fit l’un des. principaux
chefs des calviniftes de ces cantons-là. Cette dénomination
fut renouvellée pendant le fiege de Montaûban
fous Louis XIII. & le même peuple s’enfert
encore pour défigner les fe&ateurs de Calvin.
PARPAIN ou PARPAING , f. m: terme de Maçonnerie
, qui fe dit d’une pierre de taille qui traverfe
toute l’epaiffeur d’un mur , enforte qu’il ait deux pa-
remens, l’un en-dedans, l’autre en-dehors. On dit
qu’une pierre fait parpain, quand elle fait face des
deux côtés, comme celle des parapets.
Parpain d'appui; on nomme ainfi les pierres à
deux paremens qui font entre les aleges , fit forment
l’appui d’une croifée, particulièrement quand elle eft
vuide dans l’embrafure.
Parpain d'écliiffre, mur rampant par le haut, qui
porte les marches d’un efcalier, St fur lequel on pofe
la rampe de pierre, de bois ou de fer.
La coutume de Paris, art. 2 0 7 , oblige les bourgeois
à mettre des jambes parpaignes fous les poutres
qu’ils veulent faire porter à un mur mitoyen.
PARPIROLLE, f. f. ( Monnoie de billon. ) petite
monnoie de Savoie fabriquée à Chamberry. C’eft
une efpece de fol qui eft de billon, c’eft-à-dire , de
cuivre tenant deux deniers d’argent. (D . J .)
PARQUES, f. f. pl. ( Mythol.) déeffes infernales,
dont la fonftion étoit de filer la trame de nos jours,
Maîtreffes du fort des hommes., elles en regloient
les deftinées. Tout le monde fait qu’elles etoient
trois foeurs, Clotho, Lachéfis, fit Atropos; maisÇles
Mythologues ne s’accordent point fur leur origine.
Les uns les font filles de la Nuit fit de l’Erebe ; d’autres
de la Nécefîité.St du Deftin; St d’autres encore
de Jupiter 8t de Thémis. Les Grecs les nomfnoient
/xotpa 1, ç’eft-à -d ire les déeffes qui partagent, parce
qu’ elles regloient les évenemens de notre vie ; les
Latins les ont peut-être appellées P area, du mot par-
eus, comme fi elles étoient trop ménagères dans la
difpenfation de la vie des humains, qui paroît toujours
trop courte; du-moins cette étymologie eft
plus naturelle que celle de Varron, St fupérieüre à
la ridicule anti-phrafe de nos grammairiens, quod
nemini parcant.
Leur nom particulier défigne leurs différentes fondions
; car. comme toute la deftinée des hommes
qu’on difoit être foumife à la puiffance des Parques ,
re^ardoit ou le tems de la naiffance, ou celui de. la
v ie , ou celui de la mort ; C lotho, la plus jeune des
trois foeurs, préfidoit au moment que nous venons
au monde, St tenoit la quenouille ; Laohéfis filoit
tous les évenemens de notre vie ; & Atropos en cou-
poit le fil avec .des cifeaux : toutes afliftoient aux
.couches, pour fe rendre maîtreffes de la deftinée de
l’enfant qui alloit naître.
Les Lexicographes vous diront que Clotho vient
du verbe grec x\a(it7v, filer ; Lachéfis de \clyx<lvuv ,
tirer au fort; & Atropos de aîpewfoV, immuable, ou
bien, qui change tout, qui renverfe tout : cette epithete
convient bien à la parque, qui renverfe fouvent l’ordre
des chofes , lorfqu’elle enleve des gens qui par
leur jeuneffe ou par leur vertu, fembloient dignes
d’une longue vie.
Ce n’eft pas tout., les Poètes nous peignent, félon
la variété de leur imagination, ce miniftere des Parques
; tantôt ils les exhortent à filer des jours heureux
pour ceux que le Deftin veut favorifer ; tantôt ils
nous affurent qu’elles preferivent elles-mêmes le
tems que nous devons demeurer fur là terre ; tantôt
ils nous apprennent qu’elles fe fervent à leur volonté
de la main des hommes mêmes, pour ôter la
vie à ceux dont les deftinées font accomplies. Selon
Héfiode, elles font les maîtreffes abfolues de tout le
bien St le mal qui arrive dans le monde. D ’autres
mythologues foumettent les Parques aux ordres de
Pluton ; mais l’opinion la plus générale, eft que les
Parques fervôient fous les ordres du Deftin, à qui les
dieux fit Jupiter même étoient fournis.
Lés Philosophes à leur tout donnétit aux Parques
'des fon&îbns différentes-de celles que leur-aflîgnént
les Poët-ès fit lés Mythologues* Ariftote dit què'Clor
-tho préfidoit ail tems préfent, > Lachéfis à■ l’av'ehir,
&AtrôpÔs âiitëhis pafle. Platon repréfentë eès trôïs
déeflès au milieu des fpheres célëftes avec des habits
blancs couverts d’étoilés, portant des couronnes fur
la tête, & fiégeant fur des trônes éclatans de lumière,
oii elles accordent leurs voix au chant des
fyrênes : c’eft-là, dit-il, que Lachéfis chante les chofes
paffées, Clotho celles qui arrivent à chaque inf-
tant Atropos celles qüi doivent arriver un jour.
Selon Plutarque, Atropos placée dans la fphere du
foleil, répand ici bas les premiers principes de la
vie ; Clotho qui fait fa réfidence dans la lune, forme
les noeuds éternels ; & Lachéfis , dont lè féjour eft
fur la terre, préfide aux deftinées qui nous gouvernent;
On rëpréfentoit ces déeffes fous la figtire de trois
femmes accablées de vieilleffe, avec des couronnes
faites ’de gros flocons dé laine blanche, entremêlés
de fleurs de narcifles ; une robe blanche leur cou-
vroit tout le corps, & des rubans de la même couleur
nouoient leurs couronnes ; l’une tenoit la quenouille
, l’autre le fufeau, & la troifieme les cifeaux
pour couper le fil, lorfque le tems de la m ort, que
Virgile appelle le jour des Parques, étoit arrivé. Le
grand âge de ces déeffes dénotoit, félon les Mora-
liftes, l’éternité des decrets divins ; la quenouille &
le fufeau apprenoient que c’étoit à elles à en regler
le cours ; & le fil myftérieux marquoit le peu de fond
que l’on pouvoit faire fur une vie qui tenoit à peu
de chofe. Ils ajoutent, que pour filer des jours longs
&: heureux, les Parques employoient de la laine
blanche, mais qu’elles ufoient de laine noire pour
Une v ie Courte & malheureufe : les couronnes qu’on
leur niettoit fur la tête, annonçoient leur pouvoir
abfolu fur tout l’univer$;
Paufanias place auprès du tombeau d’Ethéocle &
de Polynice une des trois Parques, à laquelle il donne
un air farouche, de grandes dents, des mains
crochues, en lin mot une figure effroyable ; c’eft
pour nous apprendre qu’on ne pouvoit rien imaginer
de plus affreux que la deftinée de ces deux malheureux
freres, dont les jours avoient été filés par
la plus barbare des Parques.
Mais le même Paufanias nomme trois Parques bien
differentes de celles dont on vient de parler. La première
& la plus ancienne e ft , dit-il, Vénus-Uranie,
c’étoit elle bien mieux que Clotho qui préfidoit à la
naiffanêe de l’homme, fuivant ce dogme de la philo-
fophie payenne, que l’Amour, le plus ancien de
tous les dieux, eft le lien des principes du monde.
La fécondé Parque, dit le même auteur, fe nomme
Taché, ou lu Fortune , à l’occafion de laquelle il cite
Pindare, Ilithye étoit la troifieme.
Comme les Parques pafloient pour des déeffes inexorables
, qu’il étoit impoflible de fléchir, on ne
crut pas qu’il fut néçeffaire de fe mettre en dépenfe
pour les honorer ; car oh ne fête guère ceux qui ne
nous font que le bien qu’ils ne peuvent s’empêcher
de nous faire ; cependant elle avoient quelques temples
dans la Grece ; les Lacédémoniens leur en
avoient élevé un à Lacédémone auprès du tombeau
d’Orefte; les Sicyoniens leur en avoient dédié un
autre dans un bois facré, oii on leur rendoit le même
culte qu’aux Furies, c’eft-à-dire qu’on leur immo-
loit fles brebis noires. Dans la ville d’Olympie, il y
avoit un autel confacré à Jupiter condufteur de9
Parques, auprès duquel ces déeffes en avoient un
autre ; mais fi ces fortes d’hommage n’étoient pas capables
de les toucher, peut-être que celui que leur
a rendu un de nos poètes modernes auroit eu plus de
fucces, quoique Catulle affure qu’il o’eft jamais ar-
Tom« X U %
rivé â pèrfohhe de fléchir Ces divinités inexorables*
Lanificas nitlli très exoraf.eJororefi .
; Contigu.
Néanmoins Roiifféait o fe tënter cetté ëntréprife i
& fe ttanfportant en efprit,aux enfers ,-il implore
j la faveur des Parqiies pour M. le comte dii Liic-, dans
! des vers qui femblent diôës par la tendréffe du fen-
timent : voici les prières qu’il leur adreffe.
Corrigeç donc pour lui vos rigoilreüx üfagés,
P rene^toUs les fufeaux qui pour les plus longs âges
Tournent entre vos mains :
C’efl à vous que du Styx les dieux inexorables
Ont confié les jours ; hélds trop peu durables,
Dès fragiles humains !
Si ces dieux, dont un jour tout doit être la proie a
Se montrent trop jaloux de la fatale foie
Q_ue vous leur redeve{ ;
Ne délibér:^ plustranche^ mes deflinées.
Et renoue{ leur f il a celui des années
Que vous lui referve^.
Ainfl daigne le ciel toujours ptir & trahqUiltè
V ’.rjèrfur tous les jours, que votre main nous file
Un regard amoureux. I■
Et puijfent les mortels,, amis de l’innocence,
Mériter tous les foins que votre vigilance
Daigne prendre pour eux.
C efl ainfl qu au-delà de la fatale barquè
Mes chants adouciroient de Corgueilleufe Parque
L'impitoyable loti
Lachéfis apprendroit à devenir fenfiblé ,
Ee le double cifeau de fa fleur inflexible
Tomberoit devant mou
Si vous voulez encore déplus grands détails ,lifez
la differtation de M. l’abbé Banier dans les mémoires
des Infcriptions. (Z>. /. )
PARQUER, v. a£h Voye^Varticle Parc.
PARQUET, f. m. ( Jurifprud. ) eft m terme de
pratique , qui dans fa première origine fignifioit
feulement une petite enceinte, comme au châtelet
l’enceinte de l’audience de la prévôté a été nommée
parc civil; dans l’ufage préfent on a donné à ce
terme différentes lignifications, fie il y a plufieurs
fortes <ie parquets, favoir.
Parquet de la grand’chambre, c’eft l’enceinte qui eft
renfermée entre les fiéges Couverts de fleurs de lys.
Il n’eft permis qu’aux princes du fang de croifer le
parquet, c’eft - à - dire de le traverfer debout pour
aller prendre leur place fur les hauts fieges ; les autres
juges paffent par des cabinets.
Parquet des gens du roi, eft le lieu oîi les gens du
roi s’affemblent pour recevoir les communications ,
entendre plaider les caufes dont ils font juges ou
qui leur font renvoyées, &c pour entendre le rapport
qui leur eft fait par leurs fubftituts, fie enfin
pour vaquer aux autres expéditions qui font de leur
miniftere.
Quelquefois on perfonnifie le parquet, & par ce
terme on entend les gens du roi eux-mêmes fie leurs
fubftituts.
Parquet des hui (fiers, eft le veftibule qui eft au-
devant de la porte par où l’on entre ordinairement
dans la grand’chambre du parlement, c’eft le lieu
où fe tiennent les huiffiers en attendant que l’on
ouvre l’audience.
Grand & petit parquet de Coilr de Rome, font deux
endroits où fe tiennent divers officiers de la daterie
pour faire leurs expéditions. Voye^ DaterIe.
Parqu et , ( Marine.') c’eft un petit retranchement
fait fur le pont avec un bout de cable, ou d’autres
groffes cordes ; on met dans çe retranchement des
L