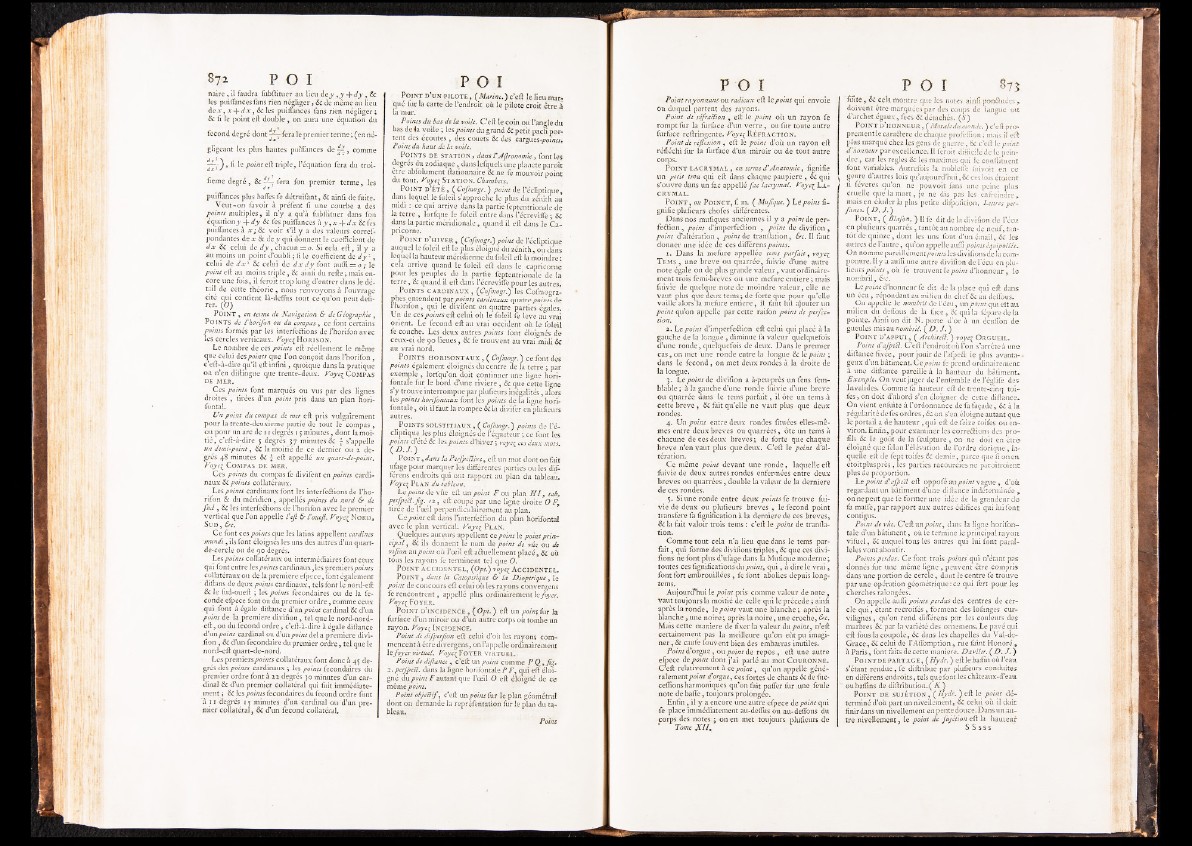
naire , il faudra fubftituer au lieu d e y ,y + d y , &
les puiflances fans rien négliger, & de même au lieu
d e * , x + d x , & le s puiflances fans rien négliger;
6c fl le point eft double , on aura une équation du
fécond degré dont fera le premier terme ; (en négligeant
les plus hautes pmffances de ~ , comme
? 11 le point eft triple, l’équation fera du troi-
fieme degré, 6c fera fon premier terme, lgs
puiflances plus baffes fe détruifant, 6c ainfl de fuite.
Veut-on favoir à préfent fi une courbe a des
points multiples, il n’y a qu’à fubftituer dans fon
équation y -f- dy 6c fes puiflances à y , x -{- d x 6c fës
puiflances à x ; 6c voir s’il y a des valeurs correfr
pondantes de x & d e y qui donnent le coefficient de
d x 6c celui de d y , chacun = o. Si cela eft , il y a
au moins un point d’oubli ; fi le coefficient de d y 1 ,
celui de d x 1 6c celui de d x dy font aufli = 03 le
point eft au moins triple, & ainli du refte ; mais encore
une fois, il feroit trop long d’entrer dans le détail
de cette théorie, nous renvoyons à l’ouvrage
cité qui contient là-deffus tout ce qu’on peut défi-
rer. (O)
POINT , en terme de Navigation & de Géographie ,
P o in t s de Vhorifon ou du compas, ce font certains
points formés par les interférions de l’horifon avec
les cercles verticaux, Foye{ Ho r is o n .
Le nombre de ces points eft réellement le même
que celui des points que l’on conçoit dans l’horifon,
c’eft-à-dire qu’il eft infini, quoique dans la pratique
on n’en diftingue que trente-deux. Voyeç C om p a s
DE MER.
Ces points font marqués ou vus par des lignes
droites , tirées d’un point pris dans un plan hori-
fontal.
Un point du compas de mer eft pris vulgairement
pour la trente-deuxieme partie de tout le compas ,
ou pour un arc de 11 degrés i 5 minutes, dont la moitié,
c’eft-à-dire 5 degres 37 minutes 6c f s’appelle
un demi-point, 6c la moitié de ce dernier ou 2 degrés
48 minutes & { eft appellé un quart-de-point.
Foye{ C o m p a s d e m e r .
Ces points du compas fe divifent en points cardinaux
6c points collatéraux.
Les points cardinaux font les interférions de l’horifon
& du méridien , appellés points du nord & de
fu d , 6c les interfeftions de l’horifon avec le premier
vertical que l’on appelle l’ejl & l'oueji. Foye^ N o rd ,
Su d , &c.
Ce font ces points que les latins appellent cardines
mundi, ils font éloignes les uns des autres d’un quart-
de-cercle ou de 90 degrés.
Les points collatéraux ou intermédiaires font ceux
qui font entre les points cardinaux, les premiers points
collatéraux ou de la première efpece, font également
• diftans de deux points cardinaux, tels font le nord-eft
& le fud-oueft ; lés points fecondaires ou de la fécondé
efpece font ou du premier ordre, comme ceux
.qui font à égalé diftance d’un point cardinal 6c d’un
point de la première divifion, tel que le nord-nord-
eft, ou du fécond ordre, c’eft-à-dire à égale diftance
d’un point cardinal ou d’un point del a première division
, 6c d’un fecondaire du premier ordre, tel que le
nord-eft quart-de-nord.
Les premiers points collatéraux font donc à 45 degrés
des points cardinaux ; les points fecondaires du
premier ordre font à 22 degrés 30 minutes d’un cardinal
6c d’un premier collatéral qui fuit immédiatement
; 6c les points fecondaires du fécond ordre font
à 11 degrés 15 minutes d’un cardinal ou d’un premier
collatéral, & d’un fécond collatéral.
P o in t d ’ u n p i l o t e , ( Marine. ) c’eft le lieu marqué
fur la carte de l’endroit où le pilote croit être à
la mer.
P oints du bas de la voile. C’eft le coin ou l’angle du
bas de 4a voiie ; les points du grand & petit pacfî portent
des écoutes , des couets & des cargues-/>o//z«.
Point du haut de la voile.
P o i n t s d e s t a t i o n , dans VAflronomie, fo n t les
d e g r e s du z o d ia q u e , dans le fq u e ls u n e p lan e te p a ro ît
ê t r e a b fo lum en t fta t io n n a ire 6c n e fe m o u v o i r p o in t
d u to u t . Foye[ STA T ION . Chambers,
P o i n t d ’ é t é , ( Cofmogr. ) point de l’écliptique,
dans lequel le l'oleil s’approche le plus du zénith au
midi : ce qui arrive dans la partie feptentrionale dç
la terre , lorfque le foleil entre dans l’écreviflé ; 6c
.dans la partie méridionale, quand il eft dans le Capricorne.
P o i n t d ’ h i v e r , (Cofmogr.) point de l’écliptique
auquel le foleil eft le plus éloigné du zénith, ou dans
lequel la hauteur méridienne du foleil eft la moindre :
cela arrive quand le foleil eft dans le capricorne
pour les peuples de la partie feptentrionalé de la
terre, 6c quand il eft dans l’écreviffe pour les autres.
P o in t s c a r d i n a u x , (Cofmogr.) les Cofmogra-
phes entendent par points cardinaux quatre points de
l’horifon, qui le divifent en quatre parties égales.
Un de ces points eft celui oii le foleil fe leve au vrai
orient. Le fécond eft au vrai occident où le foleil
fe couche. Les deux autres points font éloignés de
ceux-ci de 90 lieues, & fe trouvent au vrai midi 6c
au vrai nord.
P o i n t s h o r i z o n t a u x , ( Cofmogr. ) ce font des
points également éloignés du centre de la terre ; par
exemple , lorfqu’on doit continuer une liane horir
fontale fur le bord d’une riviere , 6c que cette ligne
. s’y trouve interrompue par plufieurs inégalités, alors
les points horifontaux font les points de la ligne hori-
fontale, où il faut la rompre 6c la divifer en plufieurs
autres.
P o in t s s o l s t i t i a u x , ( Cofmogr. ) points de l’écliptique
les plus éloignés de l’équateur ; ce font les
points d’été 6c les points d’hiver ; voye? ces deux mots.
( d . j . )
P o i n t , dans la Perfpeclive, eft un mot dont on fait
ufage pour marquer les différentes parties ou les dif-
férens endroits qui ont rapport au plan, du tableau.
Foye[ P l a n du tableau.
Le point de vûe eft un point F ou plan H I , tab.
perfpecl. fig. 12, eft coupé par une ligne droite O F9
tirée de l’oeil perpendiculairement au plan.
Ce point eft dans l’interfe&ion du plan horifontal
avec le plan vertical. Foye{ P l a n .
Quelques auteurs appellent ce point le point principal
, & ils donnent le nom de point de vue ou de
vijîon au point où l’oeil eft actuellement placé, 6c où
tous les rayons fe terminent tel que O.
P o i n t a c c i d e n t e l , (Opt.) voye^ A c c i d e n t e l .
P o i n t , dans la Catoptrique & la Dioptrique, le
point de concours eft celui où les rayons éonvergens
fe rencontrënt, appellé plus ordinairement le foyer.
Foye[ F o y e r .
P o i n t d ’i n c i d e n c e , ( Opt.') eft u n poin$fur la
furface d’un miroir ou d’uh autre corps où tombe un
rayon. Foyei I n c id e n c e .
Point de difperjion eft celui d’où les rayons commencent
à être divergens , on l’appelle ordinairement
le foyer virtuel. Foye{ F O YER v i r t u e l . .
Point de diflance , c’eft un point comme P Q , fig.
2. perfpecl. dans la lign e -h o rifo n ta le P F , q u i e ft é lo ig
n é du point F au tan t q u e l’oe i l O e ft é lo ig n é de ce
m êm çboint.
Point objectif, 'c’eft un point fur le plan géométral
dont on demande la repréfentation fur le plan du ta-,
bleau.
Point
Point rayonnant ou radieux eft le point qui envoie
ou duquel partent des rayons.
Point de réfraction , eft le point o ù un ra y on fe
rompt fur la furface d’un v e r r e , ou fur toute autre
furface reftringente. Foye^ R é f r a c t io n .
Point de réflexion, eft le point d’où un rayon eft
réfléchi fur la furface d’un miroir ou de tout autre
corps.
P o in t l a c r y m a l , en terme dé Anatomie, fignifie
un petit trou qui eft dans chaque paupière , 6c qui
s’ouvre dans un fac appellé fac lacrymal. F?ye£ L a c
r y m a l .
Po in t , ou Po in c t , f. m. ( Mufique. ) Le point fignifie
plufieurs chofes différentes.
Dans nos mufiques anciennes il y a point de perfection
, point d’imperfection , point de divifion,
point d’altération , point de tranflation, &c. Il faut
donner une idée de ces différens points.
1. Dans la mefure appellée tems parfait, voye^
T ems , une breve ou quarrée, fuivie d’une autre
note égale ou de plus grande valeur, vaut ordinairement
trois femi-breves ou une mefure entière ; mais
fuivie de quelque note de moindre valeur, elle ne
vaut plus que deux tems ; de forte que pour qu’elle
vaille alors la mefure entière, il faut lui ajouter un
point qu’on appelle par cette raifon point de perfection.
2. Le point d’imperfeftion eft celui qui placé à la
gauche de la longue, diminue fa valeur quelquefois
d’une ronde, quelquefois de deux. Dans le premier
cas, on met une ronde entre la longue 6c le point ;
dans le fécond, on met deux rondes à la droite de
la longue.
3. Le point de divifion a à-peu près un fens fem-
blable ; à la gauche d’une ronde fuivie d’une breve
ou quarrée dans le tems parfait, il ôte un tems à
cette b reve, 6c fait qu’elle ne vaut plus que deux
rondes.
4. Un point entre deux rondes fituées elles-mêmes
entre deux brèves ou quarrées, ôte un tems à
chacune de ces deux brèves ; de forte que chaque
breve n’en vaut plus que deux. C’eft le point d’altération.
Ce même point devant une ronde, laquelle eft
fuivie de deux autres rondes enfermées entre deux
brèves ou quarrées, double la valeur de la derniere
de ces rondes.
5. Si une ronde entre deux points fe trouve fuivie
de deux ou plufieurs brèves , le fécond point
transféré fa lignification à la derniere de ces brèves,
6c la fait valoir trois tems : c’eft le point de tranflation.
Comme tout cela n’a lieu que dans le tems parfait
, qui forme des divifions triples, 6c que ces divi-
fions ne font plus d’ufage dans la Mufique moderne ;
toutes ces lignifications du point, q u i, à dire le v ra i,
font fort embrouillées , fe font abolies depuis long-
tems.
Aujourd’hui le point pris comme valeur de note ,
vaut toujours la moitié de celle qui le précédé ; ainli
après la ronde, le point vaut une blanche ; après la
blanche, une noire ; après la noire, une croche, &c.
Mais cette maniéré de fixer la valeur du point, n’eft
certainement pas la meilleure qu’on eût pu imaginer,
& caufe fouvent bien des embarras inutiles.
Point d’orgue, ou point de repos , eft une autre
efpece de point dont j’ai parlé au mot C o u r o n n e .
C’eft relativement à ce point, qu’on appelle généralement
point d'orgue, ces fortes de chants & de fuc-
ceflions harmoniques qu’on fait paffer fur une feule
note de baffe, toujours prolongée.
Enfin, il y a encore une autre efpece de point qui
fe place immédiatement au-deffus ou au-deffous du
corps des notes ; on çn met toujours plufieurs de
Tome NU*
IM Ig ? & ^ c é la m o n tr e q u e le s no te s a in fl p o n & u é e s ,
d o iv e n t ê tre m a rq u é e s p a r d e s co u p s d e lan g u e o u
d’a r c h e t é g a u x , fe c s 6c d é ta ch é s . (S)
P o i n t d ’h o n n e u r , (Morale du monde. ) c’eft pro*
prementle caractère de chaque profefîion ; mais il eft
plus marqué chez les gens de guerre, 6c c’eft le point
d'honneur par excellence. Il feroit difficile’ de le peindre
, car les réglés 6c les maximes qui le conftituent
font variables. Autrefois la nobleü'e fuivoit en ce
y genre d’autres lois qu’aujourd’hui, 6c ces lois étaient
1 fi féveres qu’on ne pouvoit fans une peine plus
cruelle que la mort, je ne dis pas les enfreindre ,
mais en éluder la plus petite difpofition. Lettres per-
fana. (D . J .) ^ r
P o i n t , ( Blafon. ) Il fe d it de la d iv i f io n d e l’ é c u
e n p lu fie u r s 'q u a r r é s , t a n tô t au n om b re d e n e u f , tan t
ô t d e q u in z e , d o n t le s u n s fo n t d’u n ém a i l, 6c le s
a u t r e s d e l ’a u t r e , q u ’ o n a p p e lle au flï points èquipollés.
O n n om m e pareillemen t/ 'o/ /z ;sles d iv ifio n s d e la com -
p o n u r e . I l y a au fli u n e a u t r e d iv i f io n d e l ’é c u en p lu fieu
r s points, où f e t ro u v e n t l e point d’h o n n e u r , le
n om b r i l , &c.
Le point' d’honneur fe dit de la place qui eft dans
un écu , répondant au milieu du chef & au deffous.
On appelle le nombril de l’éeu, un point qui eft au'
milieu du deffous de la t à c e , 6c qui la fépare de la
pointe. Ainfl on dit N. porte d’or à un écuffon de
gueules mis au nombril. (D . J .)
P o i n t d ’ a p p u i ,, ( Arckitecl. ) voye1 O r g u e i l .
Point déafpccl. C ’eft l’endroit où l’on s’arrête à une
diftance fixée, pour jouir de l’afpeél le plus avanta-
geux d’un bâtiment. Ce point fe prend ordinairement
à une diftance pareille à la hauteur du bâtiment.
Exemple. On veut juger de l’enfemble de l’églife des
Invalides. Comme fa hauteur eft de trente-cinq toi-
fes, on doit d’abord s’en éloigner de cette diftance.
On vient enfuite à l’ordonnance de fa façade, 6c à la
régularité de fes ordres, 6c on s’en éloigne autant que
le portail a de hauteur , qui eft de feize toifes ou environ.
Enfin, pour examiner les correélions des profils
6c le goût de la fculpture , on ne doit en être
éloigné que félon l’élévation de l’ordre dorique, laquelle
eft de fept toifes 6c demie, parce que fi on en
étoit plus près , les parties racourciesne paroîtroient
plus de proportion.
Le point d'afpect eft oppofé au point vague , d’où
regardant un bâtiment d’une diftance indéterminée T
on ne peut que fe former une idée de la grandeur de
fa malle, par rapport aux autres édifices qui lui font
contigus.
Point de vûe. C’eft un point, dans la ligne horifon-
tale d’un bâtiment, où fe termine le principal rayon
vifuel, & auquel tous les autres qui lui font parallèles
vont aboutir.
Points perdus. Ce font trois points qui n’étant pas
donnés fur une même ligne , peuvent être compris
dans une portion de cercle, dont le centre fe trouve
par une opération géométrique : ce qui fort pour les
cherches râlongées.
On appelle aufli points perdus des centres de cercle
q ui, étant recroifés, forment des lofanges curvilignes
, qu’on rend différens par les couleurs des
marbres 6c par la variété des ornemens. Le pavé qui
eft fous la coupole, 6c dans les chapelles du Val-de-
Grace, 6c celui de l’Affomption, rue faint Honoré ,
à Paris, font faits de cette maniéré. Daviler. (D . J .)
P o i n t d e p a r t a g e , (Hydr.) eftlebaflînoùl’eau
s’étant rendue , fe diftribue par plufieurs conduites
en différens endroits, tels que font les châteaux-d’eau
oubaflins de diftribution. ( K )
P o i n t d e s u j é t i o n , ( Hydr. ) eft le point déterminé
d’où part un nivellement, 6c celui où il doit
finir dans un nivellement en pente douce. Dans un autre
nivellement, le point de fujêtion eft la hauteur
S S sss