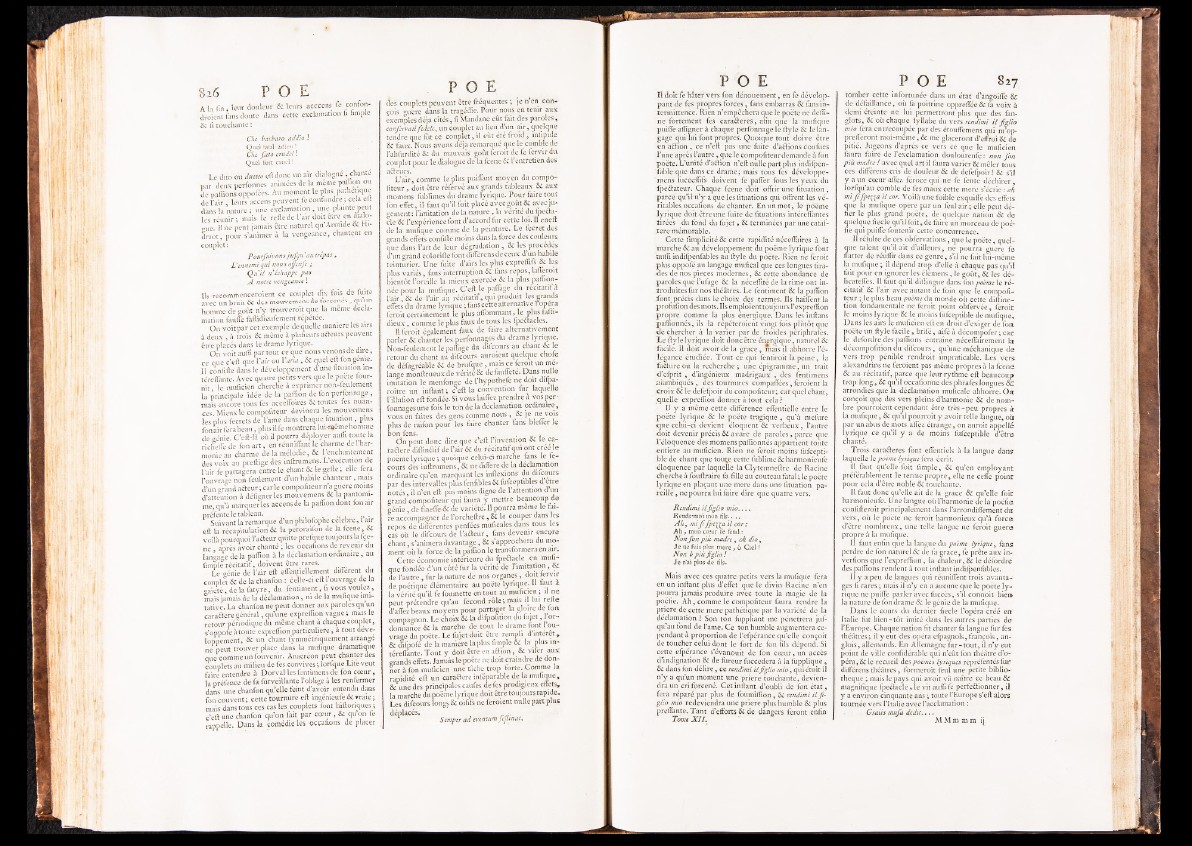
A la fin, leur douleur & leurs acccens fe ccinfon- ’
droient fans doute dans cette exclamation fi fimple
& ii touchante :
Clic barbaro addio !
Quel fatal adieu !
Chc fato crudd !
Quel fort cruel !
Le duo ou iuetto eftdonc un air dialogue chanté
par deux nerfonncs animées de la même paffion ou :
de paffions oppofées. Au moment le plus pathétique ,
de l’air leurs accens peuvent fe confondre ; cela eit
dans la nature; une exclamation, une plainte peut
les réunir; mais le refte de l'air doit être en dlalo- -
eue. Il ne peut jamais être naturel qu Armicle oc rii-
draot, pour s’animer à la vengeance, chantent en
couplet :
Pourfuivons jufquau trépas ,
L'ennemi qui nous ojfenfe ;
Qu'il n'échappe pas
A notre vengeance !
Ils recommenceroient ce couplet dix fois^ de fuite
avec un bruit & des mouvemens de forcenés, qu’un
homme de goût n’y trouverait que la même déclamation
fauffe faffidieufemeniïépétée.
On voitpar cet exemple de quelle manière les airs
à deux , à trois & même à pluheurs a&eurs peuvent
être placés dans le drame lyrique.
On voit auffi par tout ce que nous venons de dire,
ce que c’eft que l'air ou Varia, & quel eft fon genre.
Il confifte dans le développement d’une fituation m-
téreffante. Avec quatre petits vers que le poete fournit
le muficien cherche à exprimer non-feulement
la principale idée de la paffion de fon perfonnage ,
mais encore tous fës acceffoires & toutes fes nuances.
Mieux le compofiteur devinera les mouvemens
les plus fecrets de l ’a in e dans chaque fituation, plus
fon air fera beau, plus il fe montrera lui-nȐme homme
de génie. C’eft-là oiiil pourra déployer auffi toute la
richeffie de fon art, en réunifiant le charme de l’harmonie
au charmé de la mélodie, & l ’enchantement
des voix au preftige des inftrumens. L’exécution de
l ’air fe partagera entre le chant & le gefte; elle fera
l’ouvrage non-feulement d’un habile chanteur, mais
d’un grand acteur; carie compofiteur n’a gueremoins
d’attention à défigner les mouvemens & la pantomime,
qu’à marquer les accens de la paffion dont fon air
préfente le tableau.
Suivant la remarque d’un philofophe célébré, 1 air
eft la récapitulation & la peroraifon de la feene, &
voilà pourquoi l’a&eur quitte prefque toujours lafçe-
ne après avoir chanté ; les OCCalions de revenir du
lan*a*e delà paffion à la déclamation ordinaire, au
fimpl?récitatif, doivent être rares.
Le génie de l’air eft effeptiellement different du
couplet & de la chanfon : celle-ci eft l’ouvrage de la
gaieté, de la fatyre, du fentiment, fi vous voulez,
mais jamais de la déclamation, ni de la mufique imitative.
La chanfon ne peut donner aux paroles qu un
cara&ere général, qu’une expreffion vague ; mais le
retour périodique du même chant à chaque couplet,
s’oppofeàtoute expreffion particulière, à tout développement,
&c un chant fymmétriquement arrange
ne peut trouver place dans la mufique dramatique
que comme un fouvenir. Anacréon peut chanter des
couplets au milieu de fes convives ; lorfque Life veut
faire entendre à Dorval les fentimens de fon coeur,
la préfence dé fà furveillante l’oblige à les renfermer
dans une chanfon qu’elle feint d’avoir entendu dans
fon couvent; cette tournure eft ingénieufe&vraie;
mais dans tous ces cas les couplets font hiftoriques ;
c’eft une chanfon qu’on fait par coeur, & qu’on fe
rappelle. Dans la comédie les occaftons de placer
des couplets peuvent être fréquentes ; je n en conçois
guere dans la tragédie. Pour nous en tenir aux
exemples déjà cités, fi Mandane eût fait des paroles,
confervatifedele, un couplet au lieu d’un air, quelque
tendre que fût ce couplet, il eût été froid, infipide
& faux. Nous avons déjà remarqué que le comble de
l’abfurdité & du mauvais goût feroit de fe fervir dit
couplet pour le dialogue de la feene ô£ 1 entretien des
aCteurs.
L’air, comme le plus puiflant moyen du compofiteur
, doit être réfervé aux grands tableaux^ & aux
momens fublimes du drame lyrique. Pour faite tout
fon effet, il faut qu’il foit placé avec goût & avec jugement:
l’imitation de la nature, la vérité du fpeCta-
cle & l’expérience font d’accord fur cette loi. Il eneft
de la mufique comme de là peinture. Le fecref des
grands effets confifte moins dans la force des couleurs
que dans l’art de leur dégradation, & les procédés
d’un grand coloriftefont différens de ceux d’un habile
teinturier. Une fuite d’airs les plus expreffifs & les
plus variés, fans interruption & fans repos, lalleroit
bientôt l’oreille la mieux exercée & la plus paffion-
née pour la mufique. C’eft le paflage du récitatif à
l’a ir , & de l’air au récitatif, qui produit les grands
effets du drame lyrique ; fans cette alternative 1 opéra,
fer oit certainement le plus aflommant, le plusfalti-
dieux, comme le plus faux de tous les fpeftacles.
Il feroit également faux de faire alternativement
parler & chanter les perfonnages du drame lyrique.
Non-feulement le paflage du difeours au chant ot le
retour du chant au difeours auroient quelque choie
de défagréable & de brufque , mais ce feroit un mélangé
monftrueux de vérité & defauffete. Dans nulle
imitation le menfonge de l’hypothefe ne doit difpa-
roître un inftant ; c’eft la convention fur laquelle
l’illufion eft fondée. Si vous laiffez prendre à vos per-,
fonnagesune fois le ton de la déclamation ordinaire,
vous en faites des gens comme nous , &
plus de raifon pour les faire chanter fans blefler le
bon fens. S
Qn peut donc dire que c*eft l’invention &
rattere diftindif de l’air & du récitatif qui ont créé le
poëme lyrique ; quoique Celui-ci marche fans le fe-
cours des inftrumens, &£ ne différé de la déclamation
ordinaire qu’en marquant les inflexions du difeours
par des intervalles plus fenfibles & fufceptibles d être
notés, il n’ en eft- pas moins digne de l’attention d un
grand compofiteiir qui faura y mettre beaucoup de
aénie, de hnefle'& de variété. Il pourra meme, le faire
accompagner de l’orcheftre, & le couper dans les
repos de différentes penfées mufi cales dans tous les
cas où le difeours de l’afteur, fans devenir encore
chant s’animera davantage, & s’approchera du moment
où la force de la paffion le transformera en air.
Cette économie intérieure du fpeCtacle en mufique
fondée d’un côté fur la vérité de l’imitation, oc
de l’autre, fur la nature de nos organes, doit fervir
de poétique élémentaire au poete lyrique. Il faut à
la vérité qu’il fe foumette en tout au muficien ; il ne
peut prétendre qu’au fécond rôle ; mais il lui refte
d’affez beaux moyens pour partager la gloire de Ion
compagnon. Le choix & la difpofition du fujet, 1 ordonnance
& la marche de tout le drame font 1 ouvrage
du poete. Le fujet doit être rempli d’interet,
& difpofe de la maniéré la plus fimple & la plus m-
téreflante. Tout y doit être en aftion, & vifer aux
grands effets. Jamais le poète ne doit craindre de donner
à fon muficien une tâche trop forte. Comme la
rapidité eft un carattere inféparable de la mufique,
& une des principales caufes de fes prodigieux effets,
la marche du poëme lyrique doit être toujours rapide.
Les difeours longs & oififs ne feroient nulle part plus
déplacés. §H
* Semptr ad eventum fejlinat.
Il doit fe hâter vers fon dénouement, en fe développant
de fes propres forces, fans embarras & fans intermittence.
Rien n’empêchera que le poëte ne deffi-
ne fortement fes caraéteres, afin que la mufique
puifle affigner à chaque perfonnage le ftyle & le langage
qui lui font propres. Quoique tout doive être
en a d io n , ce n’eft pas ' une fuite d’a&ions coufiies
l ’une après l’autre, que le compofiteur demande à fon
poëte. L ’unité d’a&ion n’eft nulle part plus indifpen-
lable que dans ce drame ; mais tous fes développe-
mens fucceffifs doivent fe pafler fous les yeux du
fpedateur. Chaque fcèrie doit offrir une fituation,
parce qu’i l n’y a que les fituations qui offrent les véritables
occafions de chanter. En un mot, le poëme
lyrique doit être une fuite de fituations intérefiantes
tirées du fond du fujet, & terminées par une cataf-
lere mémorable.
Cette fimplicité & cette rapidité néceflaires à la
marche & au développement du poëme lyrique font
auffi indifpenfables au ftyle du poëte. Rien ne feroit
plus oppofé au langage mufical que ces longues tirades
de nos pièces modernes, & cette abondance de
paroles que l’ufage & la néceffité de la rime ont introduites
fur nos théâtres. Le fentiment &c la paffion
font précis dans le choix des termes. Ils haïflent la
profitfion des mots. Ils emploient toujours l’expreffion
propre comme la plus énergique. Dans les inftans
paffionnés, ils la repéteroient vingt fois plûtôt que
<le chercher à la varier par de froides périphrafes.
L e ftyle lyrique doit donc être énergique, naturel &
facile. Il doit avoir de la grâce, mais il abhorre l’élégance
étudiée. Tout ce qui fentiroit la peine, la
faéhire ou la recherche ; une épigramme, un trait
d ’efprit , d’ingénieux madrigaux , des fentimens
alambiqués , des tournures compafiees, feroient la
croix & le defefpoir du compofiteur; car quel chant,
quelle expreffion donner à tout cela ?
Il y a même cette différence eflentielle entre le
poëte lyrique &c le poëte tragique , qu’à mefure
que celui-ci devient éloquent & verbeux, l’autre
doit devenir précis & avare de paroles, parce que
l ’éloquence des momens paffionnés appartient toute
entière au muficien. Rien ne feroit moins fufceptible
de chant que toute cette fublime & harmonieufe
éloquence par laquelle la Clytemneftre de Racine
cherche à fouftraire fa fille au couteau fatal; le poëte
lyrique en plaçant une mere dans une fituation pareille
, ne pourra lui faire dire que quatre vers.
Rendimi ilfiglio mio. . . .
Rends-moi mon fils.. . . .
A h , mififpetfa il cor :
A h, mon coeur fe fend :
Non Jon più madré, oh dio
Je ne fuis plus mere, ô Ciel !
Non b più figlio !
Je n’ai plus de fils.
Mais avec ces quatre petits vers la mufique fera
en un inftant plus d’effet que le divin Racine n’en
pourra jamais produire avec toute la magie de la
poéfie. A h , comme le compofiteur faura rendre la
priere de cette mere pathétique par la variété de la
déclamation ! Son ton fuppliant me pénétrera juf-
qu’au fond de l’ame. C e ton humble augmentera cependant
à proportion de l’efpérance qu’elle conçoit
de toucher celui dont le fort de fon fils dépend. Si
cette efpérance s’évanouit de fon coeur, un accès
d’indignation & de fureur fuccedera à la fupplique,
& dans fon délire, ce rendimi il figlio mio, qui étoit il
n’y a qu’un moment une priere touchante, deviendra
un cri forcené. Cet inftant d’oubli de fon état,
fera réparé par plus de foumiffion, & rendimi il figlio
mio redeviendra une priere plus humble & plus
preflante. Tant d’efforts & de dangers feront enfin
Tome XIL
tomber cette infortunée dans un état d’angoifle &
de défaillance, où fa poitrine oppreflee & la voix à
demi éteinte ne lui permettront plus que des fan-
glots, & oii chaque fyllabe du vers rendimi i l figlio
mio fera entrecoupée par des étouffemens qui in’op-
prefleront moi-même, & me glaceront d’effroi & de
pitié. Jugeons d’après ce vers ce que le muficien
faura faire de l’exclamation douloureufe : non fon
put madré ! avec quel art il faura varier & mêler tous
ces différens cris de douleur & de defefpoir ! & s’il
y a un coeur afîez féroce qui ne fe fente déchirer ,
lorfqu’au comble de fes maux cette mere s’écrie : ah
mi Jifpe^a il cor. Voilà une foible exquifle des effets
que la mufique opéré par un feul air ; elle peut défier
le plus grand poëte, de quelque nation & de
quelque fiecle qu’il foit, de faire un morceau de poé-
ue qui puifle foutenir cette concurrence.
Il réfiilte de ces obfervations, que le poëte, quelque
talent qu’il ait d’ailleurs, ne pourra guere fe
flatter de réuffir dans ce genre, s’il ne fait lui-même
la mufique ; il dépend trop d’elle à chaque pas qu’il
fait pour en ignorer les élémens, le goût, & les dé-
licatefles. Il faut qu’il diftingue dans fon poëme le récitatif
& l’air avec autant de foin que le compofiteur
; le plus beau poëme du monde où cette diftinc-
tion fondamentale ne feroit point obfervée, feroit
le moins lyrique & le moins fufceptible de mufique.
Dans les airs le muficien eft en droit d’exiger de fon
poëte un ftyle facile, brifé, aifé à décompofer ; car
le defordre des paffions entraîne néceflairement la
décompofition du difeours, qu’une méchanique de
vers trop pénible rendroit impraticable. Les vers
alexandrins ne feroient pas même propres à la feene
& au récitatif, parce que leur rythme eft beaucoup
trop long, & qu’il occafionne des phrafes longues &C
arrondies que la déclamation muficale abhorre. Ou
conçoit que des vers pleins d’harmonie & de nombre
pourroient cependant être très-peu propres k
la mufique, & qu’il pourroit y avoir telle langue, où
par un abus de mots affez étrange, on auroit appelle
lyrique ce qu’il y a de moins fufceptible d’être
chanté.
Trois carafteres font eflentiels à la langue dans-
laquelle le poème lyrique fera écrit.
Il faut qu’elle foit fimple, & qu’en employant
préférablement le terme propre, elle ne ceffe point
pour cela d’être noble & touchante.
Il faut donc qu’elle ait de la grâce & qu’elle foie
harmonieufe. Une langue où l’harmonie de la poéfie
confifteroit principalement dans l’arrondiflement du
vers, où le poëte ne.feroit harmonieux qu’à force
d’être nombreux, une telle langue ne feroit guere
propre à la mufique.
Il faut enfin que la langue du poème lyrique, fans
perdre de fon naturel & de fa grâce, fe prête aux in-
verfions que l’expreffion, la chaleur, & le défordre
des paffions rendent à tout inftant indifpenfables.
Il y a peu de langues qui réunifient trois avantages
fi rares ; mais il n’y en a aucune que le poëte ly rique
ne puifle parler avec fuccès, s’il connoit bière
la nature de fon drame & le génie de la mufique.
Dans le cours du dernier fiecle l’opéra créé en
Italie fut bien - tôt imité dans les autres parties de
l’Europe. Chaque nation fit chanter fa langue fur fes
théâtres ; il y eut des opéra efpagnols, françois, an-
glois, allemands. En Allemagne lur-tout, il n’y eut
point de ville confidérable qui n’eût fon théâtre d’opéra,
& le recueil des poèmes lyriques repréfentés fur
différens théâtres, formeroit feul une petite bibliothèque
; mais le pays qui avoit vu naître ce beau &
magnifique fperiacle, le vit auffi fe perfectionner, il
y a environ cinquante ans ; toute l’Europe s’eft alors
tournée vers l’Italie avec l’acclamation :
Gratis rnufa dédit, . . .
M M m m m ij
• f