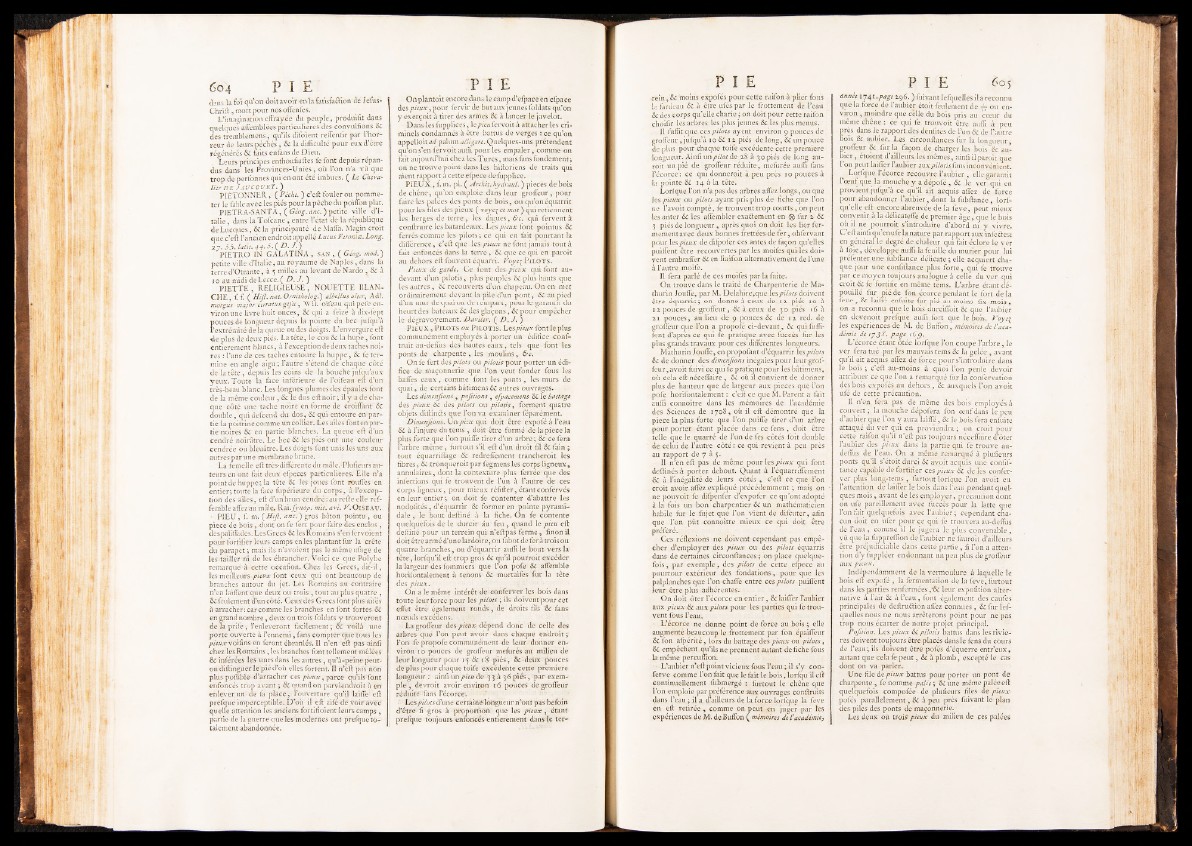
6 o 4 P I E
dans la fol qu’on doitavoiï enlafatisfaûion de îefus-
Chrift, mort pour nos offenfes.
L’imagination effrayée du peuple, produifit dans
quelques affemblées particulières des convullions 8c
des tremblemens, qu’ ils difoient reffentir par l’horreur
de leurs péchés, 8c la difficulté pour eux d’être
régénérés 8c faits enfans de Dieu.
Leurs principes enthoufiaftes fe font depuis répandus
dans les Provinces-Unies ; où l’on n’a vu que
trop-de perfonnes qui en ont été imbues. ( Le Chevallier
d e J AU c o u R T . )
PIÉTONNER, ( Pêche. ) c’eft fouler ou pommeler
le fable avec lespïés pour la pêche du poiffon plat.
PIETRA-SàN T A , ( Géog. anc. ) petite ville d’Italie
, dans la Tofcane , entre l’état de la république
deLucques, 8c la principauté de Maffa. Magin croit
que c’eft l’ancien endroit appellé Lucas Fer onia. Long. 27. 55. latit. 44.5. ( D. J. )
PIETRO IN GALATINA , s a n , ( Géog. mod.)
petite ville d’Italie, au royaume de Naples , dans la
terre d’Otrante, à 5 milles au levant de Nardo, 8c à
10 au midi deLecce. ( D. J. )
PIETTE , RELIGIEUSE, NOUETTE BLANCHE,
f. f. ( Hijl. nat. Ornitholog.) albellus al ter, Adl.
morgus major cirratus gefu , Wil. oifeau qui pefe environ
une livre huit onces, 8c qui a feize à dix-fept
pouces de longueur depuis la pointe du bec jufqu’à
l’extrémité delà queue ou des doigts. L’envergure eft
<le plus de deux pies. La tête, le cou 8c la hupe, font
entièrement blancs, à l’exception de deux taches noires
: l’une de ces taches entoure la huppe, 8c fe termine
en angle aigu ; l’autre s’étend de chaque côté
de la tê te , depuis les coins de la bouche jufqu’aux
yeux. Toute la face inférieure de l’oifeau eft d’un
très-beau blanc. Les longues plumes des épaules font
de la même couleur, 8c le dos eft noir ; il y a de chaque
côté une tache noire en forme de croiffant 8c
double, quidefcend du dos, & qui entoure ëmpartie
la poitrine comme un collier. Les ailes font en partie
noires 8c en partie blanches. La queue eft d’un
cendré noirâtre. Le bec 8c les piés ont une couleur
cendrée ou bleuâtre. Les doigts font unis les uns aux
autres par une membrane brune. -
La femelle eft très-différente du mâle.-Plufieurs auteurs
en ont fait deux efpeces particulières. Elle n’a
point de huppe; la tête 8c les joues font rouffes en
entier; toute la face fupérieure du corps, à l’exception
des ailes, eft d’unbrun cendré: au refte elle ref-
femble affez au mâle, Rai .jynop. mit. avi. /^.O i s e a u .
• PIEU , f. m. (Hift- a net') gros bâton pointu, ou
piece de bois ,-dont on fe fert pour faire des enclos ,
des paliffades. Les Grecs 8c les Romains s’enfervoient
pour fortifier leurs camps en les plantant fur la crête
du parapet ; mais ils n’avoierit pas le même ufage de
les tailler ni de les ébrancKer. Voici ce que Polybc
remarque’-à-oette occafion.-Chez les Grecs, dit-il,
les meilleurs pieux font ceux qui ont beaucoup de
branches autour du jet.r Les Romains aü contraire
n’en laiffent que deux ou trois , tout au plus quatre ,
& feulement d’un côté. Ceux des Grecs font plus aifés
à arracher: car comme les branches en font fortes 8c
en grand nombre, deux ou trois foldats y trou veront
de la prife ; l’enleveront facilement; 8c voilà une
porte ouverte à l’ennemi, fans compter que fous les
voilinsen feront ébranlés. Il n’en eft pas ainfi
chez les Romains, les branches font tellement mêlées
& inférées les unes dans les autres, qu’à-peine peut-
on diftinguer le pié d’où elles fortent. Il n’eft pas non
plus- ppffible-d’arracher ces pieux, parce qu’ils font
enfoncés trop avant ; & quand on parviendrôit à en
enlever un-'dé fa place, l’ouverture qu’il' laiffe' eft
prefque imperceptible. D ’où il eft aife de voir avec
quelle attention les anciens fortifîoient leurs camps ,
partie de la guerre que les modernes ont prefque totalement
abandonnée.
P I E
On plâfttoit encore dans le Camp d’efpace en efpace
des pieux, pour fervir de but aux jeunes foldats qu’on
y ëxerçoit à tirer des armes 8c à lancer le javelot.
Dans lesfupplices, le pie« fer voit à attacher les criminels
condamnés à être battus de verges : ce qu’on
appelloit«^ palum alligare. Quelques-uns prétendent
qu’on s’en fervoit suffi pour les empaler, comme on
fait aujourd’hui chez les Turcs, mais fans fondement;
on ne trouve point dans les hiftoriens de traits qui
aient rapport à cette efpece defupplice.
PIEUX, f. m. pl. ( Archit. hydraul. ) pièces de bois
de chêne, qu’on emploie dans leur groffeur, pour
faire les palées des ponts de bois, ou qu’onéquarrit
pour les files des pieux ( voye^ ce mot ) qui retiennent
les berges de terre, les digues, &c. qui fervent à
conftruire les batardeaux. Les pieux font pointus 8c
ferrés comme les pilots ; ce qui en fait pourtant la
différence , c’eft que les pieux ne font jamais tout à
fait enfoncés dans la terre, 8c que ce qui en paroît
au dehors eft fôuvent équarri. Voye^ P i l o t s .
Pieux de garde. Ce font desvpieux qui font au-
devant d’un pilotis, plus peuplés 8c plus hauts que
les autres, 8c recouverts d’un chapeau. On en met
ordinairement devant la pile d’un pont, & au-pied
d’un mur de quai ou de rempart, pour le garantir du
heurt des bateaux 8c des glaçons, & pour empêcher
le dégravoyement. Daviler. ( D . J. )
P ie u x , P i l o t s ou P i l o t i s . Les pieux font le plus
communément employés à porter un édifice confi*
truit au-deffiis des hautes eaux, tels que font les
ponts de charpente , les moulins ,r &c.
On fe fert des pilots ou pilotis pour porter un édifice
de maçonnerie que l’on veut fonder fous les
baffes eaux, comme font les ponts, les murs de
quai, de certains bâtimens 8c autres ouvrages.
Les dimenjions , pojidons , efpacemehs 8c le battage
des pieux 8c des pilots ou pilotis, forment quatre
objets diftincls que l’on va examiner féparément.
Dimenfions. Vnpitu qui doit être expofé àl’eau
8c à f injure du tems , doit être formé de la piece la
plus forte que l’on puiffe tirer d’un arbre; 8c ce fera
l’arbre même, furtout s’il eft d’un droit fil 8c fain ;
tout équarriffage 8c redreffement trançheroit les
fibres, 8c .tronqueroit par fegmens les corps ligneux,
annulaires., dont la contexture plus ferrée que des
infertions qui fe 'trouvent de l’un à l’autre d e . ces
corps ligneux, pour mieux réfifter, étant confervés
en leur entier ; on doit fe contenter d’abattre les
nodofités, d’équarrir & former en pointe pyramidale
, le bout deftiné à la fiche. On fe contente
quelquefois de le durcir au feu , quand le pieu eft
deftiné pour un terrein qui n’eft pas ferme, linon il
doit être armé d’une lardoire, ou fabot de fer à trois ou
quatre branches, ou d’équarrir auffi le bout vers la
tête, lorfqu’il eft trop gros 8c qu’il pourroit excéder
la largeur des fommiers que l’on pofe1 8c affemble
horifôntalement à tenons 8c mortaifes fur la tête
des pieux
On a le même intérêt de conferver lçs bois dans
toute leur force pour les pilots ; ils doivent pour cet
effet être également ronds, de droits fils '& fans
noeuds excédons.
■ La groffeur des pieux- dépend donc de celle des
arbres que l’on peut avoir dans chaque endroit ;
l’ort -fe propofe communément de leur donner environ
10 pouces de groffeur mefurés au milieu de
leur longueur pour 15 8c 18 piés, 8c deüx pouces
de plus pour chaque toife excédente cette première
longueur : ainfi un pieu de 3 3 à 3 6 pies, par exemple
, devroit avoir environ 16 pouces de groffeur
réduitë'fans l’écorce;
Les pilots d’une ceftainë-'longueur rï’ônt pas bëfoin
d’être' fi'gros à proportion que les pieux , étant
prefque toujours enfoncés entièrement dans le ter-
P I E
rein, & moins expofés pour cette raifon à plier fous
le fardeau 8c à être ufés par le frottement de .l’eau
&des corps qu’elle charie ; on doit pour cette raifon
choifir les arbres les plus jeunes 8c les plus menus.
Il fuffit que ces pilots ayent environ 9 pouces de
groffeur, jufqu’à 10 & 12 piés de.long, Sc un pouce
de plus pour chaque toife excédente cette première
longueur. Ainfi un pilot de 28 à 3 0 piés de long au-
roit un pié de groffeur réduite, mefurée auffi fans
l’écorce: ce qui donneroit à peu près 10 pouces à
la pointe 8c 14 à la tête.
Lorfque l’on n’a pas des arbres affez longs, ou que
les pieux ou pilots ayant pris plus de fiche que l’on
ne l’avoit compté, fe trouvent trop courts , on peut
les anter 8c les affembler exactement en (g) fur 2 8c
3 piés de longueur , après quoi on doit les lier fermement
avec deux bonnes frettéesde fer, obfervant
pour les pieux de difpofer ces antes de façon qu’elles
puiffent être recouvertes parles moifes qui-les doivent
embrafler 8c en liaifon alternativement de l’une
à l’autre moife.
Il fera parlé de ces moifes par la fuite.
On trouve dans le traité de Charpenterie de Ma-
thurin Jouffe, par M. Delahire,que les pilots doivent
être équarris ; on donne à ceux de 12. piés 10 -à
12 pouces de groffeur, & à.ceux de 30 piés 16 à
21 pouces, au lieu de 9 pouces 8c de 12 red. de
groffeUr que l’on a propofé ci-devant, 8c qui fuffi-
fènt d’après ce qui fe pratique avec fuccès fur les
plus grands travaux pour ces différentes longueurs.
Mathurin Jouffe, en propofant d’équarrir les pilots
8c de donner des dimenjions inégales pour leur groffeur
, avoit fuivi ce qui fe pratique pour les bâtimens,
où cela eft néceffaire , 8c où il convient de doriner
plus de hauteur que de largeur aux pièces que l’on
pofe horifontalement : c’eft ce que M. Parent a fait
auffi connoître dans les mémoires de l’académie
des Sciences de .1708, où il eft démontré que la
piece la plus forte que l’on puiffe tirer d’un arbre
pour porter étant placée dans ce fens , doit être
telle que le quarré de l’un de fes côtés foit double
de celui de l’autre côté : ce qui revient à peu près
au rapport de 7 à 5.
Il n’en eft pas de même pour les pieux qui font-
deftinés à porter debout. Quant à l’équarriffement
& à l’inégalité de leurs côtés , c’ eft ce que l’on
croit avoir affez expliqué précédemment ; mais on
ne pouvoit fe difpenfer d’expofer ce qu’ont adopté
à la fois un bon charpentier & un mathématicien
habile fur le fujet que l’on vient de difeuter, afin
que l’on pût connoître mieux ce qui doit être
préféré.
Ces réflexions ne doivent cependant pas empêcher
d’employer des pieux ou des pilots équarris
dans de certaines circonftances ; on place quelquefois
, par exemple, des pilots de cette efpece au
pourtour extérieur des fondations, pour que les
palplanches que l’on chaffe entre ces pilots puiffent
leur être plus adhérentes. .
On doit ôter l’écorce en entier, 8c laiffer l’aubier
aux pieux 8c .aux pilots, pour les parties qui fe trouvent
fous l’eau.
- L’écorce ne donne point de force au bois ; elle
augmenté beaucoup le frottement par fon épaiffeur
8c fon afpérité, lors du battage des pieux ou pilots,
8c empêchent qu’ils ne prennent autant de fiche fous
la même pereuffion.
• L ’aubier n’eft point vicieux fous l’eau ;.il s’y con-
ferve comme l’on fait que le fait le bois, lorfqu’il eft
continuellement ftibmergé : furtout le chêne que
l’on emploie par préférence aux ouvrages conftruits
dans l’eau ; il a d’ailleurs de la force lorfque la feve
en eft retirée,, comme on peut en juger par les
expériences de M. deBuffon ( mémoires dt T académie,
P I E 605
ànnee ï 741 .page 296 . ) fuivant lefqu elles il a reconnu
que la forcé de l’aubier étoit feulement de ^ ou environ
> moindre que celle du bois pris au coeur du
même chêne : ce qui fè trouvoit être auffi à peu
près dans le rapport des denfftés de l’un & de l’autre
bois & aubier. Les circonftances fur la longueur,
groffeur & fur la façon de charger les bois °& aubier
, etoient d’ailleurs les mêmes, ainfi il paroît que
l’on peut laiffer l’aubier aux pilotis fans inconvénient.
Lorfque, l’écorce recouvre l’aubier , elle garantit
l’oeuf que la mouche y a dépofé , & le ver qui en
provient jufqu’à ce qu’il ait acquis affez de force
pour abandonner l’aubier, dont la fubftance, lorf-
qu’elle eft. encore abreuvée de la feve, peut mieux
convenir a la delicateffe de premier âge, que le bois
où il ne pourroit s’introduire d’abord ni y vivre,
C ’eft ainfi qu’enufe la nature par rapport aux infedes;
en général le degré de chaleur qui fait éclore le ver
à foie, développe auffi la feuille du mûrier pour lui
préfenter une fiibftance délicate ; elle acquiert chaque
jour une confiftance plus forte, qui fe trouve
P a r ce moyen toujours analogue à celle du ver qui
croît & f e fortifie en même tems. L’arbre étant dépouillé
fur pié de fon écorce pendant le fort delà
le v e , & laiffé enfiiite fur pié au-moins fix mois,
on a reconnu que le bois durciffoit & que l’aubier
en devenoit prefque auffi fort que le bois. Foye^
les expériences de M. de Buffon, mémoires de l'académie
de ty$8. page iGg,.
L ’écorce étant ôtée lorfque l’on coupe l’arbre, le
ver fera tué par les mauvais tems & la gelée , avant
qu’il.ait acquis affez de force pour s’introduire dans
le bois ; c’eft au-moins à quoi l’on penfe devoir
attribuer ce que l’on a remarqué fur la confervation
des bois expofés au dehors, 8c auxquels l’on avoit
ufé de cette précaution.
Il n’en, fera pas de même des bois employés à
couvért ; la riiouche dépofera fon oeuf dans le peu
d’aubier que l’on y aura laiffé, 8c le bois fera enfuite
attaqué du ver qui en proviendra ; on croit pour
cette raifon qu’il n’eft pas toujours néceffaire d’ôter
l’aubier des pieux dans la partie qui fe trouve au-
deffus de l’eau. On a même remarqué à plufieurs
ponts qu’il s’étoit durci 8c avoit acquis une confiftance
capable de fortifier ces pieux 8c de les conlèr-
ver plus lông-tems , furtout lorfqüe l’on avoit eu
l’attention de laiffer le bois dans l’eau pendant quelques
mois, avant de les employer, précaution dont
on ufe pareillement avec fuccès pour la latte que
l’on fait quelquefois avec l’aubier ; cependant chacun
doit en ufer pour ce qui fe trouvera au-deffus
de l’eau, comme il le jugera le plus convenable,
vû que la fuppreffion de l’aubier ne fauroit d’ailleurs
être préjudiciable dans cette partie , fi l’on a attention
d’y fuppléer en donnant un peu plus de groffeur
aux pieux.
Indépendamment de la vermoulure à laquelle le
bois eft expofé , la fermentation de la feve, furtout
dans les parties renfermées ,iSc leur expofition alternative
à l’air & à l’eau, font également des caufes
principales de deftru&ion affez connues , 8c fur lef-
quelles nous 11e nous arrêterons point pour ne pas
trop nous écarter de notre projet principal.
Pojition, Les pieux 8c pilotis battus dans les rivières
doivent toujours être placés dans le fens du cours
de l’eau ; ils doivent être pofés d’équerre entr’eux,
autant que cela fe p eut, 8c à plomb, excepté le cas
dont on va parler.
Une file de pieux battus pour porter un pont de
charpente , fe nomme pâlie ; 8c une même palée eft
quelquefois compolée de plufieurs files de pieux
pofés parallèlement, 8c à peu près fuivant le plan
des piles des ponts de maçonnerie.
Les deux où trois pieux du milieu de ces palées