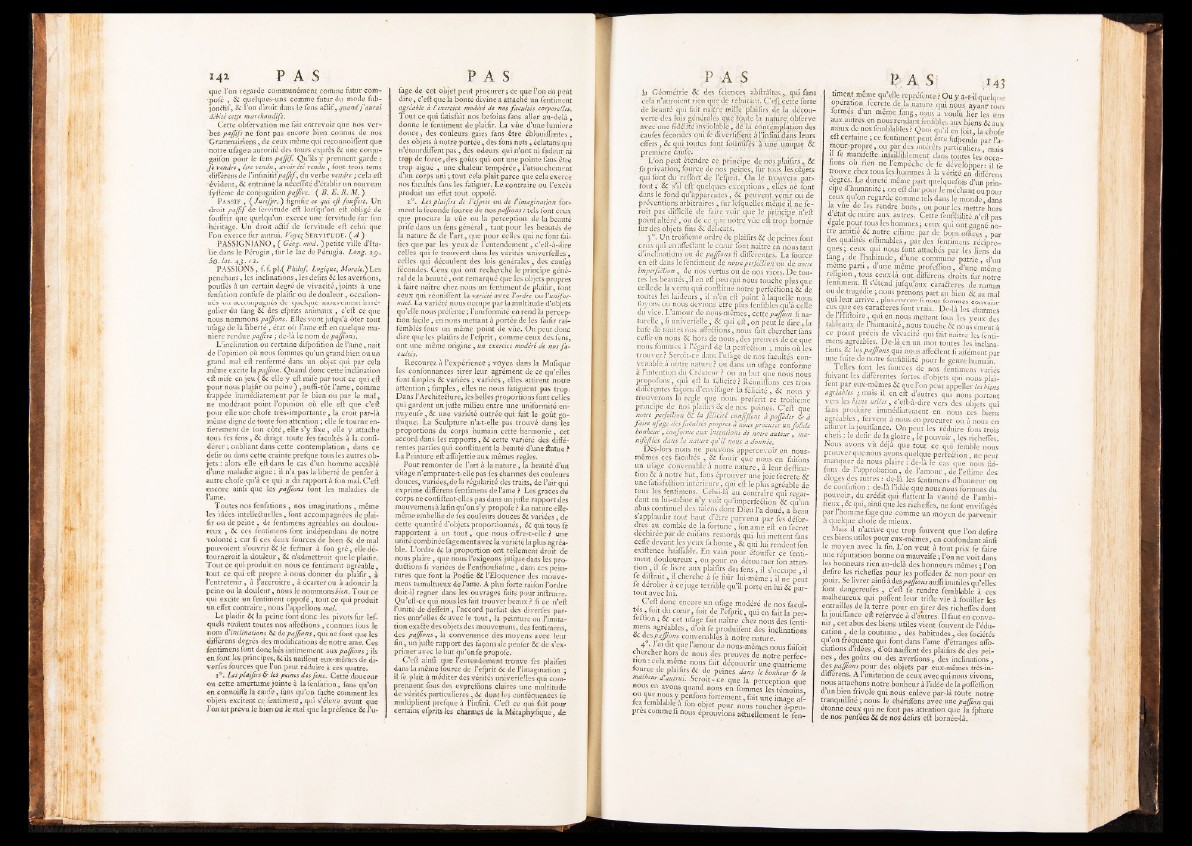
eue l’on regarde communément comme futur coin-
pol'é , & quelques-uns comme futur du mode fub-
lonriif, & l’on diroit dafts le fens a£lif, quand j'aurai
débité cet^e marckàndife.
Cette obfervation me fait entrevoir que hbs verbes
paffifs tie font pas encore bien connus de nos
Grammairiens, de ceux même qui reconnoifTerit que
notre ufage a âutorifé des tours exprès & üneconjn-
gaifon pour le fens pajjif. Qu’ils y prennent garde :
Je vendre ,êtrc vendu, avoir été vendu , font trois terns
différens de l’infinitifpajfif-, du verbe vendre ; cela eft
-évident, & entraine la néceffité d’établir un nouveau
'fyftème de conjugaifon pajfive. ( B. E. R. M. )
Passif , ( Jurifpr..) lignifie c-e qui ejl fougère. Un
droit pajjif de fervitude eft lorfqu’on eft obligé de
fouffrir que quelqu’un exerce une fervitude fur fon
héritage. Un droit aftif de fervitude eft celui que
l’on exerce fur autrui, Loye^ Servitude, (■ d)
PASSIGNIANO, ( Géeg. mod. ) petite ville d’Italie
dans le Pérugin, fur le lac de Pénjgia. Long. zç).
Sû.lat. 4 j . 12.
PASSIONS, f. f. pl.( Philof. Logique, Morale.) Les
penchans, les inclinations, les defirs & les averfions,
pouffes à un certain degré de vivacité, joints à une
lenfation confiife de plaifir ou de douleur, occafion-
nés ou accompagnés de quelque mouvement irrré-
gulier du fang & des efprits animaux , c’eft ce que
nous nommons pajjions. Elles vont jufqu’à ôter tout
'ufage de la liberté, état oii l’ame eft en quelque maniéré
rendue pajjive ; de-là le nom de pajjions.
L’inclination ou certaine difpofition de l’ame, nait
de l’ppinion oii nous fommes qu’un grand bien ou un
grand mal eft renfermé dans un objet qui par cela
même excite la pajjion. Quand donc cette inclination
eft mile en jeu ( & elle y eft mife par tout ce qui eft
pour nous plaifir ou peine ) , aufli-tôt l’ame, comme
frappée immédiatement par le bien du par le mal,
ne modérant point l’opiniorç oîi elle eft que c’eft
pour elle une chofe très-importante, la croit par-là
même digne de toute fon attention ; elle fe tourne entièrement
de fon côté, elle s’y f ix e , elle y attache
tous fes fens , & dirige toute fes facultés à la confi-
dérer ; publiant dans cette contemplation, dans ce
defir ou dans cette crainte prefque tous les autres objets
: alors elfe eft dans le cas d’un homme accablé
d’une maladie aiguë ; il n’a pas la liberté de penfer à
autre chofe qu’à çe qui a du rapport à fon mal. C’eft
encore ainfi que les pajjions font les maladies de
l’ame.
Toutes nps fenfations , nos imaginations , même
les idées intellettuelles , font accompagnées de plaifir
ou de peine , de fentimens agréables ou douloureux
, & ces fentimens font indépendans de notre
volonté ; car fi ces deux fources de bien &c de mal
pouvoient s’ouvrir & fe feriner à fon gré, elle dé-
tourneroit la douleur, & n’admettroit que le plaifir.
Tout Ce qui produit en nous ce fentiment agréable,
tout ce qui eft propre à nous donner du plaifir, à
l’entretenir, à l’accroître, à écarter pu à adoucir la
peine ou la douleur, nous le nommons bien. Tout ce
qui excite un fentiment oppofé , tout ce qui produit
un effet contraire, nous l’appelions mal.
Le plaifir la peine font donc les pivots fur lef-
quels roulent toutes nos affe&ions, connues fous le
nom d’inclinations ôc de pajjions, qui ne font que les
différens degrés des modifications de notre ame. Ces
fentimens font donc liés intimement aux pajjions ; ils
en font les principes, & ils naiffent eux-mêmes de di-
verfes fources que l’on peut réduire à ces quatre.
l°. Les plaijirs & les peines des fens. Cette douceur
ou çette amertume jointe à la fenfation, fans qu’on
en gonnoiffe la caufe, fans qu’on fâche comment les
objets excitent ce fentiment, qui s’élève avant que
Ton ait prévu fe bien ou le mal que la préfence de ï ’u»
fiige de Cet objet peut procurer; ce que ï’pn eh peut
dire , c’eft que la bonté divine a attaché un fentiment
agréable a l'exercice modéré de nos facultés corporelles•.
Tout ce qui fatisfait nos befoins fans aller au-delà.,
donne le fentiment de plaifir. La vue d’une lumière
douce, des couleurs gaies fans être :ébfouiflànte$ *
des objets à notre portée, des fôns nets, éclatons qui
n’étourdiffent pas, des odeurs qui n’ont ni fadeur ni
trop de force, des goûts qui ont une pointe fans être
trop aiguë , une chaleur tempérée, l’attouchement
d’un corps uni ; tout cela plaît parce que cela exerce
nos facidtés fans les fatiguer» Le contraire ou l’excès
produit un effet tout oppofé.
2°:. Les plajjirs de l'ëfprit oïl de l'imagination forment
la féconde fouree de nos pajjions: tels font ceux
que procure la vue ou la perception de la beauté
prife dans un fens général, tant pour les beautés de
la nature & de l’art, que pour celles qui ne font fai*
fies que par les yeux de l’entendement, c’eft-à-clire
celles qui fe trouvent dans les vérités univerfelles
celles qui découlent des fois générales, des caufes
fécondes. Ceux qui ont recherché le principe général
de la beauté, ont remarqué que les objets propres
a faire naître chez nous un fentimentde plaifir, font
ceux qui réunifient la variété avec l'ordre ou Y,uniformité.
La variété nous occupe par la multitude d’objetà
qu’elle nous préfente ; l’uniformité en rend la perception
facile, en nous mettant à portée de les faifir raf-
lemblés fous un même point de vue. On peut donc
dire que les plaifirs de l’ëfprit, comme ceux des fens,
ont une même origine, un exercice modéré de nos fa -
cul tés.
Recourez à l’expérience ; voyez dans la Mufique
les confonnances tirer leur agrément de ce qu’elles
font fimples & variées ; variées, elles attirent notre
attention ; fimples, elles ne nous fatiguent pas trop*
Dans l’Architecture, les belles proportions font celles
qui gardent un jufte milieu entre une uniformité en-
nuyeufé, & une variété outrée qui fait le goût gothique.
La Sculpture n’a-t-elfe pas trouvé dans les
proportions du corps humain çette harmonie, cet
accord dans les rapports, &£ cette variété des différentes
parties qui Conftituent la beauté d’une ftatue ?
La Peinture eft affujettie aux mêmes réglés.
Ppur remonter de Part à la nature, la beauté d’un
vifage n’empninte-t-elle pas fes charmes des couleurs
douces, variées, de la régularité des traits, de l’air qui
exprime différens fentimens de l’ame ? Les grâces du
corps ne confiftent-elles pas dans un jufte rapport des
mouvemensà la fin qu’on s’y propofe ? La nature elle-
même embellie de fes couleurs douces & variées, de
cette quantité d’objets proportionnés, & qui tous fe
rapportent à un tou t, que nous offre-t-elle } une
unité combinée fagement avec la variété la plus agréable.
L’ordre & la proportion ont tellement droit de
nous p laire, que nous l’exigeons jufque dans les productions
fi variées de l’entnoufiafine, dans ces peintures
que font la Poéfie & l’Eloquence des mouve-
mens tumultueux de l’ame. A plus forte raifon l’ordre
doit-fi rogner dans les ouvrages faits pour inftniire.
Qu ’eft-ce qui nous les fait trouver beaux ? fi ce n’eft
l’unité de deflein, l’accord parfait des diverfes parties
entr’elles & avec le tout, la peinture ou l’imitation
exaCte des objets des mouvemens, des fentimens,
des pajjions, la convenance des moyens avec leur
fin , un jufte rapport des façons de penfer & de s’exprimer
avec le but qu’on fe propofe.
C’eft ainfi que l’entendement trouve fes plaifirs
dans la même fouree de l’ëfprit & de l’imagination ;
il fe plaît à méditer des vérités univerfelles qui comprennent
fous des exprçffions claires une multitude
de vérités particulières, & dont les conféquences fe
multiplient prefque à l’infini. C’eft ce qui fait pour
certains efprits fes charmes de la Métaphyfique, de
la Géométrie &: des fciençes abftràitqs^ qui fans
cela n’aûf oient rien que'dé rebutant. C ’efe çette forte
de beaiité qui fait naître miffe' plaifirs dé la découverte
dés lois' géherâîës'qû.è route, la ' natufè1. Ôbferve
avec une fidélité inviolable ,.‘dedà contemplation des
fcaufés fëcôfides qiti fe divërfifién^ àTinfefeîiahs leurs
e f f e t s . q u i toutes font foiimïi£S ,'jî ifefe iiiffque &
première caufë.
L’on peut étendre ce principe de nqs(.plaifirs.&
fa privation^ foüfç'e de nos peinés, $ir -'felR ie^plgets
qui font du réffôrTclé l’efcrit. On ,1e trouvera.partout
; &. s’il èfe quélqifes excéptions'. elfes nè font
dans lé fond qifapparentés", &: peuvent, yenîr ou de
préventiqhs arbitraires , fur lefquçliés, même’ il ne fe-
roit pas difficile de faire voir que lé principe n’eft
point altéré",.'Ou dé çefoüe nôtrè vue eft trop, bornée
fur des objets fins & délicats..
3 °. Un troisième ordre de plaifirs & dé peinés font
ceux qui en affeCtant le coeur font haîtrècn lions tant
d’inclinatîq'ns otï dé pajjiôns fi différentes; La toùtce
en eft dans le fentiment de nôtre ptrfcUïoffoîfde notre
imperfection , de nos vertus ou de nos vices. De tou-
tés -fes beàûtés, il en eft peu qui nous touche plus que
celle de la'vertu qui conftïtüe notre perfection; & de
toutes leS laideurs , il n’en eft point à laquelle nous
foyons ou n.ôjis devions’êtfé plus fenfible.s qu’à çërië
du v ice .L’impur de nous-mêmes, cèttèpajpdn ûnaturelle.,
fi üniverfelle,‘ & qui eft, on peut le <lire;. la
bafé de routés nos affeftions, nous fait chercher fans
Ceffe en nous & hors de nous, des preuves de ce que
nous fônïmes à’ l’égard de là peffeûion ; mais ôîiles
prouver,? Sçroit-ce dans.l’ufage de nos facultés eon-
venablë à' nôtre nature ? ou dans un ufage conforme
à l’intention du Créateur ? ou au but que nous nous
propofons, qui eft la félicité? Réuniflbns çës trois
differentes façôns d’enyifàger la félicité , & nous y
trouverons la tegle que: nous preferit ce trôifiemé
prineipe'dç'ftpspfeifirS^'deiips peines.'C’eft que
notre perfection & la félicité confident à pofféder 6- d
faire ufage des fatuités propres a nous procurer un folid/i
bonheur , conforme aux intentions de notre auteur , ma-
nifeflées dans 'la nature qu'il nous a donnée.
Dès-lofs .nous ne pouvons àppercevoir en nous-
mêmes çés facilites , & feritir’que nous en faifons
im ufage" convenable à notre nature , à leur deftina-
tion & à nôtre but, fan? éprouver une joie fecrete &
une fatisfa&ion intérieure, qui eft le plus agréable de
tous les fentimens. Celui-là au contraire qui regardant
en lui-même n’ÿ voit qu’imperfeaion & qu’un
abus continuel des .tâlens dont Dieu l’a doué, a beau
s applaudir tout haut d’être parvenu par fes défor-
dres au comble de la fortune , fon ame èft en fecret
déchirée par de cuifans remords qui lui mettent fans
ceffe devant les yeux fa honte, & qui lui rendent fon
exiftence haiffable. En vain pour éfoiiffër ce fendillent.
douloureux, ou pour en détourner fon attention
il fe livre aux plaifirs des fens, il s’occupe il
le diftrait, il cherche à fe fuir lui-même ; il ne peut
fe dérober à ce juge terrible qu’il porte en lui & partout
avec lui.
, C’eft donc encore un ufage modéré de nos facul-
tes , foit du cçeur, foit de l’ëfprit, qui en fait la per-
tettion ; & cet ufage fait naître chez nous des fentimens
agréables, d’oîi.fe.produifent des inclinations
q s P f jo n s convenables à notre nature.
4 .J ai dit que l’amour de nous-mêmes nous faifoit
chercher hprs de nous des preuves de notre perfection:
cela meme nousTait découvrir une quatrième
iource de plaifirs & de peines dans le bonheur & le
W Ê Ê Ê m ■ ■ ■ perception que
nous en ayoqs.quand nons en fommes les témoins.
I l y penfons fqrt.emeqt , fait une image afc
fez l'emblabie-.à fon ■ ■ pour nous toucher à-peu-
pres copim^ fi nous éprouvions aaueUèmérit le ïentiment
meme tp,!c::o reptcil-me i' Ou y a-fâl quelque
operation, fecrcte deja /ïamre c[ui npus avant tous
■ B B vàuUVÏier les Uns
m x aufçes en nous rendant .Çnlibles auxiiens & aux
mauxde nds femUaBlesT Quoi qu'ifen S t , 1a chofe
«S fm ^ t^ p té t t e .fq fp è A d u ' parJ’ail
fe manifefee.infeilliblenrenfedansi t ^ e s ïes'Occa-
fions ou rién ne l ’empêché de fe' ‘devel&ppej;:il fe
fe y é jitó^ , différens
iffiKSfc îi? rforetç itpImeéBi'téqBèlqîJèfeié çlfffp pr;n„
SffiÇrfÿl'iffiîS'dé ; qn e t dqrgqur le.n)eçlrantpu pour
re8ar<k £9^me dans le. monde, dans
la vue de les rendr^. bons, ou pour les mettre hors
d’etat de nuire aux autres. Cette fenfibilité n’eft pas
P,0^ îous ^es hommes ; ceux qui pnt gagné notre
amitié notre eftime par <ïe bons pffices , par
des qualités eftimables, pa rles fentimens réciproques;
ceux qui nous font attachés par "les liens du
faPe>?' de l’habitude, d’une commune patrie, d’un
même parti, d’une, même.p ro fe ff io n d ’une même,
religion , tous ceux-là ont différens droits lur notre
fentiment. Il s’étend jufqu’aux carafteres de roman
ou de tragédie ; nous prenons, part au bien & au mal
qui leur arrive , plus encore fi nous fommes convaincus
que ces caractères font vrais. De-là les charmes
de l’Hiftoire , qui en nous mettant fous les yeux des
tableaux de l’humanité,.nous touche & nous émeut à
ce point précis de vivacité qui fait naître les fenti-
mens agréables. De-là en un mot toutes les inclinations
& les pajjions qui nous affeûent fi aifémentpar
une fuite de notre fenfibilîté pour le genre humain.
Telles font les fources de nos fentimens variés
fuivant les différentes fortes d’objets qui nous plai-
fent par eux-mêmes & que l’on peut appeller les biens
agréables ; mais il en eft d’autres qui nous portent
versies biens utiles, c’eft4 -dire vers des objets qui
fens produire immédiatement en nous ce? biens
agréables , fervent à nous en procurer ou à nous en
alfurer la jouiftànce. On peut les réduire fous trois
chefs.: le defir de la, gloire , le pouvoir, les richefles.
Nous avons vû déjà que tout ce qui femble nous
prouver que nous ayons quelque perfeÛion, ne peut
manquer dè nous plaire : de-là le cas que nous fai-
fpns. de l’approbation, de l’amour ,.d ë l’eftime des
eloges des autres : de-là les fentimens d’honneur Pu
de confufion : de-là l’idée que nous nous formons du
pouvoir, du crédit qui flattent la vanité de l’ambitieux
, & qui, ainfi que les richefles, ne font envifasés
par l’homme fage que comme un moyen de parvenir
H quelque choie de mieux.
Mais il n’arrive que trop fouvent que l’on defire
ces. biens utiles pour eux-memes, en confondant ainfi
le moyen avec la fin. L ’on veut à tout prix fe faire
une réputation bonne ou mauvaifé ; l’on ne voit dans
les honneurs rien au-delà des honneurs mêmes ; l’oii
defire les richefles pour les pofféder & non pour en
jouir. Se livrer ainfi à des pajjions auffi inutiles qu’ elles
font, dangereufes , c’eft fe rendre femblable à ces
malheureux qui paffent leur trifte v ie à fouiller les
entrailles de la terre pour en tirer des richefles dont
la jouiffance eft refervée à d’autres. Il faut en conven
ir, Cet abus des biens utiles vient fouvent de l’édu-
cation , de la coutume, des habitudes , des fociétés
qu’on fréquente qui font dans l’ame d’étranges affo-
ciations d’idées , d’où naiffent des plaifirs & des peines
, des goûts ou des averfions, des inclinations ,
pajjions pour des objets par eux-mêmes très-in-
différons. A l’imitation de ceux avec qui nous vivons,
nous attachons notre bonheur à l’idée de la pofleflion
d’un bien frivole qui nous enlevé par-là toute notre
tranquillité ; nous le çhériffons avec une pajjion qui
étonne ceux qui ne font pas attention que la Iphere
de nos penfées & de nos defirs eft hornée-ià.