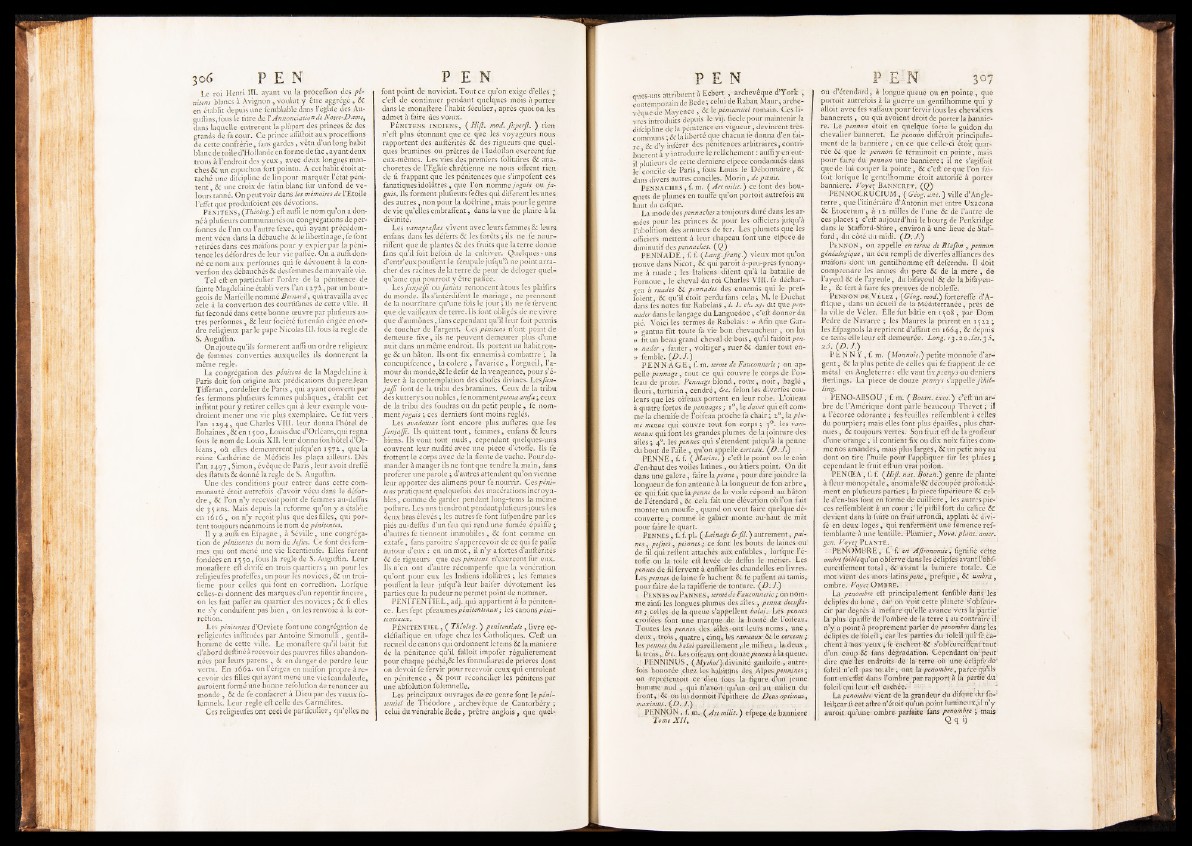
Le roi Henri III. ayant vu la proceflion clés pc-
nitens blancs à Avignon , voulut y être aggrégé , &
en établit depuis une femblable dans l’égliiè des Au-
guftins,fous le titre de V Annonciation de Notre-Dame,
dans laquelle entrèrent la plupart des princes & des
grands de fa cour. Ce prince afliftoit aux procédions
de cette confrérie, fans gardes, vêtu d’un long habit
blanc de toile d’Hollande en forme de fa c , ayant deux
trous à l’endroit des y eu x , avec deux longues manches
& un capuchon fort pointu. A cet habit étoit attaché
une difcipline de lin pour marquer l’état pénitent
& une croix de fatin blanc fur un fond de velours
tanné. On peut voir dans les mémoires de l’Etoile
l’effet que produifoient ces dévotions.
Pénitens, (Théolog.) eft aufli le nom qu’on a donné
à plufieurs communautés ou congrégations deper-
fonnes de l’un ou l’autre fexe, qui ayant précédemment
vécu dans la débauche & le libertinage, fe font
retirées dans ces maifons pour y expier par la pénitence
les défordres de leur vie paffée. On a aulîi donné
ce nom aux perfonnes qui 1e dévouent â la con-
verlion des débauchés & des femmes de mauvaife vie.
Tel eft en particulier l’ordre de la pénitence de
fainte Magdelaine établi vers l’an 12 7 !, par un bourgeois
de Marfeille nommé Bernard, qui travailla avec
zele à la converfion des courtifanes de cette ville. Il
fut fécondé dans cette bonne oeuvre par plufieurs autres
perfonnes, & leur fociété Tut enfin erigée en ordre
religieux par le pape Nicolas III. fous la réglé de
S. Auguftin.
On ajoute qu’ils formèrent aufli un ordre religieux
de femmes converties auxquelles ils donnèrent la
même réglé.
La congrégation des pénitens de la Magdelaine à
Paris doit fon origine aux prédications du perejean
Tifferan , cordelier de Paris , qui ayant converti par
fes fermons plufieurs femmes publiques, établit cet
inftitut pour y retirer celles qui à leur exemple vou-
droient mener une vie plus exemplaire. Ce fut vers
l’an 1294, que Charles VIII. leur donna l’hôtel de
Bohaines, & en 1500, Louis duc d’Orléans, qui régna
fous le nom de Louis XII. leur donna fon hôtel d’Orléans,
où elles demeurèrent jufqu’en 1572 , que la
reine Cathérine de Médicis les plaça ailleurs. Dès
l’an 1497, Simon, évêque de Paris, leur avoit dreffé
des ftatuts & donné la réglé de S. Auguftin.
Une des conditions pour entrer dans cette communauté
étoit autrefois d’avoir vécu dans le défor-
dre, & l’on n’y recevoit point de femmes au-deffus
de 3 5 ans. Mais depuis la reforme qu’on y a établie
en 1616 , on n’y reçoit plus que des filles, qui portent
toujours néanmoins le nom de pénitentes.
Il y a 'aufli en Efpagne, à Séville, une congrégation
de pénitentes du nom de Jefns. Ce font des femmes
qui ont mené une vie licentieufe. Elles furent
fondées en 1550, fous la réglé de S. Auguftin. Leur
monaftere eft divifé en trois quartiers ; un pour les
religieufes profeffes, un pour les novices, & un troi-
fieme pour celles qui font en corre&ion. Lorfque
celles-ci donnent des marques d’un repentir fincere,
on les fait paffer au quartier des novices ; & fi elles
ne s’y conduifent pas bien, on les renvoie à la correction.
Les pénitentes d’Orviete font une congrégation de
religieufes inftituées par Antoine Simonulli, gentilhomme
de cette ville. Le monaftere qu’il bâtit fut
d’abord deftiné à recevoir des pauvres filles abandonnées
par leurs parens , & en danger de perdre leur
vertu. En 1662. on l’érigea enmaifon propre à recevoir
des filles qui ayant mené une vie fcandaleufe,
auroient formé une bonne refolution de renoncer au
monde , & de fe confacrer à Dieu par des voeux fo-
lemnels. Leur réglé eft celle des Carmélites.
Ces religieufes ont ceci de particulier, qu’elles ne
font point de noviciat. Tout ce qu’on exige d’ elles *
c’eft de continuer pendant quelques mois à porter
dans le monaftere l’habit féculier, après quoi on les
admet à faire des voeux.
Pénitens indiens, ( Hifi. mod. fuperjt. ) rien
n’eft plus étonnant que ce que les voyageurs nous
rapportent des auftérités & des rigueurs que quelques
bramines ou prêtres de l’Indoftan exercent fur
eux-mêmes. Les vies des premiers folitaires & ana-,
choretes de l’Eglife chrétienne ne nous offrent rien
de fi frappant que les pénitences que s’impofent ces
fanatiques idolâtres , que l’on nomme joguis ou ja-
guis. Ils forment plufieurs fefres qui different les unes
des autres , non pour la doCtrine, mais pour le genre
de vie qu’elles embraffent, dans la vue de plaire à la
divinité.
Les vanaprajlas vivent avec leurs femmes & leurs
enfans dans les déferts & les forêts ; ils ne fe nour-
riffent que de plantes &: des fruits que la terre donne
fans qu’il foit befoin de la cultiver. Quelques - uns
d’entr’eux pouffent le fcrupule jufqu’à ne point arracher
des racines de la terre de peur de déloger quel-
qu’ame qui pourroit y être paffée.
Les fanjaffi ou fanias renoncent à tous les plaifirs
du monde. Ils s’intérdifent le mariage, ne prennent
de la nourritnre qu’une fois le jour ; ils ne fe fervent
que de vaiffeaux de terre. Ils font obligés de ne vivre
que d’aumônes, fans cependant qu’il leur foit permis
de toucher de l’argent. Ces pénitens n’ont point de
demeure fixe, ils ne peuvent demeurer plus d’une
nuit dans un même endroit. Ils portent un habit,rouge
& un bâton. Ils ont fix ennemis à combattre ; la
concupifcence, la co le re , l’avarice , l’orgueil, l’amour
du monde,& le defir de la vengeance, pour s’élever
à la contemplation des chofes divines. Lesjan-
jajfi font de la tribu des bramines. Ceux de la tribu
des kutterys ou nobles, fe nomment per ma amfa ; ceux
de la tribu des fondras ou du petit peuple, fe nomment
joguis ; ces derniers font moins réglés,
Les avadoutas font encore plus aufteres que les
fanjajji. Ils quittent tout, femmes, enfans & leurs
biens. Ils vont tout nuds, cependant quelques-uns
couvrent leur nudité avec une piece d’étoffe. Ils fe
frottent le corps avec de la fiente de vache. Pour demander
à manger ils ne font que tendre la main, fans
proférer une parole ; d’autres attendent qu’on vienne
leur apporter des alimens pour fe nourrir. Ces pénitens
pratiquent quelquefois des macérations incroyables
, comme de garder pendant long-tems la même
pofture. Les uns tiendront pendant plufieurs jours les
deux bras élevés ; les autres fe font fufpendre par les
piés au-deffus d’un feu qui rend une fumée épaifîe ;
d’autres fe tiennent immobiles , &C font comme en
extafe fans paroître s’appercevoir de ce qui fe pafle
autour d’eux : en un mot, il n’y a fortes d’aufterités
& de rigueurs que ces pénitens n’exercent fur eux.
Ils n’en ont d’autre récompenfe que la vénération
qu’ont pour eux les Indiens idolâtres ; les femmes
pouffent la leur jufqu’à leur baifer dévotement les
parties que la pudeur ne permet poipt de nommer.
PÉNITENTIEL, adj. qui appartient à la pénitence.
Les fept pfeaumespénitentiaux; les canonspénitentiaux.
PÉNITENTIEL, ( Thlolog. ) penitentïale , livre ec-
cléfiaftique en ufage chez les Catholiques. C’eft un
recueil de canons qui ordonnent letems & la maniéré
de la pénitence qu’il falloit impofer régulièrement
pour chaque péché,& les formuliares de prières dont
on devoit fe lervir pour recevoir ceux qui entroient
en pénitence , & pour réconcilier les pénitens par
une abfolution folemnelle.
Les principaux ouvrages de ce genre font le péni-
tentiel de Théodore , archevêque de Cantorbéry ;
celui du vénérable Bede, prêtre anglois, que quel-
« J * attribuent à E cbert, archevêque d’York ;
contemporain de Bede ; celui de Raban Maur, aïelïe»
venue de Mayence , & le pcniiaiùd romain. Ces livres
tnfrAiits depuis, le Ivijifieclepour maintenir -la
difcipline de la pénitence en vigueur, devinrent très-
communs ;& la liberté que chacun fe donna d’en faire
& d’y inférer des pénitences arbitraires, contribuèrent
à y introduire le relâchement : aufli y en eut-
il plufieurs de cette derniere efpece condamnés dans
le concile de Paris, fous Louis le Débonnaire , &
dans divers autres conciles. Morin, de poenit.
Pennaches , f. m. {Art milit.) ce font des bouquets
de plumes en touffe qu’on portoit autrefois au
haut du cafque. ;
La mode des pennaches a toujours dure dans les armées
pour les princes oc pour les officiers julqu’à
l’abolition des armures de fer. Les plumets que les
officiers mettent à leur chapeau font une efpece de
diminutif des pennaches. (Q)
PENNADE, f. f. {Lang.franç.) vieux mot qu’on
trouve dans N icot, & qui paroît à-peu-près fynony-
me à ruade ; les Italiens difent qu’à la bataille de
Fornoue , le cheval du roi Charles VIII. fe déchargea
à ruades &C pennades des ennemis qui le pref-
foient, & qu’il étoit perdu fans cela ; M. le Duchat
dans fes notes fur Rabelais , /. A ch. xj. dit que pm*
nader dans le langage du Languedoc, c’eft donner du
pié. Voici les termes de Rabelais : » Afin que Gar-
» gantua fut toute fa vie bon chevaucheur , on lui
» fit un beau grand cheval de bois, qu’il faifoit peu-
» nader , fauter, voltiger, ruer & danfer tout en-
» fernblé. {D , J. )
P E N N A G E -, f. m. terme de Fauconnerie ; on appelle
pennage , tout ce qui couvre le corps de l’oi-
feau de proie. Pennage blond, rou x, noir, baglé ,
fleuriyturturin, cendré , &c. félon les diverfes couleurs
que les oifeaux portent en leur robe. L’oifeau
à quatre fortes de pennages ; i °, le duvet qui eft comme
la chemife de l’oifeau proche fa chair; 20, plume
menue qui couvre tout fon corps ; 30. les vanneaux
qui font les grandes plumes de la jointure des:
ailes ; 40. les pennes qui s’étendent jufqu’à la penne
du bout de l’aile, qu’on appelle cerceau. {D. A)
PENNE, f. f. ( Marine. ) c’eft le point ou le coin
d’en-hâut des voiles latines., ou à tiers point. On dit
dans Une galere, faire la penne, pour dire joindre la
longueur de fon antennè à.la longueur de fon arbre,
çe qui, fait que h penne de la voile répond au Bâton
de l’étendard, & cela fait, une élévation où l’on fait
monter un moufle, quand on veut faire quelque découverte
,\ comme, le gabier monte au-haut de mât
pour faire le quart.
Pennes , f.<f. pl. (:Lainage & fil.') autrement, pairies.,,
pefnés, peinnes.; ; ce font’ les> bouts de laines ou
de fil qui relient attachés aux enlubles, lorfque.l’étoffe
ou la toile eft levée ; de deffus le métier. Les
pennes de fil fervent à enfiler les chandelles en livres*
Les pennes de laine fe hachent Ôt fe paffent aii tamis,-
pour faire de la tapiflèrie de tenture. {D. A )
* P enNESok Pannes , termè de Faueonnerie ; ôn nomme
ainfi les longues plumes des âîles., ptnntz decufia-
tce ; celles de la queue s’appellent balai.. Les pennes
croifées font Une marque. ,de la bonté de. l’oifeaiu.
Toutes les pennes dqs, aîles^ oint Ipiits.noms , line,
d e u x t r o is , quatre ; cinqi,; les ram e a u x le cerçeau ;
les pennes du balai pareillement ,ile.milieu, la. deux,
la trO,is ,,i Les oifeaux.ont douze pennes à:la queue«
PENNINUS, {Mythol'),divinité gaüloife-, autre-?
fois honorée cfiez, les habitcîns des A Ipesipen/tines
on repréléntpit ce ' dieq fiau$ la figure d’un/.jeune
homme- nud , qui fravqit:;qu’un.oeil au milieu du
front, > ôc p;n liû donnpit l’épithete de Deus optimus,
maximu^.'{D., A ) , ; 1 PENlS(QN , f. m. { Are milit. ) efpece de bannière
Tome X I 1\
ou d’étendard, à longue queue ou en pointe , què
portoit autrefois à la guerre un gentilhomme qui y
alloit avec fes vaffaux pour fervir fous les chevaliers
bannerets , ou qui avoient droit de porter la bannière.
Le pennon étoit en quelque forte le guidon du
chevalier banneret. Le pennon différoit principalement
de la bannière, en ce que celle-ci étoit quar-
rée & que le pennon fe terminoit en pointe, mais
pour faire du pennon une bannière ; il ne s’agiffoit
que de lui couper la pointe , & c’eft ce que l’on faifoit
lorfque le gentilhomme étoit autorifé à porter
bannière. Voye\ Banneret. (Q)
PENNOCRUCIUM, {Gé'og. and. ) ville d’Angleterre
, que l’itinéraire d’Antonin met entre Uxacona
& Etoeetum, à 12 milles de l’une &c de l’autre de
ces places ; c’eft aujourd’hui le bourg de Penkridge
dans lé Stafford-Shire, environ à une lieue de Stafford
, du côté du midi. {D. A )
Pennon , on appelle en ternit de Blajott, pennon
généalogique, un écu rempli de diverfes alliances des
maifons dont un gentilhomme eft defcendu. Il doit
comprendre les armes du pere & de la mere , de
l’ayeul & de l’ayeule, du bifayeul & de la bifayeu-
l e , & fert à faire fes preuves de nobleffe.
Pennon de.Vêlez , {Géog. mod.) forterefle d’Afrique
, dans un écueil de la Méditerranée, près de
la ville de Vêlez. Elle fut bâtie en 1508, par Dom
Pedre de Navarre ; les Maures la prirent en 1522 ;
les Elpagnols la reprirent d’affaut en 1664, & depuis
ce tems elle leur eft demeurée. Long. i i .z o .là t .iS .
zj$. {D. A )
P £ N N Y , f. m. {Monnoie.) petite monnoie d’argent,
& la plus petite de celles qui fe frappent.de ce
métal en Angleterre : elle vaut fix penny s ou deniers
fterlings. La piece de douze pennys s’appelle' fchil-
ling.
> PENO-ABSOU ,'f,Jm. { Botarii èxot.) c’eft un arbre
de l’Amérique dont parlé beaucoup Thevet ; il
a l’écorce odorante ; fes feuilles reffemblent à celles
du pourpier; mais elles font plus épaiffes, plus charnues
, & toujours vertes. Son fruit eft de la groffeur
d’une orangé ; il contient fix ou dix noix faites, domine
nos amandes, mais plus larges, & un petit noyau
dont on tire l’huile pouf l’appïiqüer fur les;plaies ;
cependant le fruit eft un vrai poilon.
PENCEA , f. f. {Hifl. nat. Botah.) genre de plante
à fleur monopétale, anomale^ découpée prdfondé-
ment en plufieurs parties ; l'a'piece fupéfieure celle
d’en-bas font en forme de cuilliere, lés autres pièces
reffemblent à un coeur ; (le piftil fort du calice &
devient dans la fuit'e un fruit'arrondi, applati & divifé
en deux loges-,- tjui retiferniéiit une femence ref-
femblante à une lentille.^Plumier, Nova, plant, amer.'
gen. Voye^ Plante.^
- PENOMBRE, f. f.: cri'Xflronomie', figififiè celte
ombre foibUoyton obferve dans lés éclipfès avanf l’obf-
curciffement total , ’■ &::àvânt!:la lumière totale.' Ce
mot vient des mots latins fient, prefqiië:, Si 'timbra 9
ombre. Foye^ O mbre. ■ -
La pénombre eft principalement fenfible- dkn^'les
éclipfës du lun'e , car on voit cette pldhete "s’ôpfciir-
cir par degrés à niefùre' qu’ellè aVancé vers la pgrtie '
là plus épaiffe de Tofiibre de la terre ;'au contrarré il;
n’y a point à proprement parler de pénombre dansles!
éclipfès d e fb leil, car les' parties du foleil ÿjiii4ë.cà-'
chent à'ïï©sryeux ^fè 'càéhent ’& s?bbfcuixïflçhTtôut;
; d’un coup &c fans dégradation. Cependant onJjpeut
; dire quelles endfoits-dèTa’ tërre oü fine eclipre'dé*
i foleil n’eft pas totale ; Ont la pénombre, parce'Cfpfils
font eneffet dans1 l’ombre par rapport à la partie dit'
foleil’qui leur jeft cachée.1^ :’ !j
La pénombre vient de la grandeur du difque du'fo-1
leil;car fi cet aftre n’étoif qifun point lumineuxfi 1-n’y
auroit. qu’une' ombre- parfaite fans pénombre ; mais
Q q