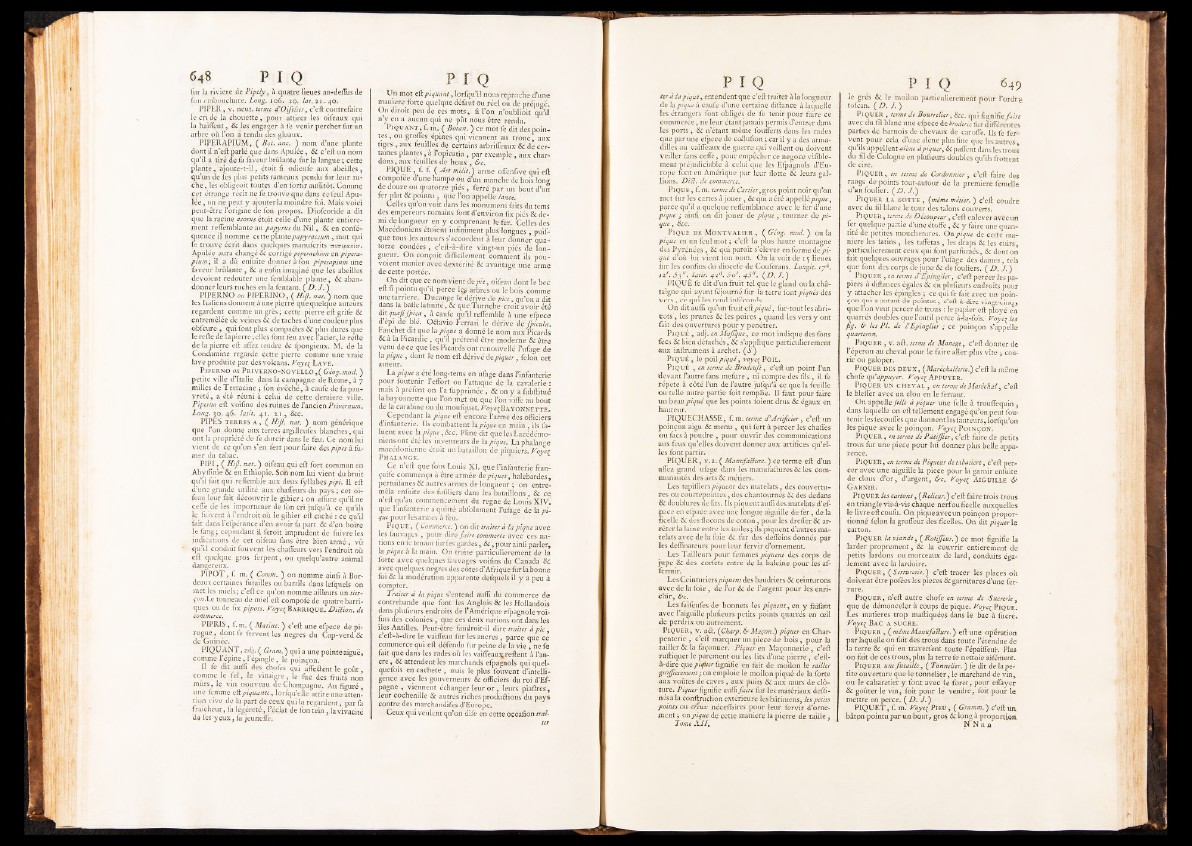
fur la riviere ,de Pipely, à quatre lieues aü-deffus de
fon embouchure. Long. 106. ?o. lat. %i. 40*
PIPER, y. neut, ter/«e d'Oifelier, ç’ eft contrefaire
le cri de la chouette, pour .attirer les oifeaux qui
la h aï (lent, & les engager à fe venir percher fur un
arbre oh l’on a tendu des gluaux,
PÏPERAPIUM,. ( Bot. anc. ) nom d’une plante
dont il q’eft parlé qu.e dans Apulée, & c ’ell un nom
qu’il a tiré de fa faveur brûlante fur la langue ; cette
plante, ' ajoute-t-il, étoit fi odieufe aux abeilles,
qu’un de fes plus petits rameaux pendu fur leur ruch
e, lés'obligeoit toutes d’en fprtir auffitôt. Comme
çgt étrange récit ne fetrouveque danseçfeul Apulée
, on ne peut y ajouter la moindre foi. Mais voici
peut-être l’origine de fon propos. Diofcoride a dit
que la rapine açorus étoit celle d’une plante entièrement
reffemblante au papyrus du N il, & en confé-
ouençe il nomme cette plantepapyraceum, mot qui
le trouve éçrit dans quelques manufcrits 7rs7npuK/ov.
Apulée aura changé & corrigé peperachion en pipera-
pium\ il a dû enluite donner à ion piperapiu.m une
faveur brûlante , &c a enfin imaginé que les abeilles
dévoient redouter une Semblable plante , & abandonner
leurs ruches en la Sentant. ( D. J. )
PIRERNO ou PIPERINO, ( Hiß. nat, ) nom que
les Italiens donnent à une pierre que quelque auteurs
^regardent comme un grès ; cette pierre eft grife &c
entremêlée de veines & de taches d’une couleur plus
pbfçure , qui font plus compares & plus dures que
le relie de lapierre;elles font feu avec l’acier, le relie
de la pierre eft affez tendre & Spongieux. M. de la
Condamine regarde cette pierre comme une vraie
lave produite par des volcans. Foye{ L a ve.
Piperno ou Priverno-nqyello , ( Gèog.mod. )
petite ville d’Italie dans la campagne de Rome, à 7
milles de Terracine ; fon éyêché, à caufe de fa pau-
yreté, a été réuni à celui de cette derniere ville.
Piperno eft voifine des ruines de l’ancien Privernum.
Long. 30.46. ladt. 41. 21 , &c.
PIPES terres a , ( Hiß. nat. ) nom générique
que l’on donne aux terres argilleufes blanches-, qui
ont la propriété de fe durcir dans le feu. Ce nom lui
vient de ce qu’on s’en Sert pour faire des pipes à fumer
du tabac.
PIPI? ( Hiß.nat. ) oifeau qui eft fort commun en
Abyffinie & en Ethiopie. Son nom lui vient du bruit
qu’il fait qui relfemble aux deux Syllabes pipi. Il eft
d’une grande utilité aux chalfeurs du pays ; cet oifeau
leur fait découvrir le gibier ; on allure qu’il ne
çeffe de les importuner de fon cri jufqu’à ce qu’ils
le fuivent à l’endroit où le gibier eft caché : ce qu’il
fait dans l’efpérance d’en avoir fa part & d’en boire
le fang ; cependant il feroit imprudent de Suivre les
indications de cet oifeau fans être bien armé, vû
' qu’il conduit fouvent les chalfeurs vers l’endroit où
eft quelque gros Serpent, ou quelqu’autre animal
dangereux.
PIPOT, f. m. ( Comm. ) on nomme ainli à Bordeaux
certaines futailles ou barrils dans lefquels on
met les miels; c’ell ce qu’on nomme ailleurs un ticr-
ÇM-Le tonneau de miel eft compoSé de quatre barriques
ou de Six pipots. Foye{ Barrique. Diction, de
commerce.
PIPRIS, f. m. ( Marine. ) c’eft une efpece de pirogue
, dont fe fervent les negres du Cap-verd &
de Guinee.
PIQUANT, ad). ( Gram. ) qui a une pointe aiguë,
comme l’epme, l’épingle , le poinçon.
Il fe dit aulfi des chofes qui affeâent le goût,
comme le Sel, le vinaigre, le Suc des fruits non
murs, le vin nouveau de Champagne. Au figuré
une femme eû piquante, lorfqu’elle attire une attend
tion vive de la part de ceux qui la regardent, par fa
fraîcheur, fa légéreté, l’éclat de fon tein, la vivacité
de fes y eux , fa jeunefle.
Un mot éft piqiiant, lorfqu’il nous reproche.d’une
maniéré forte quelque défaut ou réel ou de préjugé.
On diroit peu de ces mots, Si l’on n’oublioit qu’il
n’y en a aucun qui ne pût nous être rendu.
Piquant , S. m.(Botan. ) ce mot fe dit des pointes,
ou groffes épines qui viennent au tronc, aux
tiges.,.aux feuilles de certains arbriffeaux & de certaines
plantes, à l’opicatia , par exemple, aux chardons
; aux feuilles de houx, &c.
PIQUE , f. f. ( Art milït.) arme offenfive qui eft
compoféè d’une hampe ou d’un manche de bois long
de douze pu quatorze piés , ferré par un bout d’un
fer plat & pointu , que l’on appelle lance.
Celles qu’on voit dans les monumens faits du tems
des empereurs romains font d’environ Six piés & demi
de longueur en y comprenant le fer. Celles des
Macédoniens étoient infiniment plus longues , puisque
tous les auteurs Raccordent à leur donner quatorze
coudées , c’eft-à-dire vingt-un piés de longueur.
On conçoit difficilement comment ils pou-
voient manier avec dextérité avantage une arme
de cette portée.
On dit que ce nom vient de pie, oifeau dont le bec
eft fi pointu qu il perce les arbres ou le bois comme
une tarriere. Ducange le dérive de pice, qu’on a dit
dans la baffe latinité ,•& queTurnebe croit avoir été
dit quajifpica , à caufe qu’il relfemble à une efpece
d’épi de blé. Oélavio Ferrari le dérive de fpicula.
Fauchet dit que la pique a donné le nom aux Picards
& à la Picardie , qu’il prétend être moderne & être
venu de ce que les Picards ont renouvelle l’ufage de
la pique , dont le nom eft dérivé de piquer, félon cet
auteur.
La pique a ete long-tems en ufage dans l’infanterie
pour foutenir l’effort ou l’attaque de la cavalerie :
mais à préfent on l’a fupprimée, & on y à fubftitué
la bayonnette que l’on met ou que l’on ville au bout
de la carabine ou du moufquet. B a y o n n e t t e .
^Cependant la pique eft encore l’arme des officiers
d infanterie. Ils combattent la pique en main , ils fanent
avec la pique, & c . Pline dit que les Lacédémoniens
ont ete les inventeurs de la pique. La phalange
macédonienne étoit un bataillon de piquiers. Foyer
Phalange.
Ce n eft que fous Louis XI. que l’infanterie fran-
çoife commença à être armée de piques , halebardes ,
pertuifanes & autres armes de longueur ; on entremêla
enfuite des fufiliers dans les bataillons, & cef
n’eft qu’au commencement du régné de Louis X IV.
que l’infanterie a quitté abfolument l’ufage de la pique
pour les armes à feu.
PlQUE, ( Commerce. ) on dit traiter à la pique avec
les fauvages , pour dire f aire commerce avec ces nations
en le tenant fur fes gardes, & , pour ainfi parler,
la pique à la main. On traite particulièrement de la
forte avec quelques lauvages voifins du Canada &
avec quelques negres des cotes d’Afrique fur la bonne
foi & la modération apparente defquels il y a peu à
compter.
Traiter à la pique s’entend auffi du commerce de
contrebande que font les Anglois & les Hollandois
dans plufieurs endroits de l’Amérique efpagnole voifins
des colonies , que ces deux nations ont dans les
îles Antilles. Peut-être faudroit-il dire traiter à pic ,
c eft-à-dire le vaiffeau fur les ancres , parce que ce
commerce qui eft défendu fur peine de la vie , ne fe
fait que dans les rades où les vaiffeau^,relient à l’ancre,
& attendent les marchands efpagnols qui quelquefois
en cacheté , mais le plus fouvent d’intelligence
avec les gouverneurs & officiers du roi d’Ef-
pagne , viennent échanger leur o r , leurs piaftres,
leur cochenille & autres riches productions du pays
contre des marchandifes d’Europe.
■' Ceux qui veulent qu’on dife en cette occafion traiter
etr à la pique, entendent que c ’eft: traiter à la longueur
de la pique à caufe d’ime certaine diltance à laquelle
les étrangers font obligés de fe tenir pour faire ce
commerce, ne leur étant jamais permis d’entrer dans
les portis ; & n’étant même foufferts dans les rades
que par une efpece de collufion ; car il y a des arma-
dilles ou vaiffeaux de guerre qui veillent ou doivent
veiller fans ceffe, pour empêcher ce négoce vifible-
ment préjudiciable à celui que les Efpagnols d’Europe
font en Amérique par leur flotte & leurs gal-
lions. Dict. de commerce.
P i q u e , f. m . terme de Cartier, g r o s p o in t n o i r q u ’ on
m e t lu r le s ca rte s à j o u e r , & q u i a é té a p p e llépique,
p a r c e q u ’ il a q u e lq u e r e ffem b la n c e a v e c le f e r d’une
pique ; a in fi o n d it jo u e r d e pique , to u r n e r d e pique
, &c. •
P i q u e dé MbNTVALiER, ( Géog. mod. ) ou la
pique en un feul mot ; c’eft la plus haute montagne
des Pyrénées , & qui paroît s’élever en forme de pique
d’où lui vient Ion nom. On la voit de 15 Heues
iiir les confins du diocefe de Couferans. Longit. iyd.
tzL 3 , 3 latit. 42d. 5o'. 4 ^ 1 (D . J .)
PIQUÉ fe d it d’u n f ru it t e l q u e le g lan d o ù la c h â ta
ig n e q u i a y a n t fé jo u rn e fur la t e r r e font piqués des
V e r s ? c e q u i le s r en d in fé c o n d s .
On dit auffi qu’uh fruit eftpiqué, fur-tout les abri-
tots', les prunes & les poires , quand les vers y ont
fait des ouvertures pour y pénétrer.
P lQ U E , adj. en Mujique, ce mot indique des fons
fecs & bien détachés, & s’applique particulièrement
aux inftrumens à archet. (6 )
PïQÜÉ , le poil piqué, voye£ PoiL.
P lQ U E , en terme de Brodeufe * c’eft UH point l’un
devant l’autre fans mefiire, ni compte des fils, il fe
répété a côté l’un de l’autre jufqu’à ce que la feuille
ou telle autre partie foit remplie. Il faut pour faire
un beau piqué que les points foient drus & égaux en
hauteur.
PIQUECHASSE, f. m-, terme d*Artificier, c’eft un
poinçon aigu & menu , qui fert à percer les chaffes
ou facs à poudre , pour ouvrir des communications
aux feux qu’elles doivent donner aux artifices qu’elr
les font partir.
PIQUER, v. a. ( Manufacture, ) ce terme eft d’un
aflëz grand ufage dans les manufkûures & les communautés
des arts & métiers.
Les tapiffiers piquent des matelats, des couvertures
ou courtepointes ; des chantournés & des dedans
& doublures de lits, ils piquent auffi des matelats d’ef-
pace en efpaee avec une longue aiguille de fer, de la
ficelle & des flocons de coton, pour les dreffer & arrêter
la laine entre les toiles ; ils piquent d’autres matelats
avec de la foie & fur des deffeins donnés par
les deffinateurs pour leur fervir d’ornement.
Les Tailleurs pour femmes piquent des corps dé
jupe & des corfets entre de la baleine pour les affermir.
Les Ceinturierspiquent des baudriers & ceinturons
avec de I4 fo ie , de l’or & de l’argent pour les enrichir,
&c.
Les faifeufes de bonnets les piquent, en y faifant
avec l’aiguille plufieurs petits points quarrés en oeil
de perdrix ou autrement.
Piquer, V. aél. (Charp.& Maçon.) piquer en Charpenterie
, c’eft marquer un piece de bois, pour la
tailler & la façonner. Piquer en Maçonnerie , c’eft
rulliquer le parement ou les lits d’une pierre ? c’eft-
à-dire que pifiur fignifie en fait de moilon lé tailler
grojfierement; on emploie le moilon piqué de la forte
aux voûtes dé cavés , aux puits & aux mûrs de clôture.
Piquer fignifie auffi^irc furies matériaux defti-
nesà la conftruélion extérieure les bâtimenSj les petits
■ points ou creux néceffaires pour leur fervir d’ornement
; on pique de cette maniéré la pierre de taille,
Tome X I I%
le grès & le moilon particulièrement p ou r Tordra
tofcah. (D . J .)
PIQUER , terme de Bourrelier, &c. qui ûgnifie faire
avec du fil blanc une efpece de broderie fur d ifférentes
parties dç harnois de chevaux de caroffe. Ils fe fervent
pouf cela d’une alêne plus fine que les autres*
qu’ils appellent alêne à piquer, ôcpaffent dans les trous
du fil de Cologne en plufieurs doubles qu’ils frottent
de cire.
Piquer j en terme de Cordonnier -, c’eft faire des
rangs de points tout-autour de la première femellé
d’unfoulièr. ( Z ) . / . )
Piq u e r l a b o t t e , (même métier. ) e’eft coudre
avec du fil blanc le tour aes talons couverts.
Piquer, terme de Dccoupeur, c’eft enlever avec urt
fer quelque partie d’une étoffe, & y faire une quantité
de petites mouchetures. On pique de cette maniéré
les latins , les taffetas , les draps & les cuirs,
particulièrement ceux qui font parfumés, & dont on
fait quelques ouvrages pour l’ufage des daines tels
que font des corps de jupe & de fouliers. ( D. J. )
_ P lQU ÈR , en terme d'Epinglier, c’eft percer les papiers
à diftances égales & en plufieurs endroits pouf
y attacher les épingles ; ce qui fe fait avec un poini
çon qui a autant de pointes, c’eft-à-dire vingt-cinq*
que Ton veut percer de trous : le papier eft ployé en
quarrés doubles que l’outil perce à4a-fois. Voye^ les
fig. & les PI. de P Epinglier ; cé poinçon s’appelle
quarteron.
Piq u e r , v. a£l. terme de Manège, c’eft donner de
l’éperon au cheval pour lé faire aller plus vîte ; cou4
rir ou galoper.
P iq u e r des d e u x , (Maréchalieriei) c’eft la même
chofe effappuyer. F?yeç A p p u y e r .
P lQU ER UN C H E V A L , en terme de Maréchal, e’eft
le bleffer avec un clou en le ferrant.
O n appelle felle à piquer une felle à tfo u ffequ in ,
dans laquelle on eft tellement engagé qù’on peut fou-
tenir les fecOuffeS que donnent les fauteurs ylorfqu’on
les pique av ec le poinçon. Foye{ Po in ç o n .
Piq u e r , en terme de Pâtifjier, c’eft faire de petits
trous fur une piece pour lui donner plus belle apparence.
Piq u e r , en terme de Piqueur de tabatière, c’ëft perc
er avec une aiguille la piece pour la garnir enfuité
de clous d’o r , d’argent, &c. Foyt{ A ig u il l e &
G a r n ir .
P iq u e r les cartons, ( Relieur.) c’eft faire trois trous
en triangle vis-à-vis chaque nerfou ficelle auxquelles
le livre eft coufu. On pique avec un poinçon proportionné
félon la groffeur des ficelles. On dit piquer le
Carton.
P lQU ER la viande , ( Rotiffeur.) ce mot fignifie ia
larder proprement, & la couvrir entièrement dé
petits lardons ou morceaux de lard, conduits également
avec la larcJoire. -
Piq u e r , ( Serrurerie. ) c’eft tracer les places où
doivent être pofées les pièces & garnitures d’une ferrure.
Piq u e r , n’eft autre chofe en termt de Sucrerie,
que de démonceler à coups de pique. Foyer Piq u e .
Les matières trop maftiquées dans le bac à fueré*
Foyei Ba c a su c r e .
^ P iq u e r -, JmêmeManufacture.) eft une operation
par laquelle on fait des trous dans toute l’étendue de
la terre & qui en traverfent toute i’épaiffeuh Plus
on fait de cés trous, plus la terre fe nettoie aifëment.
P lQU ER une futaille, f Tonnelier. ) fe dit de la petite
ouverture que le tonnelier, le marchand de v in,
ou le cabaretier y font avec le foret, pour effayer
& goûter le vin, foit pour le vendre, foit pour le
mettre en perce. ( D. J. )
PIQUET, f. m. Foye^ PtEÜ, ( Gramm. ) c’eft lia
bâtpn pointu par-un bqut, gros & long à proportion
N N n n