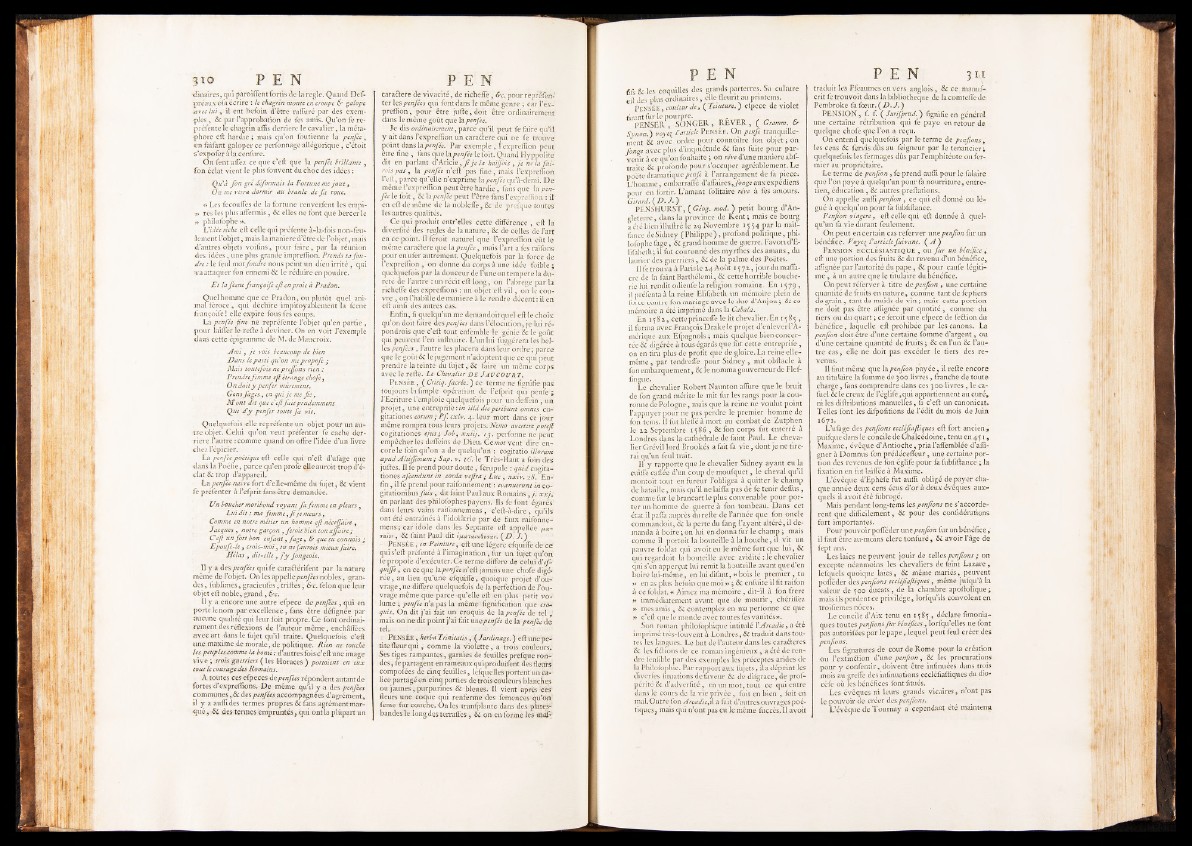
binaires, qui paroïffent fortis de la réglé. Quand Def-
préaux ola écrire : le chagrin monte en croupe & galope
avec lu i, il eut befoin d’être raffuré par des exemples
, 6c par l’approbation de Tes amis. Qu’on fe repréfente
le chagrin aflis derrière le cavalier, la métaphore
eft hardie ; mais qu’on foutienhe la penfée,
en faifant galoper ce perfonnage allégorique, c ’étoit
s ’expofer à la cenfure.
On fent affez ce que c’eft que la penfée brillante ,
•fon éclat vient le plus fouvent du choc des idées :
Qu'à fort gre déformais la Fortune me joue ,
On trie verra dormir ail branle de fa roue.
« Les fecouffes de la fortune renverfent les empi-
•» res les plus affermis , 6c elles ne font que bercer le
philofophe ».
L’idée riche efl; celle qui prefente à-la-fois non-feulement
l’objet, mais la maniéré d’être de l’objet, mais
d’autres objets voifins , pour faire, par la réunion
des idées, une plus grande impreflïon. Prends ta foudre
: le feul mot foudre nous peint un dieu irrité , qui
va attaquer fon ennemi 6c le réduire en poudre.
Et lafeene françoife efl en proie à P radon.
Quel homme que ce Pradon, ou plutôt quel animal
féroce, qui déchire impitoyablement la feene
françoife ! elle expire fous fes coups.
La penfée fine ne repréfente l’objet qu’en partie ,
pour laiffer le refte à deviner. On en voit l’exemple
dans cette épigramme de M. de Maucroix.
Ami , je vois beaucoup de bien
Dans le parti qu’on me propofe ;
Mais toutefois ne prejfons rien :
Prendre femme efl étrange chofe,
On doit y p enfer mûrement.
Gens fages, en qui je me fie ,
M’ont dit que c'cfl fait prudemment
Que d'y penfer toute fa vie.
Quelquefois elle repréfente un objet pour un autre
objet. Celui qu’on veut préfenter fe Cache derrière
l’autre : comme quand on offre l’idée d’un livre
chez l’épicier.
La penfée poétique eft celle qui n’eft d’ufage que
dans la Poéfie, parce qu’en profe elle auroit trop d’éclat
6c trop d’appareil.
La penfée naïve fort d’elle-même du fujet, & vient
fe préfenter à l’efprit fans être demandée.
Un boucher moribond voyant fa femme en pleurs ,
Lui dit : ma femme ,Ji je meurs,
Comme en notre métier un homme efl néceffaire ,
Jacques , notre garçon , feroit bien ton affaire;
C'ejl ùn fon bon enfant, fig e , & que tu connois j
Epoufe-le , crois-moi , tu n e f aurais mieux faire.
Hélas , dit-elle , j'y fongeois.
Il y a dts penfées qui fe caraftérifent par la nature
même de l’objet. On les appellepenfées nobles, grandes
, fublimes, gracieufes, trilles, &c. félon que leur
objet efl noble, grand, &c.
Il y a.encore une autre efpece de penfées , qui eh
porte le nom par excellence, fans être défignée par
aucune qualité qui leur foit propre. Ce font ordinairement
des réflexions de l’auteur même, enchâffées
avec art dans le fujet qu’il traite. Quelquefois c’ eft
line maxime.de morale, de politique. Rien ne touche
les peuples,comme la bonté : d’autres fois c’eft une image
vive ; trois guerriers ( le s Horaces ) portoient en eux
tout le courage des Romains.
A toutes ces efpeces de penfées répondent autant de
fortes d’expreflions. De même qu’il y a des penfées
communes, 6c des penfées accompagnées d’agrément,
il y a auflides termes propres & fans agrément marqué,
ÔC. dçstermes 'empruntés, qui ont la plupart un
caraftere de vivacité, de richeffe, &c. pour repféfen-
ter les penfées qui font dans le même genre ; car l’ex-
preflion, pour être jufte, doit être ordinairement
dans le même goût que lapenjée.
Je dis ordinairement, parce qu’il peut fe faire qu’il
y ait dans l’expreflion un cara&ere qui ne fe trouve
jjoint dans la penfée. Par exemple , Texpreflion peut
etre fine , fans que la penfée leloit. Quand Hyppolite
dit en parlant d’Arid e, ƒ je la hmffois, je ne La fui-
roispas, la penfée n’eft pas fine, mais l’expreffion
l’eft, parce qu’elle n’exprime la penfée qu’à-demi. De
même l’expreflion peut être hardie, fans que la penfée
le foit, 6c Va penfée peut l’ être fans l’expreflion : il
en eft de même de la nobleffe, & de prefque toutes
les autres qualités.
Ce qui produit entr’ elles cette différence , eft la
diverfité des réglés de la nature, 6c de celles de l’art
en ce point. Il feroit naturel que l’exprelîion eut le
même caraélere que la penfée, mais l’art a fes raifons
pour enufer autrement. Quelquefois par la force de
l’expreflion , on donne du corps à une idée foible ;
quelquefois par la douceur de l’une on tempere la dureté
ae l’autre : un récit eft long, on l’abrege par la
richeffe des expreflions : un objet eft v i l , on le couvre
, on l’habille de maniéré à le rendre décent : il en
eft ainfi des autres cas.
Enfin, fi quelqu’un me demandoitquel eft le choix
qu’on doit faire des penfées dans l’élocution, je lui répondrais
que c’eft tout enfemble le génie 6c le goût
qui peuvent l’en inftruire. L’un lui fuggérera les belles
penfées, l’autre les placera dans leur ordre ; parce
que le goût 6c le jugement n’adoptent que ce qui peut
prendre la teinte du fujet, 6c faire un même corps
avec le refte. Le Chevalier d e J a u c o u r t .
Pensée, ( Critiq. facrée. ) ce terme ne fignifie pas
toujours la fimple opération de l’efprit qui penfe ;
l’Ecriture l’emploie quelquefois pour un deffein, un
projet, une entreprile : in illd dieperibunt omnes co-
gitationes eorum ; P f. cxlv. 4. leur mort dans ce jour
même rompra tous leurs projets. Nemo avertere potejl
cogitationes ejus; Job, xxiij. 13. perfonne ne peut
empêcher les deffeins de Dieu. Ce mot veut dire encore
le foin qu’on a de quelqu’un : cogitatio illorimt
apud Altijfimum; Sap. v. 16. le Très-Haut a foin des
jultes. Il fe prend pour doute, fcrupule : quid cogitationes
afeendunt in corda veffra ; Luc , xxiv, 28. Enfin
, il fe prend pour raifonnement : evanuerunt in co-
gitationibus fuis , dit faint Paul aux Romains ,/ . x x ji
en parlant des philofophes payens. Ils fe font égarés
dans leurs vains raifonnemens , c’eft-à-dire, qu’ils
ont été entraînés à l’idolâtrie par de faux raifonnemens
; car idole dans lès Septante eft appellée pa.-
tclÏov , 6c faint Paul dit ipciTcud>ù»<rctv. ( Z>. /. )
• Pensée , en Peinture, eft une légère efquiffe de ce
qui s’eft préfenté à l’imagination, fur un fujet qu’on
fe propofe d’exécuter. Ce terme différé de celui d’efquiffe
, en ce que fopenfée n’ eQ. jamais une chofe digérée,
au lieu qu’une efquiffe, quoique projet d’ouvrage,
ne différé quelquefois de la perfection de l’ôu-
vrage même que parce qu’elle eft en plus petit volume
; penfée n’a pas la même fignification que croquis.
On dit j’ai fait un croquis de la penfée de tel
mais on ne dit point j’ai fait une penfée de la penféede
tek.;, .
PENSÉE, herba Trinitatis , ( Jardinage. ) eft une-pé-
tite fleur q u i, comme la violette, a trois couleurs.
Ses tiges rampantes, garnies de feuilles prefque rondes,
fe partagent en rameaux qui produifent des fleurs
compofëes de cinq feuilles, lefquellefc portent un Calice
partagé en cinq parties de trois couleurs blanches
ou jaunes, purpurines & bleues. Il vient après:eès‘
fleurs une coque qui renferme des femences qu’on
feme fur couche,. On les tranfplante dans des plates«'
bandes le- long des terraffes, ôc o n en forme les maTfifs&
les coquilles des grands parterres. Sa culture
eft des plus ordinaires, elle fleurit .auprintems.
Penser, ctmkur4ç:, . (Teinture.') «%ece.de violet
tirant fur le pourpre. __
PENSER , SONGER , R Ê V E R , ( Gramm. &
Synon.) voye{ l'article Pensée. On penfe tranquillement
6c avec ordre pour connoître fon objet ; on
fonge avec plus d’inquiétude 6c fans fuite pour parvenir
à ce qu’on fouhaite ; on rêve d’une maniéré abf-
traite 6c profonde pour s’occuper agréablement. Le
poète dramatique penfe à l’arrangement de fa piec.e.
L’homme, embarraffé d’affaires,jongeauxexpédiens
pour en fortir. L’amant folitaire rêve à fes amours.
Girard. (D . J. )
PENSrtURST, ( Géog. mod. ) petit bourg d’Angleterre
, dans la province de Kent ; mais ce bourg
a été bien illuftré le 19 Novembre 1554 par la naif-
fance deSidney ( Philippe), profond politique, philofophe
fage, 6c grand homme de guerre. Favori d’E-
lifabeth; il fut couronné des myrthes des amans, du
laurier des guerriers, ôc de la palme des Poètes.
Il fe trouva à Paris le 24 Août 157Z, jour du maffa-
cre de la faint Barthélemi, & cette horrible boucherie
lui rendit odieufe la religion romaine, En 1579,
il préfenta à la reine Elifabeth un mémoire plein de
force contre fon mariage avec le duc d’Anjou ; & ce
mémoire a été imprime dans la Cabala.
En 15 8 2, cette princeffe le fit chevalier. En 15 8 5 ,
il forma avec François Drake le projet d’enlever l’Amérique
aux Efpagnols ; mais quelque bien concertée
& digérée à tous égards que fut cette entreprife,
on en tira plus de profit que de gloire. La reine elle-
même , par tendreffe pour Sidney, mit obftacle à
fon embarquement, &c le nomma gouverneur de Flef-
fmgue.
Le chevalier Robert Naunton affure que le bruit
de fon grand mérite le mit fur les rangs pour la couronne
de Pologne, mais que la reine ne voulut point
l’appuyer pour ne pas perdre le premier homme de
fon tems. 11 futbleffé à mort au combat de Zutphen
le 22 Septembre 1586, & fo n corps fut enterré à
Londres dans la cathédrale de faint Paul. Le chevalier
Grévil lord Brookés a fait fa v ie , dont je ne tirerai
qu’un feul trait.
Il y rapporte que le chevalier Sidney ayant eu la
cuiffe caffée d’un coup de moufquet, le cheval qu’il
montoit tout en fureur l’obligea à quitter le champ
de bataille, mais qu’il ne laiffa pas de fe tenir deffus,
comme fur le brancart le plus convenable pour porter
un homme de guerre à fon tombeau. Dans cet
état il paffa auprès du refte de l’armée que fon oncle
commandoit, & la perte du fang l’ayant altère, il demanda
à boire ; on lui en-donna fur le champ ; mais
comme il portoit la bouteille à la bouche, il vit un
pauvre foldat qui avoit eu le même fort que lui, &
qui regardoit la bouteille avec avidité : le chevalier
qui s’en apperçut lui remit la bouteille avant que d’en
boire lui-même,, en lui difant, « bois le premier, tu
» en as plus befoin que moi » ; & enfuite il fit raifon
à ce foldat. « Aimez ma mémoire , dit-il à fon frere
» immédiatement avant que de mourir, cheriffez
» mes amis , & contemplez en ma perfonne ce que
» c’eft que le monde avec toutes fes vanités ».
Son roman philôfophique intitulé l’Arcadie, a ete
imprimé très-fouvent a Londres, 6c traduit dans toutes
les langues. Le but de l’auteur dans les caraâeres
6c les fictions de ce roman ingénieux, a été de rendre
fenfible par des exemples les préceptes arides de
la Philofophie. Par rapport aux fujets, il a dépeint les
diverfes ntuations défaveur 6c de dilgrace, de prof-
périté 6c d’adverfité, en un mot, tout ce qui entre
dans le cours de la vie privée, foit en bien , foit en
mal. Outre fon Arcadie,il a fait d’autres ouvrages poétiques,
mais qui n’ont pas eu le même fuccès. Il avoit
traduit les Pfeaumes en vers anglois, & ce manuf-
crit fe trouvoit dans la bibliothèque de la comteffe de
Pembroke fa foeur. ( D . J. )
PENSION, f. f. ( Jurifprud. ) fignifie en général
une certaine rétribution qui fe paye en retour de
quelque chofe que l’on a reçu.
On entend quelquefois par le terme de penfions,
les cens 6c fèrvis dus au feigneur par le tenancier ;
quelquefois les fermages dûs par l’emphitéote ou fermier
au propriétaire.
Le terme de penjion, fe prend aufii pour le falaire
que l’on paye à quelqu’un pour fa nourriture, entretien,
éducation, 6c autres preftations.
On appelle aufli penjion , ce qui eft donné ou légué
à quelqu’un pour la fubfiftance.
Penjion viagère, eft celle qui eft donnée à quelqu’un
fa vie durant feulement.
On peut en certain cas referver une penjion fur un
bénéfice. V°ye{ l'article fuivant. ( A )
Pension ecclésiastique , ou J ’ur un bénéfice ,
eft une portion des fruits 6c du revenu d’un bénéfice,
afîignée par l’autorité du pape, 6c pour caufe légitime
, à un autre que le titulaire du bénéfice.
On peut réferver à titre de penjion , une certaine
quantité de fruits en nature, comme tant de feptiers
de grain, tant de muids de vin ; mais cette portion
ne doit pas être affignée par quotité, comme du
tiers ou du quart ; ce feroit une efpece de feôion du
bénéfice, laquelle eft prohibée par les canons. La
penjion doit être d’une certaine fomme d’argent, ou
d’une certaine quantité de fruits ; 6c en l’un 6c l’autre
cas, elle ne doit pas excéder le tiers des revenus.
Il faut même que la penjion payée, il refte encore
au titulaire la fomme de 3 00 livres, franche de toute
charge, fans comprendre dans ces 300 livres , le ca-
fuel & le creux de l’églife ,qui appartiennent au curé,
ni les diftributions manuelfes, fi c’eft un canonicat.
Telles font les difpofitions de l’édit du mois de Juin
1671.
L’ufage des penjions eccléjiajliques eft fort ancien,
puifque dans le concile de Chalcédoine, tenu en 45 1 ,
Maxime, évêque d’Antioche, pria l’affemblée d’afli-
gner à Domnus fon prédéceffeur, une certaine portion
des revenus de fon églife polir fa fubfiftance ; la
fixation en fu t labiée à Maxime.
L’évêque d’Ephèfe fut aufli obligé de payer chaque
année deux cens écus d’or à deux évêques auxquels
il avoit été fubrogé.
Mais pendant long-tems les penjions ne s’accordèrent
que difficilement, 6c pour des confidërations
fort importantes.
Pour pouvoir pofféder une penjion fur un bénéfice ,
il faut être au-moins clerc tonfuré, 6c avoir l’âge de
fept ans.
Les laïcs ne peuvent jouir de telles penjions ; on
excepte néanmoins les chevaliers de faint Lazare ,
lefquels quoique laïcs, 6c même mariés, peuvent
pofféder des penjions eccléjiafliques, même jufqu’à la
valeur de 500 ducats, de la chambre apoftolique;
mais ils perdent ce privilège, lorfqu’ils convolent en
troifiemes noces.
Le concile d’Aix tenu en 1585, déclare fimonia-
ques toutes penjions fur bénéfices, lorfqu’elles ne font
pas autorifées par le pape, lequel peut feul créer des
penjions. .
Les fignatures de cour de Rome pour la création
ou l’extinftion d’une penjion, 6c les procurations
pour y confentir, doivent être infinuées dans trois
mois au greffe des infinuations eccléfiaftiques du dio-
cèfe où les bénéfices font fitués.
Les évêques ni leurs grands vicaires, n’ont pas
le pouvoir ae créer des penjions. /
L’évêque de Tournay a cependant ete maintenu