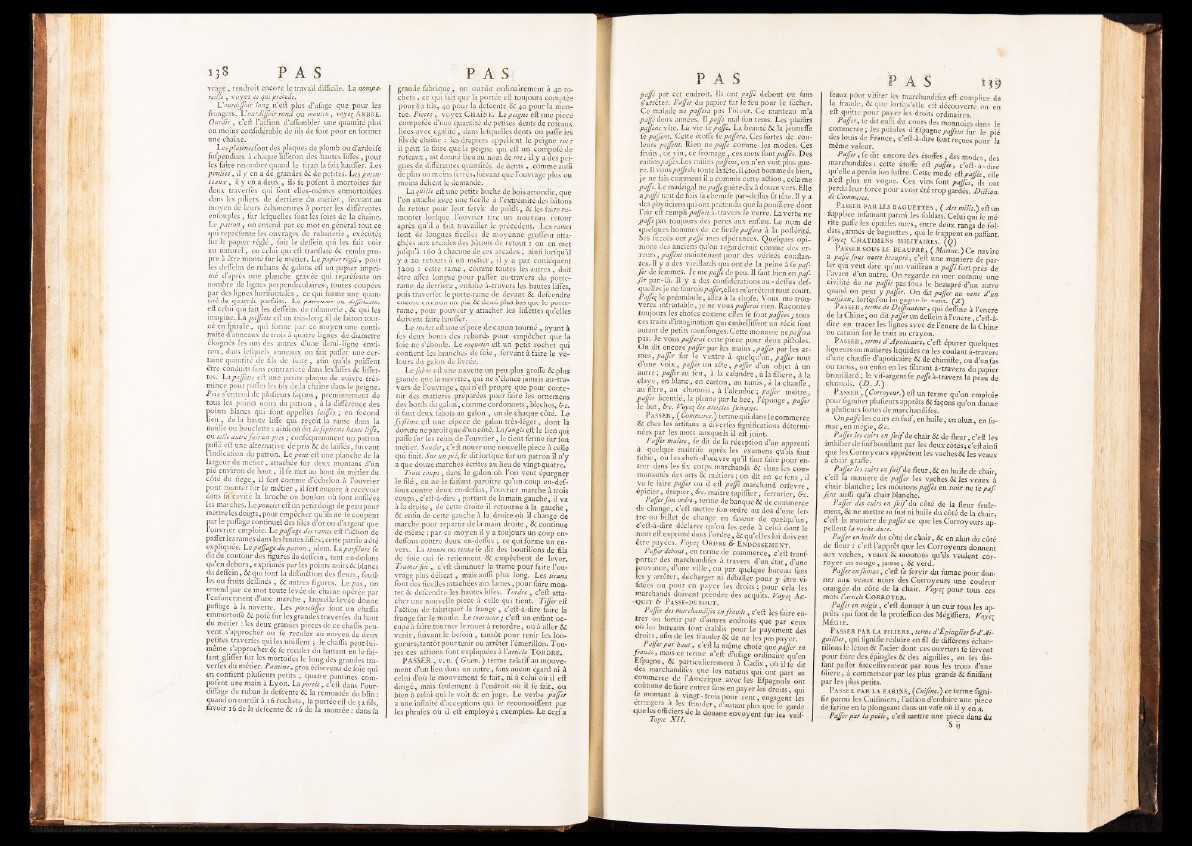
virage, rendroit encore le travail difficile. La nompa-
reiUe , voyez ce qui précède.
Uourd'ijfoir lofig. n’eft plus d’ufage que pour les
frangers. Idourdiffoir rond ou moulin, voye^ A rbre.
Ourdir, c’eft l’qdïiôn (fiafiémbler une quantité plus
pu moins confidérable de fils de foie pour en former
une chaîne.
LespUùnesfont des plaques de plomb ou d’ardoife
fufpendues à chaque lifleron, des hautes liffes, pour
les faire retomber quand i,e tiran la fait hauffer. Les
poulies, il y en a de. grandes & de petites. Les poten-
ceaux, il y en a deux,, ils fe pofent à mortoifes fur
deux traverfes qui font elles-mêmes enmoitoifées
dans les piliers de,derrière du métier, fervantau
moyen de.leurs échancrures à porter les différentes
ënfouples , fur lefquelles font les foies de la chaîne.
Le patron,r on entend par ce mot en général tout ce
qui repréfente les ouvrages de rubanerie, exécutés
iur le papier réglé, foit le deffein qui les fait voir
-au naturél, ou celui qui eff tranflaté & rendu propre
à être monté fur le métier. Le papier réglé, pour
les deffeins de rubans &ç galons eff un papier imprimé
d’après une planche gravée qm repréfente un
nombre de lignes perpendiculaires , toutes coupées
par des lignes horifontalès , ce qui forme une quantité
de quafr.és parfaits. Le patroneur ou dejjinateur
eff celui qui fait les deffeins de rubanerie , & qui les
imagine.. La paJJ'ette eff un très-long fil de laiton tourne
en fpirale, qui forme par ce moyen une continuité
d’anneaux de trois à quatre lignes de diamètre
éloignés les uns des autres d’une demi-ligne environ,
dans lefquels anneaux on fait paffer une certaine
quantité de fils de fuite, afin qu’ils puiffent
être conduits fans contrariété dans îes liftes & liffet-
tes. Lapaffette eff une petite plaque de cuivre très-
mince pour paffer les fils de,la chaîne dans le peigne.
Pris s’entend de plufieurs façons, premièrement de
tous les, points noirs du patron , à la différence des
points blancs qui font appellés laiffés ; en fécond
lieu , de la haute liffe qui reçoit la rame dans la
maille ou bouclette : ainfi on dit lafeptieme haute liffe,
ou telle autre fait un pris ; conféquemment un patron
paflé eff iine alternative de pris & de laiffés, luivant
l’indication du patron. Le pont eff une planche de la
largeur du métier, attachée fur deux montans d’un
pié environ de haut, il fe met au bout du métier du
côté du fiege, il fërt comme d’échelon à l’ouvrier
pour monter fur le métier , il fert encore à recevoir
dans fa' 'cavité la broche ou boulon où font enfilées
les marches. Le poucier eff un petit doigt de peau pour
mettrelesdoigts, pour empêcher qu’ils ne fe coupent
par le paffage continuel des filés d’or ou d’argent que
l’ouvrier emploie. Le paffage des rames eff l’aftion de
paffer les rames dans les hautes liffes ; cette partie a été
expliquée. Le paffage du patron, idem. La parfilure fe
dit du contour des figures du deffein, tant en-dedans
qu’en dehors, exprimés par les points noirs&blahes
du deffein, & qui font la diftinûion des fleurs, feuilles
ou fruits deffinés , &: autres figures. Le pas, on
entend par ce mot toute levée de chaîne opérée par
l’enfoncement d’une marche , laquelle levée donne
paffage à la navette. Les porteliffes font un chaffis
emmortoifé & pofé fur les grandes traverfes du haut
du métier : les deux grandes pièces de ce chaffis peuvent
s’approcher ou fe reculer au moyen de deux
petites traverfes qui les uniffent ; le chaffis peut lui-
meme s’approcher & fe reculer du battant en le fai-
fant gliffer fur les mortoifes le long des grandes traverfes
du métier. P amine, gros écheveau de foie qui
en contient plufieurs petits ; quatre pantines com-
pofent une main à Lyon. La portée, c’eft dans l’our-
diffage du ruban la defeente & la remontée du blin :
quand on ourdit à 16 rochets, la portée eff de 3 2 fils
.(avoir 16 déjà defeente & 16 de la montée : dans la
grande fabrique, on.ourdit,ordinairement à 40 rochets
, ce qui fait que la portée eff toujours comptée
pour 80 fils, 40 pour la defeente & 40 pour la montée.
Pièces , voyez C haîne. Le peigne eff une pieep
.compofée d’une, quantité de petites dents de roleaux
liées avec égalité , dans lefquelles dents on paffe les
fils de chaîne : les. drapiers appellent le peigne rot :
il peut fe faire que le peigne qui eff un çompofé de
roleaux, ait donné lieu au nom de rot : il y a des peignes
de, différentes quantités de dents ,. comme auffi
déplus ou moins ferrés, fuivant que l’ouvrage plus ou
moins délicat le demande.
La quille eff une petite bûche de bois arrondie, que
l’on attache avec une ficelle à l’extrémité des bâtons
de retour pour leur fervir de poids ,. &ç j§s faire remonter
lorfque l’ouvrier tire un ,nouveau retour
après qu’il a fait travailler le précédent. Les rames
font de longues ficelles, de moyenne groffeur attachées
aux arcades des bâtons de retour : on en met
jufqu’à 160 à chacune dé ces arcades ; ainfi lorfqu’il
y a 20 retours à un métier, il y a par conféquent
3200 : cette rame , comme toutes les autres , doit
être affez longue pour palier au-travers du porte-
rame de derrièreenfuite à-travers les hautes liffes,
puis traverfer. le porte-rame de devant & defeendre
encore environ un pie & demi plus bas que le porte-
rame , pour pouvoir y attacher les. liffettes qu’elles
doivent faire hauffer.......
Le roçhet eff. une efpçce de canon tourné , ayant à
fes deux bouts des rebords pour empêcher que la
foie ne s’éboule. Le ropuetineù. un petit ro.chet qui
contient les branches de foie , fervant à faire le yx-r
lours du galon de livrée.
Le falot eff une navette un peu plus groffe &plus
grande que la navette, qui ne s’élance jamais au-travers
de l’ouvrage, qui n’eft propre que pour contenir.
des matières préparées pour faire les ornemens
des bords du galon, comme cordonnets, bleçhes, &c,
il faut deux fabots au galon , un de chaque côté. Le
fyfléme eff une efpece de galon très-léger, dont là
dorure ne paroît que d’un côté. Lafangle eff le lien qui
paffe fur les reins d,e l’ouvrier, le tient ferme fur foii
métier. Souder, c’eft nouer une nouvelle pièce à celle
qui finit. Sur un pié, fe dit lorfque fur un patron il n’y
a que douze marches écrites au lieu de vingt-quatre.'
Trois coups, dans le galon où l’on veut épargner
le filé. , en ne le faifant paroître qu’un coup en-def-
fous .contre deux en-deffus, l’ouvrier marche à trois
coups, c’eff-à-dire , partant de la main gauche, il va
à la d roite, de cette droite il retourne a la gauche ,
& enfin de cette gauche à la droite où il change de
marche pour repartir de la main droite, & continue
de même : par ce moyen il y a toujours un coup en-
deffous contre deux en-deffus ; ce qui forme un envers.
La tenure ou tenue fe dit des bourillons de fils
de foie qui fe retiennent & empêchent de lever.
Tramer fin , c’eft diminuer la trame pour faire l’ouvrage
plus délicat, mais auffi plus long. Les tirons
font des ficelles attachées aux lames, pour faire monter
& defeendre les hautes liffes. Tordre , c’eft attacher
une nouvelle pièce à celle qui tient. Tiffer eff
l’ariion de fabriquer la frange , c’eft-à-dire foire la
frange fur le moule. Le tourneur ; c’eft un enfant occupée
faire tourner le rouet à retordre, ou à aller &
venir, fuivant le befoin , tantôt pour tenir les. longueurs,
tantôt pour tenir ou arrêter l’émerillon. Toutes
ces avions font expliquées à l 'article T ordre.
PASSER, v. n. ( Gram. ) terme relatif au mouvement
d’un lieu dans un autre, fans aucun égard ni à
celui d’oîi le mouvement fe fait, ni à celui où il eff
dirigé, mais feulement à l’endroit où il fe fait, ou
bien à celui qui le voit & en juge. Le verbe paffer
a une infinité d’acceptions qui fe reconnoiffent par
les phrafes où il eff employé ; exemples. Le ceçf a
paff par cet endroit. Ils ont paffé debout Ou foris
s’arrêter. Paffer du .papief fur le feu pour le Pécher.
C e malade ne paffera pas l’hiver. Ce manteau m’a
jpaffé deux années. Il paffe mal fon tems. Les piaifirs
paffent vite. La vie fe paffe. La beauté & la jeuneffe
fe paffent. Cette étoffe fe paffera. Ces fortes de couleurs
paffent. Rien ne paffe comme les modes. Çes
fruits, ce vin, ce fromage, ces mets fontpaffés. Des
raifinspaffés.Les raifins paffent, on n’en voit plus guère.
Il vous paffe de toute la tête. Il étoit homme debien,
je ne fais comment il a commis cette aétion, cela me
paffe. Le madrigal ne paffe guère dix à douze vers. Elle
a paflé t,ant de rois fa chenfife par-deffus fa' tête. II y a
des phyficiens qui ont prétendu que la pouffiere dont
l’air eft rempli paffoit à-travers le verre. La vertu ne
paffe pas toujours des peres aux enfans. Le nom de
quelques hommes de ce fieclepaffera à la poftérité.
Ses fuccès Ont paffé mes efpérances. Quelques opinions
des anciens qu’on regarderoit comme des erreurs
, paffent maintenant pour des vérités conflan-
tes-Il y a des vieillards qui ont de la peine à fe pafi
fe r de femmes. Je me paffe de peu. Il faut bien en paf-
ffer par-là-, Il y a des confiderations au - deffus def-
quelles je ne faurois/»<^cr,eïles m’arrêtent tout court.
Paffei le préambule, allez à la çhofe» Vous me trouverez
intraitable, je ne vouspafferai rien. Racontez
toujours les chofes comme elles fe fontpaffées ; tous
a?es traits d’imagination qui embelliffent un récit font
autant de petits meiifonges. Cette monnaie nepaflerp
pas. Je vous pafferai cette piece .pour deux piftoles.
On dit encore paffer par les mains, paffer par les armes,
paffer fur le ventre à quelqu’un, paffer tout
d’une veix^. paffer un atte, paffer d’un objet à un
autre ; paffer au feu, à la calandre, à la filiere, à là
c la y e , en blanc, en carton, au t.amis, à la chauffe,
au filtre, au chamois, à l’alepibic ; paffer maître
paffer licentié, la plume par je bec, l’éponge, paffer
le but , &c. V l e s articles fuiyans.
Passer , ( Commercp.) terme qui dans le commerce
& chez les artifans a diverfes lignifications déterminées
par les mots auxquels il eff joint.
Paffer maître, fe dit de la réception d’un apprenti
à quelque maîtrife après les examens qu’ils faut
fiibir t ©ù les chefs-d’oeuvre qu’il faut faire pour entrer
dans les fix corps marchands & .dans les communautés
des arts & métiers ; on dit pn ce fens , il
va fç faire paffer ou il eff paffé marchand orfevre
épicier, drapier, &c. maîtretapiffier, ferrurier, &ç.
Ppflerfon ordre, terme de banque & de commerce
de change, c eff mettre fon ordre au dos d’une lettre
ou billet de change en faveur de quelqu’un,
c’eff-à-dire déclarer qu’on les çede à celui dont le
nom eff exprimé dans i’ordrê, & qu’elles lui doivent
être payées. Voye.1 O rdre & Endossement.
Paffer debout, en terme de commerce t c’eft tranfi
porter des marchandifes à travers d’un état, d’une
province, d’une v ille , ou par quelque bureau fans
les y arrêter, décharger ni déballer pour y être vi-
fitées ou pour en payer les droits ; pour cela les
marchands doivent prendre des acquits; Foyer h c -
• QDIT & Pa SSEtDEIJODT.
Paffer des marchandifes en fraude, c’eft les faire entrer
ou fortir par d’autres endroits que par ceux
ou les bureaux font établis pour je payement des
droits, afin de les frauder Ôc de ne les pas payer.
Paffer par haut, c’eft la même chofe que paffer en
fraude, mais ce terme n’eft d’ufage ordinaire qu’.en
Wpagne, & particulièrement à Cadix, où ilfe dit
<les marchandifès que les nations qui ont part an
commerce de l’Amérique avec les Efpagnols ont
coutume de foire entrer fans en payer les droits, qui
, montant à vingt - trois pour cent, engagent les
etrangers à les frauder, d’autant plus que le garde
que lqs officiers de la douane envoyent ffir les vaifloijie
Al//,
■ feawp^ir yiiiter les ta g tO m ÿ& t 'tè complice i * la frande, & que loifqu’elle eft eff qintte pour payer les droits odrdéicnoauirveesr.te on en
P « icf, <C dit M® f e ç»urs des moanoies datis lè
commerce i tes p M r t i ’flpagae paflini & r le mé
■ VS W de France * ç-’eft-à-dire loat reçues pour la
meme valeur. r
■(’Æ r i f t i i t encore des étoffes -, des modes des
matehandfest cette étoffe eft pàfte, c'eft-à-’ dire
jqu’elle a perdu-fen luftre. Cette mode ettpçffé, elle
n’eft p i« , en vogue» iCes v » s font tâffh,, Hs’ ont
perdu leur force pipr avoir été trop gardés. Diction,
de Commerce•
Passer par ers b ASMÉrtES, ( Art milii.) eft un
tappltee infamant parmi les foldats. Gelui qui le mét
»te paffe Je? épaules nues, entre deux rangs de fol»
datS:, armés de baguettes, qui le frappent en paffant.
Voy% -Ckatimens m ih taires.. (Q)
Passer sous ie beaupré , ( Marine. ) C e navirê
tRe r uni veutn dojirres bqcua’iuipnr çv,a cif’feefat uu nae maniéré de par- ^ d un autre» On regarde en pmaejjr'é cfoormt mpreè su dnee Civilité 4e ne paftr fsts fô n s le beaupré d’un autre jqtHnfeép peut y P à f i r . On dit p a ff ir a u ven t d 'u fi
yaiffeau, lorfqu’onluv gagne le vent. (Z)
Passer , terme ie Pejjim tevr, qui deffine à Itencrê
de la Chine ; on dit poftr un deffein à l’encre c’etl-à;
dire en tracer les lignes avec de l’encre de la Chine
ou carmin fur l.e trait an cray-om.
Passer , ttrmt d'Apoùcain, c’eft épùrër Quelques
ligueurs ou matières tequides ea les coulant àrtravers
d’une chauffe d’appticaire & de chimifte, ou d’unfas
ï>u tamis; ou eufrn en les Sltrant à-travers du papief
brouillard ; le vif-argent fe poJJ't à-travers la peau de
ichampis. (JO. /.)
poPura lsisgenrif i,e (r, Çpolurfrioejutursr .a)p epfrtê utsn & te rfmaçeo nqsu q’oun’o nem dopnloniee
plufieurs fortes de marchandifes. - maOcn, petai fmfeé lgesie c, uirs en;■ fuif, en huile, en alun, enfu»
imPbfitbJJeprr d lees f ioeiiifrbsp eunil fiaunitf pi ear c hleasi rd &eu xd ec ôftléesu ;r ç,e’e’fetf at inlefsi àq uceh aleirs Cgroarffreo.yeurs apprêtent les Vaches& les veaux
ç|’e Pfta fTfa* rm éeasn ciéurirés ,edne f u i f de fleur , & en huile de chair, chair blanche ; les mpaofufetor nlse s yaches & les veaux à paffés en noir ne fe p a f
fint auffi. qu’à chair blanche.
Paffer des cuirs en fu i f du côté de la fleur feulement,
<§£ ne mettre ni fuif ni huile du côté de la chair,
e’eff la maniéré de paffer ce que les Corroyeurs appellent
la vache dure.
Paffer en huile du côté de chair, & en alun du côté
de fleur : c’ eft l’apprêt que les Corroyeurs donnent
aux vaches, yeaux &ç moutons qu’ils veulent corroyer
en rouge, jaifne, & verd.
Pqffer enfiimac, ç ’eft fe feryir du fumac polir donner
aux veaux noirs des Corroyeurs une couleur
orangée du côté de la chair. Foye^ pour tous ces
mots C article CORROYER.
prêPtas ffqeuri e fno mnté gdiee ,l aé ’perfot fdeoffninoner d àe su Mn céugiifrf tieoruss; les apFoyer
Mégie. • 1
P ASSER PAR LA FILIERE, terme d'Épinglier & d'Ai-
tgiulliollniesr l,e q îuéti ofnig n&if ile’a rcéiedru diroen etn c feils odeu vdriifeférrse fnès féecrvheannt
spaonut rp faofifreer dfeusc céepfifniyg.leems e&nt dpeasr atioguusi llleess, treonu sle sd ’ufanie
fpialire lrees, pàl ucso mpemtietsn.ce* par lés plus grands & finiffant
fie Ppaarsmsei rl epsa Cru lifain fiaerrsi,n le’a,é (tiCounif dîr’ieen.)d cueir tee urmnee pfiigencie
de farine en la plongeant dans un vafe où il y en a.
Paffer par la poêle, e’eft mettre ime pSieijce dans du