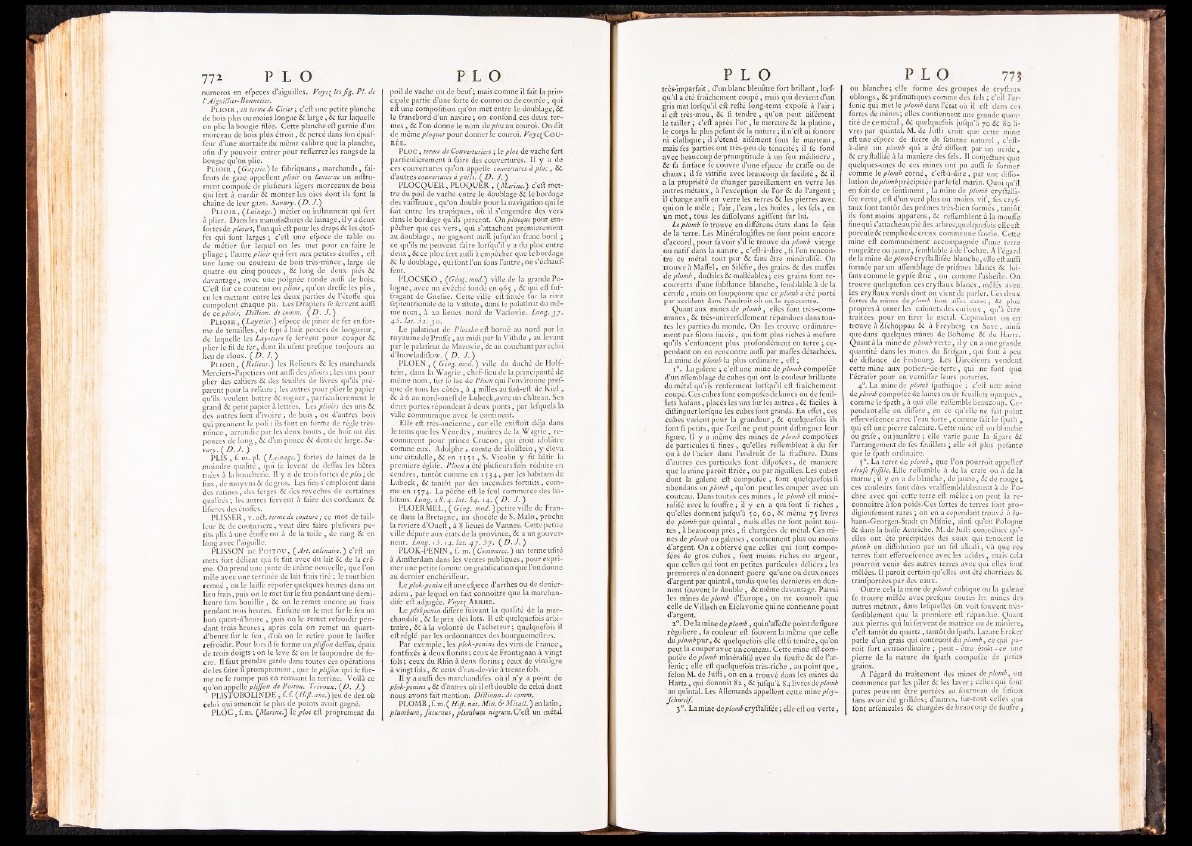
numéros en efpeces d’aiguilles. Voye^ les fig. Pl. de
VAiguillier-B onnetier.
P l i o i r , en terme de Cirier ; c’eft une petite planche
de bois plus ou moins longue 6c large, 6c fur laquelle
on plie la bougie filée. Cette planche eft garnie d’un
morceau de bois plùs étroit, 6c percé dans fon épaif-
feur d’une mortaife du même calibre que la planche,
afin d’y pouvoir entrer pour refferrer les rangs de la
bougie qu’on plie.
P l i o i r , (Galerie!) le fabriquans , marchands, fai-
feurs de gaze appellent plioir ou lanterne un infiniment
compofé de plufieurs légers morceaux de bois
qui fert à ourdir 6c monter les oies dont ils font la
chaîne de leur gaze. Savary. (D. J.)
P l i o i r , (Lainage.) métier ou infiniment qui fert
à plier. Dans les manufactures de lainage, il y a deux
fortes de pHoirs, l’un qui eft pour les draps 6c les étoffes
qui font larges ; c’eft une el'pece de table ou
de métier fur lequel on les met pour en faire le
pliage ; l’autre plioir qui fert aux petites étoffes, eft
une lame ou couteau de bois très-mince, large de
quatre ou cinq pouces, 6c long de deux piés 6c
davantage, avec une poignée ronde aufli de bois,
C ’eft fur ce couteau ou plioir, qu’on dreffe les plis,
en les mettant entre les deux parties de l’étoffe qui
eompofent chaque pli. Les Drapiers fe fervent aufli
de ce plioir. Diction, de comm. (D . J .)
P l i o i r , (Layetier.) efpece de pince de fer en forme
de tenailles, de fept a huit pouces de longueur,
de laquelle les Layetiers fe fervent pour couper &
plier le fil de fer , dont ils ufent prefque toujours au
lieu de doux. (D . J .)
P l i o i r , (Relieur.) les Relieurs & les marchands
Merciers-Papetiers ont aufli des plioirs ; les uns pour
plier des cahiers 6c des feuilles de livres qu’ils' préparent
pour la reliure ; les autres pour plier le papier
qu’ils veulent battre 6c rogner, particulièrement le
grand 6c petit papier à lettres. Les plioirs des uns 6c
des autres font d’ivo ire, de buis , ou d’autres bois
qui prennent le poli : ils font en forme de régie très-
mince , arrondie par les deux bouts, de huit ou dix
pouces de long, 6c d’un pouce 6c demi de large. Sa-
vary. ( D . J. )
PLIS f. m. pl. ( Lainage. ) fortes de laines de la
moindre qualité, qui fe lèvent de defliis les bêtes
tuées à la boucherie. Il y a de trois fortes de plis; de
fins, de moyens & de gros. Les fins s’emploient dans
des ratines, des ferges 6c des reveches de certaines
qualités ; les autres fervent à faire des cordeaux 6c
lifieres des étoffes.
PLISSER, v. aft. terme de couture ; ce mot de tailleur
6c de couturière, veut dire faire plufieurs petits
plis à une étoffe ou à de la toile , de rang 6c en
long avec l’aiguille.
PLISSON d e P o i t o u , (Art. culinaire.) c’eft un
mets fort délicat qui fe fait avec du lait 6c de la crème.
On prend une pinte de crème nouvelle, que l’on
mêle avec une terrinée de lait frais tiré ; le tout bien
remué , on le laiffe repofer quelques heures dans un
lieu frais, puis on le met fur le feu pendant une demi-
fieure fans bouillir , & on le remet encore au frais
pendant trois heures. Enfuite on le met fur le feu un
bon quart-d’heure , puis on le remet refroidir pendant
trois heures ; après cela on remet un quart-
d’heure fur le feu , d’oii on le retire pour le laiffer
refroidir. Pour lors il fe forme un pliJJon deffus, épais
de trois doigts ; on le leve 6c on le faupoudre de fu-
cre. Il faut prendre garde dans toutes ces opérations
de les faire fi promptement., que le plijfon qui fe forme
ne fe rompe pas en remuant la terrine. Voilà ce •
qu’on appelle plijfon de Poitou. Trévoux. (D. J.)
PLISTOBOLINDE, f. f. (Hijf. anc.) jeu de dez oh
celui qui amenoit le plus de points avoit gagné.
P LO C , f. m. (Marine.) le ploc eft proprement du
poil de vache ou de beuf; mais comme il fait ■ ■ la. principale
partie d’une forte de.couroiou de courée, qui
eft une compofition qu’on met entre le doublage, &
le francbord d’un navire ; on confond ces deux termes
, 6c l’on donne le nom de ploc au couroi. On dit
de mêmeploquer pour donner le couroi. Foy.eçO(JURÉE.
P l o c , terme de Converturiers ; le ploc de vache, fert
particulièrement à faire des couvertures. Il y a de
ces couvertures qu’on appelle couvertures à ploc, 6c
d’autres couvertures à poils. (D . J .)
PLOCQUER, PLOQUER , (Marine.) c’eft mettre
du poil de vache entre le doublage 6c le bordage
des vaiffeaux, qu’on double pour la navigation qui fe
fait entre les tropiques, où il s’engendre des vers
dans le bordage qu’ils'percent. On plocque pour empêcher
que ces vers, qui s’attachent premièrement
au doublage , ne gagnent aufli jufqu’au franc bord ;
ce qu’ils ne peuvent faire lorfqu’il y a du ploc entre
deux, 6c ce ploc fert aufli à empêcher que lé bordage
6c le doublage, qui font l’un lous l’autre, ne s’échauffent.
PLOCSK'O , (Géog. mod.) ville de la grande Pologne,
avec un évêché fondé en 9 6 5 ,6c qui eft fuf-
fragant de Gnefne. Gette ville elt fituée fur la rive
feptentrionale de la V iftule, dans le palatinat du même
nom, à 20 lieues nord de Varlovie. Long.gy.
4S. lat. 5z. go.
Le palatinat de Plocsko eft borné au nord par le
royaume de Pruffe, au midi par la Viftule , au levant
par le palatinat de Mazovie, 6c au couchant par celui
d’Inowladiflow. (D . J .)
PLOEN , ( Géog. mod. ) ville du duché de Holf-;
tein, dans la Wagrie, chef-lieu de la principauté de
même nom, fur le lac de Ploen qui l’environne prefque
de tous les côtés, à 4 milles au fud-eft de K.iel >
& à 6 au nord-oueft de Lubeck,avec un château. Ses
deux portes répondent à deux ponts, par lefquels la
ville communique avec le continent.
Elle eft très-ancienne, car elle exiftoit déjà dans
letems que les Vénedes, maîtres de la Wagrie, reconnurent
pour prince Crucon, qui étoit idolâtre
comme eux. Adolphe , comte de Holftein , y éleva
une citadelle, & en 1 1 5 1 ,$ . Vicolin y fit bâtir la
première églife. Ploen a été plufieurs fois réduite en
cendres, tantôt comme en 1534, par les habitans de
Lubeck, 6c tantôt par des incendies fortuits, comme
en 1574. La pêche eft le feul commerce des ha-
bitans. Long, 28. 4. lat. 64. 14, ( D . J. )
PLOERMEL, ( Géog. mod. ) petite ville de France
dans la Bretagne, au diocèfe de S. Malo, proche
la riviere d’Oueft, à 8 lieues de Vannes. Cette petite
ville députe aux états de la province, 6c a un gouverneur.
Long. 16.14. lat. 4 3 . S y . \ D I J .)
PLOK-PENIN , f. m. (Commerce.) un termeufite
à Amfterdam dans les ventes publiques, pour exprimer
une petite fomme ou gratification que l’on donne
au dernier enchériffeur.
Le plok-penin eft une efpece d’arrhes ou de denier-
adieu , par lequel on fait connoître que la marchant,
dife eft adjugée. Voye^ A r r h e .
Le plokpenin différé fuivant la qualité de la mar-
chandife, 6c le prix des lots. Il eft quelquefois arbitraire,
& à la volonté de l’acheteur ; quelquefois il
eft réglé par les ordonnances des bourguemeftres.
Par exemple, les plok-penins des vins de France,
fontfixés à deux florins; ceux de Frontignan à vingt
fols ceux du Rhin à deux florins ; ceux de vinaigre
à vingt fols, 6c ceux d’eau-de-vie à trente fols.
Il y a aufli des marchandifes où il n’y a point de
plok-penins , 6c d’autres où il eft double de celui dont
nous avons fait mention. Dictionn. de comrn.
PLOMB, f. m. ( Hifi. nat. Min. & Métall. ) en latin ,
plumbum, futur nus, plumbum nigrum, C ’eft un métal.
très-imparfait, d’un blanc bleuâtre fort brillant, lorfqu’il
a été fraîchement coupé, mais qui devient d’un
gris mat lorfqu’il eft refté long-tems expofé à l’air ;
il eft très-mou, 6c fi tendre , qu’on peut aifément
le tailler ; c’eft après l’o r , le mercure 6c la platine,
le corps le plus pefant de la nature ; il n’eft ni fonore
ni élaftique ; il s’étend aifément fous le marteau,
mais fès parties ont très-peu de ténacité ; il fe fond
avec beaucoup de promptitude à un feu médiocre ,
& fa furface fe couvre d’une efpece de craffe ou dé
chaux ; il fe vitrifie avec beaucoup de facilité, 6c il 1
a la propriété de changer pareillement en verre les
autres métaux, à l’exception de l’or 6c de l’argent ;
il change aufli én verre les terrés 6c les pierres avec
qui on le mêle ; l’air, l’eau, les huiles , les fels , én
un mot, tous les diffolvans agiffent fur lui.
Le plomb fe trouve en différens états dans le fein
de la terre. Lés Minéralogiftes ne font point encore
d’accord, pour fâvoir s’ilfe trouve du plomb vierge
ou natif dans la nature , c ’eft-à-dire, fi l’on rencontre
ce métal tout pur 6c fans être minéralifé. On
trouve à Maffel, en Siléfie, des grains 6c des maffes
de plomb, duttiles 6c malléables ; ces grains font recouverts
d’une fubftance blanche, femblableà delà
cérufe , mais on foupçonne que ce plomb a été porté
par accident dans l’endroit où on le rencontre.
Quant aux mines de plomb, elles font très-communes
, 6c très-univerfellement répandues dans toutes
les parties du monde. On les trouve ordinairement
par filons fuivis , qui font plus riches à mefure
qu’ils s’enfoncent plus profondément en terre ; cependant
on en rencontre aufli par maffes détachées.
La mine de plomb la plus ordinaire , eft ;
i°. Lagalene ; c’eft une mine de plomb compofée
d’un affemblage de cubes qui ont la couleur brillante
du métal qu’ils renferment lorfqu’il eft fraîchement
coupé. Ces cubes font compofés dè lames ou de feuillets
luifans, placés les uns fur les autres, 6c faciles à
diftinguerlorfque les cubes font grands. En effet, ces
cubes varient pour la grandeur, 6c quelquefois ils
font fi petits, que l’oeil ne peut point diftinguer leur
figure. 11 y a même des mines de plomb compofées
de particules fi fines , qu’elles reffemblent à du fer
ou à de l ’acier dans l’endroit de la fraélure. Dans
d’autres ces particules font difpofées, de maniéré
que la mine paroît ftriée, ou par aiguilles. Les cubes
dont la galene eft compofée , font quelquefois fi
abondans en plomb , qu’on peut les couper avec un
couteau. Dans toutes ces mines , le plomb eft miné--
ralifé avec le fouffre ; il y en a qui font fi riches ,
qu’elles donnent jufqu’à 50, 60, 6c même 75 livres
de plomb par quintal, mais elles ne font point toutes
, à beaucoup p rès, fi chargées de métal. Ces mines
de plomb ou galenes, contiennent plus ou moins
d’argent. On a obfervé que celles qui font compofées
de gros cubes, font moins riches en'argent,
que celles qui font en petites particules déliées ; les
premières n’ en donnent guere qu’une ou deux onces
d’argent par quintal, tandis que les dernieres en donnent
fouvent le double , 6c même davantage. Parmi
les mines de plomb d’Europe, on ne connoît que
celle de Villach en Efclavonie qui ne contienne point
d’argent.
i° . De lamine de plomb, quin’affe&e point défiguré
régulière, fa couleur eft fouvent la même que celle
du plomb pur, 6c quelquefois elle eft fi tendre, qu’on
peut la couper avec un couteau. Cette mine eft compofée
de plomb minéralifé avec du foufre 6c de l’ar-
fenic ; elle eft quelquefois très-riche , au point que,
félon M. de Jufti, on en a trouvé dans les mines du
Hartz, qui dortnoit 82,6 c jufqu’à 84 livres de plomb
‘ au quintal. Les Allemands appellent cette minepley-
fchweif.
30. Lamine deplomb çryftalifée; elle eft ou verte,
ou blanche-; elle forme des groupes de Cfyftaux
oblongs, 6C prifmatiques comme des fels ; c’eft l’af*
fenic qui met le plomb dans l’état où il eft dans Ce3
fortes de mines; elles contiennent une grande quantité
de ce métal, & quelquefois jufqu’à 70 6t 80 livres
par quintal. M. de Jufti croit que cette mine
eft une efpece de fucre de faturne naturel , c’eft-
à-dire un plomb qui a été diffout par un acide»
6c cryftallifé à la maniéré des fels. Il conjefture que
quelques-unes de ces mines ont pu aufli fe former
comme le plomb corné, c’eft-à-dire, par une diffo-
lution de plomb précipitée par le fel marin. Quoi qu’il
enfoitde ce fentiment, la mine de plomb cryftalli*
fée verte, eft d’un verd plus ou moins v if ; fes cryf-
taux font tantôt des prilmes très-bien formés , tantôt
ils font moins apparens, 6c reffemblent à la moufle
fine qui s’attache au pié des arb‘res;quelquefois elle eft
poreufe & remplie de creux comme une fcorie. Cette
mine eft communément accompagnée d’une terre
rougeâtre ou jaune, femblable à de l’ochre. A l’égard
delà mine de plomb cryftallifée blanche, elle-eft aufli
formée par un affemblage de prifmes blancs 6c luifans
comme le gypfe ftrié , ou comme l’asbefte. On
trouve quelquefois ces cryftaux blancs, mêlés avec,
les cryftaux verds dont on vient de parler. Ces deux,
fortes de mines de plomb font affez rares, 6t plus
propres à orner les cabinets des curieux , qu’à être
traitées pour en tirer le métal. Cependant on en-
trouve à Zfchoppau 6c à Frèyberg en Saxe , r ainfi
que dans quelques mines de Bohème 6c du Hartz*
Quant à la mine de plomb verte, il y en a une grande
quantité dans les mines du Brifgau, qui font à peu
de diftance de Fribourg. Les Direfteurs vendent,
cette mine aux potiers-de-terté, qui ne font • que
l’écrafer pour en verniffer leurs poteries.
40. La mine de plomb fpathique ; c’eft une' miné?
de plomb compofée de lames ou de feuillets opaques,
comme le fpath, à qui elle reflemble beaucoup. Cependant
elle en différé, en ce qu’elle ne fait point
effervefcence avec l’eau forte , comme fait le fpath ,
qui eft une pierre calcaire. Cette mine eft oirblanchè
ou grife, ou jaunâtre ; elle varie pour la figure 6c
l’arrangement de fes feuillets ; elle eft plus pefante
que le fpath ordinaire.
50. La terre de plomb, que l’on pourroit appelle!',
cérufe fojfle. Elle reflemble à de la craie, ou à de la
.marne ; il y en a de blanche, de jaune, Sc de rouge ^
ces couleurs font dues vraiflemblablemeht à de l’o-*
chre avec qui cette terre eft mêlée ; on peut la re-
Connoître à fon poids. Ces fortes de terres font pro-
digieufement rares ; on en a cependant t ro u v é à Jo-*
hann-Georgen-Stadt en Mifnie, ainfi qu’én Pologne
& dans la baffe Autriche. M. de Jufti c o n je c tu re qu’elles
ont été précipitées des eaux qui tenoient le
plomb en diffolution par un fel alkali, vu que ces
terres font effervefcence avec les acides, mais'cela
pourroit venir des autres terres avec q u i elles font
mêlées. Il paroit certain qu’elles ont été charriées &
tranfportées par des eaux.
Outre cela la mine de plomb cubique où la galenâ’
fe trouve mêlée avec prefque toutes les mines des
autres métaux, dans lefquelles ôri voit fouvent très-'
fenfiblement que la première eft répandue. Quant
aux pierres qui lui fervent de matrice ou de minière*
c’eft tantôt du quartz, tantôt du fpath. Lazare Erckct
parle d’un grais qui contenoit du plomb, ce qui paroit
fort extraordinaire ; peut - être étoit - ce une
pierre de la nature du fpath compofée de petits
grains.
A l’égard du traitement dès mines de plomb, ôit
Commence par les piler 6c les laver ; celles qui font
, pures peuvent être portées au fourneau de firfioni
; fans avoir été grillées ; d’autres, fur-tout celles qui
j font arfénicales 6c chargées de beaucoup dé foufre *