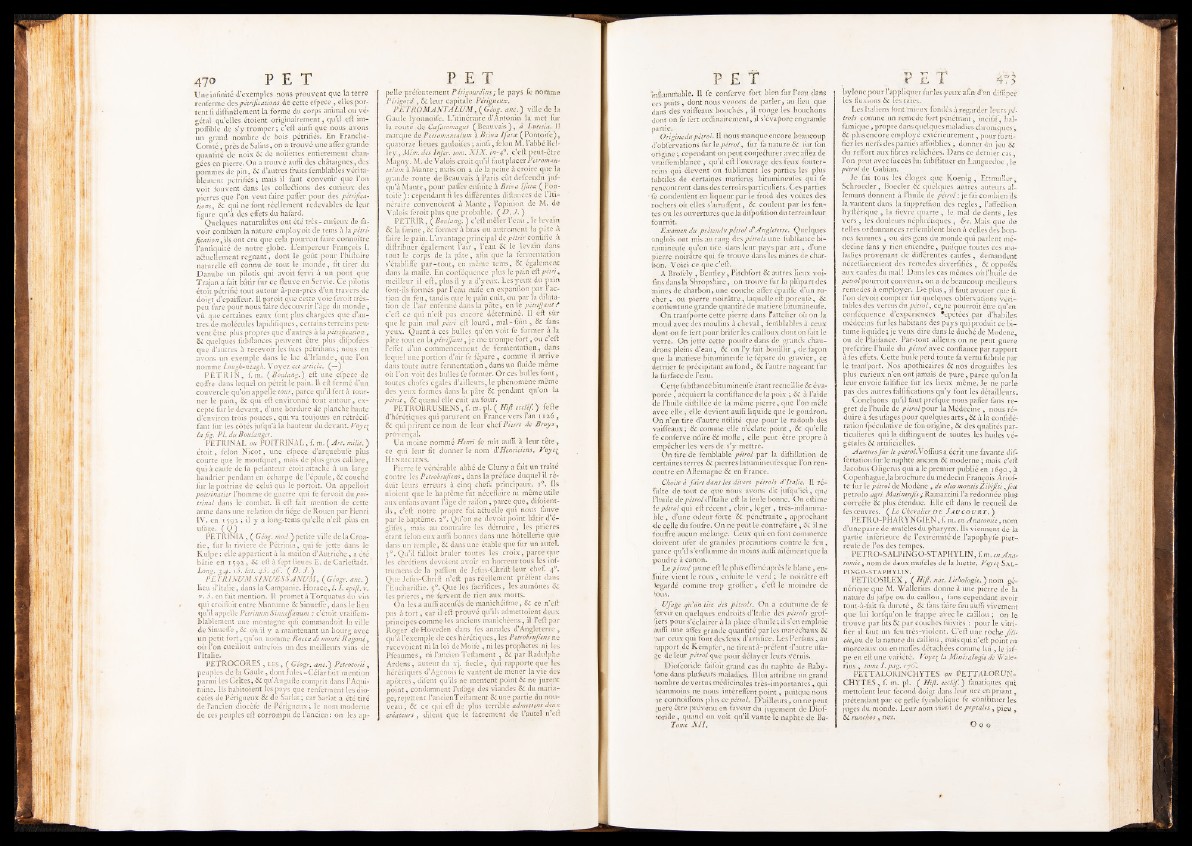
Une infinité d’exemples nous prouvent que la terre
renferme des pétrifications de cette efpece , elles portent
fx diftin&ement la forme du corps animal ou v égétal
qu’elles étoient originairement, qu’il eft im-
poflible de s’y tromper ; c ’eft ainfi que nous avons
un grand nombre de bois pétrifiés. En Franche-
Comté , près de Salins, on a trouvé une allez grande
quantité de noix 6c de noifettes entièrement changées
en pierre. On a trouvé aufli des châtaignes, des
pommes de pin, 6c d’autres fruits l'emblables véritablement
pétrifiés ; mais il faut convenir que l’on
voit fouvent dans les colleftions des curieux des
pierres que l’on veut faire paffer pour des pétrifications,
6c qui ne font réellement redevables de leur
figure qu’a des effets du hafard.
Quelques naturaliftes ont été très - curieux de fa-
voir combien la nature employoit de tems à la pétrification
, ils ont cru que cela pourroit faire connoître
l’antiquité de notre globe. L’empereur François I.
a&uellement régnant, dont le goût pour l’hiftoire
naturelle eft connu de tout le monde, fit tirer du
Danube un pilotis qui avoit fervi à un pont que
Trajan a fait bâtir fur ce fleuve en Servie. Ce pilotis
étoit pétrifié tout autour à-peu-près d’un travers de
doigt d’epaiffeur. Il paroit que cette voie feroit très-
peu fure pour nous faire découvrir l’âge du monde,
vu aue certaines eaux font plus chargées que d’autres
de molécules lapidifiques, certains terreins peuvent
être plus propres que d’autres à la pétrification,
6c quelques fubftances peuvent être plus difpofées
que d’autres à recevoir les fucs pétrifians ; nous en ‘
avons un exemple dans le lac d’Irlande, que l’on
nomme Lough-neagh. V oyez cet article. (—)
PÉ T R IN, f. m. ( Boulang.) eft une efpece de
coffre dans lequel on pétrit le pain. Il eft fermé d’un
couvercle qu’on appelle tour, parce qu’il fert à tourner
le pain, 6c qui eft environné tout autour, excepté
fur le devant, d’une bordure de planche haute
d’environ trois pouces, qui va toujours en rétrécif-
fant fur les côtés jufqu’à la hauteur du devant. Voye{
la fig. PI. du Boulanger.
PÉTRIN AL ou POITRINAL, f. m. ( Art. milit. )
é to it , félon N ico t, une efpece d’arquebufe plus
courte que le moufquet, mais de plus gros calibre,
qui à caufe de fa pefanteur étoit attaché à un large
baudrier pendant en écharpe de l’épaule, 6c couché
fur la poitrine de celui qui le portoit. On appelloit
poitrinatier l’homme de guerre qui fe fervoit du poi-
tr'mal dans le combat. H eft fait mention de cette
arme dans une relation du fiége de Rouen par Henri
IV. en i<9Z ; il y a long-tems qu’elle n’eft plus en
ufage. ( Q)
PETR1NIA, ( Géog. mod.) petite ville de la Croatie,
fur la riviere de Pétrinia, qui fe jette dans le
Kulpe : elle appartient à la maifon d’Autriche, a été
bâtie en 1592, 6c eft à fept lieues E. de Carleftadt. "
Long. 3 4 . tS. lut. 46. 46'. (D . J .)
P E T R I N U M SINUESSANUM, ( Glogr. anc. )
lieu d’Italie, dans la Campanie. Horace, /. 1. epijl.v.
y. S. en fait mention. Il promet à Torquatus du vin
qui croiffoit entre Minturne 6c Sinueffe, dans le lieu
qu’il appelle Petrinum Sinueffanum : c’étoit vraiffem-
blablement une montagne qiti commandoit la ville
de Sinueffe, 6c où il y a maintenant un bourg avec
un petit fort, qu’on nomme Rocca di monté Ragoné,
oîi î’on cueilloit autrefois un des meilleurs vins de
l’Italie.
PÉTROCORES , l e s , ( Glogr. anc. ) Petrocorii ,
peuples de la Gaule, dont Jules - Céfar fait mention
parmi les Celtes, 6c qu’Augufte comprit dans l’Aquitaine.
Ils habitoient les pays que renferment les dio-
cèfes de Périgueux 6c de Sarlat ; car Sarlat a été tiré
de l’ancien diocèfé de Périgueux ; le nom moderne
de ces peuples eft corrompu de l’ancien: on les appelle
préfentement P érigourdins ; le pays fe nomme
Périgord , 6c leur capitale Périgueux.
PE TROM AN TA LUM , (Géog. anc.') ville de la
Gaule lyonnoife. L’itinéraire d’Antonin la met fur
la route de Coefaromagus (Beauvais ), à Lutetia. 11.
marque de PetroniantaLum à B riva Ifaroe ( Pontoife),
quatorze lieues gauloifes ; ainfi, félon M. l’abbé Bel-
ley., Mérn. des InJ'cr. tom. X IX . in-40. c’eft peut-être
Magny. M. de Valois croit qu’il faut placer Petroman-
talum à Mante ; mais on a de la peine à croire que la
grande route de Beauvais à Paris eût defeendu jufqu’à
Mante, pour paffer enfuite à B riva Ifarce ( Pontoife
) : cependant ii les différentes diftances de l’Itinéraire
convenoient à Mante, l’opinion de M. de
Valois feroit plus que probable. ( D . J. )
PÉTRIR, ( Boulang. ) c’ eft mêler l’eau, le levain
6c la farine, 6c former à bras ou autrement la pâte à
faire le pain. L ’avantage principal de pétrirconlifte à
diftribuer également l’air , l’eau 6c le levain dans
tout le corps de la pâte, afin que la fermentation
s’établiflè par-tout, en même tems, 6c également
dans la maffe. En conféquence plus le pain eft pétri,
meilleur il eft, plus il y a d’yeux. Les yeux du pain
font-ils formés par l’eau mife en expanfton par l’action
du feu, tandis que le pain cuit, ou par la dilatation
de l’air enfermé dans la pâte, en le pétrifiant ?
c’eft ce qui n’eft pas encore déterminé. Il eft sûr
que le pain mal pétri eft lourd, mal - fain , 6c fans
yeux. Quant à ces bulles qu’on voit fe former à la
pâte tout en la pétrifiant, je me trompe fort, ou c’eft
l’effet d’un commencement de fermentation, dans
lequel une portion d’air fe fépare , comme il arrive
dans toute autre fermentation, dans un fluide même
où l’on voit des bulles fe former. Or ces bulles font,
toutes chofes égales d’ailleurs, le phénomène même
des yeux formes dans la pâte 6c pendant qu’on la
pétrit, 6c quand elle cuit au four.
PETROBRUSIENS, f. m. pl. ( Hift eccléf. ) fefte
d’hérétiques qui parurent en France vers l’an 1126,
6c qui prirent ce nom de leur chef Pierre de Bruys,
provençal.
Un moine nommé Henri fe mit aufli à leur tête,
ce qui leur fit donner le nom d'Henriciens* Voye^
H e n r i c i e n s . . #
Pierre le vénérable abbé de Cluny a fait un traité
contre les Petrobrujiens, dans la préface duquel il réduit
leurs erreurs à cinq chefs principaux. i° . Ils
nioient que le baptême fut néceffaire ni même utile
aux enfans avant l’âge de raifon, parce que, difôient-
ils , c’eft notre propre foi aûuelle qui nous fauve
par le baptême. 20. Qu’on ne devoit point bâtir d’e-
glifes, mais au contraire les détruire, les prières
étant félon eux aufli bonnes dans une hôtellerie que
dans un temple, 6c dans une étable que fur un autel.
30. Qu’il falloit brûler toutes les croix, parce que
les chrétiens dévoient avoir en horreur tous les inf-
trumens de la paflîon de Jefus-Chrift leur chef. 40.
Que Jefus-Chrift n’eft pas réellement préfent dans
l’Euchariftie. 50. Que les facrifices, les aumônes 6c
les prières, ne fervent de rien aux morts.
On les a aufli accufés de manichéifme, 6c ce n’ eft
pas à to r t , car il eft prouvé qu’ils admettoient deux
principes comme les anciens manichéens, il l’eft par
Roger de Hoveden dans fes annales d’Angleterre,
qu’à l’exemple de ces hérétiques, les Petrobrujiens ne
recevoient ni la loi de Moïfe , ni les prophètes ni les
Pfeaumes, ni l’ancien Teftament , 6c par Radulphe
Ardens, auteur du xj. fiecle, qui rapporte que les
hérétiques d’Agenois fe vantent de mener la vie des
apôtres, difent qu’ils ne mentent point 6c ne jurent
point, condamnent l’ufage des viandes 6c du mariage,
rejettent l’ancienTeftament 6c une partie du nouveau
, 6c ce qui eft de plus terrible admettent deux
créateurs , difent que le facrement de l’autel n’ eft
rnflamrfiablê. Il fe conferve fort bieh fur l’eau dans
ces puits , dont nous venons de parler, au lieu que
clans des vaiffeaux bouchés , il ronge les bouchons
dont on fe fert ordinairement, il s’évapore en grande
partie.
Originedupétrol. Il nous manque encore beaucoup
d’obfervations fur lepétrol, fur fa nature 6c furfon
origine ; cependant on peut conjefturer avecaffez de
vraiffemblance , qu’il eft l’ouvrage des feux fouter-
reins qui élevent ou fubliment les parties les plus
fubtiles de certaines matières bitumineufes qui fe
rencontrent dans des terroirs particuliers. Ces parties
fe condenfent en liqueur par le froid des voûtes des
rochers oii elles s’amafl'ent, 6c coulent par les fentes
ou les ouvertures que la difpofition du terrein leur
fournit.
Examen du prétendu pétrol d?Angleterre. Quelques
unglois ont mis au rang des pétrols une fubftance bi-
tumineufe qu’on tire dans leur pays par arf , d’une
pierre noirâtre qui fe trouve dans les mines de charbon.
Voici ce que c’eft.
A Brofely , Bentley, Pitchfort 6c autres lieux voi-
fins dans la Shropshire, on trouve fur la plûpart des
mines de charbon, une couche affez épaiffe d’un rocher
, ou pierre noirâtre, laquelle eft poreufe, 6c
contient une grande quantité de matière bitumineufe.
Ôn tranfporte cette pierre dans Fattelier où on la
moud avec des moulins à cheval, ferfiblables à ceux
dont on fe fert pour briferles cailloux dont on fait le
verre. On jette cette poudre dans de grands chau-
drons pleins d’eau, 6c on l’y fait bouillir , de façon
que la matière bitumineufe fe fépare du gravier, ce
dernier fe précipitant au fond, 6c l’autre nageant fur
la furface de l’eaiu .
Cette fubftancé bitumineufe étant recueillie 6c évaporée
, acquiert la confiftance de la poix ; 6c à l’aide
de l’huile diftillée de la même pierre, que l’on mêle
avec elle-', elle devient aufli liquide que le goudron.
On n’en tire d’autre utilité que pour le radoub des
vaiffeaux ; 6c comme elle n’edate point, 6c qu’elle
fe conferve nôtre 6c m olle, elle peut être propre à
empêcher les vers de s’y mettre.
On tire de femblable pétrol par la diftillation de
certaines terre? 6c pierres bitumineufes que l’on rencontre
en Allemagne 6c en France.
Choix a faire dans les divers pétrols d.'Italie. Il ré-^
fuite de tout ce qüe nous avons dit jufqu’ic i, que
.l’huile de pétrol d’Italie eft la feule bonne. On eftime
le pétrol qui éft récent, clair, léger , très-inflammable
, d’une odeur forte 6c pénétrante , approchant
<le celle du foufre. On ne peut le contrefaire, 6c il ne
fouffre aucun mélange. Ceux qui en font commercé
doivent ufer de grandes précautions contre le feu ,
parce qu’il s’enflamme du moins aufli aifément que la
poudre à canon.
Le pétrol jaune eft lé plus eflimé après le blanc, en-
jfuite vient le roux, eniuite le verd ; le noirâtre eft
Regardé comme trop groflier, c’eft le moindre de
fous. :
Ufage qu'on liée des pétrols. On à côutume de fe
fervir en quelques endroits d’Italie des pétrols grof-
fiers pour s’éclairer à la place d’huile ; il s’én emploie
aufli une âffez grande quantité par les maréchaux 6c
oar ceux qui font des feux d’artilice. Les Perfans, au
rapport de Kempfer, ne tirent à-préferit d’autre ufage
de leur pétrol que pour délayer leurs .vernis.
Diofcoride faifoit grand cas du naphte de Baby-
fone dans plufieurs maladies. Il lui attribue un grand
nombre de vertus médicinales très-importantes, qui
léanmoins ne nous intérefl'ent point, puifque nous
ie connoiffons plus ce pétrol. D ’ailleurs, on ne peut
ruere être prévenu en faveur du jugement de Diof-
soride , quand on voit qu’il vante l e naphte de Ba-
To/n e X I î .
bylone pour l’appliquer fur les yeu x nfim d’en diftiper
les fluxions 6c les taies..
Les Italiens font mieux fondés à regarder leurs/>/-
trois comme un remede fort pénétrant ■, incifif, bal-
famique , propre dans quelques maladies chroniques7,
6c plus encore employ é extérieurement, pour fortifier
les nerfs des parties affaiblies , donner du jeu 6c
du reffort aux fibres relâchées. Dans ce dernier cas,
Bon peut avec fuccès lui fubftituer eh Languedoc, le
pétrol de Gabianv
Je fai tous les éloges que Ko en ig , Ettnuiller,
Schroedcr, Boeder 6c quelques aùtres auteurs al-
lemans donnent à l’huile de pétrol'. je fai combien ils
la vantent dans la fuppreflion des réglés, l’affeâion
hyftérique , la fievre quarte , le mal de dents, les
vers , les douleurs néphrétiques , &c. Mais que de
telles ordonnances reffemblent bien à celles des bonnes
femmes , ou des gens du monde qui parlent médecine
fans y rien entendre, puifque toutes ces maladies
provenant de différentes caufes , demandent
néceffairement des remedes diverfifiés , 6c oppofés
aux caufes du mal! Dans les cas mêmes où l’huile de
pétrol pourroit convenir, on a de beaucoup meilleurs
remedes à employer. De p lus, il faut avouer que fi
l’on devoit compter fur quelques obfervations véritables
des vertus du pétrol, ce#ne pourroit être qu’en
conféquence d’expériences *epetées par d’habiles
médecins furies habitans des pays qui produit ce bitume
liquide ; je veux dire dans le duché de Modene,
ou de Plaifance. Par-tout ailleurs on ne peut guere
preferire l’huile du pétrol avec confiance par rapport
à fes effets. Cette huile perd toute fa vertu fubtile par
le tranfport. Nos apothicaires 6c nos droguiftes les
plus curieux n’en ont jamais de pure, parce qu’on la
leur envoie falfifiée fur les lieux même. Je ne parle
pas des autres falfifications qu’y font les détailleurs:.
Concluons qu’il faut prefque nous paffer fans regret
de l’huile de pétrol pour la Médecine , nous réduire
à fesufages pour quelques arts, 6c à la confidé-
ration fpéculative de fon origine, 6c des qualités particulières
qui la diftinguent de toutes les huiles vé-,
gétales 6c artificielles.
A ute tirs fur le pétrol. V oflius a écrit une favante dif-
fertation fur le naphte ancien 6c moderne ; mais c’eft
Jacobus Oligerus qui a le premier publié en 1690, à
Copenhague,la brochure du médecin François Ariof-
te lur le pétrol de Modène , de oleo montis Zibifiti ,feu
petrolo agri Matinenfis ■; Ramazzinil’a redonnée plus
cérrefte 6c plus étendue. Elle eft dans le recueil de
fes oeuvres.1 ( Le Chevalier D E J a d c o u r t . )
PETRO-PH ARYNGIEN * f. m. en Anatomie, nom
d’une paire de mufcles du pharynx. Ils viennent de la
partie inférieure de l’extrémité de l’apophyfe pier-
reufe de l’os des tempes.
PETRO-SALPINGO-STAPHYLIN, f. m. en Anatomie
, nom de deux mufcles de la luette. Voye1 S a l -
PINGO-STAPHYLIN.
PETROSILEX, ( Hiß. nat. Lithologie.. ) nom générique
que M. Wallerius donne à une pierre de la
nature dû jafpe ou du caillou, fans cependant avoir
tout-à-fait fa dureté, ,6c fans faire feu aufli vivement
que lui lorfqu’on le frappe avec le caillou ; on le
trouve par lits 6c par couches fiiiyies : pour le vitrifier
il faut un feutres-violent. C ’eft une roche fili-
cée,bu de la nature du caillou, niais qui n’eft point en
morceaux ou en mafles détachées comme lu i, le jafpe
en eft une variété. Voye{ la Minéralogie de Wale-
rius , tome I. pag. >yS.
PETTALORINCHYTES ou PETTALORUN-
CH Y TE S , f. m. pl. ( Hiß. eccléf. ) fanatiques qui
mettoient leur fécond doigt dans leiir nez en priant,
prétendant par ce gefte fymboliqûe fe cohftituèrles
juges du monde. Leur nom vient de peptalts, pieu ,
6c runchos, nez.
O 0 o