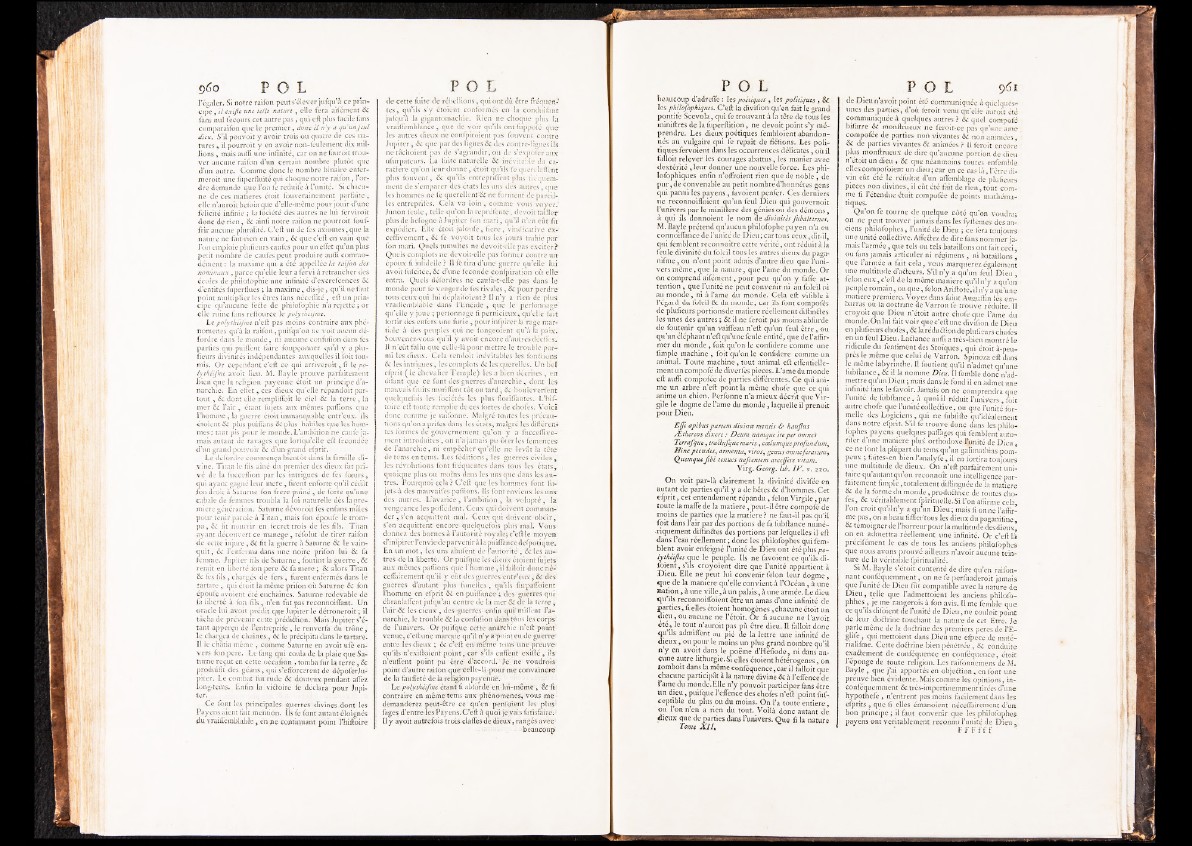
5 6 o P O L P O L
l’égaler. Si notre raifon peut s’élever jufqu’à ce principe
, il exifle une telle nature , elle fera aifement 6c
fans nul fecours cet autre pas, qui eft plus facile fans
comparaifon que le premier, donc il n'y a qu un J ml
dieu. S’il pouvoit y avoir trois ou quatre de ces natures
, il pourrait y en avoir non-feulement dix millions
, mais aufli une infinité, car on ne l'aurait trouver
aucune raifon d’un certain nombre plutôt que
d’un autre. Comme donc le nombre binaire enfermerait
une fuperfluité qui choque notre raifon, l’ordre
demande que l’on fe reduife à l’unité.; Si chacune
de ces matières étoit fouverainement parfaite,
elle n’auroit befoin que d’elle-même pour jouir d’une
félicité infinie ; la fociété des autres ne lui ferviroit
donc de rien, 6c ainfi notre raifon ne pourrait fouf-
frir aucune pluralité. C’eft un de fes axiomes, que la
nature ne fait-rien en vain, 6c que c’eft en vain que
l’on emploie plufieurs caufes pour un efFet qu’un plus
petit nombre de caufes peut, produire aufli commodément
: la maxime qui a été appellée la raifon des
nominaux, parce qu’elle leur a fervi à retrancher des
écoles de philolophie une infinité d’excrefcences 6c
d’entités fuperflues ; la maxime, dis-je, qu’il ne faut
point multiplier les êtres fans néccfîité , eft un principe
qu’aucune feéte de philofophie n’a rejette ; or
elle ruine fans reflource le poly tkéifme.
Le polythéifmc n’eft pas moins contraire aux phénomènes
qu’à la raifon, puifqu’on ne voit aucun désordre
dans le monde, ni aucune confufion dans les
parties qui puifl'ent faire foupçonner qu’il y a plufieurs
divinités indépendantes auxquelles il foit fournis.
Or cependant c’eft ce qui arriveroit, fi le po-
lythèifmt avoit lieu. M. Bayle prouve parfaitement
Bien que la religion payenne étoit un principe d’anarchie.
En effet, ces dieux qu’elle répandoit partout
, 6c dont elle rempliflbit le ciel 6c la terre, la
mer 6c l’air , étant fujets aux mêmes paflions que
l’homme, la guerre étoit immanquable entr’eux. Us
■ etoient 6c plus puiffans ôc plus habiles que les hommes
: tant pis pour le monde. L’ambition ne caufe jamais
autant de ravages que lorlqu’elle eft fécondée
d’un grand pouvoir 6c d’un grand efprit.
Le défordre commença bientôt dans la famille divine.
Titan le fils aîné du premier des dieux fut priv
é de la fuccelfion par les Intrigues de fes foeurs,
qui ayant gagné leur mefe, firent enforte qu’il cédât
Ion droit à Saturne fon frere puîné, de forte qu’une
cabale de femmes troubla la loi naturelle dès la première
génération. Saturne dévorait fes enfans mâles
pour tenir parole à Titan, mais fon époufe le trompa
, 6c fit nourrir en fècret trois de fes fils. Titan
ayant découvert ce manege , réfolut de tirer raifon
de cette injure, & fit la guerre à Saturne 6c le vainquit
, 6c l’enferma dans une noire prifon lui 6c fa
femme. Jupiter fils de Saturne, foutint la guerre, 6c
remit en liberté fon pere 6c fa mere ; 6c alors Titan
6c fes fils, chargés de fers, furent enfermés dans lé
îartare , qui étoit la même prifon où Saturne 6c fon
époufe avoient été enchaînés. Saturne redevable de
fa liberté à fon fils, n’en fut pas reconnoiflant. Un
oracle lui .avoit prédit que Jupiter le détrônerait ; il
tâcha de prévenir cette prédiction. Mais Jupiter s’étant
apperçu de l’entreprife , le renverfa du trône,
le chargea de chaînes., 6c le précipita dans le tartare.
Il le chatia même , comme Saturne en avoit ufé envers
fon pere. Le fang qui coula de la plaie que ■ Saturne
reçut en cette .occafion , tomba fur la terre , 6c
produifit des géans , qui s’efforcèrent de dépoférJu-
piter. Le combat fût rude & douteux pendant affez
long-tems. Enfim Iaivi&oire fe déclara pour Jupiter.
Ce font les principales guerres divines dont les
Payens aient fait mehtion. Ils fe font autant éloignés
$lu vraifferablable, en ne continuant point l’biftoire
de cette fuite de rébellions, qui ont dû être fréquentes,
qu’ils s’y étoient conformés en la- conduifant
jufqu’à la gigantomachie. Rien ne choque plus la
vraifl'emblance, que de voir qu’ils ont fuppofé que1
les autres dieux ne confpiroient pas fouvent contre
Jupiter, 6c que par des ligues 6c des contre-ligues ils
ne tâchoient pas de s’agrandir, ou de s’expolèraux
ufurpateurs. La fuite naturelle 6c inévitable du ca-
radtere qu’on leur donne, étoit qu’ils fe querelaflcnt
plus fouvent, 6c qu’ils entrepriflent plus fiéouem-
ment de s’emparer des états les uns des autres, que
les hommes ne fe querellent'ôc ne forment de pareilles
entreprifes. Cela va loin , comme vous voyez.’
Junon feule, telle qu’on la repréfenté, devoit tailler
plus de befogne à Jupiter fon mari, qu’il n’en eût fu
expédier. Elle étoit jaloufe, fiere, vindicative ex-'
cemvement, 6c fe voyoit tous les jours trahie par
fon mari. Quels tumultes ne devoit-elle pas exciter?"
Quels complots ne devoit-elle pas former contre un
époux fi inndelle ? Il fè tira d’une guerre qu’elle lui
avoit fufeitée, 6c d’une fécondé confpiration où elle
entra. Quels déiordres ne caufa-t-elle pas dans le
monde pour fe venger de fes rivales, 6c pour perdre
tous ceux qui lui déplaifoient ? 11 n’y a rien de plus
vraiflemblable dans l’Enéide , que le perfonnage
qu’elle y joue ; perfonnage fi pernicieux, qu’elle fait
fortir des enfers une furie, pour infpirer la rage martiale
à des peuples qui ne fongeoient qu’à la paix.
Souvenez-vous qu’il y avoit encore d’autres déeflès.
Il n’eût fallu que celle-là pour mettre le trouble parmi
les dieux. Cela rendoit inévitables les fonctions
6c les intrigues, les complots 6c les querelles. Un bel
efprit ( le chevalier Temple) les a bien décrites , en
dilant que ce font des guerres d’anarchie, dont les
mauvais fruits muriffent tôt ou tard, 6c bouleverfent
quelquefois les fociétés les plus floriflàntes. L’hif-
toire eft toute remplie de ces fortes ;de chofes. Voici
donc comme je raifonne. Malgré-toutes les précautions
qu’on a prifes dans les états, malgré les différent
tes formes de gouvernement qu’on y a fucceflive-
ment introduites, on n’a jamais pu ôter les femences*
de l’anarchie, ni empêcher qu’elle ne levât la tête
detems entems. Les féditions, les guerres civiles ,'
les révolutions font fréquentes dans tous les états,
quoique plus ou moïns dans les uns que dans les autres.
Pourquoi cela? C’eft que les-'hommes font fujets.
à des mauvaises paflions. Ils font envieux les uns’
des autres. L’avarice, l’ambition, là volupté, la
vengeance les pofîedent. Ceux qui doivent commande
r, s’en acquittent mal. Ceux qui doivent'obéir,
s’en acquittent encore-quelquefois plus mal. Vous
donnez des bornes à l’autorité royale; c’eft le moyen'
d’infpirer l’envie de parvenir à la puiflancedefpotique.
En un mot, les uns ahufent de î’autorité , &'les autres
de la liberté. Or puifque les dieux étoient fujets-
aux mêmes paflions que l'nomme , il fallôit donené-'
ceflàireme'nt qu’il y eût des guerres 'entr’eux, & des'
guerres d’autant plus fùneftes, qu’ils furpafîbient
L’homme en efprit 6c en puiflance- ; ;des guerres qui
ébranlaffent jufqu’au centre de la mer 6c de la terre,
l’air & les cieux, des guerres enfin qui'-miflent l’anarchie,
le trouble & la confufion’dans tous lés corps
de l’univers. - Or puifque cette anarchie n’eft point'-
venue, c’eft une marque qu’il n’y'adjoint eu.de guerre'
entre les dieux ; 6c c’e'ft en même tems une'preuve-'
qu’ils n’exiftoient,point, car s’ils enflent exifté, ils
n’euffent point pu être dfoccôrd.-'Jé'; fie1 voudrais:
point d’autre raifon quê'telle-là pouf me convaincre
de la fauflèté de la religion payénriè.'
Le polytheifme étant fi abliirdë-en-lui-même , & fi-
contraire en même tems aux phénomènes, Vous mè-
demanderez peut-être ce-qu’en penfoient les plus1
fages d’entre les Payens. C’eft à quoi je.vàis fatisfaii-ei1
Il y ayoit autrefois trois.claffes de dieux , rangés avec-
- - beaucoup
P O L P O L
beaucoup d’adrefle : les poétiques , les politiques, 6c
les philoJophiques. C ’eft la divifion qu’en foit le grand
pontife Scevola, qui fe trouvant à la tête de tous les
miniftres de la fuperftition, ne devoit point s’y méprendre.
Les dieux poétiques fembloient abandonnés
aii vulgaire qui fe repaît de n&ions. Les politiques
fervoient dans les occurrences délicates, où il
falloir relever les courages abattus, les manier avec
dextérité , leur donner une nouvelle force. Les phi- i
lôfophiques enfin n’offraient rien que de noble , de
pur, de convenable au petit nombre d’honnêtes gens
qui parmi les payens, favoient penfer. Ces derniers
ne reconnoifloient qu’un feul Dieu qui gouvernoit
l’univers par le miniftere des génies ou des démons,
à qui ils donnoient le nom de divinités fubalternes.
M. Bayle prétend qu’aucun philofophe payen n’a eu
connoiflance de l’unitc de Dieu; car tous ceux, dit-il,
qui femblent reconnoître cette vérité, ont réduit à la
feule divinité du foleil tous les autres dieux du paga-
nifme, ou n’ont point admis d’autre dieu que l’univers
même, que la nature, que l’ame du monde. O r
on comprend aifément, pour peu qu’on y foffe attention
, que l’unité ne peut convenir ni au foleil ni
au monde, ni à l’ame du monde. Cela eft vifible à
l’égard du foleil 6c du monde; car ils font compofés
de plufieurs portions de matière réellement diftinftes
les unes des autres ; 6c il ne ferait pas moins abfurde
de foutenir qu’un vaiffeau n’eft qu’un feul être, ou
qu’un éléphant n’eft qu’une feule entité, que de l’affirmer
du monde, foit qu’on le confidere comme une
fimple machine , foit qu’on le confidere comme un
animal. Toute machine, tout animal eft eifentielle-
ment un compofé de diverfes pièces. L ’ame du monde
eft aufli compofée de parties différentes. Ce qui anime
un arbre n’eft point la même chofe que ce qui
anime un chien. Perfonne n’a mieux décrit que Virgile
le dogme de l’ame du monde, laquelle il prenoit
pour Dieu.
Ejfe apibus partent divinoe mentis & haujlus
Æthereos dix ere : Deum namque ire per omnes
Terrafque , traclufque maris, ccelumque profttndum,
Hint pecudes, armenta, viros, genus omneferarurn,
Qitemque Jîbi tenues nafeentem arceffere vitam.
Virg. Georg. lib. iy . v. 220.
On voit par-là clairement la divinité divifée en
autant de parties qu’il y a de bêtes 6c d’hommes. Cet
efprit, cet entendement répandu, félon Virgile, par
toute la maflë de la matière, peut-il être compofé de
moins de parties que la matière ? ne fout-il pas qu’il
foit dans l’air par des portions de fa fubftance numé-
.riquement diftinétes des portions par lefquelles il eft
dans l’ eaù réellement ; donc les philofophes qui femblent
avoir enfeigné l’unitc de Dieu ont été plus po-
lythéijles que le peuple. Ils ne favoient ce qu’ils di-
loient, s’ils croyoient dire que l’unité appartient à
Dieu. Elle ne peut lui convenir félon leur dogme,
que de la maniéré qu’elle convient à l’Océan, à une
nation, à une ville, à un palais, à une armée. Le dieu
qu’ils reconnoifloient être un amas d’une infinité de
parties, fi elles étoient homogènes, chacune étoit un
dieu, ou aucune ne l’étoit. Or fi aucune ne l ’avoit
é té, le tout n’auroit pas pû être dieu. Il folloit donc
qu’ils admiflent au pié de la lettre une infinité de
dieux, ou pour le moins un plus grand nombre qu’il
n y en avoit dans^ le poëme d’Hefiode, ni dans aucune
autre lithurgie. Si elles étoient hétérogènes, on
îomboit dans la même conféquence,car il falloir que
chacune participât à la nature divine 6c à l’effence de
1 ame du monde. Elle n’y pouvoit participer fans être
un dieu, puifque l’effence des chofes n’eft point fuf-
ceptible du plus ou du moins. On l’a toute entière
ou l’on n’en a rien du tout. Voilà donc autant de
dieux que de parties dans runivers. Que fi la nature
Tome X 1I%
de Dieun’avoit point été communiquée à qilelquès-*
unes des parties, d’où ferait venu quelle aurait été
communiquée à quelques autres ? 6c quel compofé
biforre 6c monftrueux ne feroit-ce pas qu’une ame
compofée de parties non vivantes 6c non animées, a
6c de parties vivantes 6c animées ? Il ferait encore
plus monftrueux de dire qu’aucune portion de dieu
n etoit un dieu > 6c que néanmoins toutes enfemble
elles compofoient un dieu; car en ce cas là l’être divin
eût été le réfultat d’un affemblage de plufieurs
pièces non divines, il eût été foit de rien, tout comme
fi l’étendue étoit compofée de points mathématiques.
Qu’on fe tourne de quelque côté qu’on voudra;
on ne peut trouver jamais dans les fyftèmes des anciens
philofophes, l’unité de Dieu ; ce fera toujours
une unité colleélive. Affectez de dire fans nommer jamais
l’armée, que tels ou tels bataillons ont foit ceci,
ou fans jamais articuler ni régimens , ni bataillons,
que l’armée a foit cela, vous marquerez également
une multitude d’acteufs. S’il n’y a qu’un feul Dieu
félon eux, c’eft de la même maniéré qu’il n’y a qu’un
peuple romain, ou que, félon Ariftote, il n’y a qu’une
matière première. Voyez dans faint Auguftin les embarras
où la doctrine de Varron fe trouve réduite. Il
croyoit que Dieu n’étoit autre chofe que l’aine du
monde. On lui foit voir que c’eft une divifion de Dieu
en plufieurs chofes, 6c la réduêtion de plufieurs chofes
en un feul D ieu. Laêtance aufli a très-bien montré le
ridicule du ferttiment des Stoïques, qui étoit à-peu-
près le même que celui de Varron. Spinoza eft dans
le même labyrinthe. Il foutient qu’il n’admet qu’une
fubftance, & il la nomme Dieu. Il femble donc n’admettre
qu’un Dieu ; mais dans le fond il en admet une
infinité fans le lavoir. Jamais on ne comprendra que
1 unité de lùbftance, à quoi il réduit l’univers , foit
autre chofe que l’unité colleétive, ou que l’unité formelle
des Logiciens, qui ne fubfifte qu’idéalement
dans notre efprit. S’il fe trouve donc dans les philofophes
payens quelques partages qui femblent auto-
riler d’une maniéré plus orthodoxe l’imité de D ieu,
ce ne font la plûpart du tems qu’un galimathias pompeux
; faites-en bien l’analyfe, il en fortira toujours
une multitude de dieux. On n’eft parfaitement unitaire
qu’autant qu’on reconnoît une intelligence parfaitement
fimple, totalement diftinguée delà matière
& de la forme du monde, produ&rice de toutes chofes,
6c véritablement fpirituelle. Si l ’on affirme cela
l’on croit qu’il n’y a qu’un Dieu ; mais fi on ne l’affirme
pas, on a beau fiffler tous les dieux du paganiftne
6c témoigner de l’horreur pour la multitude des dieux
on en admettra réellement une infinité. Or c’eft là
precifement le cas de tous les anciens philofophes
que nous avons prouvé ailleurs n’avoir aucune teinture
de la véritable fpiritualité.
Si M. Bayle s’étoit contenté de dire qu’en raifon-
nant conféquemment, on ne fe perfuaderoit jamais
que l’imité de Dieu fut compatible avec la nature de
D ie u , telle que l’admettoient les anciens philofo-
phhes , je me rangerais à fon avis. lime femble que
ce qu ils difoient de l’unité de Dieu, ne couloit point
de leur doâxine touchant la nature de cet Etre. Je
parle même de la doctrine des premiers peres de l’E-
glife, qui mettoient dans Dieu une efpece de maté-
rialifme. Cette doctrine bien pénétrée, 6c conduite
exa&ement de conféquence en conféquence, étoit
l’éponge de toute religion. Les raifonnemens de M.
Bayle , que j’ai apportés en objeftion, en font une
preuve bien évidente. Mais comme les opinions, in-
confequemment 6c très-impertinémment tirées d’une
hypothefe , n’entrent pas moins facilement dans les
efprits , que fi elles émanoient néceflairement d’un
bon principe ; il fout convenir que les philofophes
payens ont véritablement reconnu l’unité de D ie u ,
F F F ' f f f ~