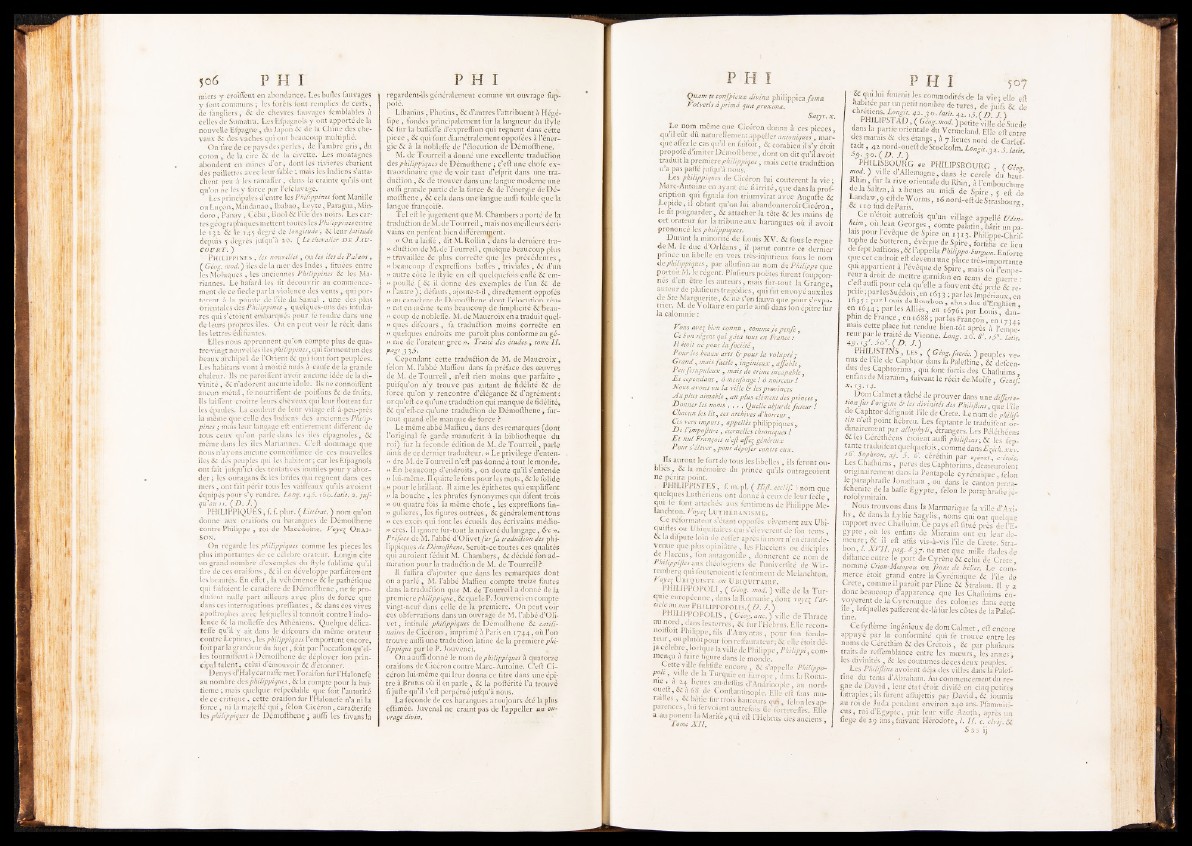
mi ers y croiffent en abondance. Les bu fies fativages
y font communs ; les forêts font remplies de cerfs,
de fangliers, 6c de chevres fauvages feinblables à
celles de Sumatra. Les Elpagnols y ont apporté de la
nouvelle Efpagne , du Japon 6c de la Chine des chevaux
6c des vaches qui ont beaucoup multiplie.
On tire de ce pays des perles, de l’ambre gris, du
coton , de la cire & de la civette. Les montagnes
abondent en mines d’o r , dont les rivières charient
des paillettes avec leur fable ; mais les Indiens s’ attachent
peu à les ramalfer, dans la crainte qu’ils ont
qu’on ne les y force par l’el clavage.
Les principales d’entre les Philippines font Manille
ou Luçon, Mindanao, Ibabao, Leyte, Paragua, Min-
doro, Panay, Cébu, Bool 6c l’ile des noirs. Les cartes
géographiques mettent toutes les Philippines entre
le 132 6c le 145 degré de Longitude, 6c leur latitude
depuis 5 degrés julqu’à 20. (Le chevalier d e Ja u -
COURT. )
P h il ip p in e s , les nouvelles , où les lies de Palaos,
( Géog. mod. ) îles de la mer des Indes , fituées entre
les Moluques , les anciennes Philippines 6c les Ma-
riannes. Le hafard les fit découvrir au commencement
de ce fiécle par la violence des vents, qui portèrent
à-la pointe de l’île du Samal , une des plus
Orientales dés Philippines, qüelques-uns des infulai-
res qui s’étoient embarqués pour fe rendre dans une
de leurs propres îles. On en peut voir le récit dans
les lettrés édifiantes.
Elles nous apprennent qu’on compte plus de quatre
vingt nouvellesîles philippines, qüiformentun des
beaux archipel de l’Oriènt 6c qui font fort peuplées.
Les habitans vont à moitié nuds à eaufe de la grande
chaleur. Ils ne paroiffent avoir aucune idée de la divinité
, & n’adorent aucune idole. Ils ne connoiffent
aucun métal, fe nourriflent de poiffons 6c de fruits.
Ils biffent croître leurs chëveux qui leur flottent fur
les épaules. La couleur de leur vil'age eft à-peu-près
là même que celle des Indiens des anciennes Philippines
; mais leur langage eft entièrement différent de
tous ceux qu’ori parle dans les îles efpagnoles, 6c
même dans les îles Mariannes. G’eft dommage que
nous n’ayons aucune connôiffance de ces nouvelles
îles 6c des peuples qui les habitent ; car les Efpagnols
ont fait jufqu’ici des tentatives inutiles pour y aborder
; les ouragans 6c les brifes qui regnént dans ces
mers , ont fait périr tous les vaiffeaux qu’ils avoient
équipés pour s’y rendre. Long. i 4S. iSo.latit. z.ju f-
qu au u. ( D . J. )
PHILIPPIQUES, f. f. plur. ( Littirat. ) nom qu’on
donne aux ■ oraifons ou harangues de Démofthené
contre Philippe , roi de Macédoine. Voye^ O raison
.
On regarde les philippiques comme les pièces les
plus importantes de ce célébré orateur. Longin cite
un grand nombre d’exemples du ftyle fublime qu’il
tire de ces oraifons, & i l en développe parfaitement
les beautés. En effet, la véhémence 6c le pathétique
qui faifoient le caraftere de Démofthene, ne fe pro-
duifent nulle part ailleurs avec plus de force que
dans ces interrogations preffantes, & dans Ces vives
apoftrophes avec lefquelles il tonnoit contre l’indolence
6c la molleffe des Athéniens. Quelque délica-
teffe qu’il y ait dans le difeours du même orateur
contre Leptines, les philippiques l’emportent encore,
foitpar la grandeur du fujet, foit par l’occafion qu’elles
fourniflent à Démofthene de déployer fon principal
talent, celui d’émouvoir 6c d’étonner.
Denys d’Halycarnaffe met l’oraifonfurl’Halonefe
au nombre des philippiques, & la compte pour la huitième
; mais quelque refpeftable que foit l’autorité
de ce critique, cette oraifon fur l’Halonefe n’a ni la
force , ni la majefté q ui, félon Cicéron, carafterife
les philippiques de Démofthene \ auffi les favans là
regardent-ils généralement comme un ouvrage fup-
pofé.
Libanius, Photius, 6c d’autres l’attribuent à Hégé-
fipe , fondés principalement fur la langueur du ftyle
6c fur la baffeffe d’expreflion qui régnent dans cette
piece , 6c qui font diamétralement oppofées à l’énergie
& à la nobleflè de l’élocution de Démofthene.
M. de Tourreil a donné une excellente traduftion
des philippiques de Démofthene ; c’eft une chofe extraordinaire
que de voir tant d’efprit dans une traduftion
, 6c de trouver dans une langue moderne une
auffi grande partie de la force & de l’énergie de Démofthene
, 6c cela dans une langue auffi foible que la
langue frànçoife.
Tel eft le jugement que M. Chambers a porté de la
traduftion deM. de Tourreil, mais nos meilleurs écrivains
en penfent bien différemment.
« On a laiffé , dit M. Rollin , dans la deruiere tra-
» duftion deM. de Tourreil, quoique beaucoup plus
» travaillée 6c plus correfte que les précédentes,
» beaucoup d’expreffions baffes , triviales , 6c d’un
» autre côté le ftyle en eft quelquefois enflé 6c em-
» poullé ( & il donne des exemples de l’un fk. de
» l’autre); défauts, ajoute-t-il, direftement oppofés
» au caraftere de Démofthene dont l’élocution réu-
» mt en même tems beaucoup de fimplicité &beau-
» coup de nobleffe. M. de Mau croix en a traduit quel-
» ques difeours, fa traduftion moins correfte en
» quelques endroits me paroît plus conforme au gé-
» nie de l’orateur grec >>. Traité des études, tome II.
page ^ 5.
Cependant cette traduftion de M. de Maucroix,
félon M. l’abbé Maffieu dans fa préface des oeuvres
de M. de Tourreil, n’eft rien moins que parfaite ,
puifqu’on n’y trouve pas autant de fidélité 6c de
force qu’on y rencontre d’élégance 6c d’agrément :
or qu’eft-ce qu’une traduftion qui manque de fidélité,
6c qu’eft-ce qu’une traduftion de Démofthene, fur-
tout quand elle manque de force ?
Le même abbé Maffieu, dans des remarques (dont
l’original fe garde manuferit à la bibliothèque du
roi) fur la fécondé édition de M. de Tourreil, parle
ainfi de ce dernier tradufteur. « L e privilège d’enten-
» dre M. de Tourreil n’eft pas donne à tout le monde.
» En beaucoup d’endroits, on doute qu’il s’entende
» lui-même. Il quitte le fens pour les mots, 6c le folide
, » pour le brillant. Il aime les épithetes qui empliffent
» la bouche , les phrafes fynonymes qui difent trois
» ou quatre fois la même chofe , les expreffions fin-
» gulieres, les figures outrées, 6c généralement tous
» ces excès qui font les écueils des écrivains médio-
» cres. Il ignore fur-tout la naïveté du langage, &c ».
Préface de M. l’abbé d’Olivetfur fa traduction des philippiques
de Démofthene. Seroit-ce toutes ces qualités
qui auroient féduit M. Chambers, 6c décidé fon admiration
pour la traduftion de M. de Tourreil?
Il fuffira d’ajouter que dans les remarques dont
on a parlé , M. l’abbé Maffieu compte treize fautes
dans la traduftion que M. de Tourreil a donné de la
première phtlippique, 6c que le P. Jouvenci en compte
vingt-neuf dans celle de la première. On peut voir
ces obfervations dans un ouvrage de M. l’abbé d’Olivet
, intitulé philippiques de Démofthene 6c catill-
naires de Cicéron , imprimé à Paris en 1744, oîi l’on
trouve auffi une traduftion latine de la première phi-
lippique par le P. Jouvenci.
On a auffi donné le nom de philippiques à quatorzè
oraifons de Cicéron contre Marc-Antoine. C’eft Cicéron
lui-même qui leur donna ce titre dans une épî-
tre à Brutus oh il en parle , 6c la poftérité l’a trouve
fi jufte qu’il s’eft perpétué jufqu’à nous.
La fécondé de ces harangues a toujours été la plus
eftimée. Juvenal ne craint pas de l’appeller un ouvrage
divin.
Quant te confpicuct divina philippica
Volveris a prima quet proxima.
Satyr. x.
Le notn même que Cicéron donna à ces pièces,
qu’il eût dû naturellement appeller anioniques , marque
allez le cas qu’il en faifoit, & combien il s’y étoit
propofe d imiter Demofthene, dont on dit qu’il avoit
traduit la premiere philippique, mais cette traduftion
n’a pas paffé jufqu’à nous.
Les philippiques de Cicéron lui coûtèrent la vie ;
Mai c-Antoine en ayant été fi irrité, que dans la prof-
cription qui fignala fon triumvirat avec Augufte 6c
Lepide, il obtint qu’on lui abandonneroit Cicéron
le fit poignarder, 6c attacher la tête 6c les mains de
cet orateur fur la tribune aux harangues oii il avoit
prononcé les philippiques.
Durant la minorité de Louis X V . & fous le régné
de M. le duc d’Orléans, il parut contre ce dernier
prince un libelle en vers très-injurieux fous le nom
de philippiques, par allufionaü nom de Philippe que
portait M. le régent. Plufieurs poètes furent foupçon-
nes d’en être les auteurs , mais fur-tout la Grange,
auteur de plufieurs tragédies, qui fut envoyé aux îles’
de Ste Marguerite, 6c ne s’en fauva que pour s’expatrier.
M. de Voltaire en parle ainfi dans fon épîtrelur
la calomnie :
Vous ave^ bien connu , comme je penfe,
Ce bon régent qui gâta tout en France ;
I l étoit né pour la fociété,
P our les beaux arts <S* pour la volupté y
Grand, mais facile , ingénieux, affable,
Peu fcrupuleux , niais de crime incapable ,
E t cependant, ô menfonge ! ô noirceur l
Nous avons vu la ville & les provinces
A u plus aimable, au plus clément des princes ,
Donner les noms . . . . Quelle abjurde fureur !
Chacun les lit, ces archives d'horreur
Ces vers impurs, appellés philippiques,.
D e rimpoflure , éternelles chroniques !
E t nul François n'efl ajfe£ généreux
P our s'élever, pour dépofer cohtre eux.
Ils auront le fort de tous les libelles , ils feront oublies,
& la mémoire du prince qu’ils outrageoient
ne périra point.
PHILïPPISTES, f. m. pl. ( Hifl. eccléf. ) nom que
quelques Luthériens ont donné à ceux de leur fefte
qui fe font attachés aux fentimens de Philippe Me-
lanchton. Voye^L u t h é r a n i sm e .
Ce reformateur s’étant oppofés vivement aux Ubi-
quiftes ou Ubiquitaires qui s’élevèrent de fon tems
6c la difpute loin de ceffer après fa mort n’en étant devenue
que plus opiniâtre , les Flacciens ou difciples
de Flaccus, fon antagonifte , donnèrent ce nom de
Philippines aux théologiens de l’univerfité de Wir-
temberg qui foutenoient le fentiment de Melanchton.
Voye^ U b iq u is t e ou U b iq u it a ir e .
PHILIPPOPOLI, ( Géog. mod. ) ville de la Turquie
européenne, dans la Romanie, dont voye^ l'article
au mot P h il ip p o p o l is .(Z ) . J. )
PHIUPPOPOLIS , ( Géog. anc. ) ville de Thrace
™ nf f r.d les terres, 6c Jhr l’Hebrus. Elle recon-
nomoit Philippe, fils d’Amyntas , pour fon fonda-
teur, ou plutôt pour fon reftaurateur; 6c elle étoit déjà
célébré, lorfque la ville de Philippe, Philippi. commença
à faire figure dans le monde. ’ I
Cette ville fubfifte encore , 6c s’appelle Philippo-
P° 1 , ville de la Turquie en Europe , dans la Roma-
me \ lieues au-deffus d’Andrinople, au nord-
oueft, & à 68 de Conftantinople. Elle eft fans murailles
, & bâtie fur trois hauteurs qui , félon les apparences
, lui fervoient autrefois tie fôrtereffes. Elle
a au ponentInMarife, qui eft l’Hebrus des anciens, ,
i 01ne X I I . 7 J
1 u , , ........... “ vvi,**iiuuuta uc ta v ie : eue éit
ta ta te e pa r un p e u t nombre de tu rc s, de juifs & de
chrétiens. Longit. 42. 30. huit. 42. ,5 / n j \
PH IL IP S T A D , ( Géog. mod. ) petite v ille dêStiede
dans la partie orientale du Vermelând. Elle eft entre
des marais & des é tan g s , à 7 lieues nord de C arlef-
t a d t , 4 2 no td-o ue lt d /.•) • eStockoIm. Longit. 2 u ,:, S i l - J - lM t C ,
PHILISBOURG ou PHÎLIPSBOURG , (Givr
W . ) ville d’Ailemagne, dans le cercle du haut
Rhin fur la nve orientale du Rhin, à l’élnhouchure
de làoaltza,à 2 lieues au midi de Spire, t eft de
Landaw.9 e f td e yd r in s , tdnord-eft de Strasbourg '
oc 110 lud de Pans. ° 9
C e n’etoit autrefois qu’un v illage appelle t/den-
, 011 “ G e o r g e s , comte palatin, bâtit un palais
pour l e veque de Spire en 1313. Philippe-Chrif-
tophe de So tte ren, é vêque de S p ir e , fortifié de lieu
de fept b a lh on s , & l’appellâ Phitippo-burgum. Enforte
que cet endroit eft devenu une place très-importante
qui appartient à l’e vêque de S p ir e , mais où l’empe*'
reur a droit de mettre garnifon en tems de guerre :
c eit auffi pour cela qu’elle a fouvent été prife 6c re-
p r iftjp a r ie sS u éd o is .e n 1633 ; parles Impèriaiix, en
1635 ; par Louis de Bourbon , alors duc d’Enghien
B B S paHeS Allié„s > B I H L o u is , .dauphin
dp F rance , en i 6 S S ; par les F rançois, en 1 7 1 4 •
mals ce“ e Place fin rendue bien-tôt après à l’empé*
reur par le traité de Vienne . Long. zC. 8'. /S" latit 4S)- ' 3'■ 5° " ‘ ( D . J .)
LES > ( Gèog.facréc. ) peuples v e -
nus de l i l e de Caphtor dans la P aleftine, 6c defeen-
dus des C aphto rims, qui font fortis des Chafluims
enfansde M izraïm, fuivant le récit de.Moiïe , Genek
x . ,3 . , 4. ’
D om Calmet a tâché de prou ve r dans une differta-
tionfur l'origine & les divinités des Philiflins. que l ’île
de Caphtor défignoit l’île de Crete. L e nom de philif
tin n eft point hébreu. Les feptante le traduifent ordinairement
par allophyli, étrangers. Les Péiéthéens
6c les Ceréthéens étoient auffi philiflins ; 6c les feptante
traduifent quelquefois, comme dans Eréch xxv
i 6 .Sophron. xj, S, 6 . c é ré th in p a r »pérai, crétois.
Les Chafluims , peres des Caphtorims, demeuroient
originairement dans la Pentapole C yrén aïque , félon
le paraphrafte Jonatham , ou dans le canton penta-
lchenite de la baffe E g y p te , félon le paraphrafte jé»
rofolymitain.
Nous trouvons dans la Marmarique la v ille d’A x i-
l i s , 6c dans la L y b ie S a g y lis , noms qui ont quelque
rapport av e c Cha fluim.Ce pays eft fitué près de l’E g
yp te , oti les enfans de Mizraïm ont eu leur demeure
; 6c il eft affis v is -à -vis l’île de Crete . Stra-
b o n , l. X VII. pag. 83 y. ne met que mille ftades de
diftance entre le port de C y r èn e 6c celui de C r e t e ,
nommé Criou-Metopou ou front de bélier. Le commerce
etoit grand entre la Cyrén aïque & l’île de
C r e te , comme il paroît par Pline 6c Strabom II y a
donc beaucoup d’apparence que les Chafluims env
o y è ren t de la C yrén aïque des. colonies dans cette
î l e , lefquelles pafferent d e-làfurles côtes de la Paleftine.
C e fyftème ingénieux de dont C a lm e t, eft encore
appuyé par la conformité qu i fe trouv e entre les
noms de Céréthim 6c des C réto is , & par plufieurs Ü
traits de reffemblance entre les moe urs, les armes',
les divinités , 6c les coutumes de ces d eux peuples.
Les Philiflins avoient déjà dés v illes dans la Paleftine
du tems d’Abraham. Au commencement du régné
de D a v id , leur état étoit divifé en cinq petites
iâtrapies ; ils furent affiijettis par D a v id , 6c ioumis
au fo i de Juda pendant environ 240 ans. Pfammit!-
c u s , ro i d’E g yp te , prit leur ville  z o th , après un
fiegë de 29 ans, fuivant Hérodote, /. II. ci clvij. 6c
S s s i j