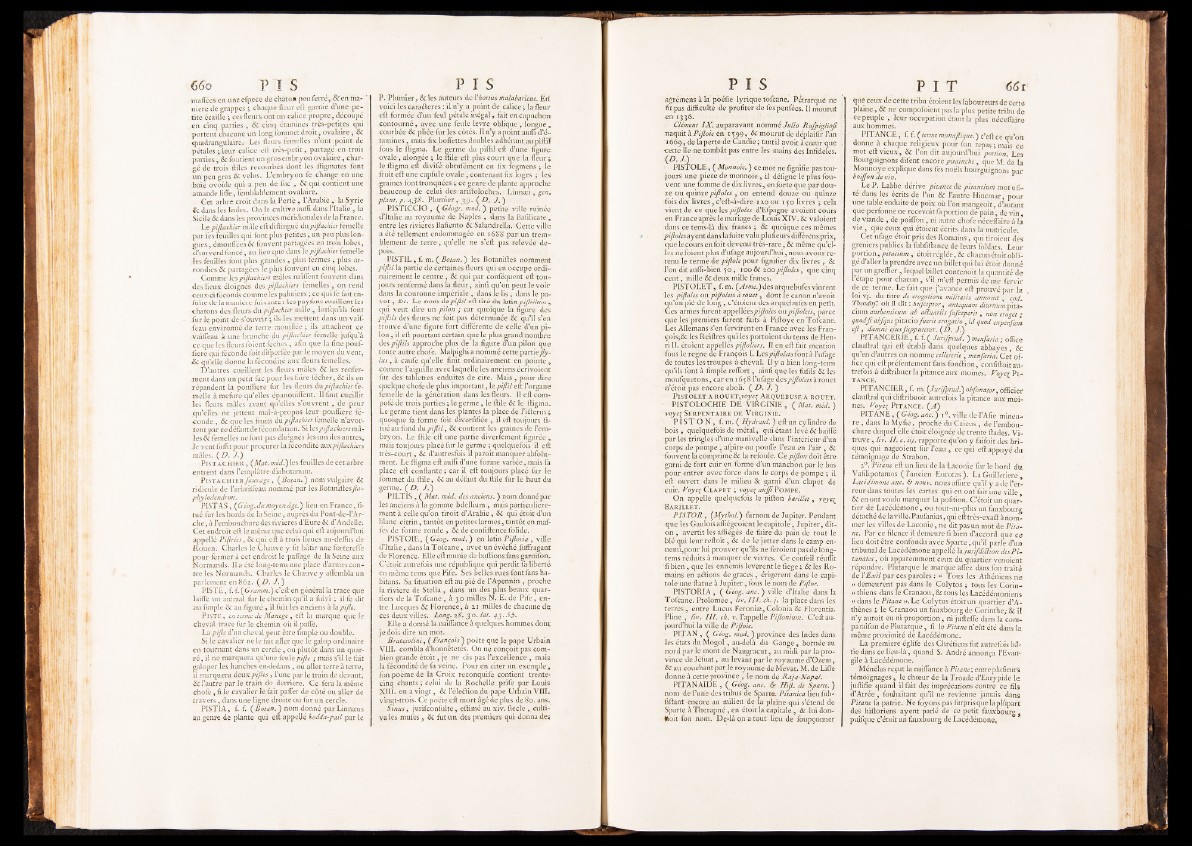
malices en une efpece de chatoft peu ferré, & en liia-
niere de grappes ; chaque fleur eli garnie d une petite
écaille ; ces fleurs ont un calice propre, découpé
en cinq parties , & cinq etamines tres-petites qui
portent chacune un long l'ommct droit, ovalaire, &
quadrangulaire. Les fleurs femelles n’ont point de
pétales;leur calice eft très-petit, partagé en trois
parties, & foutient un gros embryon ovalaire, chargé
de trois Ailes recourbés dont les ftigmates font
un peu gros & velus. L’embryon fe change en une
baie ovoïde qui a peu de fuc , & qui contient une
amande lifle, femblablement ovalaire.
Cet arbre croît dans la Perfe , l’Arabie , la Syrie
& dans les Indes. On le cultive aufli dans l’Italie , la
, Sicile & dans les provinces méridionales de la France.
Le pifiachier mâle efl: diftingué dupifiachier femelle
par fes feuilles qui font plus:petites, un peu plus longues
, émouffées & fouvent partagées en trois lobes,
d’unverdfoncé, au lieu que dans 1 e pifiachier femelle
..les feuilles font plus grandes , plus fermes , plus arrondies
& partagées le plps fouvent en cinq lobes.
Comme lès piftachiers mâles naiflènt fouvent dans
des lieux éloignés des piftachiers femelles, on rend
ceux-ci féconds comme les palmiers ; ce qui fe fait en-
fuite de la maniéré fuivante : les paylans cueillent les
:chatons des fleurs du pifiachier mâle , lorfqu’ils font
.fur le point de s’ouvrir ; ils les mettent dans un vaif-
feau environné de terre mouillée; ils attachent ce
-vaifleau à une branche du pifiachier femelle jufqu’à
ce qué les fleurs foientfe'ches, afin que la fine pouf-
.fiere qui féconde foitdifperfée par le moyen du vent,
£c qifelle donne la fécondité aux fleurs femelles.
D ’autres cueillent les fleurs mâles lk les renfer-
.ment dans un petit fac pour les faire fecher, & ils en
répandent la poufliere fur les fleurs du pifiachier femelle
à mefure qu’ elles épanouiflènt. Il faut cueillir
les fleurs mâles avant qu’elles s’ouvrent, de peur
qu’elles ne jettent mal-à-propos leur poufliere féconde
, & que les fruits du pijtachier femelle n’avortent
par ce défaut de fécondation. Si les piftachiers mâles
& femelles ne font pas éloignés les uns des autres,
Je ventfuflit pour procurer la fécondité aux piftachiers
mâles. (D . J.)
P i s t a c h ie r , (Mat. méd.)les feuilles de cet arbre
entrent dans l’emplâtre diabotanum.
Pi s t a c h ie r fauvagc, (Botan. ) nom vulgaire &
ridicule de l’arbriffeau nommé par les Botaniftesftaphylodcndron.
PISTAS, ( Géog. du moyen dge.) lieu en France, fi-
tué fur les bords de la Seine, auprès du Pont-de-l’Ar-
ch e, à l’embouchure des rivières d’Eure & d’Andelle.
Cet endroit efl le même que celui qui efl: aujourd’hui
appellé Piflrées, & qui efl: à trois lieues au-defliis de
Rouen. Charles le Chauve y fit bâtir une forterefîe
pour fermer à cet endroit le paflage de la Seine aux
Normands. Il a été long-tems une place d’armes contre
les Normands. Charles le Chauve y affembla un
parlement en 861. (D . J. )
. PISTE, f. f. (Gramm.) c’eft en général la trace que
laiffe un animal fur le chemin qu’il a fuivi ; il fe dit
au Ample & au figuré, il fuit les anciens à la pifle.
P ist e , en terme de Manege , efl: la marque que le
che va l trace fur le chemin oîi il paffe.
La pijle d’un cheval peut être fimple ou double.
Si le cavalier ne le fait aller que le galop ordinaire
en tournant dans un cercle, ou plutôt dans un quar-
r é , il ne marquera qu’une feule pijle ; mais s’il le fait
galoper les hanches en-dedans, ou aller terre à terre,
ii marquera deux piftes, l’une par le train de devant,
& l’autre par le train de derrière. Ce fera la même
chofe , fi le cavalier le fait palier de côté ou aller de
travers, dans une ligne droite ou fur un cercle.
PISTIA, f. f. {Botan.J nom donné par Linnæus
au genre de plante qui efl appellé kodda-pail par le
P. Phtmier, & le s auteurs de l’hortus malabaricus. Ëri!
voici les caraéleres : il n’y a point de calice ; la fleur
efl formée d’un feul pétale inégal, fait en capuchon
contourné, avec une feule levre oblique , longue,
courbée &c pliée fur les côtés. Il n’y a point aufli d’étamines
, mais fix boffettes doubles adhérant au piftil
fous le ftigma. Le germe du piftil efl: d’une figure
ovale, alongée ; le ftile eft plus court que la fleur ;
le ftigma eft divifé obtufément en fix fegmens ; le
fruit eft une capfule ovale , contenant fix loges ; les
graines font tronquées ; ce genre de plante approche
beaucoup de celui des-ariftoloches. Linnæi, gen.
plant, p. 43 S. Plumier ,35). ( D. J. )
PISTICCIO , ( Géogr. mod. ) petite ville ruinée
d’Italie au royaume de Naples , dans la Bafilicate,
entre les rivières Rafiento & Salandrella. Cette ville
a été tellement endommagée en 1688 par un tremblement
de terre ,• qu’ elle ne s’eft pas relevée depuis.
PISTIL, f. m. ( Botan. ) les Botaniftes nomment
piftil la partie de certaines fleurs qui en occupe ordinairement
le centre , & qui par conféquent eft toujours
renfermé dans la fleur, ainfi qu’on peut le voir
dans la couronne impériale , dans le lis , dans le pavot
, &c. Le nom de piflil eft tiré du latin pijlillum,
qui veut dire un pilon ; car quoique la figure des
piftils des fleurs ne foit pas déterminée & qu’il s’en
trouve d’une figure fort différente de celle d’un pilon
, il eft pourtant certain que le plus grand nombre
des piftils approche plus de la figure d’un pilon que
toute autre chofe. Malpighi a nommé cette partiefty-
lus, à caufe qu’elle finit ordinairement en pointe,
comme l’aiguille avec laquelle les anciens écrivoient
fur des tablettes enduites de cire. Mais , pour dire
quelque chofe de plus important, le piftil eft l’organe
femelle de la génération dans les fleurs. Ileftcom-
pofé de trois parties ; le germe, le ftile &c le ftigma.
Le germe tient dans les plantes la place de l’i&erus ;
quoique fa forme foit diverfifiée , il eft toujours ft-
tué au fond du piftil, & contient les graines de l’embryon.
Le ftile eft une partie diverfement figurée ,
mais toujours placé fur le germe ; quelquefois il eft
très-court, & d’autresfois il paroît manquer abfolu-
ment. Le ftigma eft aufli d’une forme variée, mais fa
place eft confiante ; car il ell toujours placé fur le
îommet du ftile, & au défaut du ftile fur le haut du
germe. ( D . J .)
PILTIS , ( Mat. méd. des anciens. ) nom donné par
les anciens à la gomme bdellium , mais particulièrement
à celle qu’on tiroit d’Arabie, & qui étoit d’un
blanc citrin, tantôt en petites larmes, tantôt en maf-
fes de forme ronde , & de confiftence folide.
PISTOIE, ( Géog. mod. ) en latin Piftoria , ville
d’Italie, dans la Tofcane, avec un évêché ffuffragant
de Florence. Elle eft munie de baftions fans garnifon.
C ’étoit autrefois une république qui perdit la liberté
en même tems que Pife. Ses belles rues fontfâns har
bitans. Sa fituation eft au pié de l’Apennin , proche
la riviere de Stella , dans un des plus beaux quartiers
de la Tofcane , à 30 milles N. E. dé Pife, entre
Lucques & Florence, à z i milles de chacune de
ces deux villes. Long. 28s.3 0. lat. 4 3 .56.
Elle a donné la naïffance à quelques hommes dont
je dois dire un mot.
Bracciolini, ( François ) poète que le pape Urbain
VIII. combla d’honnêtetés. On ne conçoit pas combien
grande étoit, je ne dis pas l’excellence , mais
la fécondité de fa veine. Pour en citer un exemple,
fon poème de la Croix reconquife contient trente-
cinq chants ; celui de la Rochelle prife par Louis
XIII. en a vingt, & l’éleâion du pape Urbain VIII.
vingt-trois. Ce poète eft mort âgé de plus de 80. ans.
Sinus, jurifconfulte, eftimé au xiv. fiecle , cultiva
les mufes , ôc fut un des premiers qui donna des
àgrémens à la pôéfie lyrique tofcane. Pétrarque ne
fit pas difficulté de profiter de fes perifées. Il mourut
en 1336.
Clément IX . auparavant nommé Julio Rojpiglioji
naquit à Piftoie én 1599 ? & mourut de déplaifir l’an
1669, de la perte de Candie; tant il avoit à coeur que
■ cette île ne tombât pas entre les mains des Infidèles.
( o . /.) HMHHMji PISTOLE, ( Monnoie. ) ce mot ne fignifie pas toujours
une piece de monnoie, il défigne le plus fouvent
une fomme de dix livrés, en forte que pardou-
ze ou quinze piftoles , on entend douze ou quinze
■ fois dix livres , c’eft-à-dire-izo ou 150 livres ; cela
vient de ce que les piftoles d’Efpagne avoient cours
en France après le mariage de Louis XIV. & valoient
dans ce tems-là dix francs ; & quoique ces mêmes
■ piftoles ayent dans lafuite valu planeurs différons prix,
que le cours en foit devenu très-rare, &: même qu’elles
ne foient plus d’ufage aujourd’hui, nous avonsre-
tenu le terme de piftoie pour lignifier dix livres , &
l’on dit aufli-bien 50, 100 & zoo piftoles, que cinq
-cent, mille & deux mille francs.:
PISTOLET, f. m. (Arme.) des arquebufes vinrent
-les piftoles ou piftolets à rouet, dont le canon n’avoit
qu’un pié de long , c’étoient des arquebufes en petit.
■ Ces armes furent appelléespiftoles ou piftolets, parce
que les premiers furent faits à Piftoye en Tofcane.
: Les Allemans s’en fervirent en France avec les Fran-
• çois;& les Reiftres qui les portoient du tems de Henri
II. étoienî appellés piftoliers. Il en eft fait mention
• fous le régné de François I. Les piftolets (ont k l’ufage
de toutes les troupes à cheval. Il y a bien long-téms
• qu’ils font à fimple reffort, ainfi que les fufils & les
moufquetons, car en 16 5 8 l’ufage des piftolets à rouet
n’étoit pas encore aboli. ( Z). J. )
P is t o l e t a r o u e t yoye[ A r q u e b u s e a r o u e t .
- PISTOLOCHIE DE VIRGINIE , ( Mat. méd. )
voyc{ S e r p e n t a ir e d e V ir g in ie .
P I S T O N , f. m. ( Hydraul. ) eft un Cylindre de
bois , quelquefois de métal , qui étant levé & baiffé
•par les tringles d’une manivelle dans l’intérieur d’un
•corps de pompe, afpire ou pouffe l’eau en l’air , &
■ fouvent la comprime & la refoule. Ce pijlon doit être
‘ garni de fort cuir en forme d’un manchon par le bas
pour entrer avec force dans le corps de pompe ; il
eft ouvert dans le milieu & garni d’un clapet de
cuir. Foye[ C l a p e t ; voye{ aujji Po m p e .
On appelle quelquefois le pifton barillet, voye^
Ba r il l e t .
PISTOR, (MythoL) furnom de Jupiter. Pendant
que les Gaulois afîiégeoient lecapitole, Jupiter, dit-
on , avertit les afliégés de faire du pain de tout le
blé qui leur reftoit, & de le jetter dans le camp ennemi,
pour lui prouver qu’ils ne feroient pas de long-
tems réduits à manquer de vivres. Ce confeil réuffit
'fi bien, que les ennemis levèrent le fiege ; &les Ro-
'mains en a étions de grâces , érigerent dans lé Capitole
une ftatue à Jupiter, fous le nom de Piftor.
PISTORIA , ( Géog. anc. ) ville d’Italie dans la
Tofcane. Ptolomée , liv. I I I . th. j, la place dans les
terres , entre Lucus Feroniæ, Colonia & Florentia.
Pline , liv. I lI . ch. v. l’appelle Piftoniurn. C ’eft aujourd’hui
la ville de Piftoie.
PITAN , ( Géog. mod. ) province des Indes dans
les états du M ogol, au-delà du Gange , bornée au
nord par le mont de Naugracut, au midi par la province
de Jéfuat, au levant par le royaume d’Ozem,
& au couchant par le royaume de Mevat. M. de Lifle
donne à cette province , le nom de Raja Nupal.
PITANAIDE, ( Géog. anc. 6* Hift. de Sparte. )
nom de l’une des tribus de Sparte. Pitanica lieu fub-
fiftant encore au milieu de- la plaine qui s’étend de
Sparte àTherapné, en étoit la capitale, & lui don-
fcoit fon nom. De-là on a tout lieu de foupçonner
qtlé ceux de cette tribu étoient les laboureurs de cette
plaine, & ne compofoient pas la plus petite tribu de
ce peuple , leur occupation étant la plus néceffaire
aux hommes.
PIT AN C E , f. f. ( terme monaftique. ) c’efl: ce qu’on
donne à chaque religieux pour fon repas ; mais ce
mot eft v ieux, & l’on dit aujourd’hui portion. Les
Bourguignons difent encore pitainche, que M. de la
Monnoye explique dans fes noels bourguignons par
boijjon de vin.
' Le P. Labbe dérive pitance de pitancium motulî-
te dans les écrits de l’un & l’autre Hincmar, pour
une table enduite de poix oîi l’on mangeoit, d’autant
que perfonne ne recevoit fa portion de pain, dé vin ,
de viandé , de poiffon, ni autre chofe néceffaire à fa
vie , que ceux qui étoient écrits dans la matricule.
Cet ufage étoit pris des Romains, qui tiroient dés
greniers publics la fubfiftance de leurs foldats. Leur
portion, pitacium, étoit réglée, & chacun étoit obligé
d’aller la prendre avec un billet qui lui étoit donne
par un greffier, lequel billet contenoit la quantité de
1 etape pour chacun, s’il m’eft permis de me fervir
de ce terme. Le fait que j’avance eft prouvé par la
loi vj. du titre de trogatione rnilitaris annonce , cod.
Theodof. ou il dit : Sitfceptor, antequam diurnümjitz-
cnim authenticum ab aeluariis fufeeperit, non eroset *
quodjî abfque pitacio fuerit erogatio , id quod expenfum
eft , damni ejus fupputetur. (D . J.)
PITANCERIE, f. f. ( Jurifprud. ) menfaria ; office
clauftral qui eft établi dans quelques abbayes, tk.
qu’en d’autres on nomme cellererie , menfaria. Cet office
qui eft préfentement fans fon&ion, confiftoit autrefois
à diftribuer la pitance aux moines. Voyez Pit
a n c e .
PITANCIER, f. m. (Jurifprud.) obfànator^ officier
clauftral qui diftribuoit autrefois la pitance aux moines.
Voyez Pit an .c e . (A )
PITÀNE, ( Géog. anc. ) i°. ville de l’Afîe mineure
, dans la M yfie, proche du Caïcus , de l’embouchure
duquel elle étoit éloignée de trente ftades. Vi-
truve, liv. II. c. iij. rapporte, qu’on y faifoit des briques
qui nageoient fur l’eau , ce qui eft appuyé du
témoignage de Strabon.
z°. Pitane eft un lieu de la Lacôrtie fur le bord du
Vafilipotamos ( l ’ancien Eurotas). LaGuilletiere,
Lacédémone anc. & nouv. nous affure qu’il y a de l’erreur
dans Toutes les cartes qui en ont fait une ville
& en ont voulu marquer la pofition. C’étoit un quartier
de Lacédémone, ou tout-aù-plus un fauxbourg
détaché de la ville. Paufanias, qui eft très-exaft à nommer
les villes de Laconie, ne dit pas un mot de Pitane.
Par ce filence il demeure fi bien d’accord que ce
lieu doit être confondu avec Sparte, qu’il pafle d’un
tribunal de Lacédémone appellé la jürifdiclion des Pi-
tanates, oîi apparemment ceux du quartier venoient
répondre. Plutarque le marque affez dans fon traite
de l’E x il par ces paroles : « Tous les Athéniens ne
» demeurent pas dans le Colytos ; tous les Corin-
» thiens daps le Cranaou,& tous les Lacédémoniens
» dans le Pitane ». Le Colytos étoit un quartier d’A thènes
; le Cranaou un fauxbourg de Corinthe; & il
n’y aurait eu ni proportion^ ni jufteffe dans la com-
paraifon de Plutarque, fi le Pitane n’eût été dans la
même proximité de Lacédémone.
La première églife des Chrétiens fut autrefois bâtie
dans ce lieu-là, quand S. André annonça l’Evangile
à Lacédémone.
Ménélas reçut la naiffance à Pitane ; entre plufieurà
témoignages , le choeur de la Troade d’Euiypide le
juftifie quand il fait des imprécations contre Ce fils
d’Atrée, fouhaitant qu’il ne revienne jamais dans
Pitane fa patrie. Ne foyons pas furprisquelaplûpart
des hiftoriens ayent parlé de ce petit fauxbourg ,
puifque c’étoit un fauxbourg de Lacédémone,