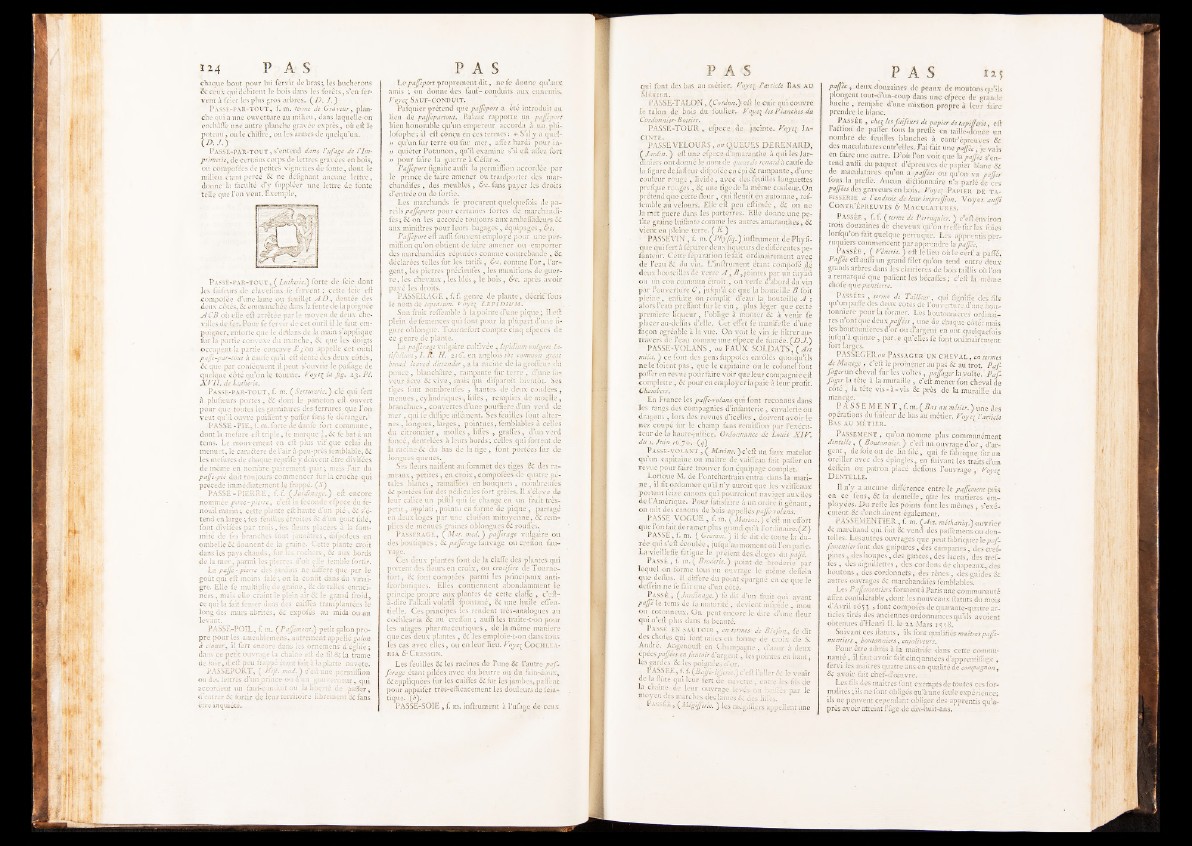
chaque bout pour lui fervir de bras ; les bûcherons
ôc ceux qui débitent le bois dans les forêts,s’en fervent
à icjer les plus gros arbres. ( D . J. )
PAS SE-PA R-TO UT , f.’m. terme de Graveur, planche
qui a une ouverture au milieu, dans laquelle on
enchâffe une. autre planche gravée exprès, où eft le
poteau, ou le chiffre, ou les armes de quelqu’un.
(D . J . )
P a s s e -PAR -TOU T , s entend dans l ufage de l'Imprimerie,
de certains corps de lettres gravées en bois,
ou compofées de petitès vignettes de fonte, dont le
milieu étant perce Ôc ne dcfignant aucune lettre,
donne la faculté d’y fuppléer une lettre cle fonte
telle que l’on'veut. Exemple*
Passè-par-tout , ( Lutherie.') forte de fcie dont
les faifeurs.de çlàveflinsTe fervent; cette fcie eft
compofée d’une lame ou feuillet A D , dentée des
.deux côtés, ôc emmanchée dans la fente de lapoignee
A CB où elle eft arrêtée parle moyen de deux chevilles
de fer. Pour fe fervir de cet outil il le faut empoigner,
enlorte que le dedans de la main s’applique
fur la partie convexe du manche, ôc que le»; doigts
occupent la partie concave E ; ou appelle cet outil
paffc-par-tout à caufe qu’il eft denté des deux côtés,
ôc que par conféquent il peut s’ouvrir le paffage de
quelque côté qu’on le tourne. Voytç la fig. 23. PI.
X V I I . de Lutherie.
Passe-par-tout , f. m. ( Serrurerie. ) clé qui fert
à plufieurs portes, ôc dont le paneton eft ouvert
pour que toutes les garnitures des ferrures que l’on
veut qu’il ouvre puiffent y palfer fans fe déranger.*
PASSE - PIE, f. m. forte de danfe fort commune,
dont la mefure eft triple, fe marque g, ôc fe bat à un
tems. Le mouvement en eft plus v if que celui du
menuet, le caractère de l’air à-peu-près femblable, ôc
les mefures de chaque reprife y doivent être divifées
de même en nombre pairement pair.; mais l’air du
paffe-pié doit toujours commencer fur la croche qui
précédé immédiatement le frappé. (S)
PASSE - P IERRE, f. f. (.Jardinage.') eft encore
nommée perce - pierre, c’eft la fécondé efpece du fenouil
marin ; cette plante eft haute d’un p ié , ôc s’étend
en large ; fes feuilles étroites ôc d’un goût falé,
font divifées par trois , fes fleurs placées à la fom-
mité de fes branches font jaunâtres, difpofées en
ombelle ôc donnent de la graine. Cette plante croît
dans les pays chauds, fur les rochers, ôc aux bords
de la mer, parmi les pierres d’où elle femble fortir. ^
La pàffe - pierre des jardins ne différé que par le
goût qui eft moins falé ; on la confit dans du vinaigre.
Elle fe multiplie, de graine , ôcde talles enracinées
, mais elle craint le plein airôc le grand froid,
ce qui la fait femer dans des cailles tranfplantées le
long des murs abrités, ôc expofés au midi ou au
levant.
PASSE-POIL, f. m. ( Paiement S) petit galon propre
pour les ameublemens, autrement appellé galon
à douer, fert encore dans les ornemens d’églife;
dans ce petit ouvrage la chaîne eft de fil ôc la trame
de foie, il eft peu frappé étant fait à la platte navete.
PASSEPORT, ( mod. ) c’ eft une permiflion
ou des lettrés d’un prince ou d’un gouverneur, qui
accordent un lauf-conduit ou la liberté de paffer,
d’e.vîrer Ôc fortir de leur territoire librement ôc fans
être inquiété.
Le paffcport proprement d it, ne fe donne qu’aux
amis ; on donne des fauf- conduits aux ennemis.
Voyei Sauf- conduit.
Pafquier prétend que pajfeport a etc introduit au
lieu de pajfepartout. Balzac rapporte un pafj'eport
bien honorable qu’un empereur accorda à un phi-
lofophe ; il eft conçu en ces termes : « S’il y a quel-
» qu’un fur terre ou fur m,er, .affez hardi pour in-
» quiéter Potamon, qu’il examine s’il eft allez fort
» pour faire la guerre à Céfar ».
Pafj'eport lignifie aufli la permiflion accordée par
le prince de faire amener ou tranfporter des mar-
chandifes , des meubles , &c. fans payer les droits
d’entrée ou de fortie.
Les marchands fe procurent quelquefois de pareils
pa(feports pour certaines fortes de marchandifes
; Ôc on les accorde toujours aux ambaffadeurs ôc
aux miniftres pour leurs bagages , équipages, &c.
Pajfeport eft aufli fouvent employé pour une per-
mifîion qu’on obtient de faire amener ou emporter
des marchandifes réputées comme contrebande , ôc
déclarées telles fur les tarifs , &c. comme l’o r , l’argent
, les pierres précieufes , les munitions de guerre
, les chevaux, les blés, le bois, &c. après avoir
payé les droits.
PASSERAGE , f. f. genre de plante, décrit"fous
le nom de lepïdium. Vdye^ L e p ïd iu m .
Son fruit reffemble à la pointe d’une pique ; il eft
plein de femences- qui font pour la plûpart d’une figure
oblongue. Tournefort compte cinq efpeces de
ce genre de plante.
La p a (ferâge vulgaire cultivée * lepidijim vulgare la«
tifolium, I. R. H. 2.16. en anglois the cotnmon great
broad leaved dittander, a la racine de la grofleur du
pouce , blanchâtre , rampante fur terre , d’une faveur
âcre ôc v iv e , mais qui difparoît bientôt. Ses
tigês font nombreufes", hautes de deux coudées,
menues , cylindriques, liftes , remplies de moelle,
branchues , couvertes d’une pouflïere d’un verd de
iner , qui fe diflipe aifément. Ses feuilles font alternes
, longues, larges , pointues, femblables à celles
du citronnier, molles , liftes , grades, d’un verd
foncé, dentelées à leurs bords; celles quifortent de
la racine ôc du bas de la tig e, font portées fur. de
longues queues..
Ses fleurs naiffent au fommet des tiges,& , des rameaux*
petites , en croix, compofées de quatre pétales
blancs , ramaffées en bouquets , nombreufes
ôc portées fur des pédicules fort grêles. Il s’élève de
ieur calice un piftil qui fe change en un fruit très-
petit , applati, pointu en forme de pique , partagé
en deux loges par Une cloifon mitoyenne, Ôc remplies
de menues graines oblongues ôc rouffes. -
PASSERAGE, ( Mat. med. ) pajferage vulgaire ou
des boutiques ; ÔC pajferage fauvage ou creflon fauvage.
...
Ces deux plantes font de la claffe des plantes qui
portent des fleurs en croix, ou crucifère de Tourner-
fort, ôc font comptées parmi les principaux anti-
feorbutiques. Elles contiennent abondamment le
principe propre aux plantes de cette claffe , c’eft-
à-dire l’alkali volatil fpontané, ôc une huile effen-
tielle. Ces principes les rendent très-analogues au
cochlearia ôc au creffon ; aufli les traite-t-ori pour
les ufages pharmaceutiques, de la meme maniéré
que ces deux plantes , ôc les emploie-t-on dans’tous,
les cas .avec elles, ou en leur lieu. Voye{ C ochlearia
& C resson.
Les feuilles ôc les racines de l’une ôc l’autre paffer
âge étant pilées avec du beurre ou du fain-doux,
ôc appliquées fur les cuiffes ôefur les jambes, paffent
pour appaifer très-efficacement les douleurs de lbia-
tique. (f).
PASSE-SOIE , f. m. inftrument à l’ufage de ceux
qui font des bas au métier. Voyet(. l'article Bas au
Mét ier,
PASSE-TALON, (Cordojif eft le cuir qui couvre
le talon de bois du foulier.- Voy.e^ les Planches du
Cordonnier-B ottièr.
PÂSSÉ-TOUR , efpece , cîe. .jacinte. Voye^ Ja-
CINTE .
PASSE VELOURS, |H QUEUES DE RENARD,
( Jardin. ) eft une efpece d’amaranthe à qui lès Jardiniers
ont donné le nom de queue de renard à caufe de
la figure de,fafleur difpofée en épi ôç rampante, d’une
couleur rouge , livide, avec des feuilles longuettes
prefque rouges * ôc une tige de la même couleur. On
prétend que' cétte fleur , qui fleurit en automne, ref-
iemble aii velours. Elle eft peu eftimée , ôc on ne
la met guere dans les parterres. Elle donne une petite
graine luifante comme les autres amaranthes, ôc
vient en pleine terre. ( K )
1 PASSEVIN , f. m. ( Phyfiq. ) inftrument de Phyfi-
que qui fert à fépàrci: deux liqueurs de différentes pe-
fanteur. Cette leparation fe mit ordinaireriient avec
de l’eau Ôc du vin. L’inftrument étant côriipôfé de
deux bouteilles dé verre A ,B , j ointes par un tuyau
ou un côu cpmnïun étroit , on vërfe d’abord du vin
par l’ouverture C , jufqu’à c eq u e la bouteille B foit
pleine , enfuite, ôn remplit d’eau la bouteille A :
alors l’eau prefl’ant fur le v in , plus léger que .cette
première liqueur, l’oblige à monter ÔC à venir fe
placer au-deffus d’elle. Cet effet fe manifefte' d’une
façon agréable à la vue. On voit lé vin fe filtrer au-
travers de.l’eau comme une efpêCë de fi'iméé. CD.J.')
PASSE-VOLANS , ou FAUX SOLDATS, ( Art
miliù.') ce font des gensfuppofés enrôlés quoiqu’ils
•ne le foient pas ■, que le capitaine ou le colonel font
paffer en revue poùrfaire voir que leur compagnie eft
complette, ôc pour en employer la paie à leur profit.
Chambers.
En France les paffe-volans qui font reconnus dans
les rangs des Compagnies d’infanterie, cavalerie ou
dragons , lors des revîtes d’icëlles , doivent avoir le
•nez coupé fur le champ fans remiflion par l’exécuteur
de la haute-juftice. Ordonnance de Louis X IV .
du i. Juin i <fy 6'. Jq)
Passe-vo lant , ( Marine. ) c’eft un faux matelot
qu’un capitaine ou maître de vaifièau fait paffer en
revue pour faire trouver fon équipage complet.
Lorlque M. de Pontchartrain entra dans la marine
, il fit ordonner qu’il n’y aùroit que les vaiffeaux
portant feize canons qui pourroient naviger aux îles
de rAmérique. Pour iatisfaire à un ordre fi gênant
on mit des canons de bois appellés paffe-volans.
PASSE VOGUE , f. m..( Marine.) c’eft un effort
que l’on fait de ramer plus grand qu’à l’ordinaire.(Z)
PASSÉ , f. m. ( Gramm. ) il fe dit de toute la duree
qui s’eft ecoulee, julqu’au moment où l’on parle.
La vieilleffe fatigue le prélènt des éloges du paffé.
Passe , f. m.( Broderie.^) point de broderie par
lequel on forme fous'un ouvrage le même defièin
que deffus. Il différé du point épargné en ce que le
deffein ne fe fait que d’un côté.
Passe , ( Jardinage.) fe dit d’un fruit qui ayant
paffé le tems de fa maturité , devient infipide , mou
ou cotonneux. On peut encore le dire d’une fleur
qui n’eft plus dans fa beauté.
Passé en sautoir , en termes de B la fon , fie dit
des chofes qui, font miles en forme de croix ide S.
André. Angenouft en Champagne , d’azur à deux
epeespajfees en fautoir d’argent, les pointes en haut,
les gardes ôc les poignées d’of.
I ç f. wÊÊBBSÊÊmmm & k v en ir
de la flûte qui leur iert de- navette entre les- fils de
la chaîne de leur, ouvrage levés où baifîes par le
moyen des marches des lames Ôc des liftes.
.• Passée , ( Mégifferie. ) les mégiffiers appellent une
paffee , deux douzaines de peaux de moutons qu4ils
plongent tout-d’un-coup dans une efpece de .grande
huche , remplie d’une mixtion propre à leur faire
prendre le blanCi
„ f AS^ÉE ». ckel ées faifeurs de papier de tapifférie, eft
1 action de paffer fous la preffe en taille-douce un
nombre de feuilles blanches à contr’épreuves ÔC
des maculaturës entr’elles. J’ai fait une paffee, je vais
en faire une autre. D ’où l’on voit que la paffee s'entend,
aufli’ du paquet d’épreuves de papier blanc ôc
de maculaturës qu’on a >pajfées ou1 qu’on va paffer‘
fous^ la preflè. Aucun dictionnaire n’a parlé de çes
paffées des graveurs en bois. Voyer -Papier de t a pisserie
à Vendroit de leur inipreffîon. Voyez auffi
C ôntr’epreuves & Ma culaturës.
PASSEE , f. f. ( terme de Perruquier. ) 'c*eft environ
trois douzaines de cheveux qu’on treffe fur lés foies
lorfqu’on fait quelque perruqufi. Les apprentis perruquiers
commencent par apprendre la paffée. .
Passee , ( Vénerie. ) eft le liëù où le cerf a paffé.
Paffée eû auffi un grand filet qu’on tend entre deux
grands arbres dans les clairières de. bois taillis où l’on
a remarqué que paffent les bécaffes ; • c’èft la même
êhôfe que pàntierre.
Passées , terme de Tailleur, qui lignifie des fils
qu on paffe des deux cotés de l’ouverture d’une, boutonnière
pour la former'. Les boutonnière*? ordinaires
n’ont que deux paffées , une de chaqué-côté: niais
les-boiitônniëres d’or ou d’argent en ont quelquefois
jufqu’à.quinze , .par .e qu’elles fe font ordinairement
fort larges.
PASSüGERo« Passager un ch e v a l , en termes
de Manège , C’eft le promener au pas ôc au trot. P a f
fagerwn cheval fur les vbltës , paffager la.volte. P a f
fager la tête à la muraille ,- c’eft mener fon cheval de
cô té , la tête v is - à -v is Ôc près de la muraille' du
manège. ‘ ‘
P A S S E M E N T , f. m .(B a s au métier. ) une des
opérations dufaifeur de bas au métier. Voye^l'article
Bas au MÉTIER.
Passement , qu’on nomme plus communément
dentelle , ( Boutonnier. ) c’eft un ouvrage d’or , d’argent,
de foie ou de lin filé, qui fe fabrique fur un
oreiller avec des épinglés, en fuivant lès traits cl’uii
deffein ou patj-on placé deffous l’ouvrage . V0y-z
D entelle. ,
Il n’y a aucune différence entre le paffement pris
en ce fens, ôc la dentelle, que les matières employées.
Du refte les points font les mêmes , s’exé-:
entent .ôc s’enchaînent également.
PASSEMENTIER, f. m. (Art. méchaniq.) ouvrier
ôc marchand qui fait ôc vend des paffemens ou dentelles.
Les autres ouvrages que peut fabriquer lepaf-
fementier font des guipures, des campanes, des cref-
pines, des houpes, des ganc.es, des lacets, des tref-
fes , des aiguillettes , des cordons de chapeaux, des
boutons , des cordonnets, des rênes , des guides ôc
autres ouvrages ôc marchandifes femblables.
Les Paffemtntiers forment à Paris une communauté
affez confidérable,dont les nouveaux ftatuts du mois
d’Avril 1053 , font compofés de quarante-quatre articles
tirés des anciennes ordonnances qu’ils avoient
obtenues d’Henri II. le z z Mars i < <8.
Suivant ces ftatuts, ils font qualifiés maîtres paffe-
menders , Moutonniers, enjoliveurs.
Pour etre admis à la maîtrife dans cette communauté
, il faut avoir fait cinq années d’apprentiffage ,
fervi les maîtres quatre ans en qualité de compagnon,
ôç avoir fait chef-d’oeuvre. '
Les fils des maîtres font exempts de toutes ces formalités
; ils ne font obligés qu’à une feule expérience;
ils ne peuvent cependant obliger des apprentis qu’a-
près avoir atteint l’âge de dix-huit-ans.