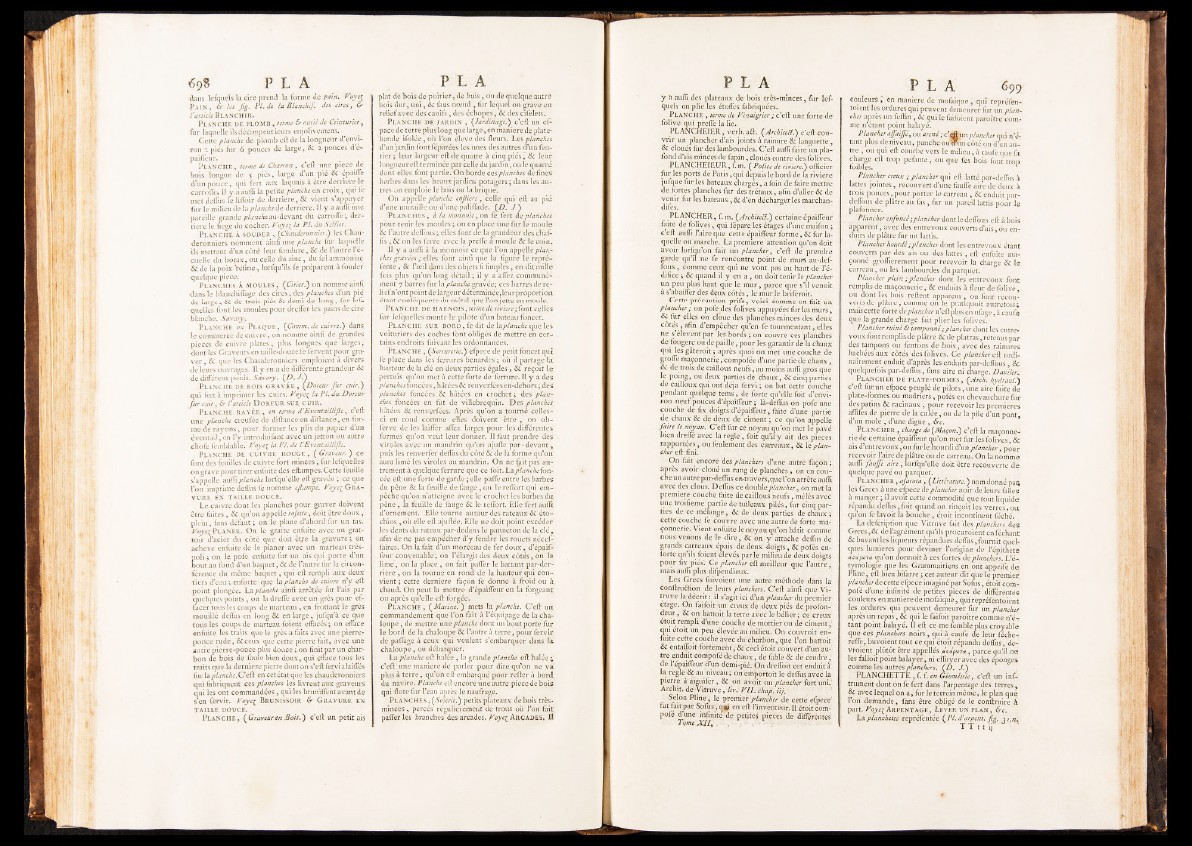
clans lefquels la cire prend la forme de pain. V?ye{
Pa i n , '6* Us fig. Pi.de La BlanduJ. des cires, &
L’article BLAN CHIR.
P LAN CH E DE PLOMB , terme & outil de Ceinturier,
fur laquelle ils découpent leurs enjolivemens.
Cette planche de plomb eft de la longueur d’environ
$ pies fur 6 pouces de large, & a pouces d e-
paiffeur.
P l a n c h e , terme de Charron, c’eft une pièce de
bois longue de 5 pies, large d’unjpie & épaiffe
d’un pouce, qui fert aux laquais à etre derrière le
-carroffe. Il y a auffi la petite planehe en croix, qui fe
met deffus le liffoir de derrière, & vient s’appuyer
fur le milieu de la planche de derrière. Il y a aulli une
pareille grande planche au-devant du carroffe; derrière
le fiege du cocher, Voye^la PL. du Sellier.
P l a n c h e À s o u d e r , (Chauderonnier.) les Chauderonniers
nomment ainfi une planche fur laquelle
ils mettent d’un côté leur foudure, & de l’autre l’e-
-cuelle du borax, ou celle du zinc, dufel ammoniac
& de la poix réfine, lorfqu’ils fe préparent à fouder
quelque piece.
P l a n c h e s à m o u l e s , (Cirier.) on nomme ainfi
dans le blanchiffage des cires, des planches d’un pié'
de large, & de trois piés & demi de long, fur lefquelles
font les moules pour dreffer les pains de cire
blanche. Savary.
P l a n c h e ou P l a q u e , ( C om m .d e cuivre. ) dans,
le commerce de cuivre, on nomme ainfi de grandes
pièces de cuivre plates, plus longues que larges *
dont les Graveurs en taille-douce fe l'ervent pour graver
, & que les Chauderonniers emploient à divers
de leurs ouvrages. Il y en a de différente grandeur &
•de différent poids. Savary. (D . J .)
P l a n c h e d e b o i s g r a v é e , (Doreur fur cuir.')
qui fert à imprimer les cuirs. Foye{ la PL du Doreur
fur cuir , & l'article D O R EU R SUR CU IR.
P l a n c h e R A Y É E , en terme d'Eventaillifte, c’eft
une planche creufée de diftance en diftance, en forme
de rayons, pour former les plis du papier d’un
éventail, en l’y introduifant avec un jetton ou autre
•chofe femblable, Foyt{ la Pl. de l ’Eveptaillifle.
P l a n c h e d e c u i v r e r o u g e , ( Graveur. ) ce
font des feuilles de cuivre fort minces, fur lefquelles
on grave pour tirer enfuite des eftampes. Cette feuille
s’appelle auffi planche lorfqu’elle eft gravée ; ce que
l’on imprime deffus fe nomme ejlampe. V?ye£ G R A VU
R E EN TAIL LE DOUCE.
Le cuivre dont les planches pour graver doivent
être faites , & qu’on appelle rofette, doit être doux,
plein, fans défaut ; on le plane d’abord fur un tas.
Voye^ P l a n e r . On le gratte enfuite avec un grattoir
d’acier du côté que doit êtf e la gravure ; on
aeheve enfuite de le planer avec un marteau très-
poli ; on le pofe enfuite fur un ais qui porte d’un
bout au fond d’un baquet, & de l’autre fur la circonférence
du même baquet, qui eft rempli aux deux
tiers d’eau ; enforte que la planche de cuivre n’y eft
point plongée. La planche ainfi arrêtée fur Pais par
quelques points, on la dreffe avec un grès pour e f facer
tous les coups de marteau, en frottant le grès
mouillé deffus en long &. en large, jufqu’à ce que
tous les coups de marteau foient effacés ; on efface
enfuite les traits que le grès a faits avec une pierre-
ponce rude, &ceux que cette pierre fait, avec une
autre pierre-ponce plus douce ; on finit par un charbon
de bois de faule bien doux, qui efface tous les
traits que la derniere pierre dont on s’eft fervialaiffés
fur la planche. C ’eft en cet état que les chauderonniers
qui fabriquent ces planches les livrent aux graveurs
qui les ont commandées , qui les bruniffent avant de
s’en fervir. Foye{ B r u n i s s o ir & G r a v u r e e n
TA IL LE DOUCE.
P l a n c h e , (Graveuren B o is .) c ’ e ft u n p e t it ais
p la t d e b o is d e p o i r ie r , d e b u i s , o u d e q u e lq u e a u t r e
b o is d u r , u n i , & fan s noe u d , fu r le q u e l o n g r a v e en
r e l i e f a v e c d es ca n ifs , d e s é c h o p e s , & d e s c i fe le t s .
P l a n c h e d e j a r d in , (Jardinage.) c’eft un ef-
paee de terre plus long que large, en maniéré de plate-
bande ifolée, oii l’on eleve des fleurs. Les planches
d’un jardin fontféparées les unes des autres d’un fen-
tier ; leur largeur eft de quatre à cinq piés, & leur
longueur eft terminée par celle du jardin, ou le quarré
dont elles font partie. On borde ces planches de fines
herbes dans les beaux jardins potagers ; dans les autres
On emploie le buis ou la brique.
On appelle planche cofiiere , celle qui eft au pié
d’une'muraille ou d’une paliffade. (D . J.)
P l a n c h e s , à la monnoie, on fe fert de planches
pour tenir les moules ; on en place une fur le moule
& l’autre deffous ; elles font de la grandeur des chaf-
fis , & on les ferre avec la preffe à moule & le coin.
Il y a auffi à la monnoie ce que l’on appelle planches
gravées ; elles font ainfi que la figure le repré-
fenté, & l’oeil dans des objets fi fimples, en dit mille
fois plus qu’un long détail ; il y a affez communément
7 barres fur la planche gravée; ces barres de relief
n’ont point de largeur déterminée,leur proportion
étant conféquente du métal que. l’on jette en moule.
P l a n c h e DE HARNOIS, terme de riviere ;{•ont celles
fur lefquelles monte le pilote d’un bateau foncet.
P l a n c h e s u r b o r d , fe dit de la planche que les
voituriers des coches font obligés de mettre en certains
endroits fuivant les ordonnances.
P l a n c h e , (Serrurerie.) efpece de petit foncet qui
fe place dans les ferrures benardes ; où il partage là
hauteur de la clé en deux parties égales, & reçoit le
permis qu’on met à cette forte de ferrure. Il y a des
planches foncées, hâtées ôc renverfées en-dehors ; des
planches foncées.& hâtées en crochet; des planches
foncées en fût de villebrequin. Des planches
hâtées & renverfées. Après qu’on a tourné celles-
ci en rond comme elles doivent être , on ob-
ferve de les laifler affez larges pour les différentes
formes qu’on veut leur donner. Il faut prendre des
viroles avec un mandrin qu’on ajufte par - devant,
puis les renverfer deffus du côté & de la forme qu’on
aura limé les viroles au mandrin. On ne fait pas autrement
à quelque ferrure que ce foit. La planche foncée
eft une forte de garde ; elle paffe entre les barbes
du pêne & la feuille de fauge , ou le reffo.rt qui empêche
qu’on n’atteigne avec le crochet les barbes du
pêne, la feuille de fauge & le reffort. Elle fert auffi
d’ornement. Elle tourne autour des rateaux & éto-
chios, où elle eft ajuftée. Elle ne doit point excéder
les dents du rateau par-dedans le panneton de la clé ,
afin de ne pas empecher d’y fendre les rouets nécef-
faires. On la fait d’un morceau de fer doux, d’épaif-
feur convenable ; on l’élargit des deux côtés, on la
lime, on la place , on fait paffer le battant par-der-
riere , on la tourne en rond de la hauteur qui convient
; cette derniere façon fe donne à froid ou à
chaud. On peut la mettre d’épaiffeur en la forgeant
ou après qu’elle eft forgée.
P l a n c h e , (Marine.) m e t s la planche. C ’e f t u n
c om m a n d em e n t q u e l ’o n fa i t à l’ é q u ip a g e d e la ch a lo
u p e , d é m e t tr e u n e planche d o n t u n b o u t p o r te fu r
l e b o r d d e la c h a lo u p e & l’au t re à te r r e ., p o u r f e r y i r
d e p a ffa g e à c e u x q u i v e u le n t s’ em b a r q u e r d an s la
c h a lo u p e , o u d é b a rq u e r .
La planche eft halee , la grande planche eft halée ;
c’eft une maniéré de parler pour dire qu’on ne va
plus à terre, qu’on eft embarqué pour refter à bord
du navire. Planche eft encore une autre piece de bois
qui flote fur l’eau après le naufrage.
P l a n c h e s , (Soierie.) p e t its p la te a u x d e b o is trè s -
m in c e s , p e r c é s r é g u liè r em e n t d e t ro u s o ù l ’o n fa i t
p a ffe r le s b ran ch e s d e s a r c a d e s . Foye^ A r c a d e s . Il
y a auffi des plateaux de bois quels on plie les étoffes fabriqutéreèss.-minces, fur lefPlanche
, terme de Vinaigrier ; c’eft une forte de
folivé qui preffe la lie.
PLANCHEIER, verb. a£t. (Architecl.) c’eft couvrir
un plancher d’ais joints à rainure & languette,
& cloués fur des lambourdes. C’eft auffi faire un plafond
d’ais minces de fapin, cloués contre des folives.
PLANCHEIEUR, 1. m. ( Police de riviere.) officier
fur les ports de Paris, qui depuis le bord de la riviere
jufque fur les bateaux charges, a foin de faire mettre
de fortes planches fur des trétaux, afin d’aller Sc de
venir fur les bateaux, & d’en décharger les marchan-
difes.
PLANCHER, f. m. (Architecl.) certaineépaiffeur
faite de folives, qui féparë les étages d’une maifon ;
c’eft auffi l’aire que cette épaiffeur forme, & fur laquelle
on marche. La première attention qu’on doit
avoir lorfqu’on fait un plancher, c’eft de prendre
garde qu’il ne fe rencontre point de murs au-def-
ious , comme ceux qui ne vont pas au haut de l’édifice
; & quand il y en a , on doit tenir le plancher
un peu plus haut que le mur, parce que s’ilvenoit
à s’abaiffer des deux côtés, le mur le briferoit.
Cette précaution prife, voici comme on fait un
plancher ; on pofedes folives appuyées fur les murs,
& fur elles on cloue des planches minces des deux
cotes, afin d’empêcher qu’en fe tourmentant, elles
ne s’elevent par les bords ; on couvre ces planches
defougere ou de paille, pour les garantir de la chaux
qui les gateroit ; après quoi on met une couche de
groffe maçonnerie, compofée d’une partie de chaux,
& de trois de caillous neufs, au moins auffi gros que
le poing, ou deux parties de chaux, & cinq parties
de cailloux qui ont déjà fervi ; on bat cette couche
pendant quélquë tertis, de forte qu’elle foit d’environ
neuf pouces d’épaiffeur ; là-dèffus on pofe une
couche de fix doigts d’épaiffeur, fàite d’une partie
de chaux & de deux de ciment ; ce qu’on appelle
faire le hoyau. C ’eft fur ce noyau qu’on met le pavé
Lien dreffe avec la règle, foit qu’i l ÿ ait des pièces
rapportées, ou feulement des carreaux, & le plancher
eft fini.
On fait encore des planchers d’une autre façon ;
après avoir cloué un rang de planches, on en côu-
che un autre par-deffus en-travers,que l’on arrête auffi
avec des clous. Deffus ce doubleplanch er, on met la
première couche faite de caillous neufs, mélés avec
une troifieme partie de tuileaux pilés, fur cinq parties
de ce mélangé, & de deux parties de chaux ;
cette couche fe couvre avec une autre dé forte maçonnerie.
Vient enfuite le noyau qu’on bâtit comme
nous venons de le dire, & on y ' attache deffus de
grands carreaux épais de deux doigts, & pofés en-
forte qu’ils foient elevés parle milieu de deux doigts
pour fix piés. Ce plancher eft meilleur que l’autre ‘f‘
mais auffi plus difpendieux.
Les Grecs-fiiivoient une autre méthode dans la
conftruérion de leurs planchers. C’eft ainfi que Vi-
truve la décrit : il s’agit ici d’un plancher du premier
etage. On faifoit un creux de deux piés de profondeur,
& on battoit la terre avec le bélier; ce creux
etoit rempli dùine couche de mortier ou de ciment,1
qui etoit un peu élevée au milieu. On couvroit en-
niite cette couche avec du charbon, que l’on battoit
& entaffoit fortement, & céci étoit couvert d’un autre
enduit-compofé de chaux, de fable & de cendré,;
de 1 epaiffeurd- un demi-pié. p n dreffoit cet enduit à
la réglé & âu-niveau; on emportoit le deflus avec la
pierre; à àiguifer, & on avôit un plancher fbrt uni.'
Archit. de-'Vitruve, -Bvï VH. ckaj). iij.
Selon Pline'; le premier plancher de cette éfpecé
fut fait par Soïus, ciijg en eft l’inventeur. Il étoit compofé
d’une infinité'de petites pièces de différénteS
T$nUyXII* . . . - ri------ r •
couleurs, en manière de mofafque, qui reprefen-
toient les ordures.qui peuvent demeurer fur un plancher
a [mes un feftin , & qui le faifoient paroître comme
n’étant point balayé.
Plancher ajfaiffe, ou aient ■ c’çjft pn plancher qui n’étant
plus de niveau, panche oircrim côté ou d’un autre
, ou qui eft courbe vers le milieu, à caufe que fa
pharge eft trop pefante, ou que fes bois font trop
foibles. 1
Plancher creux ; plancher qui eft latté par-deffus à
lattes jointes, recouvert d’une fauffe aire de deux à
trois pouces, pour porter le carreau, & enduit par-
deffous de plâtre au fas , fur un pareil lattis pour le
plafonner.
P lancher enfoncé ; plancher dont le deffous eft à bois
apparent, avec des entrevoux couverts d’ais, ou enduits
de plâtre fur un lattis.
Plancher hourdé; plancher dont les entrevoux étant
couverts par des ais ou des lattes , eft enfuite maçonné
groffierement pour recevoir la charge & le
carreau, ou les lambourdes du parquet.
Plancher plein ; plancher dont les entrevoux font
remplis de maçonnerie, & enduits à fleur de folive,
ou dont les bois reftent apparens, ou font recouverts
de plâtre, comme on le pratiquoit autrefois ;
mais cette forte dtplancher n’eft plus en ufage, à caufe
que la grande charge fait plier les folives.
Plancher ruiné & tamponné;plancher dont les entrevoux
font remplis de plâtre & de platras, retenus par
des tampons ou fentons de bois, avec des rainures
hachées aux côtés des folives. Ce plancher eft ordinairement
enduit d’après les enduits par-deffous, &
quelquefois par-deffus, fans aire ni charge. Daviler.
P l a n c h e r d e p l a t e - f o r m e s , (Arch. hydraul.)
c’eft fur un efpace peuplé de pilots, une aire faite de
plate-formes ou madriers, pofés en chevauchure fur
des patins & racinaux , pour recevoir les premières
àffifes de pierre de la culée, ou de la pile d’un pont,
d’un mole , d’une digue , &c.
P l a n c h e r , charge de (Maçon.) c*eft la maçonnerie
de certaine épaiffeur qu’on met fur les folives, &
ais d’entrevoux, ou fur le hourdi d’un plancher, pour
recevoir l’aire de plâtre ou de carreau. On la nomme
âuffi fauffe aire , lorfqu’elle doit être recouverte de
quelque pavé ou parquet. ■
P l a n c h e r , afarota, (Littérature.) nom donné pai;
les Grecs à une elpece de plancher noir de leurs falles
à manger ; il avoit cette commodité que tout liquide
répandu deffus, foit quand on rinçoitles verres, ou
qu on fe lavoit la bouche , étoit incontinent féché.
La delcription que Vitruve fait 'des planchers des
Grecs , & de l’agrément qu’ils procuroient enféchant
& buvant les liqueurs répandues deffus, fournit quelques
lumières pour deviner l’origine de l’épithete
acâpana cju’on donnoit à ces fortes de planchers. L’étymologie
que les Grammairiens en ont apprife de
Pline, eft bien bifarre ; cet auteur dit que le premier
plancher àe cette efpece imaginé par Sofiis, étoit compofé
d’une infinité de petites pièces de différentes
couleurs en maniéré de mofaïque, quirepréfentoient
les ordures qui peuvent demeurer fur un.plancher,
après un-repas, & qui le faifoit paroître comme n’é-r
tant •point balayé. Il eft ce-me femble plus croyable
que ces planchers noirs, qui à caiife de leur feche-;
reffe, buvoienttout ce qui étoit répandu deffus, de-
vroient plutôt être appellés parce qu’il ne
les falloit point balayer, ni eïïùyer avec des éponges
commèles autres planchers. (D . J.)
PLANCHETTE * f. f. en Géométrie, c’eft un inf-
trument dont on fe fert dans l’arpentage des terres ,
& avec lequel on a, fur leterrein même, le plan que
l’on demande, fans être obligé de le conftruire à
part. Foye[ A r p e n t a g e , L e v e r u n p l a n , &c.
La planchette repréfentée (P l. d’arpent, fig. i i,n f
T T 1 1 ij