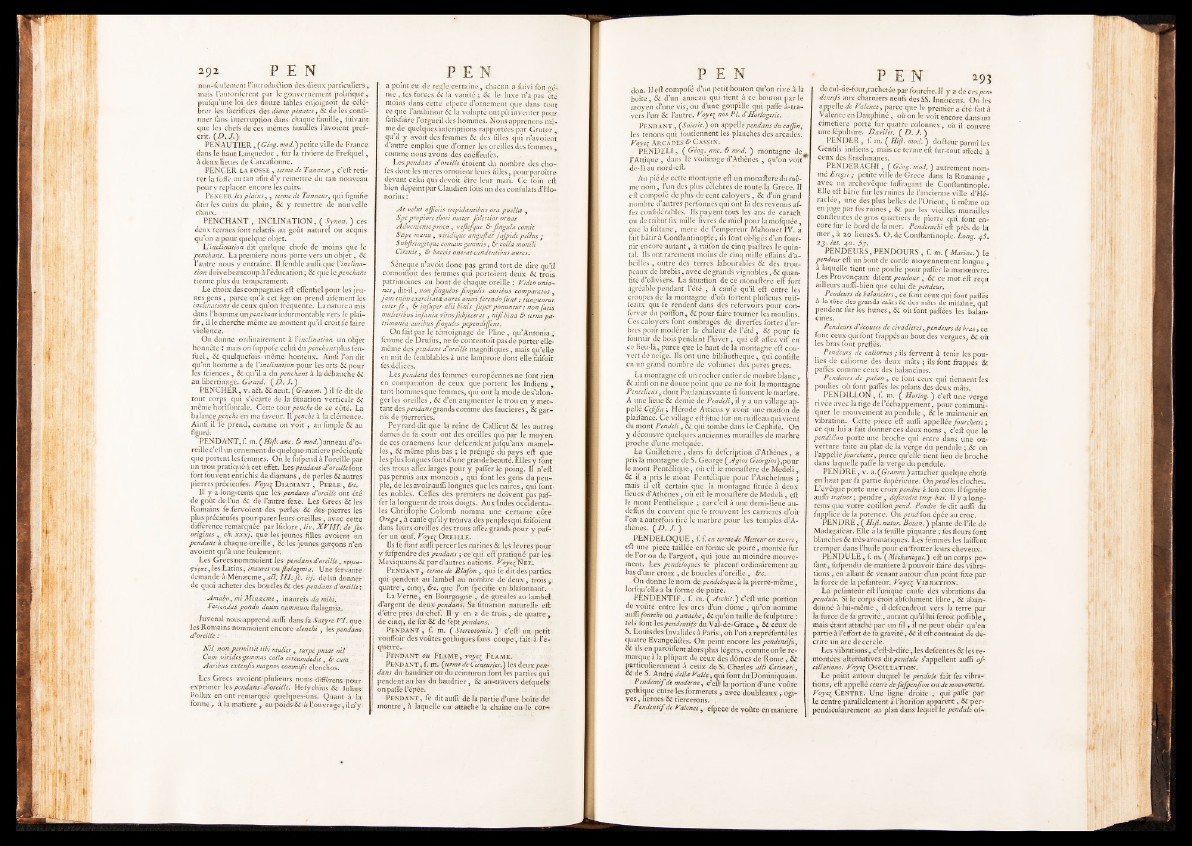
non-fculentent l’introduélion des dieux particuliers,
mais l’autoriferent par le gouvernement politique,
puilqu’une loi des douze tables enjoigno'it de célébrer
les facrifices des dieux pénates, & de les continuer
fans interruption dans chaque famille, fuivant
que les chefs de ces. mêmes familles l’a voient pref-
çrit. (D .J . )
PENAUTIER, ( Géog. mod Y) petite ville de France
dans Je haut Languedoc , fur la riviere de F refquel,
à deux lieues de Carcaffonne.
PENCER la FOSSE terme de Tanneur, c’eft retirer
la foffe au tan afin d’y remettre du tan nouveau
pour y replacer encore les cuirs.
PENOER les plains, , terme de Tanneur, qui lignifie
Oter les cuirs dit plaint, & y remettre de nouvelle
chaux. '
PENCHANT ,, INCLINATION, ( Sÿnon. ) ces
deux termes font relatifs au goût naturel ou acquis
qu’on a-1 pour quelque objet.
Uinclination dit quelque chofe de moins que le
penchant., La* première nous; porte vers un o b j e t &
l’autre nous y entraîne. Il femble auffi que l’inclination
doive beaucoup, à l’éducation ; & que le penchant
tienne plus du tempérament.
Le choix!des.compagnies efi: effentiel pour les jeunes
gens , parce qu’à cet âge on prend aifément les
inclinations de ceux qu’on fréquente. La nature a mis
dans l’homme unpe«c/i<z«rinfurmontable vers le plai-
fir,.il le cherche même au moment qu’il croitie faire
violënce.
On donne ordinairement à l'inclination un objet
honnête % mais on fuppofe celui du penchantphxs fen-
fuel, & quelquefois; même1 honteux. Ainfi l’on dit
qu’un homme a; de Y inclination-pour les arts &pour
les fciences, & qu’il a du penchant à la débauche 8c
au libertinage. Girard. (D .J . ).
PENCHER, v . a£h &ineut; ( Gramm. ) il fe dit de
tout corps qui s’écarte de-la fituation verticale &
même horîfontale.- Cette tour penche de ce côté. La
balance penche en ma faveur. Vipenche à là clémence.
Ainfi il fe prend, comme ôn v o i t , au fimplë & au
figuré;
PENDANT, f..m. (Hijb.anc. modY) anneau d’o-'
reille c’ efl un .ornementde quelque matière précieufe
que portent les femmes. On le lufpend à l’oreille par
un trou pratiqué à cet effet. Les pendans dY oreille-font
fort fou vent: enrichis dediamans, de perles & autres
pierres précieufes; Voye% D iamant , Perle , &c.
Il y adong.Ttems que les pendons d’oreille ont été
de goût ded,un;&. dé l’autre fexe. Les Grecs: Ôc Ies>
Romains fe fervoient dés perles- & desv-pierres les-
plus-précieufes pouriparer leurs oreilles , avec Getté
différence remarquée par Ifidore, liv. X V III. de fes-
origines n ch.^xxxj. què lesqeunes-filles1 aVoiént un
pendant à chaque oreille , &-les -jetmes garçons n’en-
avoient qu’à^une feulement;
Les Grecsnommoient lès^ pèrtdans £ oreille,
çipac-, lesXatins-, .'maures -ou fàlàgmia. Une férvante
demande àiMènæcme.,-**#. III: Jh iij. de lai donner
de quoi acheter.des boucles-&-des />e/z^/z.î d'oreille'. : '
Amabo,mï Mencecme , inaureis da mihi.
Faciendas pyndo duUm-nummum ftalagmia.
Iuvenal nous-apprend auffi àansfa-Satyre.VL que
les Romains nommoient encore elenchi, les pendans ■
d'oreille:
N il nom psrmittit tibi-mulier, turpe putat ntl
Cum viridesgemmas.collo circumdtdit , .<£ eufn, •
Aitribus -,extenjîs magnos commijii elencKos.
Les Grecs avoienrplüfieurs noms diffêrens pour
exprimer les pendons-- d'oreille. Hefychius &: Julius*
Pollux en ont remarqué’ quelques-uns. Quant à-1 la<
forme, à la matièreau-poidsôê à l’ouvrage-, il n-’ya
point eu de réglé certaine, chacun a fiiivi fon pé-
■ nie , fes forces & fa vanité ; & le luxe n’a pas été
moins dans cette efpece d’ornement que dans tout
ce que l’ambition & la volupté ont pu inventer pour
. fatisfaire l’orgueil des hommes. Nous apprenons même
de quelques inferiptions rapportées par Gruter ,
qu’il y avoit des femmes & des filles qui n’avoient
| d’autre emploi qiie d’orner les oreilles des femmes,
i comme nous avons des coëffeufes.
Les pendans £ oreille étoient du nombre des cho-
! fes dont les rneres ornoienr leurs filles, pourparoître
| devant celui qui devoit être leur mari. Ce foin efi
bien dépeint par Claudien fous-un des confulats d’Ho-
noritis:
A t velut offeiis trepidantibus or a puellce ,
Spe propiore thori mater folertior ornât
Adveniente proco, vejlefque & Jirigula comit
Stspe manu, vitidique angujlat jajpide peclus ;
Subjlringitque comam gemmis, & colla monili
Circuit, & baccis onerat candentibus aures.
Séneque n’avôit donc pas grand tort de dire qu’il
connoifloit des- femmes qui portoient deux & trois
patrimoines au bout de chaque oreille : Video unio-
nes, dit-il , non Jingulos Jingulis au ri bus comparatos ,
jam eni/n exercitata aures oneri ferendo funt ; junguntur
inter Je , & infuper alii binis fuper ponüntur: nonfatis
mulieribus infania viros fubjecerat , niji bina & ténia pa*
trimonia auribus Jingulis pependijjent.
On fait par le témoignage de Pline , qu’Antonia ,
femme de Drufus, ne fe contentoit pas de porter elle-
même des pendans d'oreille magnifiques, mais qu’elle
en mit de femblables à une lamproie dont elle faifoit
fes délices.
Les pendans des femmes européennes ne font rien
en comparaifon de ceux que portent les Indiens ,
tant hommes que femmes* qui onf la mode des’alon-
ger les oreilles d’en augmenter lé trou en y méritant
dès pendans grands comme des faucieres, & garnis
de pierreries.
Peyrard dit que la reine de Callicut & les autres
dames de fa cour ont des oreilles qui. par lè moyen
de ces ornemens leur defeendent jufqu’aux mamelles
, & même pliis-bas ; le préjugé du pays eft que
les plus longues font d’une grande beauté. Elles y font
des trous afiez larges pour y paffer le poing. Il n’efl
pas permis aux moncois , qui font les gens du peuple,,
de les avoirauffi longues que les naires, qui font-
les nobles. Celles des premiers ne doivent pas paffer
là longueur de trois doigts. Aux Indes occidentales
Chriflopne. Colomb nomma une certaine côte
Orega, à caufe qu’il-y trouva dès peuplesqui faifoient
dans leurs oreilles des trous affez grands pour y paffer
un oeuf. Voye^D keillE.
Ils fe font auffi percer les riahnes & les levres pour
y fiifpendre dés p'endàris \-c-^:oyi\ efl pratiqué'par les
Mexiquains & par d’autres natîorïs-. V oy e^ tV.
Pendant , terme de B là fd h qui fe<dit des: parties
qui pendent au lambel ati-nôrribr-e de"deux, trois,;
quatre',-cinq1, &c. que l’-on lj)écifie en blafonhant.
La Verrie z en Bourgogne , de gueules au lambel
d’-afgent de d ë u pendarist Sa'fitiiàtiort naturelle eft
d-être près duJchef. Il y eh a de-trois'-,-de quatre,
de cinq-, de fix & de {&ç>tpendans.
Pendant , f. m. ( Stereotürfièi c’eflp un petit
vOüffôir des Voûtes gothiques fans coü p e y fa ità l’é-
quèrre. •
Pendant ou- Fd am e , voye^ Flame.
Pen d an t, f Iti; (terme!dè‘Ceinturier.) 1 es deux pen-1
dans du battdrier-ou du ceinturon font les parties qui
pendent au bas du baudrier , &- aU-travers defquels;
on paffe Pépéë.
Pen d an t, fe dit auffi dè là partie d’une boîtë de'
montre, à: làquellè on' attàehê là1 chaîne ou le cor-«
don. Il efi cotnpofé d’un petit bouton qu’on rivé à là
boîte , & d’un anneau qui tient à ce bouton par le
moyen d’une vis, ou d’une goupille qui pafl’e à-travers
l’un- & l’autre. Voye^ nos PI. d'Horlogerie.
PENDANT, (Soierie Y) on appelle pendans dit cafjiri^
les tenons qui foutiennent les planches des arcades.
Voyei A rcades & CASSiti.
PENDELI, ( Géog. anc. & mod. ) montagne dé .
l’Attique , dans le voifinage d’Athènes , qu’on voie
de-làau nord-eft.
Aù pié de cette montagne efi un monaftere'du même
nom, l’un des plus célébrés de toute-la Grèce. Il
efi compofé de plus de cent caloyers , & d’un grand
nombre d’autres perfônnes qui ont là des revenus af-
fez confidérables. Ils payent tous les ans de carach
ou de tribut fix mille livres de miel pour la mofqüée,
que la fultane, mere de l'émpèrëür Mahomet IV. a
fait bâtir à Coriftantinople ; ils font' obligés d’en fournir
encore autant, à raifon de cinq piaftres l'é quintal.
Ils ont rarement moins de cinq nulle effains d’abeilles
, outre dés terres labourables & dés troupeaux
de brébis, avec de grands vignobles, & quantité
d’oliviérs. La fituation decemônàftere efi fort
agréable pendant l’été , à caiifè qu’il efi éntre les
croupes de la montagne d’où fortent plufieurs ruif-
feaux qui fé rendent dans des refervoirs pouf con-
fefVer du poiffon, & pour faire tourner les moulins.
Ces caloyers font ombragés dé divérfes fortes d’arbres
pour modérer la chaleur de l’été , & pouf fe
fournir dè bois pendant l’hiver ., qui efi afiez v if en
ce liéu-là, parce que le haut delà montagne efi couvert
de neige. Ils ont une bibliothèque, qui confifie
en un gfand nombre dé volumes des peres grecs.
La montagne efi un rocher entier de marbre blanc,
& ainfi on ne doute point que ce ne foit la montagne
Penteliciis, dont Paufanias vante fi fouvent le marbre.
A une lieue & demie de Pendeli, il y a un village ap-
pellé Cefijia-, Hérodë Atticus y avoit une maifon de
plaifance. C e village eftfitué fur un riiifleauqui vient
du mont Pendeli, & qui tombe dans le Cephife. On
y découvre quelques anciennes murailles de marbre
proche d’une mofqùée.
La Guillëtiere, dans fa defeription d’Athènes , a'
pris la’montagne dé S. George (Agios Georgios),pour
le mont Pentélique, où efi le monaftefe de Medeli
& il a pris le mont Pentélique pour l’Ànchefmus ;
mais il efi certain que la montagne fituée à deux
Iieües-d’Athènes, où efi le monaftére de M edeli, efi
le mont Penthélique ;■ car c’efi à une demi-lieue au-
defîits du couvent que fe trouvent les carrières; d’où
l’oma autrefois tiré le marbre pour les temples d’Athènes.
( D . j . )
PENDELOQUE, f. f. en terme de Metteur en oeuvre,
efi une pièce taillée en-forme de pb ifémontée fur
de l’or ou de l’argent, qui joue au moindre mouvement.
hes1 pendeloques fe placent ordinairement air
bas d’une croix , de bouclés, d’oreille ,■ &c.
On donhé le’nom de pendeloque à la pierre-même,
lorfqu’elle a la forme dè poire.
PENDENTIF y f. m. ( ArchitY) c’eft urie portion
de voûté entre les' afcs( d’un dôme ,i qldôn* nomme
aumfourch'e ou panache ,\ & qu’on taille de fcùlpture :
tels1 ibnt lçspendcndfs’ du Vai-de-Grace , 8c cëuxde
S; Louis des Invalides à Paris , où l’oh a repféfentéles
quatre Evangeliftès. On^^peint encore lès pendentifs,
& ils:en' paroiffent alorsrplus légers ,, comiheorl le remarque
à la plûpart de ceux des dômes de Rome, &
particulieréiîient à ceux de S. Charles alli Catinari,
& de S. André della-Vallè, qui font duDôminiquain.
Pendentif de moderne,, e* emla'pôr'tion'd’unè Voûté
gothique entre lès formerets j avëc dou ble au xogi-
vesy bernes & tiercerorls. \
1 Pendentif de Valence \ efpece de voûte en maniéré
de cul-de-four,rachetée par fourche.il y a de ces pen•
denttfs aux charniers neufs des SS. Innocens. On les
appelle de Valence, parce que le premier a été fait à
Valence en Dauphiné, où on le voit encore dans un
cimetiere porté, fur quatre colonnes , où il couvre
une fépultiire. Daviler. (D . J . )
PENDER, f. m. ( Hiß. mod. ) do&ehr parmi les
Gentils indiens ; mais ce tefme efi fur-tout affe&é à
ceux des Brachmanes.
PENDERACHI, ( Géog. mod. ) autrement, nommé
Eregri; petite ville de Grece dans la Romanie ,
avec un archevêque fufïfagànt de Conftantinople.
Elle efi bâtie fur les ruines de l’ancienne ville d’Hé-
raclee, une des plus belles dè l’Orient, fi même on
en juge par fes ruines, & par les vieilles murailles
confinâtes de gros quartiers dé pierre oui font encore
fur le bord de1 la mer. Pendérachi efi près de la
mer, à 20 lieues S. O. de Conftantinople. Long. 45.
23. lat. 40. 5y.
PENDEURS, PENDOURS , f. m. (Marine.') le
pendeur e fi un bout de corde moyennement longue ,
à laquelle tient une poulie pour paffer la manoeuvre.
Les Provençaux difent pendour , & ce mot efi reçu
ailleurs auffi-bien- que celui d'e pendeur.
Peiideurs de balanciers, ce font céux qui font paffés
à la tête des grands mâts & des mâts de mifaine, qui
pendent fur les hunes, & où font paffées les balan-
cines.
P endeùrs d'écoutes de civadieres, pendeur s de bras, ce
font ceux qui font frappés aù bout des vergues, & où
les bras font preffés.
Pendeurs de caiiornes ; ils fervent à tenir les poulies
de caliorne des deux mâts ; ils font frappes &
paffés comme ceux des balancines.
Pendeurs de palan, ce font ceux qui tiennent les
poulies où font paffés les palans des deux mâts.
PENDILLON, f. m. ( Horlog. ) c’efi une vergé
rivée avec là tige de l’échappement, pour communiquer
le mouvement au pendule , & le maintenir eh
vibration. Cette pièce efi auffi appellée fourchette ;
cè qui lui a fait donner ces deux noms , c’efi que le
pendillon porte une broche qui entre dans une ouverture
faite au plat de la verge du pendule ; &c on
l’appelle fourchette, parce qu’elle tient lieu de broche
dans làquellè paffe la verge du pendule.
PENDRE, v. a. (Gramm.).attacher quelque chofe
en'haut par fa partie fupérieure. Onpendles cloches.
L’évêque porte une croix pendue à fon cou; Il fignifie
auffi' traîner’, pendre ,* dfcendre trop bas. Il y a long-
tems que votre cotillon pend. Pendre fe dit auffi du
fupplice de la potence. On pend fon épée au crôc.
PENDRÉ, ( Hiß. natnr. Botan. ) plante dë l’île de
Madagafcar. Elle a la feuille piquante ; fes fleurs font
blancnes & très-aromatiques. Les femmës les laiffent
tremper dans l’huile poiu en ‘frotter leurs cheveux.
PENDULE , f. m. (MickaniqueY) efi: un corps pe-
fant , fufpendù' de maniéré à pouvoir faire des vibrations
y en allant & venant autour d’un point fixe par
la forcé dé la pefariteur. Voye^ VrBRATrÔN.
La pefanteür efti’uniqüe caufe- des vibrations dir
pendule. Si le co^ps étoit abfolument libre, & abandonné
à lui-mêmè , il defeendroit vers la terre par
la force de fa gravifé yautant qu’iHui feroitpoffibl'e ,
mais étant attaché par un f il, il ne peut obéir qu’en:
partie à l’effort de fa gravité, & il eir contraint de décrire
un arc de cercle.
Les vibrations'y c’efi-à-dire y les defeentes & les re-
montées altéfiiafives àivpëndale s’appellent auffi of-
cillations. Voye%_ OsciTEATION.
Le point autour duquel Të pendule- fiiit fes vibrations
ie f i appellé centre de fufpenßon o\Idtmouvement.
Voye^ C entre. Une ligne1 droitè ,• qui paffe par
le centre parallèlement à'l-’horifon' apparent, 8c pér-
pendiculairement au plan dans lequël le pendule of->