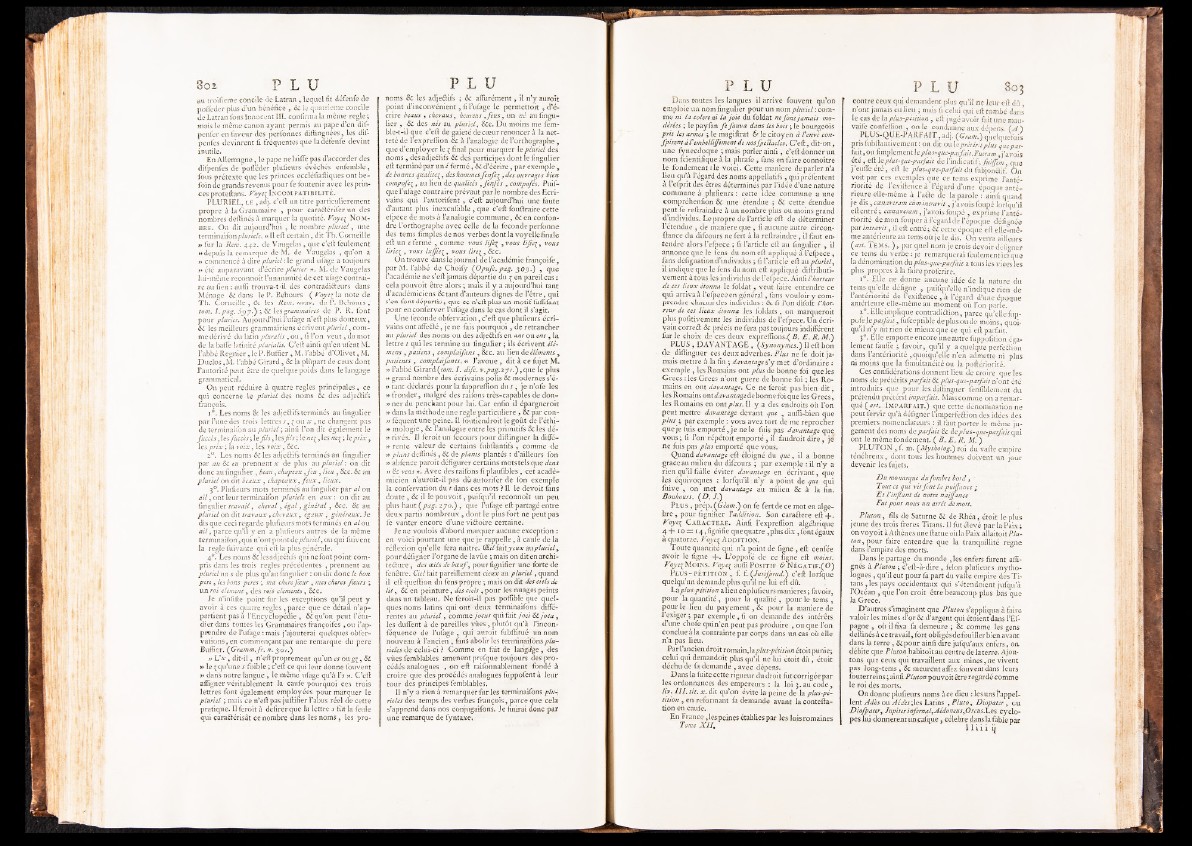
au troifieme concile de Latran , lequel fit défenfe de
poffeder plus d’un bénéfice , 6c le quatrième concile
de Latran fous Innocent III. confirma la même réglé ;
mais le même canon ayant permis au pape d’en dil-
penfer en faveur des perfonnes diftinguées, les dif-
penfes devinrent fi fréquentes que la défenfe devint
inutile.
En Allemagne, le pape nelaiffe pas d’accorder des
difpenfes de pofféder plulieurs évêchés enfemble,
fous prétexte que les princes eccléfiaftiques ont be-
foin de grands revenus pour fe foutenir avec les princes
proteftans. In c o m p a t i b i l i t é .
PLURIEL, l e , adj. c’eft un titre particulièrement
propre à la Grammaire , pour caraftérifer un des
nombres deftinés à marquer la quotité. Foyei N o m b
r e . On dit aujourd’hui , le nombre pluriel, une
terminaifonpluriele. « 11 eft certain, dit Th. Corneille
» fur la Rem. 442. de Vaugelas , que c’ell feulement
» depuis la remarque de M. de Vaugelas , qu’on a
» commencé à dire pluriel', le grand ufage a toujours
» été auparavant d’écrire plurier ». M. de Vaugelas
lui-même reconnoît l’unanimité de cet ufage contraire
au fien:aufii trouva-t-il des contradicteurs dans
Ménage 6c dans le P. Behours ( Foyez^ la note de
Th. Corneille , 6c les Rem. nouv. du P. Behours ,
*0/77.1. pas. J07.) ; 6>C les grammaires de P. R. font
pour plurier. Aujourd’huil’ufage n’eft plus douteux,
6c les meilleurs grammairiens écrivent pluriel, comme
dérivé du latin pluralis , o u , fi l’on v eu t, du mot
de la bafl'e latinité pluriatis. C’eft ainfi qu’en ufent M.
l’abbé Regnier, le P. Buffier , M. l’abbé d’Olivet, M.
Duclos ,M. l’abbé Girard, 6c la plupart de ceux dont
l’autorité peut être de quelque poids dans le langage
grammatical.
On peut réduire à quatre réglés principales, ce
qui concerne le pluriel des noms 6c des adjettifs
françois.
i° . Les noms & les adjettifs terminés au fingulier
par l’une des trois lettres s , [ ou x , ne changent pas
de terminaifon au pluriel ; ainfi l’on dit également le
fuccès, les fuccès ; le fils , lesfils ; le //«{, les ne^ ; le prix,
les prix ; la voix, les voix, 6cc.
20. Les noms & le s adjettifs terminés au fingulier
par au 6c tu prennent x de plus au pluriel : on dit
donc au fingulier , beau, chapeau ,feu , lieu , &c. 6c au
pluriel on dit beaux , chapeaux, feu x , lieux.
30. Plufieurs mots terminés au fingulier par al ou
a il, ont leur terminaifon pluriele en aux : on dit au
fingulier travail, cheval, égal, général , 6cc. 6c au
pluriel on dit travaux , chevaux, égaux , generaux. Je
dis que ceci regarde plufieurs mots terminés en alow
a il, parce qu’il y en a plufieurs autres de la même
terminaifon, qui n’ont point de pluriel, ou qui fuivent
la réglé fuivante qui eft la plus générale.
40. Les noms & les adjettifs qui ne font point compris
dans les trois réglés précédentes , prennent au
pluriel un s de plus qu’au fingulier : on dit donc le bon
pere , les bons peres ; ma chere foeur , mes cheres fizurs ;
lin roi clement, des rois cléments, 6cc.
Je n’infifte point fur les exceptions qu’il peut y
avoir à ces quatre réglés , parce que-ce détail n’appartient
pas a l’Encyclopédie , & qu’on peut l’étudier
dans toutes les Grammaires françoifes , ou l’apprendre
de l’ufage : mais j’ajouterai quelques obfer-
vations, en commençant par une remarque du pere
Buffier. (Gramm.fr. 77.30/.)
» L’x , dit-il, n’eft proprement qu'un.« ou g [ , 6c
» le 1 qu’une s foible ; c’eft ce qui leur donne fouvent
» dans notre langue , le même ufage qu’à l’s ». C ’eft
affigner véritablement la caufe pourquoi ces trois
lettres font également employées pour marquer le
pluriel ; mais ce n’eft pas juftiner l’abus réel de cette
pratique. Il feroit à defirer que la lettre s fût la feule
qui caractérisât ce nombre dans les noms, les pronoms
& les adjettifs ; 6c affurément, il n’y aüroit
point d’inconvénient, fi l’ufage le permettoit , d’écrire
beaus , chevaus, heureus, feus, un né au fingulier
, & des nés au pluriel, &c. Du moins me fem-
ble-t-il que c’eft de gaieté de coeur renoncer à la netteté
de l’expreffion 6c à l’analogie de l’orthographe,
que d’employer le 1 final pour marquer le pluriel des
noms , des adjectifs 6c de.s participes dont le fingulier
eft terminé par un é fermé, 6c d’écrire, par exemple ,
de bonnes qualité{ , des hommes fenfeç , des ouvrages bien
compofe1 , au lieu de qualités ,fenfés , compofés. Puif-
que l’ufage contraire prévaut parle nombre des Ecrivains
qui l’autorifent, c’eft aujourd’hui une faute
d’autant plus inexcufable , que c’eft fouftraire cette
efpece de mots à l’analogie commune, 6c en confondre
l’orthographe avec celle de la fécondé perfonne
des tems fimplesdenos verbes dont la voyelle finale
eft un e fermé , comme vous liftç , vous lijie£, vous
U rieç , vous lu (fie{ , vous lirez , 6cc.
On trouve dans le journal de l’académie françoife,
par M. l’abbé de Choify (Opufc. pag. 309.) , que
l’académie ne s’eft jamais départie du ^ en pareil cas :
cela pouvoit être alors ; mais il y a aujourd’hui tant
d’académiciens & tant d’auteurs dignes de l’être, qui
s’en font départis, que ce n’eft plus un motif fuffifant
pour enconferver l’ufage dans le cas dont il s’agit.
Une fécondé obfervation, c’eft que plufieurs écrivains
ont affetté, je ne fais pourquoi, de retrancher
au pluriel des noms ou des adjettifs en ant ou ent, la
lettre t qui les termine au fingulier ; ils écrivent élé-
mens, patiens, complaifans , 6cc. au lieu de éléments ,
patients , complaifants. « J’avoue , dit à ce fujet M.
» l’abbé Girard(tom. I . dife. v .pag.zyt.) ,que le plus
» grand nombre des écrivains polis 6c modernes s’é-
» tant déclares pour la fuppremon du t , je n’ofe les
» fronder, malgré des raifons très-capables de don-
» ner du penchant pour lui. Car enfin il épargneroit
» dans la méthode une regie particuliere , 6c par con-
» féquent une peine. Il fbutiendroit le goût de l’éthi-
» mologie, 6c l’analogie entre les primitifs 6c les dé-
» rivés. Il feroit un fecours pour diftinguer la diffé-
» rente valeur de certains f'ubftantifs , comme de
» plans defiinés, 6c de plants plantés : d’ailleurs fon
» abfence paroît défigurer certains motstels que dens
» & vens ». Avec des raifons fi plaufibles , cet académicien
n’auroit-il pas dû autorifer de fon exemple
la confervation du t dans ces mots ? Il le devoit fans
doute , & il le pouvoit, puifqu’il reconnoît un peu
plus haut ( pag. 270.) , que l’ufage eft partagé entre
deux partis nombreux , dont le plus fort ne peut pas
fe vanter encore d’une vittoire certaine.
Je ne voulois d’abord marquer aucune exception :
en voici pourtant une que je rappelle, à caufe de la
réflexion qu’elle fera naître. (Fil fait y eux au pluriel y
pour défigner l’organe de la vue ; mais on dit en architecture
, des otils de boeuf, pour lignifier une forte de
fenêtre. Ciel fait pareillement deux au pluriel, quand
il eft queftion du fens propre ; mais on dit des ciels de
Ut, 6c en peinture, des ciels , pour les nuages peints
dans un tableau. Ne feroit-il pas poflible que quelques
noms latins qui ont deux terminaifons différentes
au pluriel, comme jocus qui fait joci 6c joca,
les duflent à de pareilles vues, plutôt qu’à l’irtconr
féquence de l’ufage , qur auroit fubftitué un nom
nouveau à l’ancien , fans abolir les terminaifons plu-
rieles de celui-ci ? Comme en fait de langage , des
vîtes femblables amènent prefque toujours des procédés
analogues , on eft raifonnablement fondé à
croire que des procédés analogues fuppofent à leur
tour des principes femblables.
Il n’y a rien à remarquer fur les terminaifons plu-,
rieles des temps des verbes françois, parce que cela
s’apprend dans nos conjugaifons. Je finirai donc par
une remarque de fyntaxe.
P L U
Dans toutes les langues il arrive fouvent qu’on
emploie un nom fingulier pour un nom pluriel : comme
ni la colere ni la joie du foldat ne font jamais modérées
; le payfan fe fauva dans les bois ; le bourgeois
prit les armes ; le magiftrat 6* le citoyen à Ccnvi con-
fpirentàÜembelliffementde nosfpeclacles, C’eft, dit-on,
une fynecdoque ;mais parler ainfi , c’eft donner un
nom feientifique à la phrafe , fans en faire connoître
le fondement : le voici. Cette maniéré de parler n’a
lieu qu’à l’égard des noms appellatifs , quipréfentent
à l’efprit des êtres déterminés par l’idée d’une nature
commune à .plufieurs : cette idée commune a une
compréhenfion 6c une étendue ; 6c cette étendue
peut fe reftraindre à un nombre plus ou moins grand
d’individus. Le propre de l’article eft de déterminer
l’etendue , de maniéré que , fi aucune autre circon-
ftance du difeours ne fert à la reftraindre, il faut entendre
alors l’efpeçe ; fi l’article eft au fingulier , il
annonce que le fens du nom eft appliqué à l’efpece ,
fans défignation d’individus ; fi l’article eft au pluriel,
il indique que le fens du nom eft appliqué diftributi-
vement à tous les individus de l’efpece. Ainfi L’horreur
de ces lieux étonna le foldat, veut faire entendre ce
qui arriva à l’efpece en général, fans vouloir y comprendre
chacun des individus : 6c fi l’on difoit l ’horreur
de ces lieux étonna les foldats , on marqueroit
plus pofitivement les individus de l’efpece. Un écrivain
corred & précis ne fera pas toujours indifférent
fur le choix de ces deux expreffions.( B. E. R. M.)
PLUS , DAVANTAGE , {Synonymes.) Il eft bon
de diftinguer ces deux adverbes. Plus ne fe doit jamais
mettre à la fin ; davantage s’y met d’ordinaire :
exemple , les Romains ont plus de bonne foi que les
Grecs : les Grecs n’ont guere de bonne foi ; les Romains
en ont davantage. Ce ne feroit pas bien dit,
les Romains ont davantage de bonne foi que les Grecs,
les Romains en ont plus. Il y a des endroits oîi l’on
peut mettre davantage devant que , aulli-bien que
plus \ par exemple : vous avez tort de me reprocher
que je fuis emporté, je ne le fuis pas davantage que
vous ; fi l’on' répétoit emporté , il faudroit dire, jë
ne fuis pas plus emporté que vous.
Quand davantage eft éloigné du que, il a bonne
grâce au milieu du difeours ; par exemple : il n’y a
rien qu’il faille éviter davantage en écrivant, que
les équivoques : lorfqu’il • n’y a point de que qui
fuive , on met davantage au milieu 6c à la fin.
Bouhours. (Z), ƒ.)
Plu s , prép. (Géom.') on fe fert de ce mot en algèbre
, pour figniher Faddition. Son caraftere eft - f .
Voye^ C a r a ç t e r e . Ainfi l’expreffion algébrique
4 + 1 0 = 1 4 , lignifie que quatre , plus d ix , font égaux
à quatorze. Foye[ A d d it io n .
Toute quantité qui n’a point de ligne, eft cenfée
avoir le ligne + . L’oppofé de ce ligne eft moins.
FoyeçMo in s . Voye^ auffi Po s it if & N é g a t if .(O )
P lu s - p é t i t io n , f. f. (Jurifprud.) c’eft lorfque
quelqu’un demande plus qu’il ne lui eft dû.
La plus-pétition a lieu en plufieurs maniérés ; favoir,
pour la quantité , pour la qualité , pour le tems ,
pour le lieu du payement, 6c pour la maniéré de
l ’exiger ; par exemple, fi on demande des intérêts
d’une chofe qui n’en peut pas produire , ou que l’on
conclue à la contrainte par corps dans un cas oîi elle
n’a pas lieu.
Par l’ancien droit romain,la plus-pétition étoit punie;
celui qui demandoit plus qu’il ne lui étoit dû, étoit
déchu de fa demande , avec dépens.
Dans la fuite cette rigueur du droit fiit corrigée par
les ordonnances des empereurs : la loi 3. au code,
§ jg H L tit. x. dit qu’on évite la peine de la plus-pétition
, en reformant fa demande avant la contefta-
tion en caufe.
En France ,les peines établies par les lois romaines
Tome X I I .
P L U 803
contre ceux qui demandent plus qu’il ne leur eft du,
n’ont jamais eu lieu ; mais fi celui qui eft tombé dans
le cas de ia.plus-pétition , eft jugé avoir fait une mau-
vaife confelfion , on le condamne aux dépens (A )
PLUS-QUE-PARFAIT,adj. (Gram.) quelquefois
pris fubftantivement ; on dit ou le prétérit plus que par-
fait, ou Amplement le plus-que-parfût.Fueram , j’avois
é té , eft plus-que-parfait de l’indicatif; fiiiffïm, que
j ’euffeété, eft le plus-que-parfait du fubjonâif. On
voit par ces exemples que ce tems exprime l’antériorité
de 1 exiftence à l’égard d’une époque antérieure
elle-même à latte de la parole : ainfi quand
je dis, coenaveram càmintravit, j’avois foupé lorfqu’ii
eft entré; coenaveram, j’avois foupé , exprime l’antériorité
de mon fouper à l’égard cle l’époque défignée
par intravit, il eft entré; 6c çette époque eft elle-même
antérieure au tems pû je le dis. On verra ailleurs
(<7r/. 1 EM s. ) , par quel nom je crois devoir défigner
ce tems du verbe: je remarquerai feulement ici que
la dénomination du plus-que-parfait a tous lés vices les
plus propres à la faire proferire.
i° . Elle ne donne aucune idée de la nature du
tems qu’elle defigne , puifqu’elle n’indique rien de
l’antériorité de l’exiftençe, à l’égard d?une époque
antérieure elle-même au moment où l’on parle.
2°. Elle implique contradittion, parce qu’elle fup-
pofe le,parfait, fufceptible de plus ou de moins, quoiqu’il
n’y ait rien de mieux que ce qui eft parfait.
30. Elle emporte encore une autre fuppofition également
fauffe ; favoir, qu’il y a quelque perfettion
dans l’anteriorite , quoiqu’elle n’en admette ni plus
ni moins que la fimultanéité ou la poftériorité.
Ces confîdérations donnent lieu de croire que les
noms :de prétérits parfait 6c plus-qut-parfa.it n’ont été
introduits que pour les diftinguer fenfiblement du
prétendu prétérit imparfait. Mais comme on a remarque
( art.. Im p a r f a it .) que cette dénomination ne
peut fervir qu’à défigner l’imperfettion des idées des
premiers nomençlateurs : il faut porter ï§ même jugement
des noms de parfait 6c dtp lus-que-parfait qui
ont le même fondement. ( B. E. R. M. )
PLUTON , f. m. (Mytholog.) roi du vafte empire
tenebreux, dont tous les hommes doivent un jour
devenir les fujets.
Du monarque du fombre bord, ■
Tout ce qui vit f ent la puijfance y
Et L'infant de notre naiffance
Fut pour nous un arrêt de mort.
Pluton, fils de Saturne 6c de Rhéa, étoit le plus
jeune des trois freres Titans. Il fut élevé par la Paix ;
on voyoit à Athènes une ftatue où la Paix allaitoit Pluton
, pour faire entendre que la tranquillité régné
dans l’empire des morts.
Dans le partage du monde ,les enfers furent affi-
gnés à Pluton ; c’eft-à-dire , félon plufieurs mythologues
, qu’il eut pour fa part du vafte empire des T itans
, les pays occidentaux qui s’étendoient jufqu’à
l’Océan , que l’on croit être beaucoup plus bas que
la Grece.
D ’autres s’imaginent que Pluton s’appliqua à faire
valoir les mines d’or 6c d’argent qui étoient dans l’El-
pagne , où il fixa fa demeure ; 6c comme les gens
deftinés à ce travail, fort obligés de fouiller bien avant
dans la terre , &pour ainfi dire jufqu’aux enfers, on.
débite que Pluton habitoit au centre de la terre. Ajoutons
que ceux qui travaillent aux mines, ne vivent
pas long-tems , 6c meurënt affez fouvent dans leurs
fouterreins ; ainfi Pluton pouvoit être regardé comme
le roi dés morts.
On donne plufieurs noms à ce dieu : lesunsl’appel-
lent A dés ou Aédhs',\es Latins , Pluto, Diopater, ou
Diofpater, Jupiter infernal,Aédoneusf)rcus.Les cyclo-
pes lui donnèrent un cafque, célébré dans la fable par
1 1 U i i j