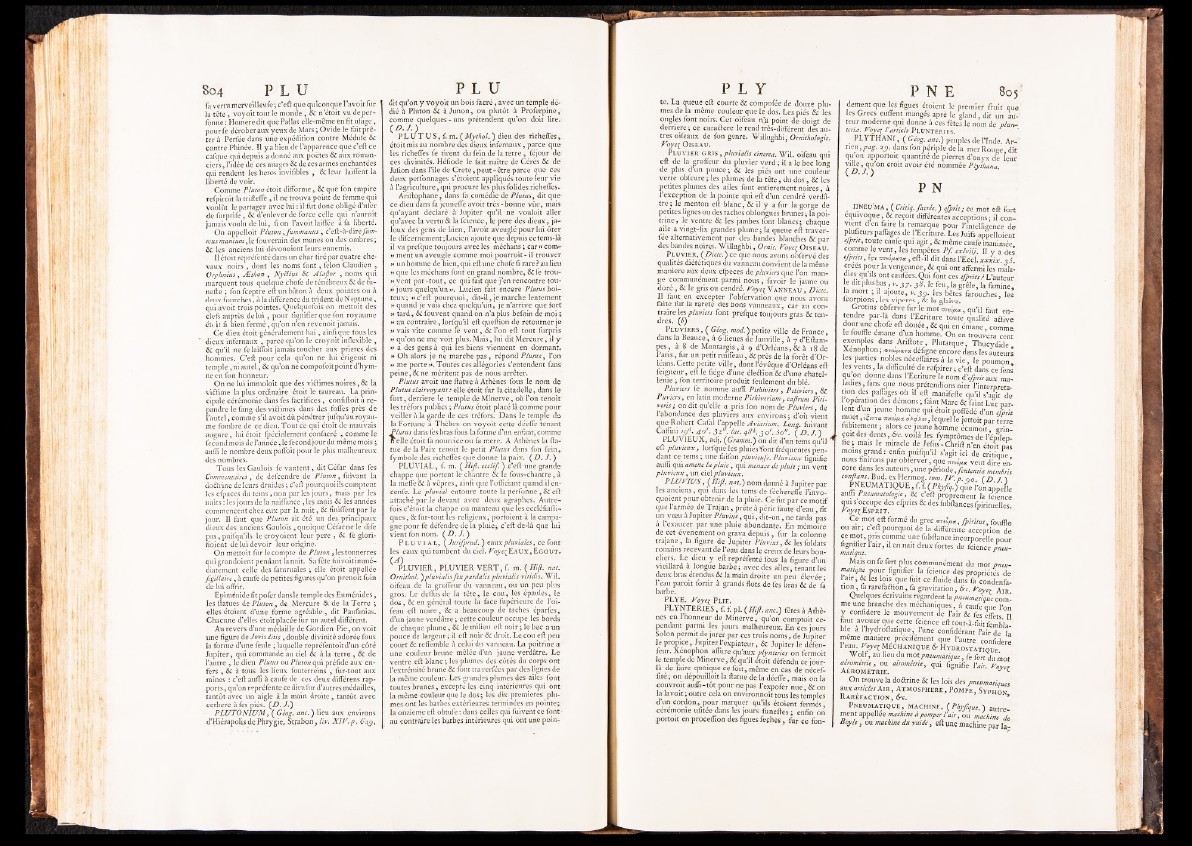
fa vertu merveilleufe ; c’eft que quiconque l ’avoit fur
la tê te , voyoittoutle monde , 6c n’étoit vu de personne
: Homeredit quePallas elle-même en fit ufage,
pourfe déroberauxyeuxde Mars ; Ovide le fait prêter
à Perfée dans une expédition contre Médufe 6c
contre Phinée. 11 y a bien de l’apparence que c’eft ce
cafque qui depuis a donné aux poètes 6c aux romanciers
, l’idée de ces nuages 6c de ces armes enchantées
qui rendent les héros invifibles , 6c leur laiffent la
liberté de voir.
Comme Pluton ètoit difforme, 6c que fon empire
refpiroit la trifteffe , il ne trouva point de femme qui
voulût le partager avec lui : il fut donc obligé d’ulér
de furprife , & d’enlever de force celle qui n’auroit
jamais voulu de lui, fton l’avoit laiflee a fa liberté.
On appelloit Pluton, fummanus , c’eft-à-direfum-
musmanium,1e fouverain des mânes ou des ombres;
&c les anciens lui dévouoient leurs ennemis.
Il étoit repiréfenté dans un char tiré par quatre chevaux
noirs , dont les noms fon t, félon Claudien ,
Orplinéus, Æthon , Nycléus 6c Alafior , noms qui
marquent tous quelque chofe de ténébreux & de fu-
nefte ; fon fceptre eft un bâton à deux pointes ou à
deux fourches, à la différence du trident de Neptune,
qui avoit trois pointes. Quelquefois on mettoit des
clefs auprès de lu i , pour fignifier que fon royaume
étcit fi bien fermé, qu’on n’en revenoit jamais.
Ce dieu étoit généralement h a ï, ainfi que tous les
dieux infernaux , parce qu’on le croyoit inflexible ,
& qu’il ne felaiffoit jamais toucher aux prières des
hommes. C ’eft pour cela qu’on ne lui érigeoit ni
temple, ni autel, 6c qu’on ne compofoit point d’hymne
en fon honneur.
On ne lui immoloit que des vittimes noires, & la
vi&ime la plus ordinaire étoit te taureau. La principale
cérémonie dans fes facrifices , confiftoit à répandre
le fang des viûimes dans des foffes près de
l’autel, comme s’il avoit dû pénétrer jufqu’au royaume
fombre de ce dieu. Tout ce qui étoit de mauvais
augure, lui étoit fpécialement çonfacré , comme le
fécond mois de l’année ,1e fécond jour du même mois ;
auffi le nombre deux paffoit pour le plus malheureux
des nombres.
Tous les Gaulois fe vantent, ditCéfar dans fes
Commentaires, de defcendre de Pluton, fuivant la
doÛrine de leurs druides; c’eft pourquoi ils comptent
les efpaces du tems , non par les jours, mais par les
nuits : les jours de la naiffance , les mois 6c les années
commencent chez eux par la nuit, 6c finiffent par le
jour. Il faut que Pluton ait été un des principaux
dieux des anciens Gaulois , quoique Céfarne le dife
pas, puifqu’ils le croyoient leur pere , 6c fe glori-
fioient de lui devoir leur origine.
On mettoit fur le compte de Pluton, les tonnerres
qui grondoient pendant la nuit. Sa fête fuivoit immédiatement
celle des faturnales ; elle étoit appellée
Jigillaire, à caufe de petites figures qu’on prenoit foin
de lui offrir.
Epiménide fit pofer dans le temple des Euménides,
les ftatues de Pluton, de Mercure & de la Terre ;
elles étoient d’une forme agréable-, dit Paufanias.
Chacune d’elles étoitplacée iiir un autel différent.
Au revers d’une médaille de Gordien Pie, on voit
une figure de Jovis ditis , double divinité adorée fous
la forme d’une feule ; laquelle repréfentoitd’un côté
Jupiter, qui commande au ciel & à la terre , & de
l’autre , le dieu Plutus ou Pluton qui préfide aux enfers
, & à tous les lieux fouterreins , fur-tout aux
mines : c’eft aufli à caufe de ces deux différens rapports
, qu’on repréfente ce dieu fur d’autres médailles,
tantpt avec un aigle à la main droite , tantôt avec
cerbere à fes piés. (Z>. J.)
PLUTONIUM, ( Géog. une. ) lieu aux environs
d’Hiérapolis de Phrygie, Strabon; liv, X IF .p , {$43,
dit qu’on y voyoit un bois facré, avec un temple dédié
à Pluton oc à Junon, ou plutôt à Proferpine,
comme quelques-uns prétendent qu’on doit lire.
w B m . . .
P L U T U S , f. m. ( Mythol. ) dieu des richeffes, .
étoit mis au nombre des dieux infernaux, parce que
les richeffes fe tirent du fein de la terre , féjour de
ces divinités. Héfiode le fait naître de Cérès 6c de
Jafion dans l’île de Crete, peut-être parce que ces
deux perfonnages s’étoient appliqués toute leur v ie
à l’agriculture, qui procure les plus folides richeffes.
Ariftophane, dans fa comédie de Plutus, dit que-
ce dieu dans fa jeuneffe avoit très - bonne vûe, mais
qu’ayant déclaré à Jupiter qu’il ne vouloit aller
qu’avec la vertu & la fcience, le pere des dieux, jaloux
des gens de Lien, l’avoit aveuglé pour lui ôter
le difeernement ; Lucien ajoute que depuis cetems-là
il va prefque toujours avec les méchans ; car« conv-
» ment un aveugle comme moi pourroit - il trouver
» un homme de bien, qui eft une chofe fi rare ? au lieu1
» que les méchans font en grand nombre, 6c fe trou-
» vent par-tout, ce qui fait que j’en rencontre tou-'
» jours quelqu’un». Lucien fait encore Plutus boi--
teux; «c’eft pourquoi, dit-il, je marche lentement'
» quand je vais chez quelqu’un, je n’arrive que fort
» tard, 6c fouvent quand on n’a plus befoin de moi ;
» au contraire, lorfqu’il eft queftion de retourner je
» vais vite comme fe vent, & l’on eft tout fiirpris
» qu’on ne me voit plus. M ais, lui dit Mercure, il y-
» a des gens à qui les biens viennent en dormant.
» Oh alors je ne marche pas, répond Plutus, l’on
» me porte ». Toutes ces allégories s’entendent fans
peine, & ne méritent pas de nous arrêter.
Plutus avoit une ftatue à Athènes fous le nom de
Plutus clairvoyant : elle étoit fur la citadelle, dans le
fort, derrière le temple de Minerve, oii l’on tenoit
les tréfors publics ; Plutus étoit placé là comme pour
veiller à la garde de ces tréfors. Dans le temple de
la Fortune à Thèbes on voyoit cette déeffe tenant
lut us dans fes bras fous la forme d’un enfant, comme
elle étoit fa nourrice ou fa mere. A Athènes la ftatue
de la Paix tenoit le petit Plutus dans fon fein,:
fymbole des richeffes que donne la paix. (Z>. J. )
PLUVIAL, f. m. ( Hiß. ecclèf. ) c’eft une grande
chappe que portent le chantre 6c le fous-chantre, à
la meffe 6c à vêpres, ainfi que l’officiant quand il en--
cenfe. Le pluvial entoure toute la perfonne , 6c eft •
attaché par le devant avec deux agraphes. Autre--
fois c’étoit la chappe ou manteau que les eccléfiafti-
ques, & fur-tout les religieux, portoient à la campagne
pour fe défendre de la pluie; c’eft de-là que lui
vient fon nom. ( D. J. )
P l u v i a l , ( Jurifprud. ) eaux pluviales, ce font-
les eaux qui tombent du ciel. Voye{ Eaux , Eg o ut.
m
PLUVIER, PLUVIER V ER T , f. m. {Hifi. nat.
Ornithol. ) pluvialis feupardalis pluvialis viridis. W il.
oifeau de la groffeur du vanneau, ou un peu plus
gros. Le deffus de la tête, le cou, les épaules, le
dos, 6c en général toute la face fupérieure de l’oi-'
feau eft noire, 6c a beaucoup de taches éparfes,
d’un jaune verdâtre ; cette couleur occupe les bords
de chaque plume, 6c le milieu eft noir ; le bec a un
pouce de largeur ; il eft noir 6c droit. Le cou eft peu
court 6c reffemble à celui du vanneau. La poitrine a
une couleur brune mêlée d’un jaune verdâtre. Le
ventre eft blanc ; les plumes des côtés du corps ont
l’extrémité bmne 6c font traverfées par des lignes de '
la même couleur. Les grandes plumes des aîles font
toutes brunes, excepte les cinq intérieures qui ont
la même couleur que le dos ; les dix premières plumes
ont les barbes extérieures terminées en pointe;
la onzième eft obtufe : dans celles qui fuivent ce font-
au contraire les barbes intérieures qui ont une poin-:
te. L a queue e ft courte 6c compofée de douze plumes
de la même couleur que le dos. Les piés 6c les
ongles font noirs. Cet oifeau n’a point de domt de
derrière ; ce caraftere le rend très-différent des autres
oifeaux de fon genre. Willughbi, Ornithologie.
Fyyeç O ise a u .
P l u v ie r g r is , pluvialis cinerea. V i l . oifeau qui
eft de la groffeur du pluvier verd ; il a le bec long
de plus d’un pouce ; 6c les piés ont une couleur
verte obfcure ; les plumes de la tête, du dos , & les
petites plumes des aîles font entièrement noires, à
l’exception de la pointe qui eft d’un cendré verdâtre;
le menton eft blanc, & il y a fur la gorge de
petites lignes ou des taches oblongues brunes ; la poitrine,
le ventre 6c les jambes font blancs; chaque
aîle a vingt-fix grandes plume ; la queue eft traver-
fée alternativement par des bandes blanches 6c. par
des bandes noires. Villughbi, Omit. Foyer O is e a u .
Pluvïer, ( ce que nous avons obfervé des
qualités diététiques du vanneau convient de la même
maniéré aux deux efpeces de pluviers que l’on mange
communément parmi nous, favoir le jaune ou
do ré, 6c le gris ou cendré. Foyei V anneau , Dicte.
Il faut en excepter l’obfervation que nous avons
faite fur la rarete des bons vanneaux, car au contraire
1 ts pluviers font prefque toujours gras 6c tendres.
(f)
Pluviers, ( Géog. mod.) petite ville de France,
dans la Beauce, à 6-lieues de Janville, à 7 d’Eftam-
pes, à 8 de Montargis,à 9 d’Orléans,& à 18 de
Paris, fur un petit ruiffeau, 6c près de la forêt d'Orléans.
Cette petite ville, dont l’évêque d'Orléans eft
feigneur, eft le fiége d’une éleftion 6c d’une châtellenie
; fon territoire produit feulement du blé.
Pluviers fe nomme auffi Pithiviers , Petiviers, &
Puviers, en latin moderne Pithiverium, caflrum Piti-
veris ,■ on dit qu elle a pris fon nom de Pluviers, de
l’abondance des pluviers aux environs ; d’où vient
que Robert Cafaî l’appelle Aviarium. Long, fuivant
Caffini /_9d. 4 0 '. 32 ". lai. 4 ^ . 3 o'. 60". ( D . J. )
PLUVIEUX, adj. {Granimé) on dit d’un tems qu’il ^
eft pluvieux, lorfque les pluies font fréquentes pendant
ce tems; une faifonpluvieufe. Pluvieux fignifie
auffi qui amene la pluie, qui menace de pluie j un vent
pluvieux, un ciel pluvieux.
P LUFIUS, ( Hifi. nat.) nom donné à Jupiter par
les anciens, qui dans les tems de féchereffe l’invo-
quoient pour obtenir de la pluie. Ce fut par ce motif
que l’armée de Trajan, prête à périr faute d’eau, fit
un voeu à Jupiter Pluvius, qui, d it-on, ne tarda pas
à l’exaucer par une pluie abondante. En mémoire
de cet événement on grava depuis , fur la colonne
trajane, la figure de Jupiter Pluvius, 6c les foldats
romains recevant de l’eau dans le creux de leurs boucliers.
Le dieu y eft repréfenté fous la figure d’un
vieillard à longue barbe; avec des aîles, tenant les
deux bras étendus 6c la main droite un peu élevée •
l’eau paroit fortir à grands flots de fes bras 6c de fa
barbe.
PLYE. Poyeç P l ie .
PLYNTERIES, f. f. pl. ( Hifi. anc.) fêtes à Athènes
en l’honneur de Minerve, qu’on comptoit cependant
parmi les jours malheureux. En ces jours;
Solon permit de jurer par ces trois noms, de Jupiter
le propice, Jupiter l’expiateur, & Jupiter le deTen-
feur. Xenophon affure qu’aux plynteries on fermoit
le temple de Minerve , & qu’il étoit défendu ce jour-
là de faire quoique ce foit, même en cas de nécef-
fité; on dépouilloit la ftatue de la déeffe , mais on la
couvroit auffi-tôt pour ne pas l’expofer nue, & on
la la voit, outre cela on environnoit tous les temples
d’un cordon, pour marquer qu’ils étoient fermés
cérémonie ufitée dans les jours funeftes ; enfin on
portoit en proceffion des figues feçhes, fur ce fon-
(îement fjue le$ figues etoierit le premier fruit que'
les Grecs euffent manges aprè le gland, dit un au-
teur moderne qui donne à ces fîtes le nom de />/««-
teria. ^oye[ l'rtrncb Plu n t e r ie s .
PLYTHANI, ( Géog. anc.) peuples de l’Inde. Ar-'
rien,/>3|r.2ÿ. dans fon périple de la merRouge dit.
qü’on apportait quantité de pierres d’onyx de îeur
(13 ’P ) ' Cr°*t aV0' r ^ nomm®e r iy th a n a .
P N
vient d’en Faire la remarque pour l’ïhtelligence de
pluheurs pafiages de ^’Ecriture, Les Juifs appelloient
éfprit. toute caufe qui agit, & même caufe inanimée
B|jomnieJe v ent, les tempêtes Pf. cxlvùj. II y a de?
‘/pries y îjéxniiMLix, eft-il dit dans l’Eccl. xxxix. Æ
erees pouf la vengeance, & qui ont affermi les maladies
qu Îlsjmt caufées. Qui font ces efprits? L’auteur1
KTditplflsbas . V. le feu, la grêle, la famine,'
,1a mort ; il ajoute, v: j 3 . les bêtes ferouches, les
icorpions, les viperes , 6c le glaive.
Grotius obfervé fur léTmOt Wn^ï; qu’il feut en_
tendre ùjâr-là dans l’Ecriture toute qualité aftive
dont une chofe eft douée, & qui en émane, comme
lelouffle émané d’un homme. On en trouvera cent
exemples dans Ariftote , Plutarque, Thucydide
Xenophon ; wwpxtï dêfigne encore dans les auteurs
les parties nobles néceffaires £ § i v ie , le poumon
lesvents',:Ia difficulté de refpirerÿt’ ëft dans ce fens
quon donne dans l’Ecriture le nom d’ém a u x ma-'
ladies , fans que nous prétendions nier l’interpreta-
tion- des paffages oh il eft mâniféfte qu’il s’agit de
operation des' démons ; faim Marc & faim Luc parl
l r -W ? ,eUne ,honîme ^toit poffédé d’un H H
™“ ?t ,'W *« # i g S l e q u e l le jettoit par terre
lubitement ; alors Ce jeune homme écumoit grin-
çoit des dents, 6v. voilà les fymptômes de Tépilen-
fie; mais le miracle de Jéftis - Ghri» n’en était pas
(iffloms grand: enfin puifqu’il s’agit ici de critique '
a m ftiürb'Às par obferter, que M H ! veut dire encore
dans les auteurs ', une période .finunùa ntimbris
confians. Bud. ex Hermog. tom. IF. p. 0o ( D J \
PNEUMATIQUE, f. f. (Phyfîq.) que l’on appelle
auili Pneumatologie, 6c c eft proprement la fcience
qui s’occupe des efprits 6c des fubftances fpirituelles.
Foye{ Es p r it .
Ce mot eft formé du grec W a« , . fpiritus, fouffle
ou air; c eft pourquoi de la différente acception de
ce mot, pris comme une fubftance incorporelle pour
fignifier l’air, il en naît deux fortes de fcience pneumatique.
r
Mais b'n'fe fort pliiâ communément du mot pneu-
maapu-^ôur fignifier la fcience des propriétés de
Pair ’ & le gM que fuit ce fluide dans fa condenfa- '
tion, fa raréfaftion, fa gravitation, &c. Poyx, A ir
Quelques écrivains regardent la pneumatique comme
une branche des méchaniquesrf caufe que l’on
y confideré le mqSement de l’air effets II
feut1 avouer que cette fïieiïce eft tout-à-fiiit fembla
[/"f "à l’hydrpftatique, Tuhe confidérant Pair de la
même maniéré; précifément que l’autre confidera
1 eau. MECHANiÿjiE 6- Hydrostatique
W olf, atv lieu du mot pneumatique, fe fert du mot
aérométrie ■ airomime, qui fignifie l’air. Fovet
A e r o m e t r ie . j *
On trouve la doàrin'e & les lois des pneumatiques
aux articles A ir , A tm o s ph è r e , Pom p e , Sy p h o n
R a r é f a c t io n , &c.
Pn e u m a t iq u e , m a c h in e , ( Pfyfque. ) autrement
appellée machine à pomper Pair, qq machine de
Boy le , ou machine duyuidc, eft une machine par la