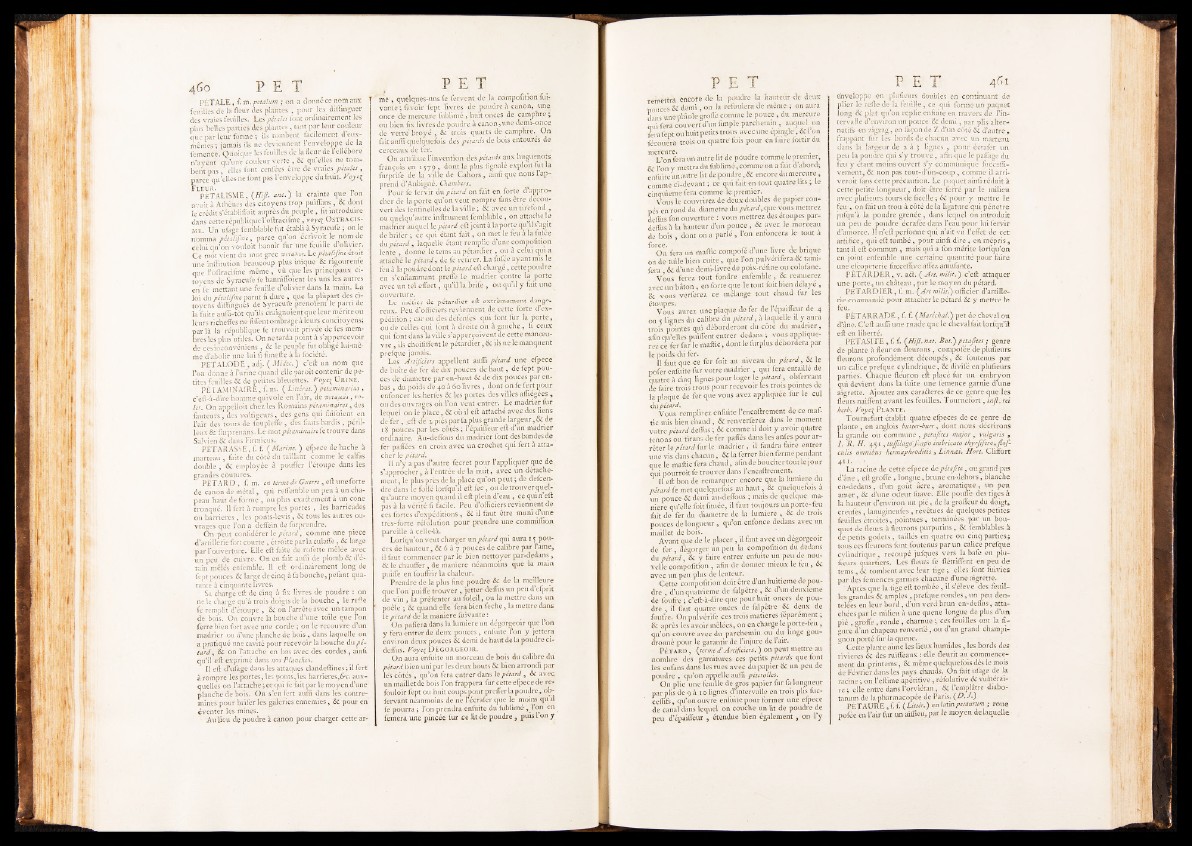
PÉTALE, f. m.petalum ; on a donné ce nom aux
feuilles de la fleur des plantes , pour les diftinguer
des .vraies feuilles. Les pétales font ordinairement les
plus belles parties des plantes , tant par leur couleur
que par leur forme ; ils tombent facilement d’eux-
mêmes ; jamais ils ne deviennent l’enveloppe de la
femence. Quoique les feuilles de la fleur de l’ellebore
n’ayent qu’un'e couleur verte , 6c qu elles ne tombent
pas , elles font cenfées être de vraiqs pétales ,
parce qu’elles ne font pas l’enveloppe du fruit. V?yt{
Fleur. . , . „
PÉTALISME, {Hiß. anc.) la crainte que Ion
avoit à Athènes des citoyens trop puiffans , 6c dont
lecrédit s’établiffoit auprès du peuple , fit introduire
dans cette république Poftracifme , voye{ Ostracisme.
Un uiage femblable fut établi à Syracufe ; on le
nomma pétalifme, parce qu’on écrivoit le nom de
celui qu’on vouloit bannir fur une feiuUe d’olivier. |
Ce mot vient du mot grec aXoç. Le p était fine etoit
une inftitution beaucoup plus inique 6c rigoureufe
que l’oflracifme même , vu que les principaux citoyens
de Syracufe fe banniffoient les uns les autres
en fe mettant une feuille d’olivier dans Ja main. La
loi du pétalifme parut fi dure , que la plûpart des citoyens
diftihgués de Syracufe prenoient le parti de
la fuite aufli-tôt qu’ ils craignoient que leur mérite ou
leurs richeffes ne fiffent ombrage à leurs concitoyens;
par là la république fe trouvoit privée de les membres
les plus utiles. On ne tarda point à s’appercevon
de cesinconvéniens , 6c le peuple fut obligé lui-même
d’abolir une loi fi funefte à la fociete.
PÉTALODE , adj. ( Médec.) c’eft un nom que
l’on donne à l’urine quand elle paroît contenir de petites
feuilles & de petites bleuettes. Voye^ U r i n e .
PÉ LAMINAIRE, f. m. ( Littéral.) petaminarius ,
c’ eft-à-dire homme quivole en l’air, de Tmapàt, vo- . 1er. On appélloit chez les Romainspétaminayes, des.
fauteurs , des voltigeurs, des gens qui faifoient^ en
l’air des tours de foupleffe , des fauts hardis , périlleux
6c fûrprenans. Le motpétaminaire fe trouve dans
Salvien & dans Firmicus.
PÉTARASSE, f. f. ( Marine. ) efpece de hache à
marteau , faite du côte du taillant comme le calfas
double , 6c employée à pouffer l’étoupe dans les
grandes coutures.
PÉTARD , f. m. en terme de Guerre, eft une forte
de canon de métal, qui reffemble un peu à un chapeau
haut de forme , ou plus exactement à un cône
tronqué. Il fert à rompre les portes , les barricades
ou barrières , les ponts-levis, 6c tous les autres ouvrages
que l’on a deffein de furprendre.
On peut confidérer le pétard, comme une piece
d’artillerie fort courte , étroite parlaculaffe, & large
par l'ouverture. Elle eft faite de rofette mêlée avec
• un peu de cuivre. On en fait aufli de plomb & d’étain
mêlés enfemble. Il eft ordinairement long de
fept pouces & large de cinq à fa bouche, pefant quarante
à cinquante livres.
Sa charge eft de cinq à fix livres de poudre : on
ne le charge qu’à trois doigts de la bouche , le refte
fe remplit d’étoupe , 6c on l’arrête avec un tampon
de bois. On couvre la bouche d’une toile que l’on
ferre bien fort avec une corde ; on le recouvre d’un
madrier ou d’une planche de bois , dans laauelle on
a pratiqué une cavité pour recevoir la bouche du pétard
, & on l’attache en bas avec des cordes, ainfi
qu’il eft exprimé dans nos Planches.
Il eft d’ufage dans les attaques clandeftines ; il fert
àrompre les portes, les ponts, les barrières,&c. auxquelles
on l’attache ; ce qui fe fait par le moyen d’une
planche de bois. On s ’en fert aufli dans les contre-
mines pour brifer les galeries ennemies, 6c pour en
éventer les mines.
Au lieu de poudre à canon pour charger cette arme
, quelques-uns fe fervent de la cdmpofition fui-
vante ; favoir fept livres de poudre à canon, une
once de mercure fublimé, huit onces de camphre ;
ou bien fix livres de poudre à canon,une demi-once
de verre broyé , & trois quarts de camphre.^ On
fait aufli quelquefois des pétards de bois entoures de
cerceaux de fer.
On attribue l’invention des pétards aux huguenots
françois en 1579 , dont le plus fignalé exploit fut la
furprife de la ville de Cahors , ainfi que nous l’apprend
d’Aubigné. Chambers.
Pour fe lervir du pétard on fait en forte d’approcher
de la porte qu’on veut rompre fans être découvert
des fentinelles de la ville ; 6c avec un tirefond ,
ou quelqu’autre infiniment femblable, on attache le
madrier auquel le pétard eft joint à la porte qu ils agit
de brifer ; ce qui étant fa it , on met le feu à la fufée
du pétard, laquelle étant remplie d’une compofition
lente , donne le tems au pétardier, ou à celui qui a
attaché le pétard, de fe retirer. La fufée ayant mis le
feu à la poudre dont le pétard eft chargé, cette poudre
en s’enflammant preffe le madrier contre la porte
avec un tel effort, qu’il la brife , ou qu’il y fait une ^
ouverture.
Le métier de pétardier eft extrêmement dangereux.
Peu d’officiers reviennent, de cette forte d’expédition
; câr ou des défenfes qui font fur la porte,
ou de celles qui font à droite où à gauche, fi ceux
qui font dans la ville s’apperçoiventae cette manoeuvre
, ils choififfent le pétardier, 6c ils ne le manquent
prefque jamais.
Les Artificiers appellent aufli pétard une efpece
de boîte de fer de dix pouces de haut, de fept pouces
de diamètre par en-haut 6c de dix pouces par en-
bas , du poids de 40 à 60 livres , dont on fe fert pour
enfoncer les herfes 6c les portes des villes afliegees ,
ou des ouvrages oii l’on veut entrer. Le madrier fur
lequel on le place, 6c oli il eft attache avec des liens
de f e r , eft de z pies par fa plus grande largeur, & de
18 pouces par les côtés ; l’épaiffeur eft d’un madrier
ordinaire. Au-deffous du madrier font des bandes de
fer paffées en croix avec un crochet qui fert à attacher
le pétard. i
Il n’y a pas d’autre fecret pour l’appliquer que d e .
s’approcher, à l’entrée de la nuit, avec un détachement,
le plus près de la place qu’on peut ; de defeen-
dre dans le foffé lorfqu’il eft fe c , ou de trouver quej|f
qu’autre moyen quand il eft plein d’eau , ce quiu eft
pas à la vérité fi facile. Peu d’officiers reviennent de
ces fortes d’expéditions , 6c il faut être muni d’une
très-forte réfolution pour prendre une commiflion
pareille à celle-là.
Lorfqu’on veut charger un pétard qui aura 15 pouces
de hauteur, & 6 à 7 pouces de calibre par l’ame,
il faut commencer par le bien nettoyer par-dedans ,
6c le chauffer, de maniéré néanmoins que la main
puiffe en fouffrir la chaleur. ,
Prendre de la plus fine poudre 6c de la meilleure
que l’on puiffe trouver , ietter deffus un peu d efprit
de vin , la préfenter au foleil, ou la mettre dans un
poêle ; & quand elle'fera bien feche, la mettre dans
le pétard de la maniéré fuivante :
On p a ffe ra dans la lum iè r e un d é g o r g e o ir q u e l’o n
y fe r a e n t re r d e d e u x p o u c e s , e n fu ite l’o n y je t te r a
e n v ir o n d e u x p o u c e s & d emi de h a u t d e là p o u d r e c i-
d eflilS. Koye[ DÉGO RGEO IR.
On aura enfuite un morceau de bois du calibre du
pétard bien uni par les deux bouts 6c bien arrondi par
les côtés , qu’on fera entrer dans le pétard, & avec
un maillet de bois l’on frappera fur cette efpece de rer
fouloir fept ou huit coups pourpreffer la poudre, ob-
fervant neanmoins de ne l’écrafer que le moins qu il
fe pourra ; l’on prendra enfuite du fublimé , J’ôn en
femera une pincée fur ce lit de poudre, puis l’on y
àe k pdmlïe là hænetfr de deux
pouces & d emi, on la refoulera de même ; on aura
clans Une phiole greffe comme le pouce-, du mercure
nui fera couvert d’un fimple parchemin , auquèl.on
f e ra fept ou huit petits trous avec une épingle', & I ’on
fécouera trois oü quatre fois pour en faire fortir du
mercure. , . . •
l.’on fera -.m autre ht de poudre eommelepremier,
l’on y mettra du fublimé. ccù::mc-or. a fait d’abord;
enfuiteunautre lit de poudre, de encore dumereuré,
comme ci-devant ; ce quifait en tout quatre lits ; le
cinquième fera comme l é premier.
Vous le couvrirez de ücux doubles de papier cour
nés en rond Sa diamètre du pétard, qukvous mettrez
deffus fon ouverture : vous mettrez des étoupes par-
deffùs à la hauteur d’un pouce: , de avec le morceau
de bois , dont on a parlé , l’on enfoncera le tout à
fo On fera un maflic compofé d'une livre de brique
ou de tuilé 'Men cuite, que l*on pulvérifera&.tami-
fera Sc d’une demi-livre de poix-refine ou colofane.
Vous ferez tout fondre enfemble, Se remuerez
aVSttn bâton , en ïéiSeq aele tout feitiien délayé , 8c vous verferez ce mélangé tout chaud, fur les
Vous aurez une plaque de fér de l’épaiffeur de 4
ou s lignes du calibre du pétard., à laquelle il y aura
trois pointes qui déborderont du côte du madrier,
afin qu’elles puiffent entrer dedans ; vous applique*
fez:]Ce ferfur le màftic; dontle furplus débordera par
le poids-du fer. . , , •'
Il fàut qti-éf ce fer fait au niveau au pétard, oc le
pofer enfuite fur votre madrier , qui fera'entaillé de
quatre à cinq lignes pour loger le pétard, Sffervant
de faire trois trous'pour recevoir les.trois-.pointes de
la plaque dé fer que vous avez appliquée , fur le cpl
du pétard.
Vous remplirez enfuite l’encaftrement de ce mai-
tic mis bien chaud , 6c renverferez dans le moment
voire pétard deffus ; 6c comme il doit y avoir quatre
tenons ou tirans de fer pafles dans les anfes pour arrêter
le pétard fur Le madrier, il faudra faire entrer
une vis dans chacun, 6c la ferrer bien ferme pendant
que le maftic fera chaud, afin de boucher tout le jour
qui pourroit fe trouver dans l encaftrement.
Il eft bon de remarquer encore que la lumière du
pétard fe met quelquefois au haut, & quelquefois à
un pouce & demi au-deffous ; mais de quelque maniéré
qu’elle foit fituée, il faut toujours un porte-feu
fait de fer du diamètre de la lumière , 6c de trois
pouces de longueur , qu’on enfonce dedans avec un
maillet de bois. - ‘ .,
Avant que de le placer, il faut avec un dégorgeoir
de fer , dégorger un peu la compofition du dedans
du pétard, & y faire entrer enfuite un peu de nouvelle
compofition , afin de donner mieux le feu, &
avec un peu plus de lenteur. , .
Cette compofition doit être d’un huitième de poudre
, d’un quatrième de falpêtre , & d’un deuxieme
de foufre ; c’eft-à-dire que pour huit onces de poudre
, if faut quatre onces de falpetre & deux de
foufre. On pulvérife ces trois matières feparement ;
& après les avoir mêlées, on en charge le porte-feu,
qu’on couvre avec du parchemin ou du linge goudronné
pour le garantir de l’injure de l’air.
PÉTARD, (terme d'Artificiers. ),on peut mettre au
nombre dès garnitures ces petits pétards que font
les enfans dans lès rues avec du papier & un peu de
poudre , qu’on appelle aufli péterolles.
On plie une feuille de gros papier fur fa longueur
par plis de 9 à 1 o lignes d’intervalle en trois plis fuc-
ceflifs, qu’on ouvre enfuite pour former une efpece
de canal dans lequel on couche un lit de poudre de
peu d’épaiffeur , étendue bien également, on l’y
enveloppe en plufieürs doubles èiï continuant de
plier le refte de la feuille , ce qui forme un paquet
long & plat qu’on replie enfuite en travers de l’intervalle
d’environ un pouce &: demi, par plis alternatifs
en zigzag, en façon de Z d’un côté & d’autre ,
frappant fur les bords de chactin avec un marteau
dans'la largeur de z à 3 lignes , pour écrafèr un
peu la poudre qui s’y trouve, afin que le pafia'ge du
feu y étant moins ouvert s’y communique fuCcefîi-
vement, & non pas tout-d’un-coup, comme il afri*
veroit fans cette précaution. Le paquet ainfi réduit à
cette petite longueur, doit être ferré par le milieu
avec plufieurs tours de ficelle ; & pour y mettre le
feu*, on fait un trou à côté de la ligature qui pénétré
jufqu’à la poudre grenée, dans lequel on introduit
un peu de poudre écrafée dans l’eau pour lui fervir
d’amorce. Il n’eft perfonne qui n’ait vu l’effet de cet
artifice, qui eft tombé, pour ainfi dire , en mépris,
tant il eft commun , mais qui a fon mérite lorfqu’on
en joint enfemble une certaine quantité pour faire
une efeopeterie fucceflive affez amufante.
PÉTARD ER, v. aét. ( An. milit. ) c’eft attaquer
une porte, un château, par le moyen du pétard.
PETARDIER, f. m. {Art milit.') officier d’artillerie
commandé pour attacher ,1e pétard & y mettre le
feu.
PÉTARRADE, f. f. {Maréchal.') pet de cheval ou
d’âne. C ’eft aufli une ruade que le cheval fait lorfqu’il
eft en liberté.
PÉTASITE , f. f. {Hiß. hat. Bot.) petafites ; genre
de plante à fleur en fleurons, compofée de plufieurs
fleurons profondément découpés, & foutenus par
un calice prefque cylindrique, & divifé en plufieurs
parties. Chaque fleuron eft placé fur un embryon
qui devient dans la fuite une femence garnie d’une
aigrette. Ajoutez aux carafteres de ce genre que. les
fleiirs naiffent avant les feuilles. Tournefort, inß, rei
herb. Voye^ PLANTE.
Tournefort établit quatre efpeces de ce genre de
plante , en anglois butter-burr, dont nous décrirons
la grande ou commune , petafites major vulgaris , 1. R. H. 451, tußilago'fcap'o inïbricato thyrfiftro, fiof-
culis omnibus hermaphrodites , Linncei. Hort. Cliffort
41 1 ’
La racine de cette efpece de petafite , ou grand pas
d’âne , eft greffe , longue, brune en-dehors, blanche
en-dedans, d’un goût âcre, aromatique, un peu
amer, & d’une odeur fuave. Elle pouffé des tiges à
la hauteur d’environ un pié, de la groflèur du doigt,
creufes , lanugineufes , revêtues de quelques petites
feuilles étroites, pointues , terminées par un bouquet
de fleurs à fleurons purpurins, & femblables à
de petits godets , taillés en quatre ou cinq parties;
tous ces fleurons font foutenus par un calice prefque
cylindrique, recoupé jufques vers la bafe en plufieurs
quartiers. Les fleurs fe flétr-iffent en peu de
tems , & tombent avec leur tige ; elles font fuivies
par des femences garnies chacune d’une aigrette.
' Après que la tige eft tombée, il s’élève des feuilles
grandes & amples , prefque rondes, un peu dentelées
en leur bord, d’un verd brun en-deflîis, attachées
par le milieu à une queue longue de plus d’un
pié , greffe, ronde , charnue ; ces feuilles ont la figure
d’un chapeau renverfé, ou d’un grand champignon
porté fur la queue»
Cette plante aime les lieux humides, les bords des
rivières & des ruiffeaux ; elle fleurit au commencement
du printems, & même quelquefois dès le mois
de Février dans les pays chauds. On faitufage de la
racine ; on l’eftime apéritive, réfolutive & Vulnéraire
; elle entre dans l’orviétan, 6c l’emplâtre diabo-
tanum de la pharmacopée de Paris. {D. J.)
PÉTAURE, f. f .,(Littér,) en latinpetaurum ; roue
pofée en l’air fur un aiflieu, pat le moyen de laquelle •